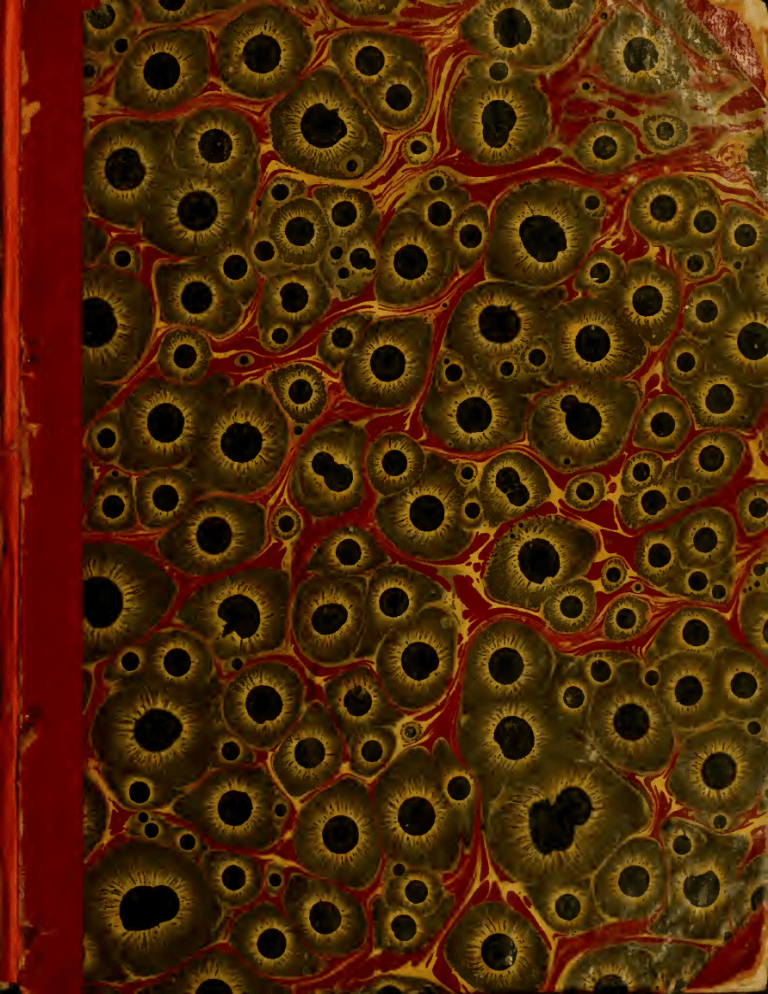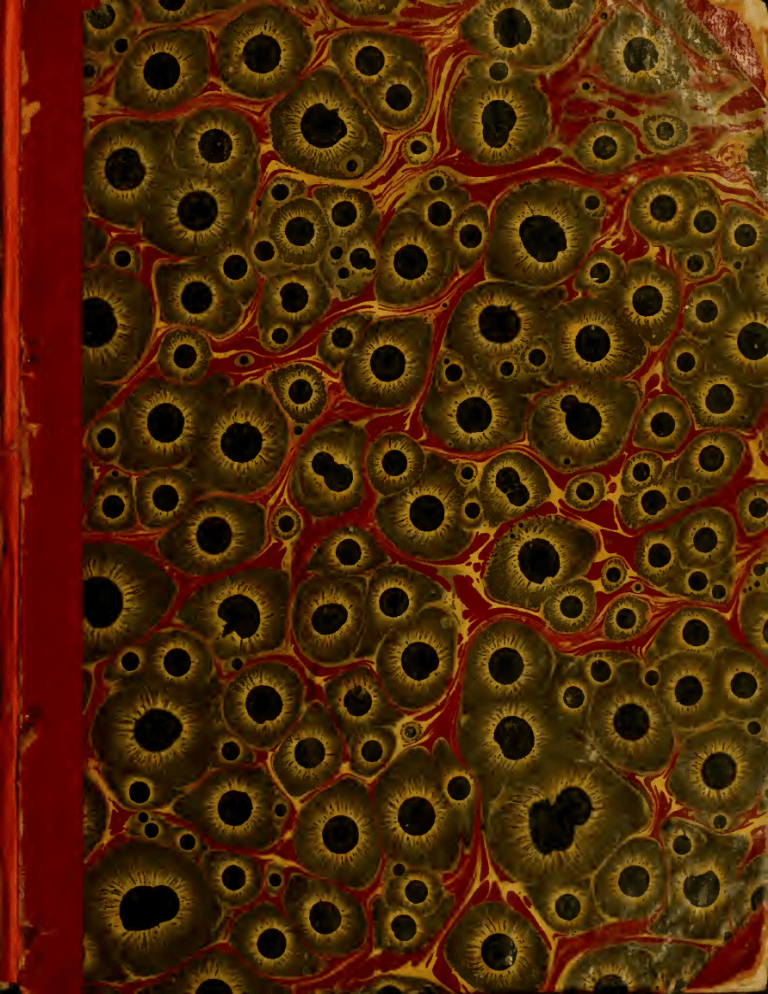
'y^f^^.
vV^Mf
'"
%^y^i^ry
O
..."
^m
k.
\
#
'i?^'^
'/#n
—
gbO
A4M4
.
ser
.
5
MÉMOIRES
DE
LACADÉMIE IMPÉRIALE
DES SCIENCES
DE
5T.
PÉTERSBOURG.
Tome VI.
AVE C
a:;:HIST01RE DE l/ACADÉMm
FOUR L'ANNEE l8l3 ET
S^.
i
8 1 4.
PETERSBOURG,
DE L'IMPRIMERIE DE LACADÉMIE IMPÉRLVLE DES SCIENCES
'1
8 1 8.
Publié par ordre de l'Académie , et avec l'obligation d'envoyer,
où il convient, le nombre d'exemplaires fixé par la loi.
N. Fufs
Secrétaire perpétuel.
Oi
ivi-yr
TABLE DES MATIÈRES.
Histoire de l'Académie Impériale des Sciences.
Années i8i3 et i8i4«
Page
Evénement mémorable
I.
.
.
Chaiigemens arrivés dans l'Académie
II.
1.
Membres décédés
2.
Nouvelles réceptions
3
Election d'un
.
'
faits
,3
•
4-
:
.
.
•
.
.
.
•
.18
.....
avancemens
civils
\5
.
..
.
ibid.
16
à l'Académie
1.
Pour
la
bibliothèque
2.
Pour
le
cabinet de curiosités
.
3.
Pour
le
cabinet de médailles
4.
Pour
le
cabinet de Minéralogie
Pour
la
bibliothèque de
5.
.
,
5. Gratifications, décorations et
Pré§ens
.
membre du Comité d'Administration
4. Distinctions littéraires
III.
.
d'instrumens
,
,
.
17
-•
.
,
.
3o
....
.
.
.
3*
»
ibid.
l'OLservatoire et pour sa collection
•
•
.
.
.33
•
•
IV. Mémoires et autres ouvrages manuscrits, présentés 1 Académie 33
\
.
Observations, expériences et notices intéressantes, faites et
communiquées 9 l'Académie
.
.
.
.
.
... ....
43
VI. Rapports présentés [xir des Académiciens chargés de com5i
missions particulières
.
VII
Voyages scientifiques
VIII. Ouvrages
miciens
.
.
.
.
.
..... ....
publiés
par
l'Académie
et
par
des
(54
Acadé65
.
,
MEMOIRES
DE
ACADÉMIE IMPERIALE DES SCIENCES..
L'
Section des sciences mathématiques.
i;
L. Eideri. Commentatio
....
La Grange
fractionem continuam , qua lU.
in
potestates biiiomialcsexprcsstt
Pagi
3
Ejiisdem.
Analysis facilis aequationem Riccatianam pcr fractionem con•
.
.
.
.
tinuam resolvendi
i9
Ejusdcm..
De intcgralibus quibusdam inventu difficillimis
3o
.
Ej^iiikm..
•
Solutio succincta et elegans problcnatis, quo quTcruntur
très
summae quam
sint
iiumeri talcS) ut tain
quadrata
.
.
.
.
.
binorum
diffcrentiac
De radio curvedinis curvarum dùplicis curvatarae
N.
Fufs.
E'
Colli>is<
N.
F/</j.
.
Duarum curvarum
investigatio
.
sinum
et
.
cit-
.
••
.
Methodus facilior investigandi novas
.
deque
66
.
illas
•
séries,
86
•
•
quibus Eidenis
cosinum anguli multipli postrcmo exprimere docuit;
terminorum
Investigatio
serici
ex
datis
productis qnotcunqiie
118
terminoruin contiguormn
curvarum quarundam , quas describit punctum
•
•
.
.
curvac Jatae dataque lege niotae
E.
Colltiis.
F.
T. Sibubcrt.
Eitlrciv.
64
earumque proprietatam
transccndcntium
.
,
indagandis
osculantis positione facillJme
culi
Ejiisdcnt.
.
Investigatio
Reflexions sur
théorie
la
du
Anomaliae verac per mediam. dctermjnatio
.
i33
.
i53
••
335
calcul différentiel
Observations de la grande Comète de l'année 1811, faites
256
.
•
Novo -Tcherkask au mois d'Août 1812
p. T.. Schubert. Des Maxima et Minima d'une fonction de plusieurs variables. 267
Winihi-Jiki.
h
Littro-x.
F>
!..
Determinatio
Sdnibtrt.
Calcul
l'an
Et^uidein.
geographicae Observatorii Casancnsis
la
Comète de i8i5,
l'Observatoire de St. Petérsbourg
îi
EJKsdem..
latitudinis
Calcul des observations de
de
1816
l'
.
opposition de Jupiter observée
.
..
,
.
.
h
St.
.
.
.
3i 1
Pétersbourg
3i9
.
.
Opposition de Jupiter et occultations observées à l'Observatoire
,.
de l'Académie.
..
.
9fj6
faites
.
.
3a8
II.
Section Jes sciences physiques.
De
liobeirxein.
genitalium
monstrosa
mciitatio
.
.
Pag*
.....
deformitatc et spina bifida coin.
341
Tbuiihng- Coleoptera Capensia, antennis lamellatis, sive clava fissili instructa,
TnnhiS.
De ptscatu Volgensi
Ozerctskoviki.
TiUshis.
3F,
.....
Plantarum novarum aut minus togiiitarum Pentas piima
De nova Medusarum specie
Gadolht.
.....
,
.
.
.
Dcscriptio et analysis. chemica Sti'mbeilitki
.
.
3g5
4^^
497
.
55o
.
565
composltione salium proportionibus
5g3
696
tetrciv. Extrait des observations météorolugiques faites à St. Pe'tersbourg
Anne'e 1806
.
.
par feu Mr. Inckbodtsoff'.
660
des observations météorologiques faites à St. Pe'tersAnnée 1Ô07
b^ourg pàt B. Petroiv,
671^
Aiundo
Ledcbour.
3F.
Gadol'in,
Ejusdeoi.-
IVilbelmiii
Discjuisitio
de
limitatis in
Extrait
....
.
ITT.
Section des sciences politiques;.
G. T. Hcrrmann.
P^ussie-
Ejusdem.
Résultat»
Données
statistiques
sur
statisticjues
sur
principales foires de
les
.
.
.
.
.
de
l'étendue-
la
la
685'^
.
surface
et
sur la
population de l'Empire de Russie, depuis i8o3 jusqu'en 1811
inclusivement
.
.
.
.
.
.712'
H.
Storcb.
Des entraves
à
des marchandises étrangères,
l'importation
comme moyen d'encourager- la production nationale. Première
•
•-
74^'
Ejusdem. Des entraves h l'importation des marchandises étrangères, comme
moyen d'encourager la production nationale. Seconde partie
776
partie
C T^.Hcnmann.
Tableaux
•
•
.
statistiques
sur
l'Empire de Russie, pendant
depu.s 1811 jusqu'en i8i5
les
commerce étranger de
amices 1802 et 1807 et
le
.
.
^^ooooco^ciooco
•
;
••
•
•
84»'
•
HISTOIRE
DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.
Années i8i3 et 1814.
1-
EVENEMENT MÉMORABLE.
Don patriotique fait pour ravancement
1.
de l'Histoire de Russie.
le 04 DéceTnbi-eiSiS'S.E. ^W. le Ministre de l'Instruction
publique
Chancelier
dans
la
fit
de
savoir a la Conférence que S. E.
l'Empire,
Histoire,
a
fournir
destiné
les
Annales Russes
Ihrfjuc.
Comte iVicoZa^ de Roumdntsoff,
vue patriotique de contribuer au perfectionnement
de l'Histoiie nationale,
doit
M^^ te
en répandant les sources de cette
une somme de 25,000 Roubles, qui
fraix
de
la
publication
que T Académie
possède
des
meilleures
dans sa Biblio-
.
VMarT'WUÀ'*
II.
CHANGEMENS ARRIVÉS DANS I/ACADÉMIE.
Membres d é c é d é s^
!..
Académiciens ordinaires.
a)
L'Académie
181 3 une
en
fit
très
grande perte par la;
mort d'un Académicien aussi estimable par
que distingué par
caractère ,
son
parmi
placer
le
droiture de
la
rang où
Géomètres de son tems et de
les
su se
a
il
sa
nation.
Mr. Sbneon Gourlcff, Académicien ordinaire pour les Physico-
Meqibre de
Mathématiques,
Mathématiques
de
Professeur
l'Académie
Pétersbourg et à
Impérial*
l'Académie
à
RussCj
éclésiastiquc
des Ingénieurs des voycs
do
St.
de,
Communication, Conseiller d'Etat et Chevivlicr de l'ordre^
de
St®.
Anne de
l8i3, dans
çu-
la
2
1 Institut
décéda
classe ,
47^ année de son âge.
la
le
11
Décembre
Le Défunt
fut rç-
Adjoint de l'Académie le 26 Mai 1796 et nommé Acad^-
micici}
ordinaire,
vier
1798.
a voit
été
à la suite d'un ordre Suprême, le 3
Avant son cnlrcc au
Ca-pitaine
Mathématique
et
d'Artillerie
d'Artillerie
service de
et
Jan-
rAcademie
Professeur de
du Corps des
1
il
Physico-
Officiers
de L\
Flotte à rames. Ayant leçu ses premières leçons de Mathé-
matiques au
2'^
corps des Cadets^ dit alors Corps des
dv
du Génie, où
dets (VArtillerie et
fut placé
1778, un goût décidé pour
det en
un
il
comme Ca-
les
Mathcinaliques et
talent supérieur le portèrent bientôt
au -de -là de lin-
struclion élémentaire de ses maîtres, et après sa sortie en
1784,
fut
il
nommé maître de navigation et d'Artillerie du
Corps des Cadets grecs.
sion Suprême, un
les ouvrages
des
lors
il
brassa
a
et
de
Officiers
avec permis-
et
chargé
la Flotte à
1798,
de don-
rames.
Dès
ouvrages des meilleurs auteurs et em-
les
successivement
parcourue
juste
fit,
hydrauliques; et c'est à son retour en
étudia
digne
il
voyage en Angleterre^ pour y examiner
leçons aux
thématiques
rendit
1792
avancé au rang de Capitaine
qu'il fut
ner
En
pures et
toutes
dans
avec
la
tant
méthodique, et un
thode des Anciens,
branches des hautes
appliquées ,
d'entrer
depuis
les
lui
firent
avec un succès qui le
carrière
de
goût
Ma-
académique, qu'il
distinction.
Un esprit
dominant pour
la
mé-
embrasser un genre de recher-
ches analogue à ce goût. Préférant à la gloire de découdes vérités nouvelles le mérite d'établir sur des bases
vrir
plus solides les vérités connues et les principes déjà établis,
il
s'attacha principalement à les démontrer d'une manière
plus
rigoureuse.
ainsi
que
la
Sa Géométrie et son Calcul différentiel,
plupart des mémoires qu'il a présentés à l'A-
cadémie^ et qui roidcnt sur des sujets analogues, prouvent
que
ses efforts
n'ont
ïls
pas
louables n'ont pas été
récompenses.
sans
eu-
succès,
comme
Des pensions ,
des
des avanceraens civils et des décorations anrt
gratifications,
en ces occasions,
attesté,
san^j
comme en une infinité d'autres,
combien notre Monarque adoré aime à protéger les sciencf»s
Ces
ceux qui «travaillent à
encourager
à
et
que feu Mr. Gourieff a rendus aux sciences
services
comme
perfectionner.
les
ne
Professeur
sont
guères
inférieurs
ceux
à
qu'il
comme Académicien. Dans les établissemeos
leur a rendus
d'enseignement nommés plus haut, ainsi que dans l'Ecole
d'Architeclure navale, dans L'Académie de Nevski et dans
des
l'Institut
il
a
donné
Elèves,
.de
xjui
leçons depuis,
voyes de communication, ou
foimé nombre de bon'
a
il
contribueront à leur tour à répandre en Ri l'A-
enseignement.
leur
des
goût des Mathématiques et
sie le
'la
Ingénieurs
Une veuve et
la
bonne méthode dans
sept orphelins pleurent
mort d'un époux et d'un père chéri, et
dans
vra
de ses
souvenir de ses amis,
le
disci[)les,
dont
quelques
uns
de
sa
mémoire vi-
ses collègues et
servent la
patrie
et
leur Souverain dans les places les plus émincntes.
Une
fit
en
autre
1814
§n/îg Lniiis
fut
l'Académie
perte
non
celle
de son respectable Doyen, Mr. /Fo//-
tirafft.
moins
sensible que
Académicien pour
la
Physique expéri-
mentale. Conseiller d'Etat et Chevalier des ordres de
Si*".
Anne de la 2*^*^. classe et de St. Vladimir du 4*^ degré, Membre
de
la
d'Agriculture,, de
tannique
Moscou, de
celle
1814 dans
la
total
des
de Berlin
suite
forces,
quel après
etc.,
mort le 20 Novembir
avoir
en
d'un épuisement
de quelques attaques d'apoplexie.
à St. Petersbourg le
capitale
cette
très
25 Août 1743,
le-
membre
ef-
fectif
de l'Académie Impériale des Sciences,
dans
sa
Mathématique
pour remplir
Elevé, après
de Physique
et
la
,
le
jeune
la
à
fut rappelle
place de Professeur de
l'Université de Tubingcn.
mort de son père, dans un des Sémin jires
du Duché de Wurtemberg,
que
et destiné à
l'état éclésiasti-
Kraft s'adonna néanmoins par goût aux
sciences qui avoient fait la réputation- de l'auteur de
jours et publia déjà en
Mathématique sous
lo et aequatore.
le
1764
titre:
Lorsqu'en
à
Tubingen
un^
obtint
pour observer
le
d'ernieT
Mr. Krofft
une part active a ces expéditions;
cadémie lui conféra' celle d'Orenbourg, ou
ce-
mémoire dfe
1767 l'Académie prépara plu-
passage de Venus devant le disque du soleil,
et
ses
De ratione ponderum sub po-
sieurs expéditions astronomiques,
chercha
et
bas âge avec son père,
été pendant plusieurs années
patrie ,
bri-
la Société des Naturalistes de
72°*^ année des son âge,
Le Défunt naquit
quitta
du Bureau
Société Impériale libre économique,
il'
l'A-
alla observer
phénomène important. Ayant été nommé Adjoint de l'Aca-
"=='
8
i"68,
demie en
et
Académicien ordinaire en 177 1^
îiiddj
après son retour, feu Nr.
culs
de
Tables de
ses
r
il
Léonard Euler dans les cal-
lune et dans ceux de sa nou-
la
velle Théorie de la lune, dont la publication avoit précé-
Un grand nombre de mémoires in-
dé celle des Tables.
Acta de
zélé
son
fut
il
Novi Commentarii ,
dans les
sérés
Acta
les
et les
Nova
l'Académie prouvent son activité scientifique et
à
remplir
nommé
ses
Physique du
de
Professeur
En
académiques.
devoirs
178c
Corps des
i"^
Cadets, et quelques années après Professeur de Mécanique
et
de Physique du Corps Impérial des Mines, places qu'il
A
remplies avec distinction
d'années.
suite
.
En
l'Amiranté l'associa
ses
devoirs
fut
1802
à
le
Département
travaux,
ses
pendant une longue
Impérial
de
en qualité de membre
le
plus cher de
celui de donner des leçons
de Mathéma-
Mais
lionoraire.
et succès
plus
le
important
et
tique et de Piiysiquo à l'HériLier présomtif du Thrône Impé*
rial
et à
son
Constantin,
Auguste frère. Monseigneur
leçons
qu'il
a
continuées
dans
le
Grand -Duc
suite
la
aux
pkis jeunes Grands -Ducs, et à Mesdames les Grandes-Duchesses,
et qu'il n'a
ncr
à
Tous
zèle
cessé
Nosseigneurs
ceux
qui
infatigable
ont
que depuis
les
très
peu de tems de don»
Grands -Ducs Nicolas
connu
le
et
Michel.
Défunt savent avec quel
et quelle scrupuleuse
fidélité
il
a rempli
9
lès
attachés a ses places, et que ce n'est qtie sa
devoirs
dernicie
maladie qui en a interrompu
exercice
de près d'un demi-siècle,
Vladimir en
1793,
1799,
après un
décoration de St.
L-a
Anne en 1801,
celie Ste
Conseiller de Collèges en
cours,
le
rang de
le
de Conseiller d'E-
celui
tat
en 1804, des gratifications nombreuses et des pensions
ont
été
carrière
II.
et
une longue
et
,
presqu' exempte de ma-
été celle d'une vie active, sobre, calme et régulière.
a
ladie,
récompenses de ses services
les
constamment heureuse
a laissé
l'union la
une veuve, avec laquelle
plus douce, et un
qui
fils
il
a
vécu 87 ans dans
depuis nombre
sert
d'années avec distinction dans la carrière diplomatique.
Académicien extraordinaire.
b)
Une
troisième
perte sensible que l'Académie
a faite
dans le cours des deux années, dont nous traçons l'iiistoire
de
celle
est
Mr. Auguste Chrétien Lehrherg, Académicien
extraordinaire pour
l'Histoire ,
d'une hydropisie de poitrine
43^
7
année de
maternelle.
donné
!/•
-
•
~
il
a
du
Après
la
âge.
La mort
1770.
Aoiit
naissance,
eût
son
sa
que
première
Conseiller
le
de
2 3 Juillet
mort
i8i3, dans
Le Défunt naquit
lui
Cour ,
Dorpat
à
la
le
ayant ravi son père avant sa
première éducation à
l'école
publique
instruction
il
se
tendresse
là
de Dorpat
rendit
à Jena
G
lui
et
y fréquenta, pendant quatre ans,
les
leçons des Profes'eurs
de cette Université avec tant de succès qu'un Gcnlilhom-
me Livonien , Mr. de Bock
Mr.
avec
Lchrherg
qui avoit
,
éloges ,
le
entendu parler de
achever
fit
à Gôttingue et voya_^ci
à
son retour d'Angleterre ,
Gouverneur de ses
ans dans ce poste et au
17
devenue
la sienne.
nore Ehlerti,
à Dorpat, qui lui
a survécu.
lui
le
études
nomma
fils.
Il
vécut
d'une famille qui étoit
il
épousa M"*^ Anne EîeO'
En 1798
membre du Magistrat
donna cinq enfans, dont une seule
En 1804
il
à*
,
sein
d'un Négociant et
fille
et
fraix ,
ses
ses
se rendit à St.
fille
Péteisbourg
avec la famille Bock, et y ayant fait la connoissance de quelAcadémiciens qui eurent occasion de reconnoître ses
ques
profondes connoisances dans l'histoire ancienne, et surtout
>dans
à
la
géographie ancienne de Russie,
l'Académie un
mémoire
Russischeii Geschichte y
démie
eut
lieu
le
fit
présenter
Beitrdge
zur
qui obtint l'appiobation de l'Aca-
et lui valut la réception
laquelle
Février
:
il
Geographischc
1 1
au nombre de ses Adjoints,
Mars 1807
et fut suivie le
7
1810 de sa nomination au rang d'Académicien ex-
traordinaire.
Quoiqu'atteinti. presque dès son. entrée dans
l'Académie, de la paralysie au point de se voir privé to-
talement de
ne
l'usage de ses jambes,
connût point de bornes.
Il
son activité litéraire
a fait présenter siiccessi-
=^
li
vement à l'Académie dix mémoires, dont chacun
un point important de
Krug,
et c'est d'après ces
peut
apprécier
la
et qui
Ont été
ami et Collègue, Mr. l'Académiciert
jour par son
au
mis
ancienne
l'histoire
ëclaircit
perte
mémoires que
monde savant
le
que l'Académie
a
par
faite
la
mort de ce Savant estimable et regretté.
c)
Membres honoraires de
E.
Mr. André de Narioff
S.
,
l'
Intérieur.
CoTiseilIer privé a^ctuel.
Président de l'Académie Impériale Russe et de la Société
économique, jChevalier de l'Ordre de
libre
1*^^
St^ Anne
de la
Commandeur de l'ordre de Danebrog^ Membre
classe.
honoraire
de l'Académie
mourût
2
le
Avril
depuis
181 3 dans
la
i5 Décembre
le
1796,
77® année de son âge.
Mr. Thomas Tichorsky, Docteur en Médecine, Membre
du Conseil
médicinal
et
de l'Académie
Médecine et de Chirurgie, Conseiller
d'Etat,
Ordres de St^ Anne de la 2^^ classe et de
4^ degré, mort à
la
81'^*^
année
IMPÉRIALE
de
Chevalier des
St. Vladimir
du
Pétersbourg le 2 Février 1814, dans
St.
de son
âge.
Le Défunt
a voit
été
reçu
membre de l'Académie le i5 Octobre 1798.
Mr.
d)
Membres honoraires externes
le
Comte Louis La Grange ,
Conservateur et de
Arts,
Officier
de
la
l'
:
Membre du Sénat
Institut national des Sciences et des
Légion d'honneur
et
grand
2
croix de
12
de
l'oiclic
1er
à rAcddcmie de Berlin, et après
Géomètre de son tems,
le premier
i8l3> âgé de 78
Avril
Mr.
un
leLmion, aiUrefois successeur de. Léonard Fal-
la
I.i
décéda à Paris
le
lo
ans.
Membre de T Institut national et
Cliarles Bossut,
Géomètres de France ,
des premiers
mort de celui - ci
mois de Janvier 1814» d'ins un âge
mort à Paris au
très -avancé.
Le Dé-
funt a voit été
reçu au nombre des membres honoraires de
l'Académie le
i3 Octobre 17.7^e)
Correspondant externe:
Maurice
Mr.
Prasse ,
de
ques à r Université de Leipsic.
le
19
1796
Sept.
1814^ âgé de 4^
et
moumt
Professeur des M'athémati^
Le Défunt
à
Leipsic
a voit
le
été reçu
2 1 Jianvier
«^ns..
Nouvelles réceptions,
IL
a)
j4u
nombre des Adjoints..
Mr. Edouard CoUlnSy Elève de l'Académie dé
classe ,
le
la
i"*
élu unanimement Adjoint pour les Mathématiques,,
26 Janvier 1814.
b)
yJu
nombre des Membres honoraires de
l'
S.
E.
Inté rieur.
Mr. le P'ince Pierre f^oîhonskl, Lieutenant -Gé»--
aérai, Aide-dc-Camp Général
de SA M/\JESTÉ IMPtiRIALE:
et
Chef de l'Etat-Major de Ses armées, Chevalier de pluordres; reçu le 27 Janvier
sieurs
181 3^
E. Mr, Paid Tchitschagoff, Amiral et Chevalier des
S.
Ordres de
St.
Alexandre Ncvsky,
classe
et
de
St.
vrier
1814.
S.
George du 4^
de St^ Anne de la
degré;
i"^^
reçu le 16 Fé-
Mr Gidilawne de Richtcr, Docteur en Médecine,
E-
Conseiller d'Etat actuel. Président de la Société physico-
médicale
de
la
S.
ffctuel.
2^^^
E.
il
Moscou et Chevalier de
classe; reçu le
'Mï.
le
l'ordre de
St^
Anne
16 Féviier 1814.
Baronet Jacques PVylîé, Conseiller d'Etat
Médecin du Corps de SA MAJESTÉ IIMPÉRIALE et
Président de l'Académie
IMPÉRIALE
de Médecine
et
de
Cliirnrgie, Chevalier de l'Ordre de St^ Anne delà i"^^classe^
et
de
S.
tuel ,
St.
E.
Vladimir du 2^ degré. Reçu le 25 Mai 1814.
Mr, Alexandre Crichton,
Médecin du Corps de
Conseiller
SA MAJESTÉ LMPÉRIALE,.
Chevalier de l'Ordre de St^ Vladimir du. 2
le
d'Etat ac-
degré ^ reçu
25 Mai 1814.
Soa Eroinence MS*".
Stanislas Sistrencemcz de BoJiust;^
Archevêque Métropoli4:aia de Mohilef sur le Borysthène^
Président
du Collège catholique Romain.,
Chevalier des
14
Ordres de
St.
André, de
St. Alexandre Nevski,
dimir du i' degré et de St^ Anne; reçu le
de St. Vla-
17 Août 1814.
Au nombre des Membres honoraires externes.
c)
Mr. Frédéric Guillaume Bessel, Piofcseur d'Astronomie
et
de
Directeur
l'
Observatoire
Royal
à
Kônigsberg en
Prusse; reçu le 2 5 Mai 1814.
d)
Au nombre des Correspondans de l'Intérieur.
Mr. Joseph Hamel, Docteur en Médecine; reçu
Juin
23
i8i3.
Mr. Joseph Samuel Littrow,
l'Université
bre
le
IMPÉRIALE
ProfcsseT.ir
de Kazan ;
d'Astronomie à
reçu le 23
Décem-
i8i3.
Mr. Alexandre Wilbrecht, Capitaine en Chef des Mi-
nes de la 5® classe. Professeur de Mathématique au Corps
IMPÉRL^L des Cadets des Mines, premier Géographe du
Dépôt IMPÉRIAL des cartes et du Directoire général des
Ecoles de l'Empire, Chevalier des Ordres de St* Anne de
la
2^^
classe
16 Février
Mr.
Professeur
versité
et
de
St.
Vladimir du
4*^
degré ;
reçu le
1814.
Charles
Frédéric
d'Histoire
Lcdebour ,
naturelle
et
de
Conseiller
de Cour,
Botanique
à l'Uni-
IMPÉRIALE de Dorpat; reçu le 25 Mai 1814.
Mr,
Jean
Doyen de
André Lohenwciii
faculté de
la
térinaire
Conseiller
de Collège,
Médecine de l'Université IMPÉ-
RIALE de Vilna ; reçu le
Mr.
,
17 Août 1814.
Louis Henri Bojanus, Professeur de Médecine véà
l'Université
de rOrdie de
St.
IMPÉRIALE de Vilna,
Chevalier
Vladimir du 4^ degré; reçu le
1 7
Août
1814.
Mr.
Cornélius Auguste Reissig» Conseiller de
Chevalier de l'Ordre
de S" Anne
Cour
et
de la 2^^ classe et de
Vladimir du 4^ degré; reçu le 17 Août 1814.
.St.
III.
Election d'un membre du Comité
d' Administration.
181 3.
élu
Le II
Août
Mr. T Académicien Schubert fut
membre du Comité pour deux ans, à la place de Mr.
TAcademicien Sevastlanoff',
1814 Le 17 Août. S. E. Mr. l'Académicien Fufs, pour
deux ans,, à la place de
rV.
Mr..
rAcadémicien Severguine.
Distinctions
I i t é r a i r e s.
Mr. r Académicieni extraordinaire Ulésius fut reçu an
nombre
des
Membres honoraires externes de l' A'cadémie
Royale des. Sciences- et Belles - Lettres de Berlin^
=
i6
Mr. FAcademicien Ozcretskovskyj Fut reçu le l ^
E.
S.
nombre des
Novembre
18 13
l'Académie
IMPÉRIALE de Médecine et de Chirurgie.
r Académicien
Mr,
reçu
r Académicien
de
Correspondant
extraordinaire
caJLe
Moscou.
fut
Nasse
fut
reçu
éconr-
libre
Société physico-médi-
Gratifications, Décorations et Avan-
cemens
M8^
S.
E.
tration
de
le
payej
l'Académicien
civils.
Ministre ordonna au Ccmité d'Adminisà
la
veuve ^t aux enfans de feu Mr.
Gouricjf une gratification de
que SA
MAJESTÉ L'EMPEREUR
au
Académicien ,
dit
travaux
pour
particuliers dont il
Mr.
de
Schkgclmilch
IMPÉRIALE
Société
la
membre honoraire de la
mique,
et
V.
extraordinaire
honoraires de
IMPÉRIALE des Naturalistes de Moscou.
la Société
Mr.
Associes
nombre des membres honoraires non-résidans de
au
il
au
l'ordre
l'Académicien
de
St.
le
2000
Roubla«î,
avoit. daigné assigner
récompenser
de
quelques
avoit été chargé.
extraordinaire
Vladimir du
4*^
Tilêsius
fut
décoré
degré, le ci Sept. 1814.
III.
PRÉSENS 'faits a L'ACADÉMIE.
Pour la Bibliothèque:
1.
De la
part de
rAcadcmie Royale des Sciences
-
I
de Stockholm:
—
Kongl. Vetenskaps Akademifns Nya Handlingar. Julius
December 1811, Januar — Deceniber 1812. 8".
Akademiens Handlingar af Ar i8i3,
2»; Kongl. Vt'tenskaps
i"")
Stockholm
181 3. 8".
De la part de l'Académie IMPÉRIALE Russe:
i«)
CoMunCHia h nP[)eBOAbi ïia^aBacMbie IlMnepamopcKOK) Poc-
4acmb VI. C. II. Gypri, 181 3. 8".
o coMiiHeuin
GxoAcmBO Me;KAy Cauc^KpHm-
cificKOK) AiiBACMicK).
2*) Paacy.-KAenie
:
CKHMi H PocciiicKHMi flibiiiaMH, H O npotnxo;i:AeHiiJ Cia^auCKiiro HapOAa. comhh. Iîb, .^leBaHAu. C.
3°) vIiiReu, ii.in
II.
Gj'pri 1812
Kpyri c.iOBecHOCiini Apeaneil
h HOBOii ;
8°.
Cc^.
C. II.
Aarapna; nepes. /\m. Coro.tobwmi.. Hacmb 5a.
6vpri 1812 b^
CmuxornBopeuie Khh3jî Gepriiï
4°) Hoib Ha paaMwmjienia.
n.
<\>.
lUiixMamoBa. C. II. 6ypi-b \%i^.
8**.
H cnDaBeA-niBafl nontcmb o naryGubixb Hano.ieoHï BoHanapiTiC jioMwc.iaxi n n[)OM nepeacn» ci» HfeMei^iaro
^3biEa AieKcaHapT» LUnuiROB^. C. fl. Gyprt )8i4' 8°.
**) KpaniKa/i
:
De la part de
la
Société Royale des Sciences
d'Ed nboiirg:
i
Transactions of the Royal Socifity of Edinburgh. Vol. VL
Edinburgli 1,8 ta. 4".
a") Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. VIL
i')
Part
Histoire,
1.
Edinburgh 1814 4^
^
^
i8
De
part
la
de
la
Société Royale des Sciences
de Londres:
rhilosophical Transactions oF the Royal Society ofLondcni,
1809 Part a; 1810 Part 1 and 2; 1811 Part i
181a. 4°.
and 2; 1812. Part 1. London 1809
1*)
for the years
—
2*) Philosophical Transactions of tlie Royal Society of London
for the year 1812. Part 2; for the year 181 3 Part i and 2.
London 1812 and i8i3. Trois Vol. in 4".
De
la
part de la
Société des Amis Scrutateurs
de la nature à Berlin:
Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin fur die neuesten Entdeckungen in der gesammten Natiirkunde. V"'- Jahrgangs 2' Quartal. Berlin 1811. 4°.
i")
Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin Magazin fur die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde; VI"". Bandes 1', 2', und 3' Quartal. Berlin 1812.4".
q")
De la part de la Société biblique à Londres:
The ninth report of the British and foreign Bible Society.
MDCCCIII, vvith an appendix and a list of subscribers and
i")
benefactors.
London
181 3. 8".
XçiGTOv èîyAwTToç. 'Ev
Aovêii'Cf-
1810.
8*.
De la part du Comité de Censure de l'Université
i") 61
2
)
3')
IMPÉRIALE de Dorpat:
diverses brochures imprimées.
Trente trois ouvrages imprimés depuis le i5 Octobre i8i3'
Trente et un ouvrages imprimés depuis le 8 Mai 1814.
19
part de la Société IMPÉRIALE des Natura-
De la
listes de
Moscou:
Mémoires de la Société IMPKRIALE des Naturalistes de Moscou. Tome IV. Moscou 181 3. 4°.
De la part du Bureau des Longitudes:
Observed Transits of the fixed Stars and Planets over the
Meridian, in the years 1799, 1806, 1807, 1808 and 1810.
De la part de l'Université IMPÉRIALE deDorpat:
Semestres in Universitate litterarum Caesarea,
quae Dorpati constituta est; a Calendis Febr. i8i4habendae.
l'raelectiones
De la part delaSociété des Sciences de Kharkoff;
YcmaBi XapROBCKaro o6iu,ecmBa Hayni.
De la part de l'Académie Royale de Berlin:
Abhandlungen der Historisch - philologischen Klasse der KÔnigl.
Preuss. Akademie der Wissenschaften, aus den Jahren 1804
—
Berlin 1814. 4°.
i8ii.
De la part du Département de la Marine:
MopcKoii Mtrfli^oc.ioBT> na Jifemo i8i5. C. H. 6ypn> 18 14.
De
de l'Académie de Médecine
Chirurgie résidante à Moscou:
part
la
et
8*.
de
Ji,[dineiniiEa
hjih iiayKa o coxpaneHiM SAOpoBbs .TouiaH34aHHaii ripc^eccopcMi npw Bep.\HH':KOMTi semepHAtH
HapHOMTi yMH.iiimt HayMaHOMT.
nepeeo^b ci. HbMCi^Raro.
1")
,
.
;
MocRBa
i8j4- ô".
OnHcanie n .ttienie o6bIKHOBennbJx^ AtmcnHXT. 6o.\b3ueH.
Co-miieiiie f^cKI^opa il Ulepepa, nepeEe^etio ci> HbMeLjiiaro
C, ^leBHi^RHM^.
MocHBa 1814. 8°.
a'')
3*
20
part de la Société Royale de Gottingue:
De là
Conirnentationcs Societatis Regiae Scientiarum Gôttingensis rei8i3. Gôttmgae 18 3. 4".
centiores. ^ cl. Il ad annos iQii
—
De
part de l'Académie Royale des Sciences
la
de Munie:
der Kônig].
Denkschriften
Mûnchen, fur das Jahr
t)e la
Altademie der Wissenschaften zu
)8i2.
Mûuchen
1814.
4"^.
partde Vlr. Fater, Professeur àKônigsberg:
Kônigéberger Archiv fiir Philosophie, Théologie, Sprachkunde und Geschichte; Jahrgang 1812. 4 tes Stûck. Konigs-
i")
bfrg 181s
8°.
Kônigsbf rger Archiv fur Naturwissenschaften und Mathematik. 4 tes Stùck. Kônigsberg 1812. 8°.
a")
De la part du Capitaine de la Flotte du
M
r.
de
K u en
s
r
s te r n
rang
i"".
:
ooRpvrb cBfema bi> i8o3, 4, 5 h i8o6 rovo noBCAfeniK) Ero Hviit^peinopcKaio He.iim^cxiiB.i, ira
»") Tl) memecrnuie
fi.iX'b,
K.'paô.iflxb HaAea;/^fe h
Heufc h npoM.
Hacmb III.
C. U. Gypri.
ï8i2. 4°.
2"
I
Mémoire
sut
une carte du détroit de la Sonde et de la
par le Capitaine de Krusenstern etc. St.
rade de Batavia
Pétcrsbourg i8j3.
;
4"-
"Wcirter-Sammlungen aus den Sprachen einiger Vôlker des
beôstlichen Asiens und der Nordwestkiiste von Amerika
kannt gtniacht von A. J. von Krusenstern etc. St. Petersburg
1810. 4".
3°)
;
4'*)'A^JArtC^ Kl. nymeuierniBijo BORpvn. cnlirna Kaniimana Kpy3ei-rin>»pna. 'C. II. 6} pri ifiidJ
Deux Volum. fol. grand
Impérial.
'
21
De la part de Mr. Fwc/icr, Directeur de la Société
d e s N a t lu y 1 s t e s à Moscou:
i
H3c.tfcAOBanie o6t> HCKonaewhixT.
Hnxo '.flimixcia. MoCKBa 1812. 8".
1°)
bt.
Mockobckou ryGepiiia
Zoognosia, tabùlis synopticis illustrata , in usura praelectio-
Q*^;
num Acaderaiae Irnp. medico-chirurgicae Mosquensis. Auctore G. Fischer.
De
la
Tom
1
part de Son
et 2.
Mosquae
181 3.
Eminence Mgr. le Métropoli-
tain StanislaveSiestrencewicz de Bohusz:
Recherches sur l'origine des Sarmates ,
des Slaves. St. Pétersbourg 1812. 8^
1")
des Esclavons
et
Table des noms propres qui indiquent les matières contenues dans les recherches historiques sur l'origine des Sarma-
2"^)
tes,
des Esclavons et des Slaves. St. Pétersbourg 181 3. 8".
De la part de AI
1°)
Tl
r.
Etter
rfgno degli Slavi,
:
hoggi corrottamente detti Shiavoni,
Don Mauro Orbini. In Sesaro 160 fol. min.
2°) A compamou of the London Muséum and Panthéon; by
Historié di
1.
W. Bullok London
i8i3. 8".
De la part de Mr. le Professeur et Chevalier Thunberg à Upsala:
observations and conjectures relative to the généraIn a letter froin
of the 0| ossum of Novth - America.
Prof. Bart.m to Mr. Roume of Pans. Philadelphia iSoti. 8%
1") Facts,
tion
A discourse on some of the principal desiderata in Natu-
a)
ral
historv ,
of
this
and on the best menis of
scient e
in the united States ;
pron'ot.iig
ttie
tudy
by Benjamin Barton.
Philadelphia 1807. 8".
\nn.iles Botanici , redacti cura Dominici Viviani. Vol.
^•)
pus a. Genuae 1804. 8".
1.
^=
20
programmes de l'Uni versitd d'Up-
4°) Plusieurs dissertations et
au nombre de dix.
sala,
5") Caroli
muni.
Thunberg
Pétri
Upsaliae i8i3.
etc.
Flora Capensis. Voluraen pri-
8".
De la part de Mr. Pat ter son, Membre et Agent de
la
Société biblique à Londres:
Eight reports of the
i")
for
the years i8o5
Britisch
and foreign Bible Society,
— 1812. 4 Volumes.
London
iôo5.
8%
The tenth report of the British and foreign Bible-Society.
2°)
London 8°.
De la part Mr. le Conseiller d'Etat actuel et Chev.
Dshounkovski:
KpaniKoe OniicaHie
De
la
part
de
Dorpat
Kpacii.ibHux'b pacminitt
C. fl. ôyjiri 1812. 8*.
h
Professeur Morgenstern
à
BnacHtHuiifxi.
cnoco6i. paase^eida hxt.
Mr.
bi>
le
Pocciii.
:
Auszûge aus den Tagebûchern und Papiercn eines Reisenden. Italien. 1 sten Bandes 3 tes Heft. Dorpat 181 3. 8°.
1°)
Praelectiones Semestres in Universitate litterarum Caesareà.
quae Dorpati constituta est, habendae etc.
".")
m
Zwei Reden a
Sarge Sr. Dnrchlaucht des Russisch-Kaisfrlichen General Fcld MarchaH's Fiirsten Golenischtsch<fKutusoff - Smolenskoi, am \* Mai 18 13 zu Dorpat gehaken
'*')
-
-
von D. Karl Morgenstern. Dorpat
181 3.
Dorptisthe Bcytrage fiir Freunde der Philosophie, Litieratur und Kunst. Herausgogeben von Karl Morgenstern j8i3.
1 ste
Halfte. Dorpat 181 3. 8*.
4'j
5") Klopstock" als vaterlandischer Dichter.
halten von
Eine Vorlesung ge-
C Morgenstern. Dorpat 1814.
4"-
i
•=™'
23
De la part <îc Mr. William Maltby à Londres:
Catalogue
of thc
Libra-ry of the
London Institution. London
i8i3. 8".
De
la
part
de Mr. rAcadémicien extraordinaire
Langsdorff:
Some account of the Herbarium of Professer Pallas; by Aylmer Bourke Lambert Esq. from the Transactions of the Lin-
i")
nean Society. Vol. X.
Discurso sobre a utilidade de Instituçao de Jardins nas
provincias de Br.'zil; por Man. Arruda da Camara etc. Rio
de Janeiro i8io. 8°.
2°)
3°
Dissertacào sobre as plantas de Brazil por Manoël Arruda
da Camara etc. Rio de Janeiro i8io. 8°.
;
;
De la
part de Mr. le Colonnel des Ingénieurs de
Waxell:
Brookshaw's Pomona Britannica, or the Nobleman and Gentleman's Fruit-Repository Nr. XX, XXIII, XXIV, XXV, XX M,
XXVJI, XXVIII, XXIX, XXX, (avec un cahier supplémentaire et le texte de l'ouvrage)
gr. Roy. fol.
;
De
la
part de Mr.
l'Académicien extraordinaire
Tilésius:
Naturhistorische Friichte der ersten Kaiserlich-Russischen unter dem Kommando des Herrn v. Krusenstern glùcklich vollbrachten Erdumseglung, gesammelt von Dr. Tilésius. Erstes
Heft, St. Petersburg i8i3. 4°.
De la part de Mr. le Professeur Struve à Dorpat:
De
geographica positione Speculae astronomicae Dorpatensis;
Auctore H. F. W. Struve. Mitaviae i8i3. 4^
De la part de Mr. le Chevalier de la Coudraye:<'''
r
TpopemH'if^CRÏc h npaKmjriecKie ypORn 4.1H «sfiAtOACiiifl ao.irornw fia Mopts. nocpcAcmBOMi p^acmofluia .tynbi om^ co.uma
i")
HAH omb 3nb3A''; GoiuHCUHbie F. JLLl&Bajibe ^e.ia Ky/\pe. G.
n. 6ypn. 161 3.
8°.
Ré[>onse aux réflexions de Mr. le Baron d'Eggers sur la
nouvelle noblesse héréditaire en France. St. Pétersbourg
2";
i8i3.
8^
,
De la part de Mr. le Conseiller
d'Etat
.
actuel et
Chev. Richter:
Commentationes Societatis pliysico- medicae, apad Univerlitterarum Caesaream MosqueHsem institutae. Vol.
1811. 4"'
et 2. Mosquae 1808
I. pars
i")
sitatem
—
1
entworFen von Dr.
Geschichte der Medizin in Russland
Wilhelin Mich. Richter. i ter Theil. Moskwa 18 13. 8".
2")
3")
,
Mf'Awo <î>H3HieCRiH »ypHa.it, hah TpyAbi Of iu,e cm n a co-
peBHOBaHiH
MocKBa
4*j
Bp n ôabixi
a
4)H3HiecKHXi
HayK.b.
Hacrnb
i.
J.808. 8".
HcmopiH MeAm^MHM bti PocciS. "^acrab i. Mocitsa 1814. 8*.
De la part de Mr. le Conseiller privé Hermbsfàdt:
Cheraische
Grundsâtze der Kunst Bier zu brauen, von S. F.
Herrabstàdt.
Berlin 1814.
8".
De la part de Mr. le Prof. Lieban k Mitau:
Ueber die Hauptbegebenhfk in der Hekab'^ des Euripides.
4".
Ein Versuch von Dr. H. C. Lieban. Mitau 1811.
des Sophoclts, iibérsetat
2»; Einige Szenen ans dem rhiloctetes
von Dr. H. C. Licbau. Mitau 18 13. 4".
H»
=
De
part
la
de
S.
E.
25
Mr. Conseiller d'État actuel
Korniloff:
i")
CnrnaAM, nocpe^crnsoMt koiixt. npon3r>o,i3mcfl maKmHMec-
AfeiicinBiH ipsGHiiro v[>Aoni.i. Cûmiiiikiim KiinHinauoMi iro
paiira KopuH.iOBUMb. C. H. 6yprb 1800. deux Vol. in folio.
jiifl
KpamKoe CHrHa.ioiipomBOAcrnBO rpeGnaro (I).iOrna, BuôpaaHoe im> CHrua.ibiioii Kuiira 11 npcj. i&oi. 8'.
g")
De la part de Mr. Buldakoff, Directeur de la Compagnie Russe Américaine:
)")
Sept livres sur divers sujets, en langue Japonaise.
2°j
Deux livres de Comptoir, en Japonais.
De la part de Mr. le Grand-Baillif Schrôter:
Beobachtungen des grofsen Cometen von 18.07, samt einem
Nachtrage zu den apliroditographisclien Fragmenten. Gôttingen 1811.
8-.
De la part de S. E. Mv. le Conseiller privé et Sénateur Golénichtcheff-K outousoff;
Oja un ncmpeG.ieHÏe eparoB^ h inrHanie
1°)
.iio6e3Haio
MocKBH i8i3. 4°'
.^OBi.
onieietmBa; cov.
hxt.
IlaBJia
F.
H3i
npe^'fe-
Kyinj-aoaa.
P.^AOCinnnii nfecni, bo c lany GeacMcpmHuxi nOABiirOBi dciitRaro rocy4apfl A.ieKcan^pa I. Cow. n. Foji. KymysoBa.
IMocRBa i8i4' 4"'
2")
3°j
04a ua ncKopeaie Cinn.iHqbi (J)paHi^*iH. coq. II. Tqa. KyrnyMoCKBa 1814.
30BblM1>.
/[•".
De la part de Mr. Sage:
i")
Institutions de Physique; par B.
Paris i8n. 8".
G. Sage.
Tome I. II. Ill
et Suppléaient.
Histoire.
4.
26
Opuscules de Physique; par B. G. Snge. Paris i8i3. 8-.
3", Tableau comparé de la conduite, qu'ont tenue envers moi
des Ministres
les Ministres de l'ancien Rei^inie, avec celle
8".
du nouveau Régime; par B. G. Sage. Paris iQM2-)
De la part de Mr. le Comte de Rumford:
Recherches sur le bois
Rumford. Paris i8i3. 8°.
1°)
et
le
charbon
;
par le
Comte de
Recherches sur la chaleur développée dans la combustion
et dans la condensation des vapeurs ; par le Comte de Rumford. Paris i8i3. 8°.
a")
De
la
part de Mr. le Conseiller
lier
privé et
Cheva-
Léonhard à Ilanau:
Taschenbuch fur die gcsammte Minéralogie. VII ten Jahrg.
8°.
te und 2 te Abtheilung. Frankf. a. M. iai3.
1
De la part de Mr.- le Prof. Giese à Kharkoff:
<J)n
Tu 3e BceoGmajï Xiimï/ï
rObTj
i8i4«
fl,.\H
yiatmixca. Hiicinb III. XapB-
8'.
De la part de Mr. le Prof. Neumann:
j")
Prinzipien
der Politik. Ein Fragment von Prof. Joli. Neu-
mann. Dorpat 1814.
2°)
Haïa-ibjibiH
8".
yro.iOBHaro npasa ;
Gypri. 1814. 8.
ocHonaHi»
Meaiia HeiiMana. C.
II.
coi.
npo4>'
Delà part de Mr. leConseiller d'Etat deZimmermann:
Australien, in Ilinsicht der Erd-Menschen- und Producten-kunde,
nebst eincr allgemeintîm Darstellung des grossen Océans,
gewohnlith das 5ùdmcer genannt. iten fîandcs ite und r>,te
Abtheihmg von E. W. A. von Zininjermann. Hamburg
.
1810.
8".
De la part de Mr. le Comte Sicrakovsky, Recteur
de l'Universilc de Cracovie:
Architektura obeymiiiaca wszelki Gatunek murowania i budo-
wHiia Toni
i
tt 2.
De là part de Mr.
J.
w Krakowie 181a. fol.
l'
Académicien Bode:
E. Bode's Erlauterungen ùber die Einriclitung und den GebraiK h seiner Astronomischen Jainbiiclier, nebst einem \'ervon 1025 Sternen, nath Pivizzi's Beobaciitungen.
Z' ichniss
Berlin i8w. 8\
De la part des Auteur s ou Editeurs:
De nova
explicatione phaenomeni elasticitatis corporum rigidorutn; Auctore G. M. Pauker. Dorpati i8i3. 4°-
Ueber den Zvveck und die Organisation der Thier-Arzeney-schulen; von Dr. L. Bojanus. Frankf a. M. i8o5. 8\
Ueber die Ausrottung der Rindviehpest; von L. Bojanus. Riga
i8io.
8°.
Anleitung zur Kenntniss und Rehandlung der wichtigsten Seuentworfen von
chen unter dera Rindvieh und_ den Pferden
L. Bojanus. Riga 1810. 8".
,
Douze
dissertations
seur a l'Université
académiques
;
par Mr. Hàlstrôm ,
Profes-
IMPÉiilALE d'Abo.
Fragments of the natural history of Pensylvania; by Benjamin
Smith-Barton Part 1. PhiLidelphia 1799. fol.
Hints on theEtymology of certain english words, and on their
afhnity to words in ihe languages of différent European,
Asiitik and American nations; in a letter from Dr. Barton
to Dr. Thomas Beddoes.
A memoir concerning the fascinating faculty, v?hi(h h is been
ascribed to the Rattle Snake, and other American Serpents;
by Benj. SmithBarton. Philadelphia 1796. 8".
4*
Supplément
a
to
which has
memoir, concerning tlie fascînating
faculty,
bt en
ascribed to the Rattle Snake and othcr
Aiucrican Serpents. In a ktter to Prof Zimmtrmann.
Facts
observations and conjectures relt^tive to the génération
of the Opossum of North - Atiicrica. In a lettcr irom Prof.
JBarton to Mr. Houme of Paris. Plulad.. i8o6'. Q:
,
A discourse on some
of the principal desiderata in natutal
romotmg the study of
f
histcry , and on the best nicans
by Benj. Smith - Barton.
this science in tlie united States
Philad. 1807. 8°.
i
{
,
przpz M. Samuela Bogomila Linde.
Slovnik Jezyka Polskiego
T. w Warszawie 1812. 4".
Vol. V. K
,
—
De summatione serierum secnndum datam legem differ..ntiatarurîi.
Auctore C. H. Kupfer. Mitaviae 181 3.
4".
Chemische Untersuchungen, mineralischer, vegetabilischer und
animalischer Substanzen.
Laboratoriums von I. F.
ô te
v.
;
Fortsetzung des cheniischen
etc. Berlin i8»3. 8-.
John
British Mineralogy or coloured figures to elucidate the Mineralogy of Great - Britain, by James Sov.'erb*. Nr. XXVlll et
XXIX. i8o5.
,
A new elucidation of colours, original, prismalik and material
etc. ;
by
1.
Sowerby.
London 180g
4^
Observations on the effects of Magnesia, in prcventing an invvith some remarks on the
creased formation of une acid
by William Brande. London
composition of the urine
;
;
1810.
4°.
Additional observations on the effects of Magnesia
liam Brande. London 18 3. 4
1
by Wil-
;
•
Experimcnts to ascertain the state in which spirit exists in
fermented liquors by W. Brande. Lundon 1811. 4*
;
Chemical Researches on the blod and some other anijnal
fluids
by William Brande. London 181.3. /[".
,
Formulae lineavum subtangcntium ac subnoru.alium
,
tangeiî-
29
tium ac iiormalium, castigatae et (îiligentius, quara
Lipsiae 1798. 6''.
let, explicatae a Fr. Th. Busse.
fieri
so-
Gang und Grôfse der Weichheit des Wassers, aus den Versu-
Zimmermann gef. Igert
chcn des Herrn v.
Leipzig 180J. 6\
von F. G. Busse.
Vcrgleichung zwischeii Carnot's und meiner Ansicht der Alund unstrer beiderbeitigen vorgeschlagenen Abhelgtbra
fung ihrer Unhchtgkeit von F. G. Busse. Freyberg 1804. 8".
,
;
Neue Méthode
des Grôfsten und Kleinsten , ncbst Beurtheilung und einiger Verbe&serung des bislit rigen Systems; von
F. G. Busse. ^Freyberg 1808. 8".
ErstcrUnterricht in der algebraischen Auflosung arithmetischer
und geonûtrisrhi r Aufgaben; von F. G. Busse. ErsterTheil.
Freyberg 1808.
8'.
Etrennes chronomttriques pour
Paris
1810.
l'an
1811 etc.
par A. Janvier.
12""-.
Essai sur les horloges
i8ii. 8^
publiques etc.
;
par A. Janvier.
Paris
Des révolutions des corps célestes par le Mécanisme des rouages ; par A. Janvier.
Paris
1812.
4^.
Thoughts on the expediency of disclosing the progresses of
manufactures
by John Cleniiel.
Newcastle upon Tine.
;
1807.
d\
The new agricultural and commercial Magazine or gênerai
Dispository of arts
Manufactures and Commerce
by John
,
,
Clennel. Nr.
;
1— i5. London 1811. 1812.
8"^.
Grammaire de la langue arabe, vulgaire et littémle
ouvrage
posthume de Mr. Savary
publié par L. Langles. Paris
,
;
a8i3.
4.°.
Notice de quelques ouvrages de Littérature Indienne, publiés
en Bengale. Paris 1814. 8".
Praktische Grammatik der Russischen Sprache, inTabellcn Und
ilegelui von Dr. Joh. Severin Vater. Leipzig 1808. Q".
==
30
Ueber G.i?ometrie, ncbst einigen Versuchen ûber die Verschiodbarkeit der Gase. Einc von der philosophisclicn Facilitât zu
DorpatgekrôntePreisfchrift, von Fried. Parrot. Dorpat 1814.8',
Pour le Cabinet de Curiosités.
2.
De la part de
Mr. Ogneff,
Directeur des
Écoles
du Gouvernement de Poltava:
Une toison d'agneau d'un beau jaune foncé.
De la part du Cabinet de SA MAJESTÉ IMPÉRIALE:
Un
1")
dans
crâne
de
Rhinocéros, du poids de 5o livres, trouvé
Kolyvan.
le district' de
Deux jumeaux en esprit de vin, dont l'un n'a aucun signe
apparent de sexe.
Q")
Envoyé par
l'Empailleur Philippoff à Astrachan:
Vingt -huit oiseaux empaillés.
Huit peaux d'animaux.
Une peau de sanglier.
Une peau de l'Antilope Saïga.
Une peau de Pélican.
De la
part de Mr.
l'Académicien extraordinaire
Langsdorff à Rio de Janeiro:
des papillons, dont les écailles
appliquées sur le papier, selon une méthode
nouvelle et particulière au donateur.
Trente -six
mêmes
feuilles représentans
sont
De la part du marchand Chabounine a Kola:
1»)
Squalus Canicula.
Q»)
Raja clavata.
3")
Spongia Norvegica.
De la part de la Régence médicinale du Gouverne m entdeKouisk:
Deux Jumeaux mâles joints par les côtés, avec la description.
De la part de Mr. Buldakoff, Directeur de la Compagnie-Russe Américaine:
Deux petits temples d'idoles, de la baie de Yaniva de l'is-
i")
le
de Saghaline.
a") Une caisse vernissée remplie des bougies de cire végétale,
5") Une coquille enchâssée, à l'usage des prêtres arabulans.
Un bonnet à l'usage des mêmes.
Un trébuchet ou balance.
6°) Un collier de défenses de sanglier, des îles de Mendoza.
4°)
5")
^°) Une mâchoire
pacifique.
de
Dauphin (Delphimus Orca) de la mer
Un poisson de bois a deux têtes, tiré d'une baleine prise
aux environs de la forteressf de Novo-Archangelsk.
8")
Une plante épineuse des îles de Sandwich.
10°) Un javelot à longue manche.
g')
De la part dti Correspondant, Mr. le Conseiller
de Collèges Lokhtine
:
Une défense et une dent molaire de Mamouth, trouvées dans
le cercle
de Tchtrnoyar.
De la part d e Mr. leChe val ierThunberg à Upsalà:
Deux
collections de plantes sèches exotiques, contenant des
plantes rares du Cap de boiuie Espérance, de ia nouvelle
Hollande, de la nouvelle Wales
etc.
32
Pour
3.
Je
Cahinct de Médailles.
De la part de S. E. Mv. le Comte d'Armfeld, Chancelier de r U n V e s t c d' A h o
i
r
i
:
Un exemplaire en argent de la médaille frappée aux fraix de
en mémoire des bienfaits que SA MAJESTE
l'Université
l'EMPÉREUR a daigné lui conférer.
,
4.
Pour le Cahinct de Minéralogie.
De la part de Mr. le Minéralogiste -Etter, Correspondant de r Académie:
Un morceau
-
de
Molybdène mêlé avec de la Hornblende et
du Feldspatli com{)acte.
De la
1")
2^
Une
lite,
ait
de Mr. l'Académicien Zakharoff:
pierre d'étain mêlée de talc transparent et de Schôr-
pesant 4 livres.
Une pierre d'étain compacte
3 livres.
a")
cristallisée
en partie
,
pesant
Ces pièces ont été tirées du district de Nertchinsk de la rive
gauche de l'Onon.
De la part de Mr. S o ^v e r b y à Londres:
Une gravure, représentant en grandeur naturelle trois météorolithes tombés: en Yorkschire le i3 Décembre 1785; h Fosà
Tipperary en Irlande
du Correspondant,
Mr. le Conseil-
en Ecosse le 5 Avril 1804
au mois d'Août 1810.
sile
De la
part
;
et
ler de Collège î.okhtine:
Deux morceaux d'argille blanche, parsemés de feuilles de plantes pétrifiées, trouvés
aux eaux minérales du Caucase.
De la part de Mr. le Conseiller privé et Chevalier
Léonhard à Hanau:
Deux modèles d'une
représentation plastique de la forme externe des montagnes, avec le texte explicatif de ces modèles.
5.
Pour la BîbïiotJicquc de l'Observatoire:
De la part de Vï.r. le Profes^ear Bessel:
Einige Resultate ans Bradley's Beobachtungen gezogen;
F. W. Btsseli Koni^sberg iiJi3»
De la part
de Mr. F Académicien Bode
à
von
Berlin:
Astronomiches Jalirbuch fur das Jahr i8i5; herausgegeben
von J. E. Bode. Berlin 1812. 8".
a»)
2')
Astronomisches Jahrbucn fiiv das Jahr 18 1 6; herausgegeben
von J. E. Bode. Berhn i8x3. 8°.
3") Astronomisches Jahrbuch fur das Jahr 1817. Berlin
i8i4-8''.
De la part de Mr. le Conseiller dé Cour et Che\alier Reissig:
Une machine déclinatoire, de
l'invention de ce savant et ha-
bile Artiste, supérieurement bien exécutée.
IV.
MÉMOIRES ET AUTRES OUVRAGES MANUSCRITS, PRÉSENTÉS À L'ACADÉMIE.
1
ISie^e
8
1
3.
Analyse des Smolenskischen Meteorsteins; par Mr. Schérer..
Ueber einen liandscbriftlichen Chronographen in der Bibliothek
der Ermitage, als eine von den Quellen derNiconischen Chro-
;
Histoi.e.
-^
"^
34
nik in der Akademischen Bibliothek. Ein Beitrag znr Kritik
der Riissischen Jâhibucher; par Mr. Krug.
BbiniicKa M3T. AOHeceiÙH
Moiine.u.epcKOMy OHmectTiBy
T. cI)iirK)ne
3Hanin h UcKyciuu-h , o cnoc^dfe At>.ian»b ciiponi.
3bi ii.iB nuieHM'iRii ; par Mr. Zagorski.
Continuation du Journal des observations astroaomiques
Wisnievsky.
De Cancris Camtschaticis ; par Mr. Tilcsiu*.
de l'Académie
par Mr. Fufs.
Histoire
des Sciences.
Impériale
KyRypy-
ii3i.
;
Année
par Mr.
1812;
Uebersicht der Witterung zu St. Petersburg wàhrend 20 Jahren,
von 1792 bis 181 a; pjr Mr. PérrotT.
Ueber die anzuwendenden Mittel den Gefahren vorzubeugen, die
und iiber
durch Anhaufung von Cidavern ntstehen kônnen
<
,
die \erbesserung der Luft bei epidemischen Krankheiten ; par
Mr. Nasse.
Résultats tirés des tableaux métriques depuis 1796 jusqu'.j 1809»
relevés sur ceux qui confessent la religion grëcqne en Russie;
par Mr. Herrmann.
O npou3xoaîAenin
ctiiflx-b
h o6pa30BaniB GesoapAOB-b bo BHympeHHOaîHBomHbixx. Co4HHf.nie Bott.e.icua; par Mr. Sévas-
tianoff.
O cinpoeHÏM p,T4ya:noiî o6o.io^kii MopcKaro nca.
fiiry, Aou-mopa.
HaGAio^enie
F.
MeA"qH»w m XiipyprLH bi ^liiBopHfe; par Mr^
Zagorski.
1°) AcmpaxaHCKoS ;
06t. oaepHbixT. coAHx-h h.ui caMOcaARaxx
4°) KpbiiMCKOÎi; 5°) KopHKOa2") ypa.tbCRoii ; 3") MaHi nKon
y") TyaaaKy.ibCKOH ; 8*) Bo p3 11 uc ko ii ;
CHOÎi ; 6") 36e.irîicKoîi
:
;
;
par Mr. Ozeretskovski,
OnHcauie rop-b oko.io^Tii^aitcs .le:i:al^H^^; par Mr. Schlégelmilch.
O BapeHiB KyuiaHbu nocpeAcinBOMV napos-b; par Mr. Z,Hgorskû
Einfache und wolfeile Zubereitung des unglasurten irdenen Geschirr's , wodurcb selbige» nicht allein wasserdicht , sonderm
=
35
aurh geschickt gernacht wird die verdiinnten Minerai - Sauren
})ar Mr. Kirchhof.
dariu zu kochen
;
Essai sur les ruines de Saratchik; par Mr.
Ein neues Fudiometer
Hermann à Pskof.
oder ein ànsfserst schnell wirkendes eiidiometrisches Mittel. nebst Beinerkungen ùber die Phosphoie=cenz par Mr. le Prof. Grindel a Dorpat.
,
;
Clavis Botaniccs antiquioris, sive synonyma auctornm Ante-Linneanoruin. nominibus genericis recentiorum accoinodata (Pl:mtae phaenogamicaei; par Mr. le Docteur Trinius.
O Me.iia.i.u' noAo6fjbixb infe.iaxT. ii3t> orHenocmoaiifibix^ ii^c.ioieji,
CROHCinBaxTj h
ijxx cnoco6h rpmonion.ipi^iH
^pyniMT. nit.ta.MX ; par Mr. le Docteur Hamel.
,
MnHepa.ïoriittecKifl npnMt>yani« o6v
cO/^ep)t;aiiiu
Rk
ocmpoet rom.ianflfe, na BaA-
niiiicKOMX Mopt; par Mr. Séverguine.
O RKrojHï^iinifM'b A nonïpe6,ieHiH men-ioniBopa npii BiiHOKypeaiH;
par Mr. Zakharoff.
Ueber die Wol^chen Nestors. Ein Bruchstûck kritischer Vorarbeiten zur Geschichte der Russen, par Mr. Ewers à Dorpat.
OciiOBaHifl BcecGmPÎi
ncinraHiecKOÛ HcmopiH; parMr. Kaidanoff.
Versuche ùber die Erzeugung des sogenannten Kali-Metall's (KaKalihydroidete) aus blofsera Wasser
linietalloid
par Mr.
,
;
Grindel à Dorpat.
Kp iiiKoe
H3.\ojKenie paaAH'iHwxi
pcHi^ia.ibiioe HûiHCACHie; par
.
cnocoSoB-b H3iACHAnib 4H^(f»e-
Mr. Gourieff.
C^^pHiecKafl TpHronoMenipiH; par le même.
Plantarum norfdum cognitarum Decas prima (iconibus illustrata);
par Mr. Hermann a Pskof.
De foetus canini velaméntis, imprimis de ipsius membrana allantoide.
•
Prof.
Observatio analomica iconibus illustrata
Bojanus à Vilna.
;
par
Mr. le
•'^ii3i(;.iorHiecKoe pa3cy:fv'\eHie o npHqwHaxT. po4HMwxi njimeirfc
H ap^r»xb nopos.oBTi ycinpoenifl bi «ic.iOBtiecKOMi. aibAh ;
-i<
par Mr. Zogorski.
5*
=="
36
praelectionibus tyronunt botanicorum acPhilosophia botanica
comodata; pir Mr Smélovski.
,
H n-uo/fulfl
Ha^i caàinflimïAuiCH xinBotnubiMi»
;
par Mr. Sévas-
tianoff.
Continuation du Journal d'Observations astronomiques;
Wisnievski.
De
derivatiombus
analyticis
dissertatio
par Mr.
par Mr. le Professeur
;
Pauker à Mitau.
Allgemeine Russische Sterblich^t'ts - Ordnung, von i ten bis 107
ten J^hr; par Mr. MuhJert, Instituteur a Wyborg.
BaMfewaniH xo^HiicmBeiiHbiH
HCiiHbifl BT. i8ii ro^y BT.
w 40 K.iHiviatna oiiifiocHrriidCJi
B.^pHfly.ife;
,
yilT-
par Mr. Spaski.
Methodus
facilior investigandi novas ill s séries, quibus EulerMS
fiinum et cosinum anguii multipli postremo exprimere dotuit ;
par Mr. Fuss.
BbiniicKa y'uincHiiwM'b B^ C. rieinepGvprî^,
nj)!!
IlMnfpamopcKoS
AK^i^eMÏH ILiyRb ^ nafi.iiOAeHiflMb o noioAixb ii «oa.n lu o.ivi,
par Mr. l'Elève TarRJ!B.leIliHx^ M nepeMtnaxH. bi 1812 ro4y
;
hanoff.
Démonstration du théorème de Taylor; par Mr. Schubert.
Chemische Analyse des Doroninskischen Aërolithen; par ^^r.
Schérer.
Investigatio terminorura sériel ex datas productis quoteunque terminorum contiguorum ptir Mr. Fuss,
;
Mémoire sur le théorème de Taylor; par Mr. Werkmeistcr, In*
stituteur a
Moscou.
ALbildiing und Beschreibung df r sonderbaren Sudaraerikanischen
Handblume (Chelroste.won riatanoiàesBuinholdi) und ihrer innern Structur insbesondere par Mr. T^ilésius.
;
Erkiarung aller in den Russist hen Ghroniken vorkommenden Namen von Sonntagen, nach ilin^n benannten Wochen und Heiligfntage, mit genauer Besummung, <ier Zeit in die sic fielen;
par Mr. K.rug.
Beschreibung
eines
neuen
Alkoholomcters ,
nebet eintr vx>t
stândigen picnometrischen
Dorpat.
Tafel
;
par Mr. le Dr. Lamberti a
Lamberti's Telemeter ockr Distanzenraesser.
Hohenmessungen
Resultnte batometrischer
Pansner;
Observations
Mars, Cerès et Pallas,
de
in Daurien;
par
^îr,
faites à l'Observatoire
IMPÉRIAL de Vilna en i8i3; p^r Mr. Sniadecki.
ÏÏJC.itiAO"«^">e
npH^Hiib pajpbiBaui» KaMueu
cyxaro ^epena CMO^euHbixTi 8040K),
niani.
,
oini».
RJHHbeB^ hsT)
*e paapwBaHi» Me-
ma.wiiHecKiixTi iiipyGoRh c^ bcaojo omu roj)OxoBi.ixb m 6oho*biXT»
3epeHT> no.iowenHMX'b oii ohkîh h hoitomx KpbnKO aaaepinwxTi,
onbiinoBt hb opciinuMi. ; par
c». npîicouoK) n.ieHiemi» uoawsk
Mr. Pétroff.
Continuation dn Journal astronomique
Donnt'es statistiques sur
la
;
par Mr. Wîsnievskî.
chasse en Russie; par Mr. Herrmann..
Auszu^ aus dem Kometen - Beobachtungs Journal des aufseror»
dentlichen Akademikrrs V. Wisnievsky, enlhaltend die Beoba^btungen d.es erofsen K.ometen vom September 1811, welche
în Neu Tscherkask im Jahr i8i2 angestellt worden»
-
-
Ueber die fabKikmàfsige Anwendung der oxydirten Salzsâure, zum
Papierbleichen
und ùber die Bereitung dieser Sàure im Gros,
sen ,
nebst
par Mr.
Beschitibung des dazu erforderlichen Apparats;;
N ssé.
Nahcre Hestimmung einiger Porph.yr- Arten aus dem Caucasus; par
Mr
Schlégelmilch.
Sur la position des plans
;
par Mr. le Frof. Littrcw a Kazan^
Mémoire
sur la transmuti^tion des matières mucilagineuses eni
sucre ^ d'après un procédé .rtificiel, sur ses qualités physicochimiques et sur les différentes époques de fermentation adop»tées à présent
par Mr. Nasse.
;
Investigûtio, rurvatum quarundam, quas describit punctum curvaeb
datae diitaque lege n.otae , par Mr. l'Elève Collins.
Dénonstrations arithmétiques; par Mr. Kausler,
Sommation de plu&ieur& séries; par Mr. Kausler^
Réflexions ultérieures sur les fractions continues périodiques
qui expriment les racines carrées des nombres entiers, et sur
par
leur usage dans la reclierche des facteurs des nombres
JMr. Kausler.
;
Continuation du Journal d'observations astronomiques;
Wisnievski.
par Mr.
O xo.iOAHJibHHKaxi M lixT. yMcaptain; par Mr. Zakharoff.
Outre cela
l'Académie à reçu régulièrement dans la
courant de l'année les observations météorologiques, faites
à Astrakhan , Nicolayelï et Cathérinbourg.
1814.
De la monnaie de cuivre, et particulièrement de celle de Russie.
Première Section. De la monnaie de cuivre en général; par Mt.
Storcli.
Hawajibuwji ocHOBaHifi cpanHnmeABiioii
ManGaxa; par Mr. Sévastianoff.
AnamoMiH
I.
<J).
B.iio-
O HaB.ieKaeMoiM-b new^eccnDh atiiBCmHbixi h np03H6aeMbixi> mfeAx;
par Mr. Zagorski.
Résumé des
affaires scientifiques traitées dans les séances ordinaires de l'Académie IMP: KIALE des Sciences, dans le courant de l'année i8i3; par Mr. Fufs.
Décades sex plantarum novarum in Imperio Rossico indigenarum par Mr. Ledebour.
;
Recherche d'une ellipse dont les dimensions approchent
le plus
des déterminations des arcs de méridien faites au Pérou, en
France, en Angleterre et en Lapponie par Mr. Wilbrocht.
;
KpamKoe
MHHcpa.iOBi. iiaii^eiiuhixb Oôep^-BeprijRleiJCiiicpoMi 3ux«^e.ib/\OMT> s-h MoJi^aBiH, BaAâxiu n Becapa6CROH OdwiacniH.
H3'4HC.'ienie
KpiimH'iecKoe paacMompfcine po^a pm6t. KorihKOMx n.iH ncracoMii
uasbiB^euaro (l'egasus Liun.) ; par Mr. Sévastianoff.
'
=
39
Essai de déterminer les élémens des planètes ou comètes par les
observations gcocentriques
par Mr. Littrow.
;
KafÎHHenia HMnepamopcKoH AKaA^niÏH
H.}K^; par Mr. Séverguine.
06r3|)Knie
m:- npp,i.ii.fi,iro
O KpacH.ibHwxi> paciritiii^x-b
Bi PocciH canioc^uiio pacmymHxi ;
par Mr. Smélovski.
Ueber die Wichtigkeit der Kenntnifs und Bearbeitung des alten
Slavisrhen Keclits fur die Erklarung der àltern Russischen Gescliithte und lùr die Russische und Slavische Geschichte ûberpar JMr. le Prof. Neumann.
liaupt
;
Beobachtungen
iu>er
Rereitung des corrosiven salzsauren
Wege par ?ir. Nasse.
die
Quecksilbers aui nassem
Chemische Analyse
;
Charkovschen Meteorsteins
des
;
par
Mr..
Scliérer»
Kants metaphysische Anfangsgriinde der Naturwissenschaft
ihren Beweisen widerlegt von F. G. v. Busse.
,
in
mit besonderer Rûcksicht àuf eine
Ueber die Pravda Ruskaja
der Akademie von Henn Professot Neumann. vorgelegte Abhandlung par Mr. Krug.
Gênera et species plantarum Pharnracevtico/ Medico et Oeconomo maxime nctabilium par Mr. le Prof. Jason Pétroff.
,
:
;,
Ueber die Quallen par Mr; Tilésius^
Recherches chimiques sur l'Acide muriatique ordinaire, par rapport à sa réaction sur l'alcohol et sur quelques métaux ; par
Mr. Nasse.
;
Extrait des observations météorologiques faites à St. Pétersbourg,
Année 1807, d'après le vieux stile par Mr. Pétroff.,
Descriptio
botanica; novae
speciei
Veronicae
,
Auctore Jasone
Pétroff.
Bf^schreibufig des Wollastonschen Goniometers ; par Mr.. Etter^
Berechiiung der in den Zeughausern aufgeschichteten Kugeln..
Eiii Beytrag zur Anwendung der Lehre von
den arithmetischen Progressiouen uud dei Gleichungea vom. ersten Grade;,
pair Mr. Kausler»
—
40
Extrait des observations météorologiques faites à Astrakhan, depar Mr. Lokhtine.
puis 1804 jusqu'à 1814.
-,
Données statistiques sur le Commerce de l'Intérieur de la Russie,
qui s'est fat par eau en 18 13; par Mr. Herrmann.
O BbinapenHhTXT.
C01HXT) H Ao^î^'TRaeMbixî» Boa^ymiibiMi» «"pa^HpoBpninMi; par Mr. Oxeretskovski.
MiiHepajtorii^iecKoe o6o3phnie cfenep^ROCHOMuoS ^acnm II »M6aK-
cRHxi ropi.; par Mr. Schlégelmilch.
Continualioii du Journal des observations astronomiques ,
depuis le 26. Janvier jusqu'au i3. Mars, par Mr. Wisnievski.
Tableau général qui indique la part que chaqiie bram he de l'industrie
•eau en
nationale a eu dans le commerce
par Mr. Herrmann.
8 3
1
1
qui
s'est
fait
par
;
i
Uebcr die Reinigung der inlandischen Cochenille
TH^papr;!,, Coc-
polonicus) durch Befreyung derselben von einer fetten Subwelchr ihre Anwendung in der Fàrbekunst erschwert;
par Mr. Kirchhof.
icus
stanz
.
BhMUicKa Y'iHMeiiubiM^ vh
AKa^ewin H iVKx
C rie nepRjprfe npH Ilxn'priTnopcj^oii
Hab.iio^ftHinMT,
jeiiiaxT. H nepeMeHaxTj
bt.
i8i3 r<
o 110104 'Xb 11 b aaviH ibix». mbpar Mr. l'Elève Tarkhanoff«
,,i,\
;
ad theoriam epicycloium pertinentes
Disquisitiones
Lmruw.
Von einer merkwiirdigon Verknôch-erung
fincr Hernie
,
;
par
Mr.
der Brustbeinmuskeln
pur Mr. Tilésius.
Réflexions sur la théorie du calcul différentiel; par. Mr. Schubert.
E«'iiiecmBeuHbiH npauaneAe'iia 11 npHMÏyâ ùii Aocmount^a bcii^h
v.-b
I^apcmiit lIjKonaesibixx; par Mr. Zinovieff.
O pLiG) h.e \e3nHnh nKùMe GtuienHuH «aabiBaeMoii; parM'r. Zinovieff.
O6o3] Li.ie
Mtic>fiv>B^
IX j/eMhHbi
iôif>
noroyu.i
bi.
mcienïM
noc.iM''H;tT»
roAa; par Mr. Zinovieff a Kazan.
meçinH
-
JlpitMLn ni» o iil.|»ofluinc.ii ^peunocnin >i
6p; aonai-iti paa-THlii\>,\-h xpebn.ouii ropx 'PocciticjvHxt.; par Mr. Sévergiim-e.
<*
O r.iinoK}])tinibixx hOAn.YKHX'i; par Mr. Zakharoff.
41
De monstrosa genitalium deformitate
t.itio ,
))ar
et
spina
befida Coininen-
Mr. Lobenvvein.
De la monnaie de cuivre, et particulièrement de celle de RusSection II. De 1» nionnaie de cuivre russe, dans son rapport avec la monnaie d'argent; par Mr. Storch.
sie.
Observations astronomiques, faites a l'Observatoire de l'Université
IMPÉRIALE de \ ilna, depuis le commencement de l'an 1814
jusqu'au mois de Juillet par Mr. Sniâdecki.
;
Coleoptera Capensia, antennis lamellatis, sive clava fissiii instructa; par Mr. l'hunberg.
De summatione serierum; par Mr. Littrow.
Gedrângter Auszug aus den Mathematischen physisch-mathematischen, physicalischen und astronoinischen /Kbhandlungens der
Denkschriften der Kaiserlichfii Akademie der Wissenschaften
zu St. l'etersburg, auf Veranstaltung derselben, von einem ihrer
Mitglieder verfertigt. II ter. Kand. Geometrische und trigonoPolygonometrie und Anwendung
inetrische Wissenschaften
der Analysis auf Géométrie und Trigonométrie. Nebst einem
Nachtrage zum ten Bande par Mr. Kausler.
,
,
1
;
Beobachtungen um die Zeit des Sommer - Solstitiums 1814,
zur
Erfindung der Schiefe der Ekliptik, auf der Kônigl. Sternwarte
zu Kônigsberg angestellt von F. W. Bessel.
O l^nK.iOH;\ 1X1.
ruxT>
,
3niinHR.toii4HXTj n
no^oônbiMT.
o6p,i30Mb
rHnomiK.ioH^axi h o 4pyKpiiBuxi MUiiaxit
,
paaîflaJou^Hxcfl
;
par Mr. Fufs.
repMinrneTiM pyKOBO^cmBO Ki npaKinHKO - SKCHOMnqecKOMV AOGbJRaniio caxapi h no.usnaio Cbipon.i 1131. CBtKjibi, maKi. «e
H Kl. 4;'yr»'Mb pa3HbiMi. ynoinpeÔ.ieuinMT, oiicii
par Mr. l'Elève Moukliine.
;
Bo3pa:i;f nie nporiiiiBi HOBf.ix'b MufeHiii Fr.
no\b3fc ceACBCHKii
par Mr. Zagorski.
MopecKM h TyMC
,
o
;
CHCineRia nT>ii}i04w Knp.ta .linnieH.
Hi.i; par Mr. Sévastianoff.
4aciflb III.
C mwnbnll. llmii-
Philosophiae botanicae. praelectionibus tyronum botanicorum ac.
cominodatae, pars alttra; ])ar Mr. Smélovski.
H'iitoire.
6
—
42
O BepmiiHli ptKH RoAra
;
par Mr. Ozcretskovski.
fjiteS
Continuation du Journal des observations astronomiques
Mars jusqu'au 19 Juin de l'année 181 3; paf
depuis le
Mr. Wisnievski.
O xiiMMHecKo'vvb nacifeACBaniH oGb!KnoBenHaro nopox^, 11 o cnocoôhxtj c.\yxRifi,\t\h Kl nonpaB.\eniK) Hcucp leinuiro uo[) j.\a
par Mr Schérer.
,
i
'.
;
•
Ueber die Rangordnung im spcitern Griechenland, verglichen mit
par Mr» Krug.
der im frùhern Rufsland
Beobachtungen iiber die Ausdelinung des Wassers durch's Gefric;
ren in luftdicht versthlosstnen FÎaschen, bey kùnstlicher uiid
natûrlicher Kàlte par Mr. Nasse.
.
monnaie de cuivre et particulièrement de celle de Russie.
Pe
Section II i. De la monnaie de cuivre dans son rapport avec
la
l'assignat; par
Mr.
Storcli.
Betrachtung ûber die successive Hildung der algebraischen Gleichungen und Folgcrungen aus derselben fur die B', stimnmng
der Anzahl reeller und imagmàrer Wurzeln, die sich in einer
je nachdem
gegebenen allgenieinen algebraischen Gleicliung
par
die Beschaff'enheit der Coetiîcienten ist, beliudcn miissen
Mr. le Docteur Kupf r.
,
,
,
Données statistiques sur les principales foires en Russie; par Mr.
Herrm.inn.
Anomaliae verae per mediam deterininatio; par Mr. Littrow.
La description et le dessin d'un tigre royal, tué le ly Octobre
18 13 dans le district de Kolyvan par Mr. bj.aski.
Réponse
la
à
deux questions proposées à Mr. Spaski de la part de
Conférence.
Observations météorologiques faites aux mines des Schlangenberg,
depuis le mois de Juin 1812 jusqu'au 14 Juillet 1814; par. Mr.
Spaski.
Ueber Seguin's I edergerbercy Méthode par Mr. Nasse.
Continuation du Journal des observations astronomiques; par Mr.
-
Wisnievski.
;
«
43
Ueber
die
Basaltformation
im Hochgebirge des Kaukasus; par
Mr. Schlégtlmilch.
Ueber die Zuckerbildung beym Malzen des Getreides und beim
Bebrûhen des Mehls mit kochendem Wasser par Mr. Kirch;
hof.
Sur
le
mouvement
des corps qui s'attirent en raison directe de
Mr. le Prof. Littrow.
leurs distances; par
HoBaH xHMHHeCKaH HOMeuK.iamypa,
O.taHACROÎi BoeiiHOÎi rcuinumajiH
,
coquHeHHafl
npOBH3opoMi
KoH^pamoMi, I^iiceBCKHMi.
du calcul différentiel. Second mémoire;
"Réflexions sur la théorie
par Mr. Schubert.
V.
OBSERVATIONS, EXPÉRIENCES ET NOTICES
INTÉRESSANTES, FAITES ET COMMUNIaUEÉS À L'ACADÉMIE.
1.
Le
un rapport de Mr. l'Académicien
Secrétaire lut
extraordinaire Wisnievski, daté de Stavropol
1812.
tite
Il
mande
Comète dans
d'avoir découvert le
la
constellation
observée jusqu'au 17 Septembre.
Bouvard a découverte le
2.
donne
de
lilr.
connaître
Août
à
la
et
de l'avoir
même que Mr.
Paris.
Professeur d'Astronomie à Kônigsberg,
un apperçu de
mieux
grand
Bcsscl,
1
19 Juillet une pe-
du Lynx,
C'est
du il Décbr.
ses
la
travaux entrepris dans la vue
nature
des étoiles
doubles.
nombre d'observations exactes a mis Mr.
6*
L^n
Besscl en
"="
44
de
état
déterminer
le
monverucnt annuel
en
propre de ces
semblent venir à
étoiles,
et les résultats qu'il
pui de
l'assertion
d'étoiles
sont autant de systèmes de corps ,
que
tire
étoiles
les
doubles
et
un mouvement commun autour d'un corps
3.
ses
"Mr.
le
sur
calculs
l'ap-
grotipes
les
ayant chacun
central.
Docteur Pansner communique le résultat de
la
d'un
hauteur
du Kamt-
des volcans
chatka, savoir de celui qui est situé à i5 ou 20 verstes
du Port de
hautecn- à
Pierre
St.
8278
et
St.
Paul ,
dont
évalue
il
la
pieds de France, d'après les observations
'barométriques et thermomctriques des Physiciens qui avbiertt
accompagné La Pérouse.
4.
.•suite
Mr. Struve, Astronome à Dorpat, communique une
d'occultations d'étoiles fixes et d'immersions et émer-
sions des satellites de Jupiter qu'il a observées.
.
Le prix
•de ces observations est rehaussé par la détermination plus
exacte de l'Observatoire de Dorpat , dont
la longitude
à
l^ S^y^ 38^'' à
l'Est
IMr.
de Paris
Struve fixe
et la latitude
à 58'. 22''. 41^5.
5.
Mr. l'Académicien
«ime notice ayant pour titre
:
extraordinaire
Tilèsius
présente
Ein cJiirurgisches Mcisterstùck der
JVatur, contenant la description d'une ossification totale des
inusclcs pcctorau.x d'une poule, ossification par laquelle la
=
nature
de
guéri la fracture
a
de cet animal,
poitrine
la
mcme que la fracture d'un
de
45
os de l'aile, enveloppé en-
tièrement d'une croûte calleuse.
Mr.
6.
une
l'Académicien
de Stavropol,
lettre
extraordinaire Wisnîefsfd,
mande
d' avoir
Sextant à réflexion ]a hauteur de l'Elbrus ,
de 16,700 pieds
trouvée
de
Mont- blanc.
et
niveau
2 3oo pieds la hauteur
Arrivé à Géorgiefsk où
le
de l'avoir
de Paris au dessus du
mer, ce qui surpasse de
la
dans
mesuré avec
du
va se rendre dans
il
quelques jours, Mr. Wisniefski se propose de repéter cette
mesure
et d'obtenir
un résultat plus exact, cette ville étant
plus proche de l'Elbrus ,
et
les
erreurs ,
provenans de la
réfraction terrestre et de l'observation d'un
aussi
petit an-
gle d'élévation, de moindre influence sur la détermination
de
la
hauteur de
la
montagne
,
et
où
il
aura par dessus
l'avantage de pouvoir déterminer plus
cela
exactement la
au moyen d'observations de l'azimuth et de la
distance,
position géographique relative de Stavropol et Géorgiefsk.
Dans
la
ses
terre
que
et
faire
7.
calculs
il
donnera
se
tiendra
compte de l'aplatissement de
à l'Académie
le résultât aussi
précis
pourra.
Mr. l'Académicien extraordinaire Tilèsius présente à
la Conférence
quelques os de Mamouth (ExtremiUs humeri
46
Ulna) qui ont été déterrés a Volkova Derevna
inferior et
par les
Sappeurs des gardes occLipés à creuser un
IMr.
8.
d'avoir
découvert
gillcuse
vitriolique ,
dont
(sulfate
de
examinera
fer).
avantageux d'y
9.
sur
Il
bords
les
établir
a
il
du Kuban une
tiré
un
le local
très
beau
et verra
une fabrique d'alun
et
terre ar-
s'il
de
vitriol
seroit
vitriol.
Mr. l'Académicien extraordinaire Schèrer présente
Chciuische Analyse
cette
fossé.
l'Académicien extraordinaire PFisniefskl mande
des
Doroninshischeii AëroUthen.
:
Selon
analyse les parties constituantes de la pierre de Do-
roninsk sont sur cent parties
:
—
Chrome
2,
—
Manganèse
Terre silicieuse
Terre métallique
Terre areilleuse
Nickel
-
—
Terre calcaire
Terre talcqueuse
Soufre
—
Perte
-
—
100, 00.
La pierre de Doroninsk est donc remarquable à cause du
Chrome
qu'elle contient.
=
Mr. l'Académicien
10.
à
la
Confcrmce
:
liber
Qiœcksiîbcrs
aiif
qu'il
seroit
utile
sels
à la
Con.seil
11.
Bcreitung
des
nassem M'ege.
Par
de Mercure
Conférence
corrossif,
il
a
dont il
d'examiner les vertus médicinales
par des expériences comparatives ;
posa
die
présenta
dont Mr. Nasse donne la description ,
obtenu doux espèces de
croit
extraordinaire Nn.^sê
Beobachtungen
sahsauren
corrosiven
des piocédés ,
47
c'est
de communiquer
pourquoi
son
pro-
il
mémoire
au
médicinal.
Mr. l'Académicien extraordinaire Schèrer présenta
un mémoire
sous
le
kovschcii Metcorsteins.
Chemische Anal/se des
titre :
Char'
Selon cette analyse les parties coa-
stituantes sont sur cent parties :
Silice
—
48
Mr le Docteur Joseph Ilamel
12.
,
Correspondant de
dans une lettre datée de Bath
l'Académie ,
communique
,
Conférence plusieurs notices intéressantes
à
la
la
fabrique
autrefois par le Dr.
établie
chair
des
baleine ,
Gibbcs, pour con-
ou de
cire ,
dont
on
peut
des
faire
bougies;
d'un Graveur en pierre, Mr. Bankes,
2°.)
Sur l'invention
de
donner une couche noire à l'agathe de Saxe,
concentré
en le
quelques heures dans de l'acide sulfujique
cuire
laissant
Sur
animaux en une espèce de blanc de
la
vertir
i°.)
:
Sur une nouvelle manière qui se pratique
3°.)
en Angleterre pour conserver fraiche, pendant des naviga-
de longue durée,
tions
viande cuite ou
la
de Mr. le Dr. Jlamel ,
étoit
rôtie.
La
lettre
accompagnée d'échantillons
du
blanc
de baleine du Dr. Gibhes ,
de
cette
substance
de
la
cire
fondue
d'un morceau d'agathe à couche
et
noire.
Mr. Mïilhr ^
13.
ment d'Irkoutsk
que
22
le
ment de
terrein
Correspondant de l'Académie,
Août on
terre
a
ressenti
qui a duré
à
causé
aucun dommage.
pouces anglais,
ïrkoutsk
40 Secondes.
succédèrent deux secousses
cependant
28''5
et
Directeur des Ecoles du Gouverne-
le ciel
.issez
mande
un tremble-
À un bruit soufortes,
qui n'ont
Le baromètre
étoit
serein et la chaleur de
degrés de l'échelle de Réaumur.
a
14
49
14- I-e Secrétaire
que
impiimé
re
lui
ment connu, Mr.
de
ons
a
envoyé un Physicien avantageuse-
Docteur Seebek,
le
qui a réussi à pro-
des cubes et cylindres de verre, par des ray-
dans
duire
voir à la Conférence un mémoi-
fit
lumière
polarisés
des
réfléchis,
et
configurations
symraétriques coloriées très remarquables et très variées.
de
repeter
priété
chargé
l'Académicien extraordinaire Pètrojf ,
15. Mr.
de Mr. Morecbinr sur la pro-
expériences
les
du
prétendue
rayon
communiquer
de
violet ,
la
vertu magnétique à une aiguille, sur laquelle on le pro-
mène, présenta à
Conférence l'appareil dont
la
il
s'est ser-
vi et lut la description de
tous les procédés qu'il a ob-
servés dan<î ses expériences.
Quoique Mr. Pétrojf eut ap-
porté
la
à
ces
expériences
plus scrupuleuse attention
Configliachi ,
et
magnétisme, ni
16.
de
lui
il
p.ar
imaginables
eu
le
même sort que
a
impossible
de prodtfire le
les
il
,
été
a
le rayon violet,
ni
par
le. rayon
et
rouge,
Mr. l'Académicien Schubert communiqua une lettre
Mr. de Kruscnstcni, datée de Londres et contenant des
notices
intéressantes
:
1°.
fjire
servir
pvoquc que
hitstciie.
les
de
un
Sur
dans une seule boctc, in\-cnté
de
soins
tous
rétrulatif à
clironomètre
dans
par Bréguct ,
la
marche
double
la
vue
linfluence réci-
deux montres exercent l'une
sur
'
l'autre;
=*
5o
cercle
sur le nbiiveaii
C^.
pour
Trougthon
de
entier
six
pieds ,
de Greenvich
l'Observatoire
fait
par
d'après
un
nouveau principe.
"^h. Fischer,
17.
à
des Naturalistes
Moscou
et
IMPÉRIALE
Correspondant de l'Acadé-
donne connoissance d'un météore qu'il a observé à
mie ,
Moscou
le
28 Octobre 1814, à
C'étoit
soir,
et
Directeur de la Société
de
un
globe se dirigeoit
la
heures 5o minutes du
feu d'une
globe de
grandeur de
la
7
pleine
lumière
lune
à
blanchâtre'
son lever.
Ce
du Nord au Sud avec une vitesse moin-
dre que celle des météores qu'on appelle étoiles tombanIl
tes.
étoit
à
une ha-uteur
mouvement
avoir un
très considérable
de- rotation
ques personnes prétendent l'avoir
et paroissait"
autour de son axe. Quelvn.i
avec une chevelure,
ce que Mr. Fischer n'a pas pu remarquer,
quoiqu'il tient
pour possible qu'une phosphores'cence de
sron
ait
{ru
produire quelque chose de semtiliable à une queue.'
1-8.
"Mr.
à Hatjan ,
le Conseiller
privé
et
Chevalier
Correspondant de l'Académie,
i°)
sur une pierre météorique, tombée,
près d'Aix la Chapelle et déterrée au
Léoithnrd
donne plusieurs
notices intéressantes concernant la Minéralogie.
tres:
atmosphèie
il
Entre au-
y a 5o ans,
commencement du
mois de Novembre de l'année passée. De cet acrolithe, qui
*=
pèse
de
7000 livres, Mr. l.èoiihard espère
1
Jiiens,
5l
dont
promet d'cn\oyer un à l'Académie;
il
(îoitliard
( variété du Spinel )
Salam
pierre
la
3°) de l'opale
;
d'obtenir des frag2°) il parle
trouvée au
St.
trouvée dans du basalte
noble
aux environs de Frankfort sur le
Mayn;
4°)
il
promet Ufj
collection orognostique des minéraux qu'i[
supplément
à
la
iransinellra
à
l'Académie au printems prochain,
VI.
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR DES AGADÉMICIENS CHARGÉS DE COxMMlSSIONS
PARTICULIÈRES.
Le
1.
Secrétaire
exiraoïdinaire
niicien
4 Décembre
1
8
de
g aphicjue
lut
un
rapport
Uisnievsky ,
de
daté,
Mr. l'Académi-
de
Stavropol
le
2 et contenant ce qui suit: 1°) la position géo-
i
quelques
points
de
la
ligne
du Caucase,
calculées par Mr.
il isnievsky ,
d'après ses observations,
de Mr.
Biitzknjt'Shy ,
Lieutenant- Colonnel de la
\\
prière
•Suite
de
militaire
S.
de
M.
la
J.,
chargé
ligne.
d'une
«î
levée topographique et
Mr. IVisnievsKy espère que l'Acadé-
mie
ne désapprouvera pas cet acte de complaisance qu'il
s'e-st
}X'rmis
mandée
par
en
le
faveur d'une entreprise aussi utile et com-
Ciou\erncmcnt;
2°)
Mr. IVisnicvsky ayant
7'
'
ïetronvo
ig
le
mète do
i8li,
jusqu'au
5'
ne
Comète,,
il
et
peu
pas
et surtout
paicequ'il
moins entre
sa
,
h\
Co-
U nMiche depuis ce jour
29 observations
U\
eoncccioa des élémcns de
à Li
dèterminiUian de son teins
à
a
y
un intorvallc de près de 18
première appaiilion et
la
d.cinièie observa-
Mï. IVisnkvsKy.
S.
2.
le
Nova - Tsc'vfMkask.
Ihtle que ces
se
il
périodique»
tion de
li
en a observé
Août,
contribueront
celte
JuilK-t
E. Mr. l'Académicien fufs, rapporta d'avoir
\i\
mémoire de Mr.
le
Professeur Littrow à llazan, sur une
méthode
de
déterminer
nouvelle
les
hauteurs observées
près du Méridien, et de l'avoir trouvé digne d'être impri-
mé avec
pour
11
ajouta
3.
l'Académie qui seront choisis
à
5^
Tome.
que l'auteur mérite d'être encouragé par l'Acalui
continuer ses communications,
Mr.
r Académicien
d'avoir lu le
cKHxî)
mémoires de
Section des Sciences malh'.'maJiqucs du
la
démie
les
extraordinaire
Krug
rapp^orta
mémoire de Mr. 5pawA/: O ApeaHtixl) Gn6ijp«
xypraHaxl»,
de l'avoir trouvé intéressant; et ju-
et
geant d'après ce mémoire et d'après ceux, que Mr. Spasski
avoit fait présenter précédcmjuent
son
goût pour des
soudre
l'Académie, que par
recherches historiques;,, et par le lieu
de son séjour actuel,
quelques
à,
il
seroit
questions
qui
en: état et à:
portée de ré-
intéressent les Historiens,
de
proposa
il
pour CCI
de
il
le
mémoire
Mai , sous
le titre ;
csoucmôaxo
,
son
fit
Mr Spassky,
Oiue^iQcmojiHHUXÔ yiCriozatt
//3<3
en
à
qu'il présent»;
reporta
Zakharoff
??ii.jaxo
et
nii^a.jiS;
triinsmises
présenté Je 5
npitmmùsMHin
cjjoco6i
jpum.nô
fcuent
IJamel ,
.iiema.jjQJio^o6'ibtx5
û.xo
commun icjuer d'eux,
r Akadémicien
Dr.
le
Air.
et qui
ejTefj
Ak.
4)
en
lui
ti
coA^p^anitt kù
rapport contenant en
substance: que ce mémoire mérite l'ultention de l'Académie,
paiccqu'il renferme nombre de
sur
n^anière
la
et
q_ualilés
d:e
produire
propriétés;
nouvelles observations, tant
les
métaux,
qu'il seroit à désirer
que sur leurs
que l'Auteur
continuât ses recherclies, dans la vue de mieux déterminéela
quantité de l'oxygène dans les dilïérens degrés d'oxy-
dation^ et qu'il repctiit ses expériences avec l'acide
cique
et
avec
la
base a couleur foncée qu'il en a
boratirée,,
en examinant bien les propriétés de cette dernière,
5)
crii
de
Mr.
Mr.
l'Académicien Storch reporta rouvrag.e manus-
Kmdanoff ,
Sarskoye - Sélo
que
la
d'im
ordre
rapport
:
Professeur - Adjoint
OcHoaamji eceoG^eà
du Lycée de
Jio.uifuitzecKOii.
Conférence l'avoit chargé d'examiner,
de
S,
contenant
E MS*". le Ministre
en
substance
:
,
ucmopin,
à la suite-
et il présenta son:
qu'il a lu cet ouvrage
avec intérêt; que le travail de l'auteur lui semble méritoile;
qiie
sa
méthode
est
facile et claire;
que
les sources>,
,
~
54
d'oïl
puisé,
a
il
bonnes et
sont
choix des ('vi-nemcns
le
idcontés dans ce Cours d'Histoire conforme au but de l'oiiainsi
\ rage,
que
les
la
conception
que ces évcncmcns amènent,
reflexions,
que
élèves ;
des
l'auteur
a
adaptées
à
bien
de mettre en avant de l'histoire de chaque état
la
fait
géographique du pais ,
description
mémoire
jeunes
des
exactes des années,
mérite
l'auteur
rendu
avoir
historiques
se
la
surchargeant des dates
reconnoisance du public Russe,
par
son
travail
les
que Goîdsmiclt,
étrangers, tels
de lui
bons auteurs
Ileercn,
Mcincrs
quVnfin Mr. l'Académicien extraordinaire An/^
même jugement
sur cet ouvrage.
Mr. l'Académicien
6.
en
contentant de nombres ronds; que
accessibles
l^lanncit c\Cj
porte le
la
gens ,
sans tourmenter Id
extraordinaire
d'.ivoir
elé à Olvhta, pour y
vertu
d'uiie
résolution
de
examiner
là
les
Pètroff
rapporta
paratonnères, en
Conférence, et de
les
avoir
trouvé tons en très bon état; qu'ayant remarqué cependant
que
le
magazin
])ctit
il
puits,
hquel aboutit
dans
à
le
poudre, n'a qu'une demie Archine d'eau',
a conseillé de lui donner plus de
•j.
conducteur du plus
profondeur.
Mis. les Académiciens extraordinaires A[n/g et /^c/i/-
herg
présentèient
Uelur
die
leur
1T olochcn
rapport
A'estoi's ,
sur
le
que Mr.
mémoire
intitulé;
Prof.
Eiccrs »
le
jugement de T Académie'.
a»
soumis
rn siibst.mce:
son
tenir
rapport contient
qu'aussi dans ce fragment d'un noirvel
idée
dans
éij)ise
,
oir-r
Russes, Mr. ELivers persiste à sou-
sur l'histoire des
vr.igc,
Ce
un
ouvrage
[Fom
antérieirr
Ursprunge des âussischen Staats): savoir que les Slaves ont
habité
convient
soyent
Danube inférieur; qu'il
oiiginairemcnt les bords du
que déjà avant
vérité
la
à
répandus
le
5®.
au -de- là des Carpathes ,
siècle
ils-
mais qu'il
se
l'es-
fait
encore chasser en Russie, en Dalmatie, en Servie etc.
])ar
des Bulgares du
Woloches de
cité
pour
et
à
la
d'accord
avec
montrer
le
trer
selon lui,
Tout en rendant
justice
sont le
à la
saga-
vaste lecture de l'auteur, ainsi qu'à son zèle
sciences,
les
Siècle, qui,
7^.
Nestor.
rapporteurs
l<:;s
ce résultat,
dont
dôcd^nent
pas
n'être
seront en état de dé-
ils
défaut de solidité, sitôt qu'ils seront chargés d'en-
dans une discussion CDmpIette de Tobjet en question.
^,
Mrs.
les
Académiciens
Nasse, chargés d'examiner
extraordinaires Scfiêrer
un mémoire de Mr.
seur Grindcly sur la formation
le
Profes-
du méulloide de kali
duit par le Galvanisme dans l'eau
et
pro-
au moyen du mercure,
firent
leur rapport, dont la substance est : que les ex*-
périences
de Mr. Grindel ne sauroient servir de preuve à
en
la
formation
réelle d'un
du mercure qui garde
sa
métalloïde;
fluidité
que l'amalgamation
ne peut point venir a
rappiii
g.ime
des
assertions
de
l'auteur ,
pu
provenir
du
fil
a
parrcquc
d'argent dont
il
cet
amal-
s'est
servi
comme tzonducteur, ce qui est
d'autant plus probable qu'
avant négligé de recueillir
d'examiner le gaz qui
et
développé pendant l'elTervesccnco,
il
avoue lui-même que
du mercure,
l'eau, après l'amalgamation
s'est
montré aucune
n'a
propriété alcaline
l'Académicien Scliuhcrt, chargé d'examiner tm
"Mr.
9.
mémoire de Mr.
en
fit
le
ihcorème de
Taylor-»
son rapport, contenant en substance: que la démon-
stration
fait
sur
JJ'erhmcistcr,
du théorème,
preuve
-de
la
donnée par
plutôt que de
subtilité
du
l'auteur
mémoire,
de
solidité
la
son esprit; que toute sa démonstration consiste dans un rai-
sonnement métaphysique qui
d'une
grande
utilité
dans
souvent sans conti'edit ,
,
les
Mathématiques ,
mais
est
qui.
pour ne pas drvenir plus pernicieux qu'utile^ doit réunir
en hii
trois
solidité,
ce
qualilc's
(jui
n'est
essentielles:
l'évidence, J'ordre et la
pas le cas de
l'autexn-,
ouveilement avec l'essence, des corps
la
qui confond
manière dont on
conçoit en Géométrie leur cngendrcment, c'est-à-dire qu'il
confond l'idéal avec
le
réel;
qu'attaché à sa
manière de
formation des corps, l'autetu- se voit dans
concevoir
la
ii('-cessité
d'avoir
recoins
à
deux aiUrcs idées
hi
nvétajiliysi-
"=
ainsi
Mr.
du tcms
et
deux grandeurs hétérogènes,
le
,
et
d'jmalgaincr
tems et l'espace.
E.
Mr. l'Acaciémicien Fufs, chargé d'examiner
description
d'un Télémètre, présenté à l'Académie p r
10.
la
du mouvement
celle
qiies ,
57
le
S.
Docteur de Lamberti, en
en substance:
construction
qtie
fit
son rapport, contenant
cet instrument, par son principe et sa
morne ,
sujet
est
à donner dans
la
pratique
des résultats très -peu exacts; et que, quoique d'un usage
commode
et
pour prendre des distances à
éxpcditif,
militaire et sans prétendre à
il
la
un degré tolérable de précision
ne sauroit être d'aucune utilité pour des levées exactes.
11.
Mr. l'Académicien extraordinaire Kii"c/i/io/, cliargé
par la Conférence d'examiner deux compositions prises des
fusées de Congreve
et
envoyées à l'Académie
mité savant du Ministère de la guerre, en
contenant
stances.
le
résultat
de son
analyse
fit
par le Coson rapport,
de ces deux sub-
D'après cette analyse les deux compositions con-
tenoient sur
loo
parties :
La première:
Nitre
—
5a
La seconde:
===
est
tliotnctte
paifaitcmcnt
à Id
de
pouvoir
en
de
l'air,
qu'on
autant
faire
Enfin Mr. Schèrcr
correspondans.
contraction
59
veut de
attribue
à
produite par un changement de
température, les variations que Mr. Grîndcl a observées au
nioven de son appareil et
de
qu'"il
attribue à
une absorption
l'air.
Mr. l'Académicien Séuer^uine ,
i3.
l'ouvrage de Mr. le Conseiller de
charge d'examiner
Cour Pansner: Resultate
dcr Untersuchiingen uher die Hdrte uiid specifiscJw SchwerQ
der
Mineraîien,
que
stance:
les
en
son
fit
rapport
peines que l'auteur
contenant
s'est
en
sub-
données, en dé-
pesanteur spécifique d'un grand
terminant la dureté
et
nombre de
méritent toute l'attention des Minéralo-
gistes ;
tés
fossiles,
la
mais que son idée, de fonder sur ces deux quali-
un nouvel arrangement systématique des minéraux, ne
sauroit obtenir leur
approbation, aussi peu que son moyen
de déterminer leur dureté, d'autant moins que
la
méthode
de JJ'crncr est beaucoup plus simple et plus exacte.
14.
Mr. l'Académicien extraordinaire Tilès'ms , chargé
d'examiner un mémoire de Mr. le Professeur Lêdébour: Décades
scx pîantanim novarum
iii
Imperio Rossico
indigena-
rum , exhiba son opinion, portant en substance: que cette
description de soixante plantes, pour la plupart
8*
du Kara-
=
6u
tchalka et des
îles
Koiiiiles, rama?;sées
non encore, on mal connues
plus
et
cliiiie
même
,
dans
les
la
lipse,
le
plus courte,
donner luipubliée,
dont
les
de méridien faites au Pérou ,
mettre plus
en
fit
et-,
et
ea France ,
en
son rapport contenant en
mémoire présente un
d' accord
de méridien;
essai
intéressant
entre les diflérentes mesures àes
que l'Auteur
s'est
de peines à trouver une ellipse dont
férassent le
Recherche d'une
dime)isions approchent le plus des détermina-
que ce
:
les
donné beaucoup
dimensions
dif-,
moins que possible des principales mesures du
degré du méridien.
16. Mr. l'Académicien extraordinaire 5'c/iércr présenta son
rapport, concernant l'analyse de deux prétendues compositions
dos fusées de Congrève, instituée par un Comité nommé par le
Ministre de la Police, à laquelle Mr. Schérer avoit été chargé
par la Conférence
confirme
celle
*
Capitaine en Chef des mines de
yîngleterre et en Lapponie,
arcs
et
Mr. l'Académicien Fufs, charge d'examiner
E.
classe et Chevalier IFilbrecht:
substance
la
même
-
Mémoires de rAcadéinie.
tions des arcs
de
dcciites , est
plus exacte qu'il n'auioit pu
mémoire de Mr.
5®.
Itii
qu'elle mérite, par conséquent, d'être
et
i5. S.
un
et
p.ir
qui
d'assister.
Il
se tiouve
que cette analyse
avoit été instituée antérieurement par
.
Mr,
en
'
l'Académicien
extraordinaire
Kirchhof.
que l'une des deux masses
est:
fusées ordinaires, et que
sineuses, de
cire
la
et
flamme inextinguible,
l'autre,
est la
Le
résultat
composition des
contenant des parties ré-
de l'antimoine, loin de brûler d'une
se
laisse
éteindre par une très petite
quantité d'eau. Mr. Schèrcr doute que ce soit la véritable
des fusées de Congrève.
niasse
l'Académicien
Mr.
17.
mémoire de Mr.
u.
und
Kenntniss
der
w.
s.
en
le
fit
Storch
chargé d'examiner le
Ncumann: Ueber die Wichtigkeit
Prof.
Bearheitung des olten Slavischen Rechts
son rapport contenant en substance
1°)
:
que l'Auteur de ce mémoire s'efforce de prouver qu'il existe
un
ancien
Scandinave;
preuves
de
IlpaBfla
il
droit
Slave indépendant du droit Germain et
2°)
qu'après avoir établi cette thèse, appuyée
historiques
PycKaa,
comme
générales
à
_,
l'Auteur
faut puiser les notions de ce droit ,
de donner une explication nouvelle;
section
passe
3°)
et dont
tance
il
essaye
que la troisième
droit Slave à quelques cas particuliers propres à
le
la
du mémoire contient une application de cet ancien
l'histoire
que
à
une des principales sources où
mémoire
de
éclaircir
des Russes et des peuples Slaves en général; 4°)
la
est terminé
par quelques vues sur l'impor-
connoissance de ce droit Slave pour la véri-
ûcation des auteurs qui ont écrit sur l'histoire de ces peu-
==
6i
pics;
5°)
que
du mémoire y
commune;
pénétration peu
qu'il peut
fait
travail
est
celui
recherches
d'une bonne tcte
pénibles
et
d'une
preuve d'une
bien avoir été trop
dans quelques unes de ses assertions,
loin
de
Aiitei'.r
l'
et
qu'il
mais que son
est le
résultat
connoissance intime des
loix Russes.
18. Mr. l'Académicien et Bibliothécaire Schubert rap-
porta
que tous
les
livres ,
destinés
par la Conférence à
réparer, autant que cela pou voit dépendre d'elle, les pertes de
l'Université
IMPÉRIALE de Moscou, c'est-à-dire, tant les
doublet tes de la Bibliothèque académique, que les ouvrages publiés par l'Académie et imprimés dans sa Typogra-
phie (un exemplaire de chacun) ont été encaissés avec soin
et seront expédiés le 9
loués à cet
19.
et
rouliers
effet.
Mrs.
Tilèsius,
Mars à Moscou , par des
les
Académiciens extraordinaires Smélovsky
chargés d'examiner un mémoire de Mr. le Pro-
fesseur Jason Petroff: Descriptio h'otanicu novae speciel
ronicae ,
en
remirent
leur opinion,
portant en substance:
que la plante sèche, décrite par Mr. Petroff^
une nouvelle espèce,
n'est
Ve-
loin
d'être
qu'une des nombreuses variétés
de la Véronique [Feronka incana, spicata, minor, angitstifnUa)
vue en
fleurs
dans son pais natal
et
décrite par Gmèlin.
='
r Académicien extraordinaire Petroff fit rap-
Mr.
2 0.
63
Okhta 18 Juin 18 14, pour y examiner les
port d'avoir été à
paratonnères.
D'après cet examen tous les quatre conduc-
teurs sont en
bon état et
puis
les
les
puits,
où vont aboutir leurs
beaucoup mieux fournis d'eau, de-
extrémités inférieures,
améliorations faites à ces puits, à la suite d'une
de
proposition
Mr. Petroff ,
contenue
dans son
rapport
de l'année passée.
21. Mr. l'Académicien extraordinaire K'irchhof, chargé
d'examiner
les
eaux
l'Académie
par
Son Eminence
de
minérales
M?"",
MohilelT,
le
envoyées à
Métropolitain SieS'
trenccvicz de Bohiisz, présenta son rapport, contenant le résul-
de
la
bouteille
livre
cet
N°.
1.
de cette eau
un
pu
être
cide
les
sel
réconnu j
réagens
dissoute
la
est:
que l'eau de
chaux
dissoute dans
consistant en carbonate de chaux
très
petite
quantité ,
n'a
mais qui est vraisemblablement de l'a-
L'eau de
la
bouteille N°.
2
manifesta par
présence de l'acide nitrique et d'une chaux
dans de l'acide carbonique.
contenant
siccité une
gris
jusqu'à siccité laissa
sâtre
la
trouvée contenir deux grains seule-
a cause de sa
qui ,
nitrique.
de
s'est
ment d'un précipité
et
contient
Après l'évaporation jusqu'à
carbonique.
l'acide
La substance en
examen.
tat
un grain
de la
et -demi
carbonate
Une livre évaporée
d'un précipité gri-
de chaux et de l'acide
64
La
«inrialiqde.
trop
petite
constituantes, ni
du
quaniiu*
ne permit pa? d'y reconnoîlic
Cciiix,
ni
irsidti
toutes
des deux
les
parlies
leur proportion.
VII.
VOYAGES SCIENTIFIQUES.
1.
L'Académicien extraordinaire IVisnievshy conti-
^Ir.
nua en 18 1 3
plan
dressé
droits,
où
ses courses astronomiques,
en poursuivant le
par lui et approuvé par l'Académie. Les enil
a
institué
des
obsçrvations,
sont Stayropol,
liavkaskaya, Oust-Labinskaya, Egorlitskaya, Novo-Tschcr-
kask,
Kamenskaya - Stanitsa, Khopersk, Tambof, Riazan,
Klin, Vychney-Volotchokj Valduï
2.
pressé
etc.
Mr. l'Académicien extraordinaire U'ismevsKy, em-
de
finir
en 1814
sa
une dernière excursion dans
longue et pénible tache par
les
Gouverncmens de Novgo-
rod, Olonetz, Yaroslav et Kostroma ,
fit
ce dernier voyage
envoya la
continuation du Journal de ses observations
astronomiques
Ce sont les observations instituées depuis le
et
î26 Janvier
jusqu'au
1 3
Mars de cette année à Oust-Waga,
Archangel, Mésèn, Pinéga, Kholmogori, Emetskoe, Shenkursk, Welsk, Weliki-Oustioug, Sohvytchegotsk, Yarensk
et
Oust - Sysolsk.
I
=
3.
E. Mr. r Académicien Ozeretshovshy
S.
position
de
Séliguer,
dont
l'envoyer
les
de
rapport
le
65
faire
environs
à
sont encore
fit
la pro-
autour
du lac
peu connus sous
naturelle, quoiqu'ils fussent
l'histoire
remarquables ,
voyage
un
très
cause du voisinage des sources du Vol-
ga, du Dnepr et de la Dvina. Comme un tel voyage parut pro-
mettre une bonne récolte pour les sciences, étant
un observateur
la
cette
Mr.
exercé,
aussi
proposition ,
le
excursion
la
par
Conférence applaudit à
voyage eut lieu
,.
et les
résultats
publiés par l'Académie,
seront
fait
de
dès que
Ozeretshovsky les aura rédigés,.
VlIL.
OUVRAGES PUBLIÉS PAR L'ACADÉMIE ET
PAR- DES ACADÉMICIENS.
i')
née 1811.
2 )
IMPÉRIALE des Sciences de St.
Tome IV, avec l'histoire de l'Académie pourl'an'
Mémoires de l'Académie
Pétersbourg.
St.
OcHOBaHivl
nepBhifl
>i3biKa
rétersbourg i6i3.
mpH
J\eOHrap^a Efi^epa, MacmH nepHoit
omAh.AtmiH, nepeBeAeHHwa cIj C|)paHi^ycKaro
ce mhofhmh npHCOBOKynJieHiiiMH,
BHCKOBarnoBbiMl», AKa^ewi» HayKb 3Kcmpaop4n-
Ha PocciriCKoiï
BacHAieivil)
,
HapHbiMl) AKa^e.viHKOMT).
omAbjienie
3.*)
4.°.
AAreGpw
i
e.
h
CAOBapb Xhmhhcckih
TomI)
i
C. IL 6yprl).
2-e,
h co^epjKau^iH Bb ce6t>
1812. 8\
co4ep.^amiH bI) ce5t) eeopiio h npaKuiHKy XiTMin h np. Tpy4a.viH AKa^cMiiKa Bac. CeBeprwHa.
Hacmb IV et (J)HrypaMH. C. IL 6 y ]g ri» iSiS. 8\
Histoire
,
9
Itfciiè jBSsmam
COMMENTATIO
TN
FRAGTIONEM CONTINUA M,
QUA ILLUSTRIS LA GRANGE POTESTATES BINOMIALES EXPRESSIT.
A U C T O R E
L.
E U L E R O.
Conventui exhibait die 20 Mart. 1780,
Iste
vir
hanc potestatem Binomialem
illtistris
(l -\- xf"
nicLhodo prorsus singuLiri ex ejus dilTerentiali logarithmico
in
hanc fractionem continuam convertit
4
:
-*- Cj -f-n)x
5-t-( 3
— ")^
2 -f- (;-(-n) x^
qnac expressio hac
insi£;ni
cxponens
numeins intcger, sive positivus, sive
negativiis ,
n
fticvit
abiumpatur
et
proprietalc gaudet,
ut quoties
ad foimain finitam redigatur
1*
4
II.
Quoniam haec fractio continua non loge iiniformi,
eam ad legem uniformrm
interrupta, progreditur,
sed
quod coramodissime fiet, si eam sequenti modo per
«remiis, id
partes repraesentemus
(i
-f-
xf
:
-
1
^A —
1
-L
^
n«
.
_il=l"li^_-U
-rn)x*
a-t-(i -t-
B
B — 3
^^—Jl^^L^'
.-^
C
C =: 5 +
^(3-t-n)x>
D
(4— n^x
^-t-(4H-n)xJ
.
etc.
Hinc
A
**•
igitur per
_,
rcductionem habebimiis
('— n)Bjc
^ "'"aB-l-(i-hn)x
D
T..
modo
erit
(i— nn)xx:a
"•" O^Mf^
_,
-^
2B-H(i-rn)e
2
(i
Simili
revo-
— n)x
,
(nn
— xx
i)
:4
:
(^-H)Cx
o _,
^ "T- jC+(2+n)x
o _i
-^
^
Ebdem. modo- habebimus.
(m.'Of
2
.
C4
-nn) xx_a
2C-^(ï-(-nJ*
(î— n)x j^ (nn
—
4 )*JC-4
y
et
1
:
p
(-
ita
porro.
III.
_i
C^
Q.(iodsi
snbstituamus,
I
+
— Ti)D3!
-
Çî
— n)x
(9
— wn)jca:|A
jam hos valores ordine loco A, B, C,
hCin — i]xx
-
etc,
continua sequentem induet formam :
fitictio
-.4.
3(J -^i*)-(-('"'~4)'fJf 4
5(_i+ix)+(^ nn
— Q)xx
:4.
7 ( ' -H a *J -1-
(tn
— i6')xx:4
etc.
IV.
Quo hinc fractiones partiales abignmus, statuamus
x:zz 2 y, ut nanciscdinur hanc expressionein
(i -t-;j)"::i i-hzny
i-i-i'
— n)y + (n n — ')yy3(i+j'J-t-('nn
— 4177
5i>-h:>}-^-{nn—9)yy
-f^+y)+ etc. »
qnae forma
"
_
—
"
transmutatnr in hanc:
(""- O»
,7^ r -u
facile
,
_L_ / ,
Addatnr utrinque
?z/,
nt prodcicet
"T-/ ~^ j('-f->) + CnTi — 4)vv
(i-j-îjji—
sCi-t-'jyj
quae expressio jam ordine
V.
sinistrum
satis
+
cfc.
'
regulari procedit..
Dividamus jam utrinque per t -h y,
evadet
:
_">_^ ,-
L''^'
'"^''^
.
:.
membrnm^
Ex parte dextra aiitemi
singulae fractiones snpra et infra per
prodibitque haec forma
et
1
-y-
y dividantnr
,,
i-|-( nti— i>vv(t-f- >)»
3 -h (
nn- 4
"" •>
V
4- >)
( '
5-h{nn-9)yy. {i+y)*
— i6')yy{i-i-y)*
— 2s)yy (i-4->)*
7-j-(n H
9 -hi nn
:
II -t- etc.
Hanc
"VI.
denuo
cxpressionem
igitiir
ad
majorem
concinnitatem iedLicemiis,statuendo-^--:^z-, ila ut sityrr^^:^*
Hoc autem modo membrum sinistrum, ob
accipiet hanc
foimam
:
—
^>;i^-^4—(,Trz3« »
i
— ^-^.
2 r
-f-
quod ergo aequa-
bitur huic fractioni continuae:
I
4- (« n
— )zz
I
3 -r
(nn— 4)gg
5-»-(nn—ji)z»
7-l-('n n
— i6)sa
9 -t- etc.
quae, ob clegantiam,
summam altentionem meretur.
VIL Nunc igitur per se manirestiim est, islam cxpressio-
nem scmper
alicubi
abiiimpi ,
integer, sive posilivus, sive neg.]ti\us.
eliam
membrum
pro n sciibatur
sinistrum
si
fiiciit
niimcriis
Evidcns autcin
est
eundem valorem retinerc^ eliainsi
—
u. Hoc enim facto evadct
nz f(i-f-z)— " H- Çi
z) "]
>
zy^n
(i
C-t-z}— 1
— —
quae fracLio,
n
(jciotics
:
—
supra etinfraper(i
—z
z-)"
mnltiplicctur,
induet liane formam:
(._zjn_^,lfl2)n
quae
est
ipsa
expressio
(,^3)n_c, _~jn J
piarccdcns. Sicqiie pcrindc
sive litterae n valor positivas, sive
nogati\us
est,
iiibiiatiir.
—
/
1
7
VTIT.
Ira
sumamns 111=^1
si
fit
niembinm
sinistrum-
rr 1, qui etiam est vjlor clcxtii. Pono posito « c= H^ 2 membjTim sinistrum evadit
etiam
fit
sinistra,
zz:
—
ut et dextra, fiunt
IX.
menti.. deducere
^^"^
nonnnllas
atitem
Ilinc
vel evanescens vel infinitas,
-.
conclusiones maximi mo-
imprimis autem casus,
dalur valor imaginarius ,
z
litterae
pars
exponenti n tribuatur valor
prouii
licet,
vero dextrum
modo sumto nziz^S
Simili
rz:i-f-z-z..
membrum
i-f-zz-,
quo
pcrducit ad insignem
conclusionem,quandoqu dem ipsa fractio continua nihilominus
manet
qua
a
rcalis,
igitur conclusione initium
Conclu sio
qua z rr
f
sumamus.
!..
/ — 1.
X. Hoc igitur casu fraclio continua banc habebit formam:'
1
i)tt
( rtn
i
— (un
5
—
4)f /
—
— (nri^—
o)ff
(n n
1
i6)ff
—
9
at
etc
vero pars sinistra nunc erit
ntV—i [(i + fy— ot+Çi— y' — )"]
:
(i-htv
quae
non
— o" —
(i
obstantibus
dcbct A-alorem rcalcm,
tV
—
Tyt
partibus
»
imaginariis
certe
haberef
quem ergo hic investigemus. Hune in;
fmcm ponamus t'- ^"-|, ita ut sit t = tang. (p; tum igitur erit:
^i -t- 1 y
~
1 j
_
-^j^
__
-^^
,,
—
modo
similique
;
His
(co?.
vil
/
ty
( l
—
eof. n
isin. 0)'*
<p~V —
t
sin. n ()
COI. tp^
JoTlpn
•
nostmra membmm sinistruni
substitulis
igitiir A'aloribus
evadit
V
^
l)
:
2 71
/ — -tg^ coj. n^
sîâ. a Cp
2 y —
I
XI. Posito ergo
ntg. (p
n tg. (P co!. n <J>
sin, n $
I
'
fg.
n <p
cprzt habebimus sequentem fiactio-
tg.
nem continuam maxime memoiabilem ;
nt
(titi
ïgTnCp
3
t)t t
— (nu —
— — 9^^
4 )tt
(.nu
S
7
—
etc.
quae igitur hoc modo repraescntaii poterit
tg. n(pZ=l
V-inn-, )tt_
3
— (nn-—
5
—
4)^f
(nii
—
o)f f
7
qiiae
ergo expressio
anguloiTim
Ita
si
per
3Cp
—
ete.
tangentem anguli simplicis
fiieiit n :=z
Eodem modo si n z^ 3, erit
tg.
-
commode adhiberi potcst ad tangentes
miiltiploriim
expiimendas.
:
_3t_
t
2, habcbimus tg. 2 cp zz ^^^.
:
iLnll
i—8tt
i.
— 3tt
3-tt
Ilic
cnsus
maxime
notabilis se ofieit
quando exponens
n accipitiir infmite paivus, tiim cnim erit tg. n (P zz. n (f), ergo,
utrinqiie
per « dividcndo,
orietiir
ista
forma:
CI)
= -'5-I-91L
-f-etc
7
qtia fractione continua per tangentemf ipseangulusexprimitiir.
nunc
Consideremcis
XII.
casum ,
quo
exponens
n
accipitur infinité magnus, at vero anguUis cp infinité parvus,
ideoque etiam eius tangens t infinité paiva, ita tamen, ut sit
nCj)
n: 0, ideoque cLiam
n
=: ô; tum
t
habebimus
igitur
istam fractioneni continuam:
te
ô
— —^3
—
gj
S
—
éji
7
—
etc.
qua formula, ex date angulo
quae ergo expressio tanquara leciproca praeceden-
potcrit,
tis
eius tangens determinari
ù,
spectari potest.
Conc1us
i
o
IL
qua exponens n evanescens assumitur
Hoc eigo casu
XIII.
J
fractio
continua
:
eiit :
2 Z
3
— 4^"
— =» _
— i6zz
S
9
7
9
etc.
Pio parte sinistra autem notandum est esse (' + ^)''- j =/(n- 2.),
ideoque
(i -f- z)" ziz
M(m$\res de VAiétd. T. VI.
i
-f- ?i/ (i
-f- z);
simili
^
modo
erit :
s
lO
^1
— *?•)=
~
i-\~ n l (i
i-'"<Je
7')»
—
— nJ(i —
()-t-nî("-t-z)-|-n/(i
'^'^
nI(.-t-2)
mcmbiLiin sinislaini evadet
5
z)l
hinc ergo habebimus islam formam
1
=
z)
—
— pz»
—
5
7
:
i6zz
9
—
efc. '
hincque ipse logarithniiis sequenLi modo cxprimetur :
r-^~
=
3
— 4Zg
5
valorem,
Ilic
nisi
efe.
Conclusio
IH.
exponens n
infinité
qiia sumitLii
XIV.
—
ergo ,
lit
qiiantitas
nz zz: u, ut sit z rz: ~
fiactio
magnus.
continua finitum sortiatur
% infinité parva statuatur, ponatur
atque nostra fractio continua erit:
,
9 -+- etc.
Pio mcmbro autem^ sinistco constat
niili(inc
modo
(i
—
habcbit hanc formam
^')''
z:: c"~^',
esse
ergo
( l
-f- ^)" zi= e^,
membrum sinistrum
:
quam ob rem habebimus hanc mcmorabilem
conLinuam
:
si-
fractioncm
11
«il'
CLiius
—
valor
tas exhiberi
-•-
1
~t~
3 -f- -j -j
tianscendens etiam hoc
modo pcr séries scli-
potest:
:
1
1.3,3
1.3..$
-f
'
1.2... 7
'^^^«oocco'^ooeoso •
+
etc.
\-
etc.
'
d
12
ANALYSIS FACILIS AEQATIONEM RICCATIANAM
PER FRACTIONEM CONTINUAM RESOLVENDI.
A U C T O P. E
E U L K R O.
L.
Convcntui. cxhibuir
I.
^it;
Marr.
2-
1780.
Jam pridem eqiiidem aequalionis Riccatianae
kitioncm per fracdonem continuam tradidi
reso-
sed usus
_,
sum
inethodo haud parum operosa , qiiae transformationes satis
Nunc autcm
abstrusas requirebat.
longe
facilior
se
niihi
obtiilit alia
via
quae cum ad fractionein
idem piaestandi ,
continuam multo simpliciorcm perdiicat, haud indigna mihi
ut eam
cum publico communicarem
visa
est ,
cum
insignes Geometrae
hoc
argunientum
,
piaecipue
summo
studio
perscrutari cocpcrint.
IL Considero autem aequationem Riccatianam, sub hac
forma expiessam
:
o d j -f- y y d X
zz:
x"
"~ '
rf
X ,
quani autem hoc modo rcpraesento :
a
dy
—
*^^-
-^ yy dx
rr:
x"
"""
rfx ,
quae quidem rêvera priore non est gencrahor;
^
yzzLX" V
h
fit
dy zzz x"" dv -\-\x
posito enim:
b— a
'^
v
x ,
d
,,
i3
modo
hoc
terminus
noviis
orieturquc sequens acquatio
introduclLis
tollctur
:
sb
b
ax'^ dv -\-
itciiim
n
—
a
x"vv d x zzz x
d x.
Veruni forma assumpta ad institutum nostram imprimis
accommodata;
vitatis
statiio aultni
a -{-b zzz c ,
axdz
— czdx -h zzdx zn
Fiat nunc
dzzii.
ista
quae prorsus
quod
z rr c 4- *",
ita
u(
sit
hanc aequationem
— {c-\-na)pdx
similis
est
-f-
:
ppdx i= x"" dx
,
piaecedenti ; tantum cnim eo dis-
secundo tcrmino loco c habeamus c --(-/za.
in
In hac aequatione jam. statuamus pono p—c-\-iia~^~''
lY.
et
substitutio
x"c?x'.
factaque subsiitutione, et subJaiis irac-
,
tionibus, peivenietur ad
axdp
est
ponoque bre-
ut prodeat sequens aequatio:
gratia
III.
ciepat^
piaeterea j"^=;- ,
calculo evoluto perveniemus ad sequentem aequdtionem :
axdq
— (c-f-2no) qdx
-f-
qqdx z=i x^'dx,
quam quidcm immédiate ex praecedente deduccie potuissemus,
scilicet loco
termini;,
qui erat
V.
Simili
q:=^c -h
'2
modo
—
et
coëfficientcm secundi
c-rna, denuo qu.intitate nci augendo.
na 4-
axdr
p scribendo q
"^
intelligitur
,
:,
si
piodituram esse
{c -f- 3 na) r
hic
pono statuamus
hanc aequationem
X 4- rrdx
zz.
x"dr.
:
14
alqne
iiltcriu.s
acqiiatio
ista
axds
Sicque porio
liic
si
statuam
r=ic-|-3;îa -f- --» P^^^'^^^
:
— + 4«n) sdx
(c
in
-{-
piogicdi
infinitiim
ssdx zn x' dx.
licet.
dnodsi iam loco litterarum p,q,r, s, etc. valores
VI.
successive substituamus, pro variabili z icpciicmus scqucn-
tcm fractioncm continuam
salis
concinnam
:
x^
C 'T- c_^_jia~hx^
.
7,
o -|- : n a ^- x"-
c-}-3 na-f-x™
c-i-^na-i-x^
unde aequationis piaecedentis, qnae, ob
ad y
valor
+ — c)^^
(a
-\-
h :=: c
X
'
:
c-'rna-j-x'"c
+ 2nd-|-x"+
c
3nii-f-É>fc.
Ilinc igitnr pro ipsa acquatione piimum proposita:
VJI.
ady
+ yydx
z=:
nbi scilicet est c zn a ,
VIIT.
continua
:
yydx r= x"" 'dx,
y liac fiactione continua exprimetur
•/
— a, ciat
:
Quodsi
ergo
x
dx ,
ciit :
vicissim
piofjonatur
ista
fractio
15
^
nunc
—
ccili
_*«
^ ~r- cH-naH-x«
vjloiein
sumiis
aequationcm dilTcrcntialeni
— cz X
a X d 7,
ciiius
cl
crgo intégrale,
niodatum ,
ijisius
z detciîiiinari per hanc
z z cl x
zn x cl x
:
-f-
praebebit valoiem
scilicct
intégrale ila
2;i:r c,
si
,
sumpliini et ad hune casiini accoiii-
vile
definiii
illius
fiactionis
continuae;
débet ^ ut, posito xizio,
(niidem n fuerit numerus positivus; at
fiat
fiicrit
si
negativus, piodiie débet z nzc , posito x ziz oo.
Hinc plurima egregia consectaria deduci possunt
IX.
pro
casibus , qui bus
giationem
admittit.
aeqoatio differentialis proposita inte-
pro aeqiiatione primum assumpta,
Tta
'ponàmus n zn '2 , exil ad y -\- y y dxz^idx,
ubi est c ziz a,
si
unde
dxm-^^T"» cuius intégrale est:
colligitur
X H- et zr
et ad
?
a / ^^t^ ,
numéros asccndendo Ac " zz: ~-,' unde vicissini
1
1
y—
—y
X
2
Ae" — 1
^
Ae«-|-i
qui valor complectetur
X
(Ae''
,
—
erit:
i)
hincque z^ixyzzz x
,
Ac*+i
summam Iiuins tïactionis continuae
:
i6
XX
SVi-\-XX
7a-f-xa!
9 c-H etc.
quac
praebeat z m: a ,
cnni
constanlis
X.
'
sumpto
x =:: o ,
A rite detcnninari potcsC.
Cum igitur, oh z zn x/, invenciimus
— A ^— X
A
+
(
2-
e "
e
auteni casu
'
1
'^
tota
A :i=
—
l.
Cum igitur sit
—X
mX
— e"
infinité
2 X
e*
parue
obrcm hoc casu habebimus
z
—X
—
etiam
:
,
'
—
s
sumpto X quasi
nisi
SX
IX
1
z r=r n.
o, fiat
quod fieri nequit, nisi su-
2X
zzzi
m
haec formula evanescit ,
eius denominator simul euancscat ,
matur
:
i)
constans A ita determinari debcr ^ ut, posito x
Hoc
inde valor
fiet
1
X
c " zrz
i
—-
-
,
quam
:
rr
n
+ X,
a
ideoque facto x z= o,
fiet
z rz: a,
prorsus uti requiritur.
Quocirca nostrae fractionis continuae hic proposilae valor erit:
—
17
ax
(1+e O
X
3X
e"^
—
1
etiam hoc modo repraesentari potest
qui
—X
X
zzzzx
—X f
e *
ciiiiis
fractionis
numerator , facta evolutione ,
fit
==('+iH + à?^ + ?fe!'+"4
Denominator vero
ax
/.
a
l^
\
T
.
erit
;
^^ 6o a a
'
I
"^ Ï^O
a+ ^^ TÔ40 a^ ^^ ^''V >
jnde nanciscimur
_
z
_ + 24a4 H- 720a
—
2 ta
î (i H- i aâ
XI.
-.^
+
îiô â4
duodsi ergo suinamus a
Taetionem continiiam
«*
-f- etc.
;r.i;6
7:174
'
+ jô^ +
S6
:::;::
i ,
etc.)
ut habeamus hasoc
:
e~*
'~~
'
3-t-xx
5+5CX__
7
adem
fractio
continua quoque
ita
+
ffc.
expiiniitur :
1 -\- l X X -\- ^- X* -]^
x^ ~\- etc.
^l^
i-H- i X X -H ï?ô X* -f- J- x^
+
|iiae ambae séries eo magis convergLint, quo
'
etc.
minor valor ipsîx
tribuatur. Scilicet si ponatur xn: 1 , huius fractionis contiauae:
M(moirciii(VA(ad. T. H.
3
—
r
it
+ +
^
3
x
•J-
valor erit
'.~^'—
:
XII. VeiTim etiam
ipsa
ter convertit. Si enim indices
et
moie
solito
ha^c fiactio continua vehemerti. 3. 5. 7. etc.
œdinedisponamuSy
fractiones subsciibanuis, eae continuo pro-
pius ad vernm valorem huius formae proceduntj haec autem
«vit
huius o{,erationis species
1.
3.
5.
7.
9.
1
I
.
4
•
lïi
I ^
3
'
21 •
16 >
•
ô >
autem pateat
Q.UO
,
:
11.
m
etc.
•
i38g •
y
làii
f.fr
^^^'
>
quam vehementer hae aeqiialitates ad>
veritatem conversant, considèrent nr differentiae inter termi-
nos contiguos, qiiae
atque
ita
erunt alteinatim positivae et ncgativae,
ordine procedunt r
.
'
I
.
3
*
1
.
I
'
3.16'
—
1
,
16.115^
»
—
.
»•
I
Il j
'
.
loji
y
loyi
1
.
16;6
Nunc igitur certo scimns erroiem postremae nostrae fraetioDis
'-^
certe
10 ji
minorem esse,'
quam
i
Minus ergo discrepat a valore vero
XIII.
Ilic
^uantus futurus
2
inzi
a
autem quaestio
sit
+
——
1
-'^
magni
^^ n:
—
05- 1.1 1676
'
t
.
momenti
se
offert,,
valor fractionis continuae pro z inventae
XX
30-t-xx_
S. a.-]- et à;.
..
13471476
:.
*9
si
loco
XX scnbamus
—
autein habcbimus ;
tv
tt,
—
ita
t
ut
sit
— tv —
x:=:t/
—
i.
Tum
I
•*
('
unde ergo imaginaria extmdere
oportet,
Ciim autein
sit:
20
Tibi
reqniritnr
igiiin*
nt
vel zn —
vel j3 rr -f- 1 ,
g
i
sit
a zzz a
et
Çgin 1
,
idroqne
Sicque gemimim habcmiis valorem
.
proj, quorum alter est/ rr ^ -|- ^, alter vero/ ci: *
XV. Haec autem intcgralia tantum
— ^.
sunt particularia ;
pro nostro scopo auteni intégrale completum nosse oportet,
nt scilicct constans aibitraria ad statuni quacslionis accoin-
modari
ponamus
ticulares, eos
reuera
<luia hic vero binos habemus valores par-
possit.
sit
+ ppclx =
ad}?
— ^x ^^
ipsa aequaLione
hae duae acqualitates
'?'
^"^^
"^
etadq H- qqdy: =^ -J,
^'
harum utraque subtrahatur ab
et orierîtur
pet j
:=:
^-\--J^
integranda^
:
c {dy —dp) 4- dx (// — pp) — o et
— qq) =z o
pcr j — p, haec vero per/ — q
—
a {dy
jqTiaruin illa
df/)
4- dx (//
,
divisa^ praebet
bas aeqiiationes r
^ dr (7-4-0 =
a^'j^ + dx(/ + = o,
^(Al:^
et
^)
dltiarum
haec, ab illa subtracta^ lelinquit
- a ^f^' +
« f-J^J"^
do: (p
:
- -o
7)
;
xruius esgo intégrale est ;
al (y
— p) — al (y —
Quia igiiur est p
luibebimus
:
aZ
y
— r= ^,
r/
—
—
^ =: C
i
q)
erit
:
— =:
— = — ^, sicque
-hfdx (p
fd x (p
J,. unde pono
-)-
^)
const..
q)
colligitui
—
21
3
XVI. Ponamus hic
colligitiir
:
/
?tz^^'' ^
zn
f^rr
brevitatis gratia
pro
et
p
et
restitutis
,
Hincque porro erit:
valoribiis, habebitur/nz '-^°^^Jri~p-— •
i-l-Aco
ax)£kto
'-f-ajc(t
r/
nnde
cj ^
,
Oiiia veio est c zi; a et
pio z inventa
/i
zz
—
2.,
nostia continua
fractio
erit r
— 3a-hx—^
XVIT.
Q'iia
mine
in
=
hac expressione, sumpto x
oo^
f t z :zz n ; conslans illa arbitiaria A convenientcr débet deternitnaii , qiiam ob rem , posito x zn co, fieri débet ^l^^"^^. izi o,.
=
i,
Quia veio hinc
A
iiicit'item est w zz: e"^, qui valor, sumpto x nr oo, enn(îit
quo obseiuato
nondum
scilicet
unum mcmbrum
aequari débet
'"^'^'^
débet
I
—
sicque
*
A =1
cuius
acjj
erit
—
m
jt^^'^. ,
delerminattir , hacc investigatio accuratius institut
débet; sumpto
per
débet o
fieii
haec
x praemagno, ex fraclione continua,
continuata,
fit
a
expressio
-f-
z nr n
— —^,
iy,_'^^j-^»
cui ergo
ideoque esse
zn^",
A aj:= -"^"^
-),.
— ax zz: A (i -4- ax"
o
ax' unde colligitur
I-
—
A.zz (i ''^ax)rT"
—^
i_i-}-ax)
,
•
Posito hic
\
'
x ziz ck> prodit
-»
3
1, ideoqtie
erit
z nz a -+--7-v^> existante w zr e"**
expiessionis valor etiam
per
séries
communes
satis;
*
'22
s
Cum enim sit w=e«*, fractio
commode exprimi poterit.
74}^ hac forma expiimi poterit
tor in hanc seriem evolvitiir
denominator vero
-^^^
:
cujus numera-
- 2 (/^+ ^;j~^7^aJTs-+- etc.),
erit :
Tum manifestum est, fore
:
(— H- r-î-^ -4z zzi a
^ (
H-
— +
^î-?
fractionibiis
in
etc.)
.TaV^ "+ {^l'x6
-+-
77^;;^
cum
Praeterea
XVIII.
;-,
+
Ponatur enim zzzan- *^
licet.
etc.)
primam sequen-
tibus partes absolutae sint negativae, eas facile
vas transmutare
/
in
positi-
—
hn, utsit:
— 5M-i-x7 a
H- etc.
sa-h*
5 a -i-*~~7 «
duare cum
habebimus
sit
%:=: a
*fe.
— ^^ loco —
,
:
3e
+
-
3 «+•«"
—
5a-f-ae
v substitut© valorc
23
XIX.
Consideifmus nunc itcrum fractionem continuara
generalem, pio % inventam, q^uae erat :
^
*i _
^ "+" c-+-^'-^x\
-
c-f-ana-j-x"'
e -j- 3 n a
-h x'*
c-f-4ri,<i-f- ff<r.
ubi valores ipsius z ex hac aeqnatione diiïeientiali :
a X dz
—
d^terminantur.
Jam
c z d X
z z d x
-{-
in fractione
zn x^cZr,
contmua omnes partes abso-
kitae, quae sunt c, c-f-na, c-f-2/2a, CH-3/za etc. progressionem
arithmeticam constituunt seciindiim dilferentiam
na crescen-
tcm, at vcro niimeratores omnes sunt inter se aequales, scilicct x".
Hïnc ergo vicissim
:
quoties talis fraciio continua
©ccunitj eius valor per aeqnationem diffeientialem ad gé-
mis Riccatianum pertinentem determinari poteiit,
quod
id
m sequente problemate accuratius pioseqiiamur.
Pr
XX.
b l c
m a.
Proposita in génère hac fractione continua
ï z= ?n -f-
A
::
24
s o 1 u t i o
Si
haec
forma
evidens
est ,
cam
et c rr
modo
CLim
.
ante
hanc converti,
in
comparetur,
allata
si
statnamus a:=: l
m tum vero potestati x" tribui débet valor A
quidem nonnisi integratione peracta
rem valor
quaesitiis pro z
X dz
fieii
— mzd X +
Q.aam ob
licet.
ex hac acquatione
quod
,
diiTerentiali
:
z z tZ x zz x" d x,
derivari débet.
XXI.
Ut nunc hanc aeqnationem ad consuetam for-
mam Riccatianae redueamus, statuamus z zz: x^v ut scilicet
hoc modo
ad
aeqtiatio
x'^'^' dv -\-
quae , per x'""^'
très
terminos redacatur
:
vvx^'^dx zn x"dx,
divisa, abit in hanc:
dx
dx z=. X
dv -j- vvx
y
quam formam ut penitus ad Riccatianam reducamus, ponamus
I
1
x'"
—
et
x'*~'"~'i=:t
fict
t, utfiatx'"~'rfxzr:^'et x
n
m
— —
cZi^^-^-—
quae
est ipsa
""
—m
= t% ideoque dx—^f'^'dt
I
,
quibus substitutis aequatio
t^^'^df,
sive
mdv -{-vvdt
nostra
— C'^^'dt,
aequatio Riccato débita.
XXH. Perpcndamus nunc ante omnia casus,
haec aequatio resolutionem admittit ,
qiiibus
qui sunt quando in
termino ad dextram posito exponcns ^^-^~^,
in
bac forma
25
7""^^'
'continetnr
grum ,
denotente
r/_Pi »
mimerivm quemcunqne inte-
sive ncgativum.
sive posiliviim ,
^— rn —
i
Ponamiis igitur
^^ utrinque binariuni addendo hubebimus
^rz—^, unde siimi -poterit mrzzQÏH-l et /izz:2. Hinc
quoties fuciit m numems impar quipatet sumto n zn 2
,
cunque, sive positivus, sive negativus,
continuae
fucrit
Z
quod
posse ,
actu
assignari
H
-r— ,-:
valorem fiactionis
ergo
contingit
:
m2
i
-f- 1
Ubi qiiidcm notandum
XXIII.
Qiiolies
absoluta
est
integratione
de-
fterî
xx =z A, estistente x'^zz t zz x"~^'.
beie x" zn A, hoc est
aiitcm
bis conditionibus continclur,
fraclio
continua proposita non
tiini
etiam par methodos ad-
hnc cognitas fmito modo netitiqiiam expnmi poterit,
contrnli
esse
dtbemus
valorem
cjns
catianam perduxisse, qtiippe
niias
si
salis
ciijiis
sed
ad aeqciationem Ric-
resolutio per séries infi-
commode exhiber! potcst, id quod unico exem-
plo dcclarabimus.
EXemp1um
XXIV.
Proposita nobis
'
a
sit
I.
haec fractio continua
H- A
4 +- "c-
AKmoirci de l'Acad.
T.FL
4
:
q6
Hic ergo
eiit
m rr
hac aoqiiatione
X d. z
« rr r, alqne
et
i
qu.ieii
differentiali
—
z-
d X 4-
7. z-
fiat
ita
fi
x
,
instilai
debeic,
ut
x ^n o
posilo
z zr !..
Ponalnr nnnc
z :zr x 2; ,
S,v -\- V V dx zi^'^^ ,
ponamns
valtir,
fit
mx
ex
:
loco x scribi of)oitcbit A^ nnde
hacqiie acqtiarione lesolnta
patet integratiGnem
t^r
oporlet
%
ipsius
viilor
quae
et
î;r^^^"^ ,
xdc/w — i/dx^
ut
ut
comnrode
in
sumto elemento
= o, qude jam
poterit prr potestates naturales
facile
ipsius
tuatur ergo u i:^ ax^-|- 6x^"*"' -f- ex
critque
Iinec
oiiiitur
in
aequatio
scricni
resol-
dx constante
sciiem lesolvi
x ascendentem.
"^'
:
Sta-
-f- c/x''^^ 4- etc.
:
^' — aX(X-i)x^~V6rX-+-i)Xx^~"-f-c(X-f-2)(XH-l)x^
H-d(X-+-3} (X+ 2)x^"*"" -f- etc.
quae
séries
aeqiiaii
débet
ipsi
j,
hoc
est
flx^— -Y bx' 4- cx^-^' H- dx'-^^
+ cx'-^^ -f
Unde patet prions seriei terminum aX(X
rcdigi debere, id
vel X HZ o vcl
XXV.
quod duplici modo
:
—
fieii
1)
etc.
ad nihilum
débet, suinendo
\zzL. l,
Stimatur ergo
coaequandac eiuut:
primo X zr: o et
séries
nostrae
4
5
^
27
•eiit
I.
2c -{- 6 dx -i- 12CX' -{- 2 o/x' -f- etc.
II.
ax'~' -\- h -f- ex -}- dxx -{- cx^ -\~etc. ^
-igitiir
et
:
_6_
.
J
^
^
I
.
,
b
_£_
2
.
.
î
1
.
3
.
2
.
*
Q
d
qiiamobiem nostra
séries
XX H
uzzx-i- —
1.2
'-.
'
.
'
3
1
.
1.2.2.3.3.4.4.$'
4.5
4-5
-^
pio n snmto
— x^ H
2-
.
Simili
d.lu
pro
lies
j
'
XXVI.
/
'
1.2.3.3.3.4^
J .4
3.4
I
.
.
-^
1
'
4
modo evolvMrrms
erit :
6 cz: 1
— X* H
2-V--3-
.
a-'
.
— —j— + etc.
3
.
3"'
3:^
4''
.
'
.
î
casnni X :zz 1, ac se-
.
inventa eut:
^^,
l.25^2.3cx-4-3.4dx2^-4.5cx^-^ 5. 6/x"* -+- etc.
€iu aequalis esse débet :
^ rz: a -4- b X H- c X X -{- (i x' -f- e X* -f fx^ -f- etc.
•
tindc
fit
:
az:z 2h
h
6rz-^n;
•
•.
a
C
T
Hinc crgo
SLiinto
a ziz 1
—
1.22.3
u Tz. X -f- 1.2 XX H
quac
cil
nunc
1
'j;
^^
.2-. 3
1
3
d
a
I.Q-.3-.42.J
.
pro u habcbinnis hanc sériera:
~ H
=r^,— X* H
x^
1.2-. 32.
^-5-^^ ^^ +- etc.
I. 2-. 32. 4-.
m praecedente prorsus congruit,.
XXVII.
«rit
,
.
4.>
_
1.2-.3-.4'
3.4
a^
c
Invente
jam
valore
litterae
u,
ob
^'
rz:
:
-f-
ï— H
x H- --% H
-4- etc.
r^V-.
^
—
'
i.a
- -f1^
1 .2*. 3
.
'
—
1
-^
-^
.2- .3- .4
3
-^^—
r etc.
h 1.2-.3-.4-.Î
4*
"
'
'
.
^^
28^
Quocirca ipse valor fiacrionis continiiae propositae
erit
:
H- etc.
X
,
XX
,
H
commode evenit,
1
ubi
obiem,
JCÎ
y-
.
-
-f-
A H- -^^,
1.
H
1.2 -h- 1.2^.3
—
'
-f-.
2
vcius
i
Ikil
valor
-f -, H
'
.
zizzi.
dnam-
fractionis
conti-
2
1.2^.
3". 4-
1
a
'
r-
2—
-f- etc..
1.2^.3^.4^.5
a r i (1 m.
Ami,
Sumamus
.^V- 4- etc.
2—
-,
'
Coro1
XXVTIT..
xzzio
^ etc.
,
-
a
1
eiit :
i
'
-2
ut siimto
fdciamus xr:^ A,,
si
nuae pioposiiae
fiactio
2
,
x4
..
.
ita
pioponatur haec
ut
continua :•
a
:zz
1
-f-
-,
3
•+ »_
4.-f-_L
5 -4- ^fe.
atque valor ipsius z etiam: sequenii modo exprimetur
2
^
^
cuiiis
-^ rîi
„2
>2
I
3l:£
+ — ^- -^ r-2^-^T^
-^-
I
«2
.1
,2
etc»
''^^•'
r72^.3'-4-.. -*-
valor in fractionibus decimalibus satis
primi poterit.
,2
:
Reperitur autem niimerator
:=:
commode cx-
2,278584 et
drnominator ^^ i, 590635, unde porro colligitur valor ipsius z =1
1,432490;.
XXI.K.
Potcst vero etiam iste valor ex ipsa
continua; deduci..
fractionc
Cum enioi- omnes numeratoifis sint nz 1,,
29
partes absolutae
soliLo
fidGtioncs
3.
4.
I
•
3
iO
.
Ô >
I
»
i;
7
*
I
2.
fraciionrs
uliciiLis
siibsciibjntur ,
.
1.
qime
tanquam indices ordine sciibantur,
'
eo
more
ut sequitur :
5.
6.
43 •
iO '
22i
propius
et
7
etc
•
iW *
1Î_9J
972
ad vciitatem; accèdent ,. quo-
continueniur..
^' »»0OO0»30MM><
,
30
DE INTEGRALIBUS QUIBUSDAM
INVENTU Dl FFICILLIM IS,
AUCTORE
L.
E U L E R O.
Conventui
Obtiilerat
1.
5.
—
intesralis
cxJiibuit die
J^
f
^
se
mihi
eum
,
jiim
fuere ,
iriiti
alqiie
infinilas
incidi,
cebat.
Primo
enim evolvi
s z^
semper
— fdxlx
forma m
eiusmodi séries
teiminis hoc
j
nullo
modo
- ^ -^
Haec autcm
erit
ï
séries
modo pateat.
/
J,
— x^^x /x m
4_
ita
li-
seriem
:
+
'^^-l
x^ H- etc.)
sit :
integratis
.
modo
in
/- x^'Bxlx =:^'^- Ix -^rZ' =- T^- l^
Sumcndo x :^ i
pcr
istum valoiem
radicalem
(i -h ix* -f- ^^r«
pro qua integranda eu m
in
pai tim
assignare nulle
ut habercm hanc formula m
solito,
formula
luicc
Snspicabar enim, non sine
Verum omnes conaLus
quarum summam
more
dudiim
partim per qiiadratiirani ciiculi ,
logarithmos exprimi:
investigandi
17M0.
Maii
cujas valorem, ab x zno ad x ^i i
extensum, cognoscere optabanp.
ratione ,
i
•
est
.—^^tj ,
reperitur
3. -i 4_ liJ
-+-
et
r?'%siiigulis
:
î
comparata ,
i, _(_ etc.
ut
cjus
summatio
,
31
Conatus
2.
J.
igit[ir
^c^d
[)lmibiis
siiccossit ,
donec
tcindfin
ipsius /x
in
scncrn
poteiat.
Scilicet
—
(i
— XX).
— Ixx =1
h
expfdîii
IX scupsi
I
'^
orancs
in
soricm re-
tolutn
qiia
eum
sit
Ilinc
institutis
negotitim
/x:=r^,/xx,
pailes
facile
fcliciter
hic loco-
— -f- etc.
-H
:
- 6-- + etc.)
quadratuiam
ad
non
enim sratim piodibat:
-f-
.— -+- —4-
C
rcs
idoneam lesolutionem
in
pioposita in ha^nc transformabatur
sicque formula
eu jus
tentaminibLis
niiper
incidi ,
Zx
perduccrent dd formulas in-
solvtrr, eiijus sinj^uli termioi
tegicihiles,
fiictorem
eicim
Giicuii
redu'-
Ciintur.
3.
§.
Q}\o hoc fàcilîus praestari
hanc reductionem
possit constituamus
:
px(i — a:!)'* — Ax(i — xx)"4-B/ax(i — XX)--',
unde dillerentiando
txir
undc
fieii
hi^itur
A
habebitur
dx
— xx)"~' dividende
— xxrzAfr — xx) — ouAx^ + B,
et per
haec aoquatio-: i
ori-
(l
débet A -f- B m: i et A-\-inA:z:zi. Hinc col-
m --^
ista
et
B zzz ^^
leductio generali?
,
quociica, sumLo x z=: ij.
:
/ax(i ~xx)''-=:^^^_;-./ax(i-xx)''-',
et loco
n scribendo X
-f-
? eiit :
/ax(i_rx/-' = l?;;^ipr(i-xx-)
32
X'
Cnm niinc, integrationcs scmper ab x r= o ad
4-
§.
extendendo,
==: i
*edactionem
/"—rr.*i=r tr: - ,
sit
repeiietui per islam
;
/dx(i-xx)'-l.i.^;
/ax(i~-xx)^
= |.|
—
ï
px(i-xx)':r:|.i.|.i.^,
etc.
His
valoiibus oïdine introductis nanciscemur sequcn-
igitiir
tem seriem
quae
séries
:
niiiho simplicior est ea qiiam snpra
attnlimus;
intérim tamcn insignem alTinitatem tenet, aique adeo isLae
dude
séries
§.
inter se
Ut summam
5.
aeqiîales.
siint
hujiis
deremus hanc generaliorem
v — — -{--^
a.i
'
2.4.4
t*
-L:?il- t^
H- j.4.6.6
nuinifcsto est
v=zf^l{y^_,,^
t z::::- l't
''^
—
^'^"^
1) ,
^''^^
qno
consi-
y(
+
etc.
'
:
= T-+-H'' + H;::t' +
cujus valor
investigemus ,
:
unde ditTerentiando adipiscimur
;
sériel
etc.
— —
'_-=;
iiucgrali
1).
Hinc ergo
invenio
suiunia quacsila s -zl ^ v.
fiet
poni debebit
,
33
V
ftin/i,
-
1
Hic primo irrationalitatem
6.
§;
cxtendi
gr.itioncm
u jr: i,
11
- n:
du
i
— uu.
oportebit
a
termino
r
^uii»
<^-^'
r
J
'
ciijus
tzizV
sit
trr i, hoc
iisqne ad
dt
-
ut
1
intégrale praebet
ideoque
u
s ziz ^,1: 1 1
:,
hoc
est
Tum autem eiit
igitur
:
r
y
/
v z=z C
Nnnc
t z:z o ,
•
q"^~ CQnhcitur
uu v
ponendo
Niinc autem inte-
uzrzO.
est
^^^ r'"~~"^
~~~
—
C esse débet Ici.
abigaraiis ,
dit
I
-f- u
'
— /(i-f-u), ubi constans
facto i/rro
prodit vzilI'Z
qui ergo est valor forniiilac initie pro-
positae, tantopere desideratas.
Praeterea vero etiam séries
aoteiaven-tas nunc summare lieet, scilicçt séries ex J. 1 , qu«jte erat
tum vero
—
--'-
--^7^
^
2.2 -f- 2-4-4 -h 2.4.6.6 H- etc.
'
quae
summationes
simt.
Hinc subjungimus seqnens
per
se
—
satis
l<>,'
abs,trusa;e
videri
pos-
T h e or e m a.
Proposita formula integraJi
f^^Al ejus valor, a termino
xzz-O usquc ad x zn i
§
".
pliciore:
trucidri
Si
ha ne
formulaiji.
cxtcnsus, est zrz.îrrls.
comparemus
ciim
ista
sini-
f~_^'^, minim nlique erit, hanc non simili modo
c[iin tamen aliund^ constat, ejus valorefla,
posse ,
Miinûrti de i Acad.
Ti'l,
^
3^4
m
ab X z=z o ad X
extensum, esse '=^'^^
_J— rc 4- X 44+
/_%- ax/r[:*,^=.] =: .^,
X' -f- x'
1
inde oiictur hacc séries
- +
/7f:i-'
1
inen valorem ex
elicere
mnlto
et
-f-
^
-4- /s
4- ,^ 4- etc.
inveni
esse
=
"^Z j
qnem tamodo
formula intcgrali nullo adluic
isla
proportio satis nie-
:
C zlliLL*
§.
î
Hinc ergo scquitur
potui.
morabiiis
ipsa
eic.
:
olim piimus
cujus siimmam
a;*
Cnm enim sit:
-
8.
:
/ -=_^Af
His vestigii5
latins
in
TT
:
insistent! ,
patentem mihi
quam operationem
—
simili
3 Z 2.
formulam
modo
tractare
licuit,.
seqnente problemate explicabo :
Pr
h 1 e m a.
—X
ôx Ix
/ 1
X )
(
valorem, al
integralem
x :^ o ad x rr i extensum, per exprès^
sionem finit am, tantum arcuhus circularibus
et
loga-
rithmis constantem, exhibere.
S o 1 u t i o.
§.
g.
antc omnia observasse juvabit ha ne formn-
ITic
/X — ÔX
m
I
-X
ab irralioualitate prorsus libéra ri pos-
—
,
35
X
ponendo
se,
hanc
abit in
«oqr.e
/—^; tum autem
:
x''=z-^^>
cnim
Ilinc
zz: t.
x^zizt'^Çi
eiit
—
l
substitLitionem prodeat y
id-
xm,
a tzz.o usque ad
t z^i 00
autem
demonstravi ,
^sse
—
istius
est
fit
per hanc
ut
ita
-— -^, nbi, quia,
ctiam ti^o, at posito
samto x :n o,
tzzzoo, hoc intégrale
Jam dudLim
extendendtim,
foimulae
valorem
hoc
casu
—
TTl-TT
sin.
Hinc ergo sequitur , etiam formulae
/X — Ô X
m
I
valorem esse
10.
—
;
integralis :
^
/(l— X)
§.
x")
(l -\~ t")
iinde dilTcrentiando prodit ^^ :r3 ,-77:^7^ ,
Il
—
sive in logarithmis-.
nlx z:: nlt
fit
faimula
ista
,
ab X :=z O
ad
X
m
extensae
1
-^, cnjus loco, brevitatis gratia^ scribamus A."
IIoc praenotato in ipsa formula proposita loco
Ix scribamus -^Ix'',
hujusque loco porro— /(i
sicque, facta cvolutionc habebimus
—
(1
— x")),
:
-Zxrii— *- + ^i^^^ + ^-i^^"l^ + etc.,
qua
série
formam
substituta^ formula nostra integralis induet
:
5*
hanc
.
B6
ad
niembra
singula
cujus
ante
valoreiii
introdLiciuin
TT
Ilunc cnmi in
levocaie licebit.
tmr
fineni
constitLva-
VI sin, --
mus liane
rcdiictionem generaliem
:
/x"- ôx (i — x")^ — A/tc"-' dx (1 ~ x")^-*
'
— xY,
.j_Bx"(i
factaque differentiatione ac divisione per
X
d X (i
—X
-,
)
prodit haec aeqiiatio :
1
imdc
— —A
x''
-+-
Bm (i — x") — XnBx\
A et B ita dcfiniiintur
literae
:
^ et B := — T-^—
zn
Quamobicm, quia omnia haec integialia ab xino ad xzni
sunt cxtenden da, habebimus banc r(?ductionem generalem :
—
Xn
ax(i— x)n\X —
dx(i— x)i\X -:;.^.p^Jx
m — i-\
r^
'/<t
5.
IIujus reductionis
11.
vàmus ,
'ac
ATI ::zz n
—m
pio
,
prima
parte
sfecifnda
i->.
/
i
.
ope singuLis partes evolerit
X :iz: 1
idc:t)que
uinde colligilur :
/x"- ''d-'x (1 — x")
'^Pro
vi
;
/
f/)«ft<;
erit
I
—"^
Xr-jr
hincque coUigilur pars sccunda
^ =z
^^ A.
—
sivc
;
'^-,
Xn^z'2 n -^'%,
.
3"7
— xV ~-—'^'^.
A.
3n —
pute, ob X
3 — ^
m
3
— - —r^—
«X — ^
A
/x"-' dx (i
Pio
tcitia
X
ilr~_5
et Xii ziz
:zz
( 1
TÈoclemque modo
/•x'-'axri
'^^31
)
erit pSrs
— xT
-
.
?»i,
ciit :
^
.
.
.
qtiarta :
—
!ir--.--j:i.i!L-::!'.4:L-i2:^.^
et ita porro.
His igitnr singulis paitibns colligendis pro valore quaesito
S hanc habebimiis expressionem
— 'm) Çî'it —^fe )
Çi— 'w)C.'Tt — w)
Çti
:
S rz: A C——
ciijus
Ç.
C'^ ^-^'^rt')
y
.
I
eigo seiiei suinmam 'investigafi oportèt.
12.
Hune in fmém. consideiemus istam sériem ^ge-
neraliorem ;
n.a
~^
^
71.2.1. in,
^
^
Ti.aa
eiitque dilTeientiatione instituta et per
^^T
'^dt
n
— m.Tt
,
(h
—
ot )(-.7i
—
171)^271
( 71
71.271
71
cujus
seiiei
surrinia
unde
ergo
dcducitiir
'7t.
manifèsto
est
^ T z= ^
(i
((i
multiplicando:
(
—ttj) (; 7|
— m) (371 — 771)^371
271.
—
—
v.v.-<-»,
3a
^Tiod inte^gral^
^a
t")
1^
'^
^—T)
ieimino 't 3r-o 'iisque ad
—
—
—
~
'^
f'')
(n
conseqnchtér "habtbiMis Tz=:/^^((i
H" ^^C.
'^
sTi.'sli
'"^
t
l),
771)
zz i
'i),
c'xte-rf^
débet, quo facto erit noster valor qiiaesittis S si:^ T.
—
38
Niinc
i3.
§.
dcducta
ad
sir
igitiir
novani
jam tantnm sumns lucrati, ut res
formulam
qiiidcm
nnllos logarithmes involventcm.
integralem
sed
Ilanc vcro fornuilara ad-
€0 ad rationalitatem perdLicere licebit statnendo i—f':=zii^,
— i= — TZ-ûi^
tuin
enim
quod
intégrale,
tendi
debcbat ^ nunc cxtendi
u
o.
rz:
fict
eu m
a
atquc
'
t z=. o
temiino
débet
nsque ad
t rz: i
ex-
m
usque
ad
ab
»
Permutatis igitur teiniiHis integralionis
J
u^
1
quod intégrale jam
'•aduz:zz i-'
nanciscemar
liinc
i
fiet :
'
certe per logarithmos et arcus circula-
res exprimera licet, sicque
problemati proposito plane est
satisfactum.
§.
Hujus formulae pars postcrior integrationem
14.
sponte admittit ,
cum
sit
j^—^zr^ ^^
valor jam evancscit facto u zn o ,
prodit
inino
qiie
taie
infinitus ;
membrum
pars
^
{^
—O
j
^^''•
at vero pro altero ter-
prior integrata continct quo-
— t^(' —
dente conjunctum dat — Z—"--.
ambo
hacc
riiembra
junciim
omnes
aiitein
reliquae
integralis
niagnitudinem;
'~
'0 »
Q^-'od
cum
praece-
Cum ic;itur sit ^-^^— nr
sumta
partes
piaebebunt
habcbunt
^-1
;i,
n y
finitam
39
Quanquam
i5.
^.
tvadita,
inLci^ialia
fornuilarum invenicncii,
taliuin
utile
fore arbitior totani
crpiis
repcterc;
quam
ergo
solct,
hie acijungam.
pammper
inxestigiKionem ,
Pr
Proposita formula
in--
disciepante traciare
succincLius qaani vulgo
b l e
fieri
m a.
T zn f
hac:
inte^rall
valorem, a tcrmiiio
ejiis
haud
siuVc
integrationem ex primis prin-
Irane
inodo
atqcie
jam passim pi-aecepta
autcin
'^'^~
^~
-n~ d u,
uzn o usque ad uzzz i ex-
tensum, investigare.
S o 1 u t i o
§.
esse
a
Modo notavimus
i6.
~l {^
— O»
ejiisque
,
tradere
V —j .jur^r»
ita
partis posterioîis intégrale
valorem intmitam, casa u:zzi,
parte priore iternm dcstrui ,
integrationem
:
unde
hanc
suflkiet ;
d U :=:
—
nator nianifesto liabeat factorem
i
ut;
sit
solius
ob
iibi
^-^p;- ,
—
partis
prioris
rem statuamus
ciim denomi-
inde nascitur talis
u,
scilicet uiizi.
ubi erit A .—
^_^
^^^^ ^ , posito
Modo autem vidimas, fràctionis -~~", va-
lorcm esse
ita
fractio
partidlis
{-
,
pars integralis
liore
lem
l II.
ut
sit
A =: ^
,
hiiicqtie
orietur
prima
{f;z^ ^^ ~ { H^ — ") ^l^^e cum poste-
parte ipslLis
-'-
-
,
:
T conjuncta producit, ut vidimus, valo-
—
,
4o
Pro,
§.
17.
Tîiendi?
sit
1
lpt;is
—
u",
i
rcliqiiis
—Qu
cos.
quqm
$
Imjiis
p.iriibiis
qo 111 para tu m-
—
1
cluiin
,
denoniinator evaf.
detetminare liccbit.
ô
Hinc autcin scquiiur tore in gcncre u ncji ""' cqs.ô;
ex qua forma
atque
bine
primani
et
est c cos. ù,
omnes potestates
altiores
ipsius u
constantes
licebit.
Evidens autem
difinirc
etiam quaevis multipla
potcstatum ,
haruni
u "%
ipsius u seriem con-
intelligitur , potpstates
rccurrentem , cujus scala relationis
stitdf re,
ut,
opnrtqt ,
esse
.
ipse.
qx qua conditionc anguluni
i^esçat ,
inve-
fdctor quiciipqLie denomina*.
-f- j///
ita,
pqsito uuz=. 2 a, cos. ô-.
inlrp;raljs
—l
par -solam
vcluti
est
A//u,
Alt', Au*, etc. se'cundiim candcm scahim relationis c cnc. ù,— 1
p^io^ic.di ,
colligi
§.
ut
ita
ex
quilpuscunquç
bipis
scqucjns
facile
queal;.
Obse^rvavi autem hanc pro,gveSsionç4n
18.
jUicissim^m ,
sujato
AirzsinJ,
boc
leinm.i
notissimum;
vpc.aroi,!,^
sin. (X H-r i) ^^:i: 2
hiacqi,ie
séries
u
sip. ô
u^s'\Q.$
Jt^
sin. ô
co^.^ sin. X^
facto
—
sin (X
sim-r
in
sub^idii^iro,
—
1) ^ ,
liaruip potestatiii^iji sequeati modo a(;\9jijpabiitur
,
=:
u^s\n.$/ziz
tfc/,5in. d
(juo
fieri
« sin.
i/,,
$ ;',
sin. 2 0.
—
:
s(Q,.
O,-;
—
4Ô —
zn usïn.5 — sin.4Ô;
nz « sin,, 3 ^
sin. 2.Ù ;
z=z
siiji;.,3^;
u,si:ip.,
etc.
:
'
,
41
atque hinc
u
Cum nunc sit
—
sin. (X
hinc
—
z= u sin. A ^
sin. $
ig.
§.
gcnere conckidimns fore:
in
^
sin. (X
—
i) 5.
:
i) ^ z=: sin. X ^ cos. Ù
—
cos. X ^ sin. è ^
fiet :
—
u^s'm.ù zn î/sin.X5
sin. X^ cos. ^ -}- cos. XOsin.^ ,
conseqcienler :
U
~\
Zi:
V- COS.
,
usum
formula ad sequentem
qiiae
X
optîrae est accomodata.
Nunc ad ipsùm angulum 5 quaerendum siimainus Xzii/ij dit
U rz
unde
—'
'^
:
h COS. n 9,
colligitnr denominator :
n
1
?(i
j/ii
—
n9)
co!
Il
— —
—
.
(u
coc. i) ii n.
n 6
«
qui ciini debeatnihilo aequari, praebet has duas aequalitates
sin,
:
/z^jno
iibi
/
est nunierus
COS.
)i
^
fore n ^ n: i tt,
unde patet
et cos, jzôzni,
inieger sive par^ sive impar, quia vero
débet esse m: i , levidcns
3
est
pro
i
snmi
debere
>
numéros pares,
o,
quorum
valorum
i!I,
n-'
ut valores pro angulo ^ assumcndi sint:
i^,
n
primus o
quem jam
§.
ita
'
^,
7i'
dat
«",
n',etc.
denominatoris
factorem
(i
— u)
,
supra cxpedivimus.
20.
Denotet nunc
eritquc
M''mf)hri derAca^.
ô
haec formula
T. FI.
quemcunquc alium istorum
i
—
2 ;/ cos.
ô-\^uu
O
certc
42
—
fjctor nostri dcnominaloris i
u",
^^^ re«
fiactio
atqiie
soluta certe continebit partem hujus formae
:
._^„^,^(,^^„ ,
cujus numerator N reperieliir, uîi alibi dcmonstravi, ex hac*^
Nn "'"~'^',~_1X -"^--^ positoscil.uu-2ucosJ-i-i =0,
forma:
tam numerator quam denominator evanes-
casu
qno
eigo
cet ;
unde ad valorem
endum ,
y^J^-^ ,
—
COS. 6)
n
Supra autem invenimus
_ (u-co.
"
X
I
/
n
V.
qnod, ob
—
m
u''
denominatoris
1 , fit
"i^;-^) ^
:
A
.
"»-+- i\
<
:
Qs/n.XO
_^ ^^g^ j^ ^
'
sin. i
quamobrem
'^^ J^''- inveni-
et
N erit
sicque numerator quaesitus
u^fu
fractionis
numeratoris
loco
dilTerentialia
substituta dabunt
'~
hiijiis
erit :
__
^.cosJcOS.m^
m
_ + __ ("— •^;-^"± - (m -h
u
COS.
^^.
(u.-cos.9)co,.9sinml,
^
y
s;n. a
,l3i
.
COS.
^'
1)
hinc
j^,__
^C.-c..0(..M>wn_m9-nn.(m4-00^
^
_^ COS.^ COS. WzO
- COS. (W-^ )$,
J
sive
N zz: - r— (iijZL££Lili!^?£f:^* -f. sin. m $ sin. ^)
N 1= -^ (sin. $ sin. m 9 — (u — cos. $) cos. m $).
f.
21.
Nostra
igitur
fractio
i'ractionem partialcm :
iin.6 iin.mê
— —
(u
tos.
é)eos.mi
^^^^
hanc
,
sive
continebit
—
.
43
qtiam ergo, per du mtiltiplicatam, integrarioportet. Qniaauteni
duabiis constat partibus,
earum postiema
-, <f itzzSÎLJlf£LJ!'±^^
*
'
nj
itt COS. S -i--uji
A
•
—
cos.d -+- uu); piior veio pars:
du sin. 9
— sin.m$ /
1
t
— 2U
^-~~ l {^
integrata dat
i
a
^
.:r— ^:^ — sin.md A tae.
•
Sicque totum intégrale hujus partis
k
— ——
a sin. 9
erit :
— — ^n- Ui-2U cos.$-huu) -h ^-^A O
an
22.
§.
1/
=r o.
quo
V
'
Superest
igitur
tantuni
facto pars logarithmica
1 / -.
_
/\\
COS. ^)
sin.mi
-n
consequenter
ture
1
—
sin.9
.
^ ^^5- rzcij:*
totiim
j
•
,
•»
a«
sin. î ô'
= ^^^^ Z2 sm.
_ »
ï 9.
_ ——
,
cos.vii
»
•
:
— —n— A
nn.wj
coj.î«
.
tag. ^^-
(tt
S) î/n.m«
ortum ex denominatoris fac-
intégrale
1 2
sin. i V --h
^
i
m &.
sin.
loco
$
successive substituan-
^, ~, -- etc. et in
valores supra assignati, qui ernnt
^, summa omnium harum formularum dat verum
valorem ipsius T, postquam
*-ln.
i,
erit :
COS.
Quod si jam in hac formula
génère
scribamus
2 u COS. $ -{- uu erit :
,
tur
ucos.t
evanescit posito
ut loco u
mi
— -—
Z4
Pars autciu circularis erit
*
tag.-^"*^
1
Il
'
Hoc intégrale manifesto jam
ni
„
__
Z(2 — 2
COS.
/
Posito
autem
in
génère
inde orta erit :
—n cos.
1
71
scilicet
2 sm.
—
71
u
'
addiderimus terminum
'-^ ,
ô :=z
^
integralis
pars
— sm.
î n II
iibi loco i scribi debent numeri i, 2, 3, 4, etc., donec intégrale
6*
44
completum, quibus omnibus cxpcditis
fiat
situs
valor quae-
crit
T inventus.
Illustremus haec aliqnot exemplis
E X e ni p
§.
Sit
2 3.
?zz=:2^
quid
et
1 11
m
i.
m minus esse débet q^iuim
»t,
7r
A :zz
ne quantitas
^^
fiat
neccssario
infmita ,
erit
n sin.-—
n
mzzzi, ideoqne
A zi: -
.
Tiim vero
tur igitur terminus lie y prodibitque
invenimus,
ante
ut
V
1
S zrz ^- l 2,
erit
Tziz'iZs. Adda-
T =z
Z 2 ;
qui
est
sicque erit,
valor formuiae
— X
*
Exemplumo,
§.
ntroque
débet
Sit
24.
vel 2. 'E.'i
m vel
prodit A rz ^^. Tum vero sumi
nnnc n rr 3, eritque
autcm
valore
l
=1 —, quem valorem solum'sumsisse snfficiet, ex quo
Tz=.
iibi
'n
—
f
COS. 2m7r/|/3 -f- ^^g Trsin.
insuper addi débet
ï Z 3.
T — .U3-\- -\-
TT,
f
m7r,
Pro casu igitur mzzii
hincque S z= ^T^^-
— dxlx- Pro
•
V i—x'
m
z::^
2,
crit
erit
+ ^J-^,
3
casu, ubi
:
ut ante A:iz.~J' . at vero
altcro»
—
- -
45
xdxlr
,./
§".
2 5.
Loco pIuiHim exomplorum formniam gêneraient
tradamus pro namero quocurlqué n, siriTTenclo Ûzzl'-—, donec
fî.it
2l^n, qiiippe quos c'asu's onincs rcjici 'ôpartet.
..7i;itur
ex
SL'ribendo
Dr,h'=>'^
formel pro casu
i, 2, 3,
etc.
—
COS.
——
C05.T
-^
-' .-^'d^
$ zz:'^^
e^oluta
et loéo î ordinc
hune valorerti:
repèrieriius
— l2Sin
Tijin
H- —
-
- /2 sjn. ^-
—
siu.-
-jzr
-i-^ -~^ sin.
,
etc.
Ha? sciTicct
fuerit
iTsqne
partr-î- c*o
f<^«, -aqie
continuari oportet , qnamdki
hoc valore
inAento habebilur
pïoblemate prima S zr A T, existente
A rr —
?î
•
pro
—
mTT
sin,
fi
-
^i
§.
26,
Dciplicis îgittir generîs termini in
sione occurnint,
quorum
priores
tantum logarithmos invol-
vunt, posteiioies. autera qnadraturain
commode usu
vcnit ,
hac exprès-
ciiculi
tt,
atque hic
ut istae postcriorcs partes omnes in
onicam formulam confrahi queant, quod, si etiam circa priores
partes
logarithmicas
praesrari posset^ id pro invente?
4«
niaximi
momentî esset habendum. Quod autem ad partes
ciiculaies attinet, carura contiactionem sequenti problemate
doctbimus.
Pr obi enta,
Omnes
ad quas in prohlemate praecC"
partes circulares ,
dente sumus perducti
sive , omisso factore
in
unam summum
communi
^
contra/iere,
hanc
,
n — 2)sin. ——i-(/i — 4)sin.*~ -+-
ser'iem :
(n - 2 ij sm. --—
summare quousque scil. ^ i non superat
So1utio
§,
27.
Ponamus
n.
:
^
bievitatis gratia
rz: Cj) atque séries
ptoposita sponte in has duas resolvitur :
nsin. 2(P H~ «sin. 4C|) -4- nsin. 6(p -+-
-+-w sin. qI<P
2 sin 2(p -h 4sin. ^(p -f^ôsin. 6(p -h
+-2isin.2i<P
tum enim
piior ,
demta posteriore , dabit valorem , queia
quaeiimus.
5.
28.
Pro priore jam statiiamiis
:
p =z sin. 2 4)-t- sin.4(p -f- sin. 6Cp -f- .^..4-sin.2 i^)
ae multiplicando per 2 sin. (p
fiét :
—
COS. 3
2 p sin. (p zzz COS. (p
—
cos. 5
— cos. 7 (p
4- COS. 3p -\- CCS. 5p-+- COS. 7 4)
— COS. (2 —
])
-I- COS. (2 i
1) (|>
-
unde
fit
p zn
/
t^t^t^
—
—
.
p — COS. (2
t -f-
1)
47
hanc
Pro altéra
29.
J.
serieni
:
q :n cos, 2
eujiis
sumnianda consideremus primo
série
^- cos.
40"^ ®os. 6
Cj)
+
-f-
cos. 2 i
^
statim dat :
differéniiiile
^|- r:2sin.2Cl)^-4sin.4Cp-h6sin.6c|)-4-.:...-+2isin. 2iC|).
Jani vero reperiemus
29 sinjp :zz:
:
—
sin.Cj) -f- sin.3CÎ)4- sin. 5
— 3 —
(2i —
—
sin.
-f-sin.
($)
sin. 5 Cp
+
—
sin. 7 Cj)
sin. 7 Cj)
1) Cp-f-sin. (2 i-j- 1) (J)
—
sin. (2 1
—
sin.
1) Cp
sive
2 q sin. Cp iz:
ideoque
—
o
1
'
(J)
+
sin. (2
_4_ £i!'jiii± ilî
1^
i:
» j;n.
conseqiienter habebimus
$
+
i
,'
i) (f)
'
:
"
quibns
sinT^
ôcp
î
valoribus
inventis
a
séries
sin. (p*
prior ,
demta posteriore,
hoc estnp -\- j^, dabit valorem quaesitum ,
problemate proposita, diicta in
partiura
f.
circularium,
3o.
*
vero in
séries
^, dabit summam omnium
quam quaerimus.
Verum ad
valores
convenit ,
casus
considerari
par,
vet numerus impar.
p
prouti
Sit
tt q
n
igitui
inveniendos
fuerit vel
primo
duos
numerus
par,
pona-
48
turque Jzrzcî/,
posLiimus
Cp :rr
p zzz
ita
""J,
cot.
^-
quae expressio
p nz
ubi
est
î
P 1= COt.
-
ncqneat
siipcvarc
ï
mine (p-z^:"^,
ciit
^j
-f- J sin. vit: .
l
cot. -^.
—
(l
Iianc
:
COS. m-K) ;
rr -jh i, prouti
atqiie
qiionîain
deducimus :
iinde
~ — cos.mTT cot.'"^
^^
ob sin.inTrrzo, reducitur ad
,
cos.7;î7r
vel impar,
nt
priori casu
facrit vel
7h
p
erit
znz o ,
numevus pat
posteriori vero
.
/
§.
3]
.
Porro atitem hoc casu
^^z:zicos.7H7rcot.'^
quae expressio,
d q
^
ob
— 1(2
r= 2 i erit :
— ^sin./7ZTC0t.^
i-t- i)sin.?nT
^
,
abit in hanc :
sin. miz zizo ,
-
zz::
?2
7inT
cos, 7» TT cot. ^v.
i
cum sumnia quaesita sit np--\-^^l, ca erit Zcot. '"^J,
niTT
consequenter, loco 2 i restitiiendo Uj erit summa rz îjicot.
Qiiare
§.
32.
Evolvamus nunc etiam altcmm casum, quo n
est nunierus impar,
bet
n,
et
quoniam 2i-\~l
siiperare
non dé-
manifesto pofii polerit 2 i -^- i z=zn, quo facto stacos. in-TT
uni
liabcmus
r^
p rz: ^ cot."""
2 sin.
.
/2
cos. 771 TT,
171 TT
2 fiin. --
—
.
n
sin. 7;i:t cot. --•
e sin.
TT. rr
Dcinde
vcro
,
49
hincqne ipsa siimmn qnacsita
72
:
,
n COS. - n _L_ ,-^i ::zi
^
2 sin.
—= n
^-
—
coi.
.
ji
Cum igiiui-j sive n sir ntimciiis par sivc im-
33.
§.
par , eadcm summa prodcat,
^
multiplicata dabit
quaiLim
summa
o]£;o
generalis supra
It
pio
scilicet
î
n cor. -- ,
lucc pcr
summam omnium parlium ciicularium,
erit
^ coi.
consequenter formula
""^j^;
T inuenia eiit runc:
i"f
,JJ!T
ziz- In -\- ~ cot.
1771771
I
:-
—
n
--
COS.
/
•
-rr
c sjn. -
COS.
~— 12 sm. —
COS.
- - 1 2 sm. ^
?;
71
etc.
qiiae expressio porro, ducta in
n sin.
^,
—
dabit.
valorem ex-
•71
pressionis
in
primo pioblemate tractatae,
hac nova formula multo
facilius
erit
sicque nunc
ex:
exempla particularia,
quolquot libucrit, evolvere.
§.
34. Circa formulam intcgralem, in problemate primo
tractatam, casr.s prorsus singuîaiis occurrit, quando /n nz ;;;
A z=z 00. At vero habebitur T zn /'o 5
sicque prodit S m: A T m. co. o, cujcis ergo valor Iv c modo
plane non dcternîinatur. Eum ergo immédiate ex ipsa prima
tum enim
fit
M<::o'irts dii'A.jd.
z/
T l'L
^
—
,
5o
m zr n erit
formula eruere convenit. Posito autem
—~
^
quae
,— x-ï ~
J
*
per seriem
forniLiLi
Sr=:/
evolvitur
ita
clxlx [l -ir X
X
seiiei
summa cum
nulla via patet ,
sit
-h x
-f- etc.)
— x""~' Dx/x rz
j^'^.
:
= ;„(l-t-^-h5-f-^-+-^ +
S
cujus
banc sciiem
:
-\- X
qnac, ab x z::; o ad x rr i exlensa, ob /
statim ducit ad
:
etc.),
^, erit S zz: ^--
.
At vero
hune valorem ex praccedenie solulione
deiivandi.
Pr
b I c
m a.
Proposita formula integraîi hac :
V zn/— 3 v
*
'
1 v%
valorem^ a tcnnino v zn o ad v zi: i extensum,
per
expressionem finitam rcpraesentarc.
35.
~
sicque
— v) ~
ejus
S o 1 u t i o
5.
( i
Z
:
Cum sit lu:=.l(i — (1 — 2;)) erit per seriem:
r zz: i^-^ + ^-7:^^ -h ^-^^ 4- etc.
erit :
V =:zfdv (^^)* + ^-T- ^' -+- -7-'"* + ^tc-).
Qiiare cum in génère sit fdv(i — v) rz — Yn-i— "+ ^'
'
hoc
ut
evanescat, posito
Facto nunc y ^z 1 ,
t?
zz o,
fieri
débet
erit pro nostro casufdv (1
C zz
— v)
r^_!rr;-
ziz ^!—_.
1
'
Si
-
Qiiamobrem habebimus
V =: —
Tiy^T)
= f (^ — «^)
vitur.
Elit enim :
—
-4-
1- etc
«
qno
I
I
ô_f_,
j_)_j
)
<
^.
ad
facilius
3
^«-hi
._
._
jznri
jzf~^
^tc)
redigi queant,
:
+ eta
p=::-^+^-4-^-+^'
r
l'a
hoc modo
^:|_3
formulas intégrales
piior ita repraesentetiir
altéra tcio
nostra in duas partes resol^
séries
*
_-<-|+|4-f-f- etc.
^_..
—
qiiae
—
—
(-
'
Cum nunc sit -jj-"^—) " 7 (^ "— i^T^* ^^ i" génère
36.
§.
:
'
4
'
:
J-f-3
^^-f-c
qnippe quae casu z:!::! in nostras séries abeunt. Inde vera
prodit
:
fJ
- i+j -h r + J^ +
iy^y -^y
llinc
erit
igitur
p
/mo
— q z:zf~^'^'~'
ad
/ nr 1
dp
= ,-^,
H-etc.i=^.
-\-y
habebimus
etc.
—
d q =. ^-^^-^
Formulam
istam
consequenter
integralem
ab
extendendo^ valor noster quacsitus
erit
Vzi: jy~^'^£P^, qui utique
sempcr pcr
arcus ciiculares assjgnari poterit»
logarilhmos
et
.
j
—
.
5ù
C
§.
o 1 1 a r i u m
r
i
Qiio has formulas ad majorera affinitatem cumt
37.
ponamus primo l'zzx",
ante tiactata redacaraus,
foimiiLi pioposiLi nunc
\ rr n n j
sit
—x
ita
ut ipsa
1
—x
dr (t
l x.
)
Ttim vero ia formula, ad quam sumus perducti, statuamus;
simili
modo y^^u,
fictque
:= j
V
formulae jam dcnominalor et alterum
supiti
inventa
paritas perferta
i
=z j
^
p~3i
cujus
membrum ctim forma
congiuit
r=i>""
^,
Q.iiarc
ut
reddatur, statuajnus nC --]- n nz ni, idcoque
ô:^^^^—^'', sicquc forma proposita
Y iiznn f — x""" ^ x
'
X
n
—
—
( i
1
fiet
^
r
x")
'^
Ix ,
sive
r.
ÔX Ix
_-
/(i— x)
Tum vero idem valor etiam ita exprimctur r
=r
hoc
sit
est
/
_
— du
^
V rz: ^"— T. Hinc ergo, cum ex problemate primo
S ::=: A T, nunc ambae formulae S et V ita a se invicem
pendent ut
*
sit
-^
V iz: -^"n—
771
iV
S c h
5.
38:
ITaec
reductio
1 i o
n
ad
similitudinem
modo peragi potest* staluendo /i ^ iz: /n^
sive
adliuc
alio
^m^, atqiie
'5^
iranc formula proposita erit :
V = /j«/— x"~'ax Ix (i — x")
(l— ^
*^
1
tum veio formula Inde
mm
\
Ctim
auttm
foi'mnla
)
derivat.i
1
—
/
it"-
V ir:
ïDlcgralcs
^^^^
—
(i
u")) ,
— «" - du,
'
quam obien> istae dnae formulac
"^'T,
:
/•
.
•^
—X
ôx
dxlx
l X
V
^
^
^^
(i-x)
inter se cohaercnt,
unde, quia formula
at,
—X
y
ob T =
-^
,
dxîr
dx
(i__aç; j
^
V~
sit
-''1
V mvento erit Szz:A (- — — Y),
quam ante
H.iec aiitem rediictio longe est piacferenda
illi^
invcnimus
defectu ,
,
qiiippe-
fractio dilTerentialrs
— ^A
posteiior tarxjnam simplicior ipsias S
spectari potest, valore hpskis
nieiatore
haec
:
.
1
S
ïta
— —
u'""^''"'' ^i: u""""' (l
du -4- -m J/
/ Il
J
crit:
)du.
.
tMnsPîimabitnr in hanc
VI
ïdcoqne
/(V
.'
sic
sive-
qirae
ibi
iaborabat
hoc
integranda erat spuiia,
quod
cnm in nu-
occuiiat potestas u'^~^'^~\ qiiae utiqne altior est
qiiam potestas denominatoiis
tégrale pro (juanlitate
ï<";
qtiociica
nunc demtim in-
T ante evolutcvm hic usuipari poterit.
O4oaoc ^^^o^oooc"«
54
SOLUTIO SUCCINCTA ET ErJCGANS PROBLEMATIS,
gpo gUAERUMUR TRES NUMERI TALES, UT TAM SUMMAE QUAM DIFFERENHAE BINORUM SINT QUADR.ATA.
R E
A U C T
E U L E R O.
L.
Convtntui exhibuit die
i
Maii
hoc problema jam a
Etsi
1.
§.
i
1780.
variis auctoribus est
tractatnm et resolutum, sequens tamen solutio oinni attcntione digna videtur, ideo
involvat, sed etiam facili negotio pluies solutiones,
tificia
inventu difficillimas^ siippeditat.
alias
§.
2.
ximus
sit
X zzi pp
X
quod non solum plura calculi ar-
quorum ma-
Sint X, y, z, très nnmeri qiiaesiti,
x
minimus vero z , ac statim patet , ponendo
,
-{-
qq
et
(p
—
q)'-
— y ^^
y^nipq
Simili
foie
x -^ y ==. {p -\- qY
modo, ponendo x
—%
-iiiz
et %:=:
2ys
s,icque
jam quatuor condilionibus est satisfactum,
fucrit
rr -^ ss zzL pp -\- qq.
duiones
et
Y
erit
x ~\- % -zz (y- -\- sy
adimplcndae
—
z zzz 2 pq
§.
3.
et
x
et
rr-\-ss
— j)%
z=z [r
si
modo
Tum vero
adhuc duae con-
ut
y-^-zzzL2pq-h2rs
restant,
scil.
— 2rs quadrala rcddanlur.
Ut primo
liât
X zz. ha -\-hb) (^cc -i- dd) f
rr -\- ss zz pj) -\- qq
tum cnim
iste
valor
statuatur
duplici
55
modo
duo
in
qiiadrata resolvi potest
pzz^ac -^bd
q rz ad
—b
r =:. a d -i~ bc
-y
— bd.
(aacd 4- abdd — abcc —
c ;
habcbimus y := 2
Ilinc ergo
',
Fiet enim
:
s tzz a c
bbcd)
et z zr: 2 (aacd -{- abcc ~ obdd — bbcd) hincque adeo
y -{- % zz- ;\cd {aa — 66)
quas crgo
§.
/ — z zz ^ab {dd — cc)^
adhuc quadrata rcddi
Ibrmiilas
dcias
et
4-
Faciamus
"y y
— zz zz i6abcd{aa — bb) {dd — cc)zzi\j
primo piodnctum,:
igitur
nnde primo necesse
est
ut haec formula :
—
6 6)
x
ab (a a
ad quadratum revocetur.
c d
Ilunc in finem statuamus :
—
c d
(d
res
a
relatione inLcr binas literas a, 6 et
poncre
— ce)
[a a
c
d zz a
licebit
,
— ce),
(cZ rf
d — ce) zz n
et quia
det ,
opoitet.
-zz
,
(a a
n a b
unde habebimus
n n b (a a
— bb)
6 6)
c, c^ pen-
:
;
unde deducitur aa ::iz''^^^~~ , quae ergo fractio ad quadratum
§.
ut
fiat
termini
lïoc autem facile praestabitur^ ponendo 0=1:64- c,
5.
^^j^^6'
aequatio
.
T
liiiilur
o
dcbet.
redcici
:
b
-
c
m 66 -h c 6c
-f- ce,
qua aequatione evoluta?
nascetur enim ista
et c' utrinque se destruent;
oz:z('2nii
zz
2
—
n a
n n
—
.
I
—
1) 66c 4- (/la
— 2) bcc; unde col•
:
.
56
erit
tlnod
6.
§.
ergo ponamus brrr G — nîiet c=r cnn — l
si
nznHn-hi.
Nimc
negotium
totiim
eo
reducitur .
ut vcl haec formula:
ah[dd
— ce) vcl hacc: cc)(aa — 6b)
Teddatur
Prior
autem formula ob d zz: a
qiiadratum.
€t
d-hC- Sun etd - c = c - ;2;z, crit ah (dd - ce) -3nn (n/n- 1 )(2—nn) ~,
erit,
duramodo
vero
ista
formula
3 0ni-j-i)
potest ;
intérim
tamcn
quae quadratuiîi
At
7-
§.
qnadratum
effici
adhiberi potest,
n zrz h
—
c ,
fl
nullo
modo
remcdium
facile
dummodo loco valoris a :zib-|-c statua lur
facto fieC^-" v^^— z:zhb
2 ?i n
— 2hc -i-cc iinde
,
1
8.
Ponatur ergo b nz ;i?j
—
1 :zz d^
ni >i/i
3 (/i«H- i) izi Q,
colliiritur - :zz -^'-'—
O
-4c
evolvcndo
5.
quo
fueiit
unde
+2
et c
m2
— ce) reducitur
?in -h-
i ,
erit
ista formula ah {cld
ad hanc
3 un {nu
Tantum
ergo opus
qnadratum,
débet
§.
scriptis
id
9.
est
1) (n n
est,
quod
Quodsi
factorcs,
ficri
—
-\-
2)-.
ut ista formula 3 (/?;i
facillimc praestatur, quia /z ;i
enini
ponatur
3 {nu
3(n— 1) — ^^(vz 4-1), tinde
Hoc
igitur
satisfaclum,
supra inlroducîas;
—
—
fit
i) zzz
n
—
î)rf!iciatur
—
1
liabct
\^(n-{- i)^j^^^^^^^.
modo omnibus conditionibus praeunde regrcdianmr ad
quantitatcs
Ac primo quidcm ex hoc valore pro
« invento dcducimus
:
/
57
?gg— /V/ ~
~^
c :=:
a
ratione
J"'"
•
"^'^'"^
sokuio tantura
'^o'^^
a,h,c,d, pendet, primo dcnomina-
inter literas
num<rii>toies
tores omittiimu?,
q"''^
vero per coîiimuncm di\isorem
hocque modo sequenics obtinebimus vaJores:
3 dividamas,
c-/4+2//g § + §§•.
Ex his derivemus literas p,q,r,s, quae eriint:
P
= 8//g^' 4- 9^%^ -p + Sof^g* -h 8i9«,
szziiôf* g\
— — (/* — 9g'y
r
(/*
'
<?
;
Pracstat antem a primis valoribus /et g, pro arbitrio assnmtis,
per giaduSj primo ad litcias a,b,c,d, hinc vero porro
ad
literas
p,q,r,s, hinc
sitos
x,y,z,
iinnc
calculum per
semper
licet.
enim
deniqcic ad
Ubi
ascendere.
juvabit,
valores negativos neatiquam
turbari ;
loco
eoriim
valores
Hanc invesiigationem
quo f :=:
qu
JO.
valores
Hirrc
porro
Hic ergo
erit
depressi
tkint
colligimus
Niânotrci d: VA.ad.
imprimis
notasse
I./'V.
l
positivos
tuto scribere
nonnullis exemplis illustremus.
EXemp1
§.
numéros qiiae-
ipsos
11
et
m
i,
g
—
i,
anzdz=:4; hzziB; c:=:i2,
azudirzi; 6:rz2;
p z^ 5 ;
q ::zi 5 ;
r zzz i
^
-,
r
— 3.
s ^zz i^
58
rz=5o; jr^So; 21=14, <1^'' valores ntiqiie satis-
unde
vciiim ista
faciiint ;
sokilio
excludenda
q^uaeslionis
EXemp
/ zz:
qiio
11.
§.
Fîic
eiit
2
quamobrem
a'r= 7 33025 ;
Hinc autem
erit
simplicjtalcm
1 11
m
ab
indule
et
2,
g rn
l.
=
m 800; 7 m 3o5 rnzSi"/;
airz 16; 6 := 1 7 ; c =r: 33 ; d
Hinc ergo pono deducitur
J 1=256,
ob
est.
/5
6.
;
niimrri qiuiesiti
ipsi
1
erunt
:
/ = 488000 ; z z=4i83o4i
:
,
— 7=495*;
+ =;1073*; X — z=z56i-;
j-f-zz= 952^; j — 2;z=264^.
H-/ ml io5^y x
a^
ce
2;
E X e ni p 1 u m
quo / =1 3
j:
12'.
Hic cigo
36
sive
per
d z:z
I.
miis..
id
naiii
accipitur.
erit
depiiniendo
ITinc erp;o ad
qnod scmper
a praeccdente
et
m
l.
^=172; c=:io8;
erit az=i;
h zn 2
c z=z 3 ;
az=:36;
;
ipsiim
evenit^,
Posito enim
g
3,
excmplmn
priimuii
icvolvi-
qiiando pio / mullijrlLim" ter-
/=: 3/i lict n ziz^\^^'~-li quae
forma non discrepat.
59
EXemp1um
/ rz:
qiio
idcoqiie
autem
Ilinc
et
g
2 .
z=:
a=ri6; h=.L3ij cr=i53; dm6;
p m: 4640; r/i=z20705; rz= 21217; 3'=: 256.
.13.
§.
1
4.
Ilic
eiit
ipsi
niimeii qnaesiti x, j^, z nimis fiunt magni,
quam ut operae pretiuQi
sit
eos evolvere.
Nota.
14-
5.
Q.noniam invenlis numeris
p,q,r,Sy ipsa solutio
X— r
=p—
ita
d, hincque
est adornata, ut fiat XH-/=zpH-(/,
X 4- 7. rz r -f- J et x
(/ ;
a, b, c,
— z zz r — s, quadrata
—
z aequantur, evolvi
y j- z et y
conveniet.
Invenimus autem / -f- z zzz 4cd (na
hb),
quae, subsLitutis valoribus supra inventis, par / et g ex-
quibus foimulae
etiam,
—
reducitur ad hanc formam
pressis,
4 if' -h 2//g§
quae manifcsto
est
:
+ 9^'y 4//êg — 6//§g -h
if'
quadratum, cujus radix
9S*).
:
4/.^ (//— 3ê§) (/» H- 2//gg -r- 9§*),
ita
ut jam
sit :
// -HZ = 4/gc (// — 3gg).>
Simili
modo cum
sit
y—
7,
zzi /\.ab (dd
— ce)
erit
/ — z — 4.4//gg(/4 — 2//g§-f-9ê*)'(/"*H-6//'gg
+ 9g*)
idegque
V> - 1 =: 4/s (jÎ/''^- 3gg) (/^ - c//gg -h 9g*) = 4/gc (//-h 3g§).
—
6b
nentiqaam pro
tarncn-
enim
qnanquani
,
supia
et
5.
§.
gencr.ili
solutio
luicc
satisfacientes pro x,
valoies
rabilcs
ea
Ccternm
5.
1
f.
est
complcciittir,
z,
/,
innnme-
habenda.
Qiioniam
posuimus azi:6-4- c et o rzib
•
7
—
c,
est ,
Jianc
positionom
maxime
esse particiilaienr^
quandoquidem
huic
aequationi
infinitis
aliis
•evidens
Intérim
potest.
hac
méthode numcri idonei pro x,/,7-,
facile
iis
AT
yy-hzz
—
fucrint invemi,
qui sint X, Y, Z, derinari posse,
as
xx-\-yy
xx-hzz yy
\r
rj
<^
alios ,
sumendo X n:
1
satis-
tameu hic observasse jtivabit, posix^nain
fieii
ex
modis
— XX
—
et Z zz:
.
\ z=z
,
—
.
X-j-Yzzzz; X — Yz=:xx — j/zizG;
y^-i-Zz:zyy'jz.U; Z — Xznxx — 2X — D; Y-)-Z^xx— G;
Ttim enim
Yzi^yy
— XïzzQ.
statim ad
numéros
Z
Hoc
modo
antem
cimiir..
Similique
tingere
licct,.
modo continue ad numéros
Add
§".
affine
r^.
et
Panciores
jam saepius
i
t a
tria
majores per-
m e n t u m.
ambages
rcquirit sequens problema;
tractatiim..
Pr
Tnvenirc
pracgrandes dedu-
quodrata ,
diffciciitiue suit
b l e
m a.
xx , y y,
quadrata.
zz ,
ita
ut hinorum!
—
,
6h
S o 1 II t i o.
§:
Posîto x—pp-hqqetf-2p(fCietxx—f/:z(pp~qqY,
17".
m 2 rs,ùelxx~2.z —{rr~-ssf.
superest nt // — zzzn ^(ppqq — rrss)
Simili modo, posito x izi rr-\~ss et z
TcinUim
ii;itiir
redtlatui
qu.idratum', postqLiarn scilicet facluni fuerit.
pp -[- qq
quod
fit,
q =z ad
lit
snpra
Liti
est
sumendo p:=zac-\~hdf
ostensiini,
zzfijt (|nadiatiHn,
— ce)
fiât
a::^dz:znn:j;2.^
§.
rr -\- ss
— bc; r—ad~hbc; sz=Lac — bd.
)•/
{d d
—
iS
quadratiim
autem ,
quod
,
vidimiis
fieii ,
— bb)
sumtis
b :zz 2 nii^ i et c :iznn'^ 2^
t
Qnod
si jain
loco
n sciibamus -, habebimiis
sequcntcs geminas delerminatioiies
a ziz d nzm m
Ilinc
istiid prodiiGtuina6cfZ((m
^ nn
;
b :=z 2
:
mm ^ nn
-,
c :=z
m m -f- 2 n w.-
Hinc cigo stimendo pio mctn numéros simpliciores sequens
tabula cxhibet pluies valoies idoneos pro
Ubi
notandum
3 divisibilis,
est,
si
ncuter numeiorum
tum valores ex
3 dcprimi posse ,
uti
s-ignis
literis
a, d, b, c.
m et n fuerit per
superioribus ortos per
in sequente tabula facLum est.
62
Tabula
exhibens valores idoneos pro literis a, h, c, d,
w
m
5
64
m
65
numeri
donlis ,
qno qnaeruntnv
ruin
samina qucim dilTcrentia
tiirn
modum modo ante
tiûiies
très
sit
animadvertimns ;
occLirrerent sumanliir
quadrupla
X.Y.Z,
ita
ut bino-
quadratum,
qnemad-
quia aiiteni ibi frac:
X ru 2 (// -h z z — X x)
Y =z. 2 (xx -j-zz — y y)
Z =: 2 (xx H- yy — %z)
qui
cigo
omnes
numeri
très
semper erunt pares ideoque
diversae prorsus sunt indolis ab
supeiior suppcditavit,
illis
numeris, quas solutio
ubi scilicet unus trium
numetorum
neccssaiio est impar, quia alioquin deprimi possent.
«-eoooooOc-coooc»
Mcmo'irti de ÎAcai.
T. VI.
—
66
DE RADIO
C U R V E D I N T S^
eu RV ARUM DU
CURVATURAE,
PL ICI S
©EJUJE CIRCULI OSCULANTIS POSITIONE. F ACILLIME IKD AGA ND IR
A U C T O R E
N.
F U S S,
Coiivcntui exhibuit die 2
Tab.
I.
^^âi"
*•
!•
§•
Sit
Mai 1610.
Z punctum- qnodcunqne
eodèm piano sita
,.
in
cnrva non
sive duplici curvatura praedita , cnjus
ergo puncti situs per ternas
coordinatas inter se normales
AXnzx, XY=:/, Y Z :iz z, ita determinettir
quam z spectari possint tanquam. fiinctiones
statnamus
functiones
x;
,
ut tam
ipsius x,
By zizpd x et d % =z: q d x; ubi ergo
ipsius
in:
/?
y
unde
et qr erunt
hincque porrO' dilTerentiando ponatur
9/9zz/?^dx et d q z:z q'd X.
Ex his igitur démentis définie
araus radium osculi curvae pro puncto Z..
2.
§.
Sit igitur
punctum H centrum
circuli osculantis,.
hocque punctum determinabitur ope ternarum coordinatarum
normalium
AF z:zf, FG>z=:g, GH:zi/i,
inter
se
HZ
radius osculi quaesitus ;
lineam
HZ' eandem< magnitudincm
retinere
eritque
est
hanc
debere,
dum^
atque manifestum
punctum Z non sohim per proximum curvae elementum,.
sed adeo
per
duo proxima promoveatur;
unde sequituï
6i
TioTj
soliim difTerentiale
>ejus
diiTerentiale
5.
atque evidens
ita
isthis rectae
HZ, sed eriam
secundum nihilo aequaii debere.
Vocemus
3.
primnm
est
hune
jam
radium
HZzrr,
osculi
eum per cooidinaUs illas x,y,z,etf,^,h,
determinari ut sit:
r'z=z(x—fy-h(r
ergo
cujus
expiessionis
— ^y-^('^—hy>
differentiale
secundum nihilo aequari débet.
tam
primum quant
At veio prima
differen-
facta divisione per
2 d x, praebet hanc aequationem:
«liera vero differentiatio ,
facta divisione per d x, suppe-j
tiatio,
ditat :
i~hpp-hqq-{- v\y —é) -^q\z — h)
atque
ex his
y—
t]\
-g
et
2 —
§.
4.
Si
—o
binis aequalionitJus definiri poterunt valores
lu
cnim prior harum aequationum ducatur in
ab eaque aulTeratur altéra in q ducta, remanet
unde sequitur
J
S
fore
:
:
V<i--qV'
Sin autem a priore illarum aequationum, in p^ducta, subtrahatur altéra per p multiplicata, prodibit
p'{^—f)-^iqp'— p q'K'^
— h)—p
:
(1 4- pp -f- qq)
9*
=•
f
63
unde nanciscimur
§.
et
p
q'
:
— >7«— /^
IP'—PÏ
Ponamus nunc brevitalis gratia l-\-pp-h-qqi=rss
f>( '-l-f f-4-^ 7)
;
5.
—7 =
/^^
sticcinctius
atque
"j
emnt expressae
siipcrioies
dcLtiminutiones
ita
:
v
valoribns,
quibns
expressione
in
data , substitutis reperietur fore
6.
§.
hic
Singiilaris
siipia
pro
radio
osculi
se
olTcit ,
quod
:
circnmstantia
unde ctiam positio
nempe
linea / non
pnncli
H indeterminata manct et in infiniliiin vaiiaii jx»-
tciit.
Omnia
autein
quod
propterea
sit
determinata ,
ejus
binae
loca
rel qiiae
lineam icctam cadent,
in
coordinatae
g
et
h per
iinicam dimensionem ipsius/ definiLintur; quare omnia pla-
ne piincta
htijns lineae
rectae pro puncto nostro quaesito
H accipi pote ru nt.
§.
7.'
Quodsi enim rem
depreliendimus j
Tab
Q.
F'g-
ï*
qtiaestionis
circulus
attentiiis
perpendamus , mox
hune delcrminationis dcfectum cum
cgregie
osculator
consentire.
Sit
curvae nostrae
in
enini
circulus
puncto Z,
in
staUi
CDZ
piano
repraesentatus^ et quoniam per operationes supra institulas
69
id
qnaesivimiis
peripheria
punctnm
quod ubique aeqnaliter
,
manifcstum
circuli ,
htijus
distet a
hanc proprieta-
est
tcm non solum pioprio centro
H
hujus circuli convenire,
H^
in
recta
ctiam omnibus punctis
scd
Unde mirum non
erccta, sumtis.
normaliser
circuli
calculus nobis innumerabilia puncta
linea recta
Z
qui ex
satisfacit,
ex
ducitur ,
ipso centro
innumerabilibus
eu m quaeri oportel , qui
autem
ipsi
quamobrem
pro r
erit
eum
methodum maximo;um
per
Quoniam aulem omnia
9.
nes
/ nascuntur,
quantitates
illa
in
pro r invcntis
Facile
om-
inter
haud
minimorum
difficile
eruere.
puncta H'' ad unicum
sola
variabilitate
hac minimi invcstigatione om-
x, y,i; p, qyp\ q\
habendae 3 ui'de cum valor pro
forma m
et
punctum Z referuntur atque ex
quantitalis
solus quae-
minimum esse
valores
inventes ;
is
H conveniat.
centro
nes
nostrum
eadem
H circuli ad punctuni
valoribus
istum valorem
intelligitur
5.
si
sita.
nostrae curvae haberi nequeant, sed
osculi
sito
exliibet in
II
est
Cum autcm omnes istae rectae ïV Z pro radïïs
8.
§.
H H.\ ad planum
r-
pro
sunt
constantibus
inventus talem habeat
:
rr=:A— cB/-hC#"
ejus
dilTercntiale nihilo aequale
positum dat f ziz.
^-
,
qui
-
"70
ex
valor desideratus pro /,
qiio
est
unde
verus radius osculi pro nostro puncto
§.
nnnc formulam supra
Qiio
lO.
ventam ad hanc postremarn revocemus,
fecimus, rr
=A—
differentiale
nihilo
substituto
fit
"^
*-'
rr:=i
B (x
aeqiiatum dat
^
^^^
x
^^
5.
pro rr in-
statuamiis, iit modo
(a:
— / ^=
supra.
—
Bï
AC— —
Z innotescit.
Ç.
— /) -h C
ac—_bb
«W
—
:?
r* =:
fit
ergo
c
~ /)»,
'
ciijiis
^"*^ valore
Cum autem sit
:
'
*
^,1
-^^ .
p' p'-^q'q'-i
habebimus x
§.
11.
— f ^ ~^^^^^-,.
et
qiiadratum radii osculi
Cum autem haec expressio non sit admodutn
commoda , eam magis evolvere conveniet, quod fiicillime
Ex valoribus pro A, B, C,
sequenti modo efficietur.
supra assignatis quaeiatur :
A C = ^^ [{pp -h qWp' -I- 9' 70 4- uu{pp 4- 97)1
BB:=:5(p/ + 990^
eritque dilTerentia
:
AC — BB =: 5 [{pp -+- 9q){p'p'-hq'q') — {pp' + qcf)']
Tf
Facta autem evoliitione reperietur r
(jpo
erit :
siibstitiito
AC — BBzril(i4-pp + qf9)=5
onde porio
fit
AC
rr
îta
— BB
p'p'-i-q'q'-i-uu *
C
ut jam hanc nacti simus expressionem valde concinnam'
pro radio oscali quaesito
(
pp -f- qtj)'
__
:
^
f.
Vp'p^-^q'q'-^ !.pq'
— qpT
'
prorsus uti ab Eidcro aliisque jam, olim est inventus.
§.
oscLili
12.
Methodo commodisimae heic expositae radium'
curvarum non in eodem piano sitarum investigandi
jam pridem osus sum
in dîssertationp
Solution de quelques
:
problèmes relatifs au déLeloppemciit des courbes à double courhure.
Ea non solum simplicior est aliis,. sed insuper quaesti--
oni propositae melius satisfacit,
quantitatera
radii
osculi ,
hoc valore
j:'p'^q'q'-^-(^pq'
in
expressionibus
L
ipsam
circuli
osculantit^
:
!^{pf-^qq')
f
J
ventis substituto erit
^
etiam
praeter ipsam-
Cum eniin invenerimus (§. ro.)
positionem déclarât.
-
ideo quod,
— qp'fy
§.
5;
pro
:
i^iPP'n
—
<]' (.<
-h pp ))
.
y—-g et ï—
/i
ih<^
12
unde pro
qiiovis
pnncto Z cuivao propositae ccntnim
H per teinas cooidinaïas j
culi osculantis
^
cir-
g, h détermi-
na li polciit.
Applicatio
I.
ad curvas in piano tabulae descriptas.
§.
Qiiod
i3.
ergo ciirva
si
tabulae fuciit descripta,
et
f/^
—
situ
ipso piano
in
z i= O, ideoque etiam 9 iz: o
erit
n: o, unde exptessio pro radio osculi
t
Pro
proposita
erit
:
'
f
autcm cent ri circuli osculantis habebimus
( -+- PP)
„
f
^
J
—
f>
:
.
j
p'
quae formulae cum démentis cognilis cgregie conveniunt.
Applicatio
IT.
ad curvas in piano quocunque descriptas.
§.
Aequatio pro
14.
coordinatas
funclio
fret
est
:
z z= a
quaecunque
r/— a-f-f3/;
SS
—
U
=z. pq^
l
-^
et
-f-
piano
ax -f- P/ ,
ipsius t, ob
unde
inter
tcrnas
y
fucrit
si
3yzi:p3x et dp:=zj)dx
Hoc igitur casu habebimusr
(/'— (3//.
pp-^qq rr
quocunque
l
-|- pp-j-
— 9 p^ nn — a p^
(a-|-(3/j)%
"
73
et
radium osculi
r =z ^'-^ ^ t±JdJi? t>y> ^
fVi-i-oLa-i-ftP
nique centri ciiculi oscnlantis hiibcbiHius
^
ss
f
J
p' {i -4s s
- .
o-
J
(Kp -h f
!^
H- (3(3))
(.
>
+
f'C'
:
.
'
aac-f- (3,3)
(app .+ «g
p' (, -i-
Pro 'positione de-
.
aa -ir ?ii)
y
•
H-cta.+ pp)
Applicatio III.
ad curvas in superficie cylindri descriptas.
§.
in
i5.
radius basium
Sit
cylindri z:^a, ejusque axis
ipsam rectam
AB incidat.
Elit
curva
qudcunque
in
iinde
pro
ii2;itur
hic yy~hzzz=zaa, Tab.
hujus
superficie
cylindri
dcscripta statui poferit j :zz a cos. (^ et î. nz a sin. (J), existante
nn£,ulû
quacunque
fnnctione
ponamus ^(p ^z tdx
et
x.
Hancobiem
hincque
habcbimus
abscisSfie
3t r^ t'dx,
— at
zr
0,
g
—
p— ^^ — of'sin — nftcos. 0;
= «t'cos.Cp — att
sin.Cp
p ;zz -J'^^m
et
tuai vcro
flt cos.
zz: ^^
Cp
9' :rr ^^'
ex qui bus
valoiibu.s colligitur
ss
:zz
i
u
ziz
a a t^f
// //
+
-\-
q' rf
Hinc autcm sequitur
y
sin. Cp;
-4-
_
:
a at t y.
-^ nu
fore
—
a a
(t^t^
-^ ss t*).
radium osculi quaesitum
si
aV (»'f'_tiss/4)
Mimcirts del'Actid. J. n.
-
'•'
lO'
,
:
S*
I.
^*
^4
et pro positione
ccntri ciiciili osculanlis
—f=
X
s s
ri^
»
—
f COS.
s% Çîîf f un (p
a {f f -i- s s 1-^)
7
''
l6.
st-i
a(f'K -f^s» H)
t»
^
§.
s
(s:t t C0-. (p -+- 1' iin:'^)
s s
y
habcbimus
tr
Ilae foimulae valent pro omnibus cui-vis,
qiias.
in superficie cylindri dcscribere licct, inltr quas praecipue
Aichimedea
notari meretur hélix
va X =Lna(p ,
-
Ponamns
x est proportionaîis.
scissae
qua anguliis
in
,
unde
sive (p :r= -*^,
ab-
bac cur-
igitur pio
fit
Cj)
t = — et
i/ zzi o,
radius osculi erit y ^z a {i -\- un), constans, uti par
undc
quandbquidcm
se est pei:spicuum ,.
qualiter -incurvata
dium baseos
§•
lihet,
17.-
nn ad
z=.
:=:
fit
a
/izz x, g =:
i.
centri
ea determinBbilur his forinulis
—/—o
y— g a
z — h
nnde
i -f-
posilioncm
X
cuiva nbique ae-
debtt, eritque radius osculi ad ra-
cssc
cylindri. ut
Quod
ista
ciiculi
osculantis
at"—
:
,.
{i
-^ nn)
(i
-}~
cos. Cp
n n)
— nny, h
sin.
z=z
=r
$ m
(i
-f-
n n) y,
i
-\-
n n)
(
z,.
— nnz. Ex primo va-
Tab.
1.
lore intelligilur punciutn
in*
ipsum punctlim X incidere.
*^'8
^
Ex secundo patef rectam F G
capiendanv esse ad alteram
axis partem et
quidem
F
FG iz: fin
,
XY.
Ex tertia pcrspi-
G II, in>.0 crcctiim, coordinatae YZ oppoG H m )in YZ. Tuin erit H cen-
citiir
normalcm
siuiin
esse debere et
tiLini
circLili
ipsuin
.
unJe patet radium osculi ZH peu
osciilantis;
punctum X transiie, quandoquidem tiianguliim FHG
omnino
HZ zr: (i ~{-
triangulo
est
siinilc
Il
XZ Y et Fllmnn.XZ et
n)XZ, ideoque
HZ XZ zzz i ~i- nn
:
:
l,
uti rtqiiiiitur.
App1
J.
i
c a t i o TV.
ad
ciirvas in
i8.
Statunîur vertex coni in
superficie (Conica
descriptas.
puneto
axis iaciddt in rectam A;1^%i:eri4^ sectio ad
AX —
nalis afcjscissaq
ut n
sit
ce,
hunc^xem nor-
statuatur hanc ob caussam tt ;zr,
tangens dimidii anguli in veitice €oni ,
que ubiquc yy -\- zz s=l nnxx.
peiûcie
ejusqae
puneto X fact^, circulus, cujus d-adius, proportio-
jnalis, in
lia
A,
liiijiis
coni descriptis
et z z=. nx sin.(P ,
existente
Pro cmvis igitur
statui
angéilo
poterit
Cj)
iinde ut aiuc ^siatuaraùâ d<pzi:tBx et
p rz: n -cos.
q
zrz.
n
sin.
(J)
//m — cintsin. Cp
7''
ZH
erit-
in
su-
y zz: nx cos.C^
functione
ipsius x,
dtzut'Bx,
— ntx sin,0,
— ntx
— nt'xs\n.(^ — nttxcos.
—« x
fietque:
cos. <0,
<2nt COS. (\)-{^_nt'xcos.(^
unde porio dcducuntur valores
11
(|),
sin. (J) ,
:
/
10
*
,
^
76
nn (i -\- 1 1 x x)
u =1 nn (2 t -{- f X -h X X t^)
jj r=
~\-
1
,
existente
vu rz:'( {-{-n") (2t4- 1 x)^4- f* x^{l-hn~i^x-) -4- 2n*(2t-+- 1 x) X' t'.
nv *
^"
Qaod positionem centriHattinct, qiioniiim xalores p^q,p^,(fyS,u^
modo assignaviinus, quovis casu obLito facile eiit eam ex
foimulis generalibus supra
f.
derivare.
allatis
cnrvas in superficie coni descriptas
Inter
19.
12.
J.
illa
singularem attentionem meretur , qaae brevissima est inter
data duo puncta cujus riàtura
COi.
his^
formulis exprimitur
:
u
1
y zn
-^
cas. bi
z
m ——
.
COS. X ùj '»
.
sin. X w ',
COS. U(
quae si cum nostris formulis generalibus §. 18. compavemiïs,
manifestum
habeamus
est
sumi debere
Cb iz:
cos.w
ncos.tai
unde porro lit trr ^- —
si
ita
ut
x=:-^ — °-^"^,ergo
et X — "^^^^^,
'O /i=:^=Lz=
î'XX—
nunc
-
- —, hincque
in formulis
"
I
Hinc omnia ad angulum
w reducendo
o
Q.uod
"-=^*ix,
A w et
§.
18.
loco
erit
>
t rr
t
dx rz."-^^'"—,
n COS. w '
et
—
-\
x valores hic
—
.
77
iaventi snbstitiiantur, prodibit ;
n
zrz
q
— n
—
n cos. CD
*K
sin.
I
-j-
p' =z ^^£J'^i [n ( 1
(}'
— — -""^ b" [« (i
-^^r^
—
—
sin. aj)^ sin. Cp
.
—
X
tis
cos. u cos. Cp],
—
—
sin. w)*),
-.
sin. uty^-^vu
^
5
w*
Evolutionem aliorum casiium specialium ulte-
20.
non prosequor, quoniam ex applicationibus snpra
iisLis
Majoiis
momenti mihi videtur sequentium bino-
problematum solutio, quorum
altero
plani ad directionem curvae in puncto
positio
fac-
nostrarum foiirmlarum. generalium jam abunde per-
spicilur.
riun
X
a (i -J- n n -)-X X n n. cof. a)-)-î
-——
existente v zn r—
n n"-"t
cof.
riiis
— n
sin. u)^ COS. Cp -J- X/î cos. w sin. Cj)],
\nn cef. <u^ /XX cot. w- -^-(1
5.
,
-f- ^^9' ^== '^'i'" cot.w* (XX COS. (0= -j- (i
p^/?''
r
,
cor. ti>
coï.
l -)- ?uz -h X X n n cot. w%
rr:
.s-
r-^
Xn
plani
in
quo
quaeritur positio
Z normalis,
minima curvae portiuncula
altero
est
sita,
quam igitur solutionem heic coronidis loco subjungamus.
P r oh
5.
21.
Proposita
curua
l
e
ma
i.
quacunque non
sita ,
determinare
puncto
Z normalitcr trajicitur.
positionem
plant
in
_,
eodem piano Tab. I.
quo
curua in ^^S-A-
s o 1 u t i o
Qnoniam punctum
Z
ciirvae
AX:^x, XY^y, YZ zziz
tanqiiam functiones
teitiae
:
per
.caardinatas
ternas
qiurum binae
deterraiDdtur_,
possynt ,
spcctaii
ponamiis ut
z =r qdx.
Jam concipiatur planum
By ziz pdx ,
per punctum Z transiens, ad quod curvae directio sit pcr-
supra
<)
pendicularis ,
ponamus
atque
cum piano tabnlae
K secantem
;
esse recta
m NKV,
hue
sicque quaestio
AKzizk et angulum PllV ;=z
puncto
libet hujiis rectae
quoque ad curvam
fore
)3
axetn
AB
ponamus
plani
piincto
hiijus
intervalluni
et evidens est,
,
in
redit , ut positio
lïunc in finem
rectae deterjuinetur.
hnjus
intersectionem
si
quo-
a
V ad Z duc.itiir recra VZ, earu
normalem ,
undc
rjiis
quantitas
nullum accipiet incrementum, dum punctum Z pc r clem^'n-
tum
quamobrem
promovetur ,
dilTeienti.ile
hujus
rectae
VZ nihilo crit acquale statuendum.
Vocenujs
intervallum
A B
perpendiculo
axein
V P ::=:v sin. ù, unde
sicque habebimus
fit
KVzzzi;, ac demisso ex
V P
,
intervallum
erit
V in
K P zz v cos.
XP z^ k-^v cos.
ô
$
et
—
a:,
:
V Z^ :zz [k -{- V 60s. & — x)' -f- (v sin^Ù — _v)= -f- z?;
oujus
lioneni
dijl'erenlialc,
:
nihilo
aequatum, pracb.ct hanc aequa-
.
19
k -I- V COS. $
ex
rcctae
posilio
qiia
A K rr
intervdlluni
— X -h
/i
(v sin. ^
— y) p — q Z'n o
N K V débet definiii hoc est tam
P K V r= ^. Quoniam
,
quam' a'ngulus
antcm haéc arquatio locum habere débet ubicunique punc-
V accipialiir
tuni
i;
,
stibtracta
ilJa
nnde ongnlus
aiitcni
ot
-\-
COS. Ô
ira
^
v z=. o
siimarnus
— X — py
k
quae ab
,
q z
-\-
et
aequatio evadet
o,
z::!
relinquit :
p V sin. ^
:r:
o ,
definitiir
ut
sit
tag.
rz
—-
k ex snperioie acquatione
intcivaUiini
ita
Ipscinv
^
definitur
sit :
qz y
k zn X -\- p Y -\-
sicquc pioblema- peifecte est solutunl.
Coro1
§'
2 2.
ex
Si
pnncto
1
a r i u
Y
m
i
in .rectam
NK demittattir
YO, manifestnm est punctiim O inter omrcctae N V fore id, cnjns distanti.a a pnncto
perpendiculmn
nia
ptmcta
cirrvae'
Z
rs':
Ad hoc
niinima.
pcndiavlnm.XQ, afqtie ob KX:r:A.
tiir
KQ.zr(A
—
x)
pcipendiciilnm
cos. ^.
X S
punctiim
pcr calculum
X in rectam KN demittatur per--
determinandu n eiiam ex
et
:
Deinde
,
XS zn 0.0 zzz y sïn. & et V S
—x
si
crit XQ.zr:(A.
ex
— x) sin.d
X ad YO demitta-X Y S rr
eiit'
ob
angulum
=y
ces. 9,
ô
,
unde porro elicitur-
—
8o
K O 3=
O Y=
quae
vae,
si
—
—
(/i
{Il
0")
COS. è
—
x)
sin. &
-hy ces- ^
cum
sit
posLiema
linca
eam
Y
ultra
^
ita
c3.
§.
aTi£;nli
Q,
Quod
C
r
si
vcio
qiianiilates
—x
z=r.
o 1 1 a r i u m
T^
ut sit
in
:
c.
q introducere
et
p
vclimus,'
=:—--^^^ct cos. $ — 7^^^;
py -\- qz, unde porro concluditur foie
Subnormalis
O Y rr J^ "77
Subtanircns
o
Y T
,
m T^iili^
r
Proponta
,
q
'
'
P r oh
2 4-
cur-
bas postremas formulas, loco
in
nostvas
.
'.
nostrae
'
notetur esse ti;.^ in— ~, hinc sin.
tuni vero erit h
,
siibnormalis
subtangens
eiit
x)sin.ù-\-yco!.e
(fe
sin. $ ,
pioducanuis usque
0\':YZ — YZ:YT,
*
}'"
linea
puncto
'.
I
e
m a 2.
cun'atura pracdita ,
duplici
Z
quovis
ejus
miiiima
curucw portiiincuîa
invcstigare
sit
phunim ,
in
pro
quo
sita.
S o 1 u t i o.
Tab.
'^
Positis ut supra coordinalis lei^iis
ï.
lum
vero
dy :i:z pàx, d%=:z qdx^
dp :=z p^dx etdqrrq^dXy
monta
AX — x, XY-j% YZzzz
ac denuo diflcrcntiando
considereipus
bina
curvae rJcr
continua, quac, .quatenus in dircclum sunt posita.
,
—
8i
planum
aliqiiod
quod ,
determincibunt,
ligalur, pl.inuin tabiilae
inteisecaii
si
prodiictum intcl-
dcbet secundum rectarn
quampiam
NSM, axem vero A B in puncto S, pro quo
statuamus
intervallmn
Ad
AS z=: s
et
an^iilum
tam ex Y quam ex
hanc rectam
Z
Y P 113 (j
—
x) sin.
Cf).
per-
dernittantur
YP et ZP, eritque, ut in J. 22
pendiculares
A S N zn
est ostensutn:
-\-y cos. (p.
Vocemiis anguliim Z P Y zz: œ, qiio nempc inclinatio plani
planum tabulae determinatur ,
quaesiti ad
et
cum sit
Z P Y HZ g , erit
tag.
%
O'
sive ,
x) sin. <P-\-ycos.(p '
(s
quod usui sequenti magis accommodatum erit
COt.
ÙJ
ZZZ
^-
est
,
z
Quoniam autem
elementa proxima
^^-^-^
in
'
:
requiritur ut curvae
eodem piano
propositae
bina
MZN sint sita, necesse
ut inclinatio hujus plani, seu angulus oi, nullam muta*
tioneni
patiatur ,
dum
piinctum
Z per bina elementa pro-
xima promovetur, unde sequitur hujus anguli w non solum
dilTerentiale
esse debere ,
gente
erit
piimum, sed etiam secundum, nihilo aequale
id
quod
pariter
de ejus tangente et cotan-
tenendum.
Mémoires de l'Acad, T. FI.
1A
82
Snmatur 'jam
solis
cooidinatis x,
qiiato prodibit
sq
sz
î/'n.Cp
z
expressionis
capicndiim ,
% pro variabilibus,
)•,
_,
(ix%\n.^
"^
sa
nnnc etiam
quod quo
T>
^
facilius
p_
«77
z
za
qy cas
,
possit
'
•
secundum
diirercntiale
ficri
(J)
a*
est
ponamns brrvi-
— qy
f=
—V —
cuJLis
dilïercntiale
quationem
.
sit :
+R
Q.sin. (p
s
I.
»
ï;a
nt aequatio diiïerentianda
.
eoque nihilo ac-
gratia :
tatis
lia
sumtis
angtili w,
:
^eo%.^
s
cnjus
dilTerentiale cotangcntis
nihilo
z= o ,
cos.
aequale
positum
dat
istam
Q.sin.
+ 5R
cos. (p
=
sumns
aequaliones
ac-
:
— sdV — a
II.
Hoc
crgo
modo
qnibus ambas incognitas
„
R eos. tp
—
fit
ex secunda aut.em emergit
S
qui valores
si
opoitet.
:
5
:
-^p
inter
investigaii
C^
Q.;i>i. <p
p
^
2 )
et
i"
prima hariim acqtiationnm
.0\
^ )
adepli
diias
o.
.
,
se comparentur,
R^P — PdR
^
tag.Cp —
odP-Pac,.
reperietiir primo :
ex
Ex
83
vcro
tiim
sin
inter
ita
combinentiir
se
ut
dacatur in
i
RdP, 2 vcro in P9R, reperietiir fore:
cxistente
sin. (^
RdP
P3R
r= /rK3PCK. d p — p a R)i -(- (Q^a p
Ciim autem
sit
Simili
derivatur
modo cum sit
paR
,
p-
— Rap —
—
—
pp
unde pono scquitur
:
^"'""'^^
(p'q
differentiando;
1
'2
facile
p a sij-
— — habcbimws
f =::-
pp
unde porro
—
^'
difîerentialibus sumtis erit
p) z dx
»
^j
fore :
Rap_paR3:::: (PjL^upllî,
zi
Denique ob
gaR
^
=: ^"~-^
erit
(z
S.Q.
unde j multiplicando per CI,
His valoribus inventis,
tes
:
— Rag, 'j_
ax rf- (--_
""
dcterminaliones
.^
.xj-f-a'gÇp»
— qxi^
—
>)j
fit:
facile
Inde derivantur sequeiir
:
11»
84
- ^,
pq—qp'
tang. (î>
,
PY
.
z=i
sin.Cl)
p'
(^
— i
1
7W-^(P'i'- rpT^'
— qx) -^
Çpx
ff
—
y)
V?4' H- iP'f —Tf?
qtiibus
plani qunesiti penitns est assignata,
positio
igitiir
dum non solum punctum
inclinatio ejus
,
ubi
axem
tryjicit ,'
sed etiarn
ad planiim tabulae innotescunt.
Corollarium i.
25. Utraque formula tani pro intervallo j, quam pro
§,
angulo CP continet p^etcf. Oiiod si statiiamus p''iz:oet(/^zr:0,
•erit-
^ rz g et tag. (J)
est
linea
recta ,
et
punctum
s et
Hoc enim
.
casu curva proposita
omnia plana per hanc
problematis
condition!
si
=g
satisfaciunt ;
angulus
C|>
recta m
ducta
nnde mirum non
manent quantitates
est
indeter-
minatae.
Corollarium 2,
§.
26,
Idem evenit,
si
statuatur
z:=zo,
ita
ut tota
curva in piano tabulae sit descripta, tum enim erit q—O, qf-O,
ideoque
est ,
tg.
(I>
quoniam
satisfacit.
n: 5 et J =z g ,
ipsuni
ut
supra,
quod miium non
planum tabulae hoc casu quaesito
85
Co
J.
27.
Omnia
valoribus
supra
na tionem
03
tag.
i
autem
3.
haec clarioia évadent,
inventis etiam
quaeramus.
cj
o 1 1 a r i 11 m
si
ipsam plani qnaesiri
Erat autem ejus tangens
incli-
:
rz:
quae expressio, sponte evanescens casu z =: o , ob
(s
in
— x)
sin. Cî) -h
sequentem abit
tag.
(M
y cos. (b :z=
,
,
,
per p et q definitam
=1 tlJ-±JZJL:zJl)l
«•ocqQeoAo*»'^^
/
;
^,
ex
•
86
DLARUM CURVARUM TRANSCENDENT! UM
EARUMQUE PROPRIETATUM TiVESTlGATIO.
A Ur TORE
E.
COL LIN S.
Cor.vcntui exhibait die 3o Sepr.
1.
§.
Utiaque curvamm, quarum investigationem hic
scopo
niihi
18 ii.
proposai,
est
logaiithmica
ac
aeqiutiones,
quas lopeii inter coordinatas earum, similes inter se. Condilioncs , qdibiis dcterminantur iiae acquationes, sunt sini-
plicissimae ,
perinde ac
radiis
ciirvedinis,
snin
eas
habite
piius
expressiones
arcuum,
lectificatione
singulatiiii ,
respecta
ad
inde résultantes pio
cet.
tum veio
mutaas earuni
Conteniplatus
ambas
relationes.
conjuncte,
Itaque se-
quitar ipsa disquisitio.
Prohlema i.
5.
lab. II.
Inrcnire
2.
X
axis
curvam
,
abscissamm
qua ,
\ii
A B
V X ad tau^cntctji T Y
acquctur
,
si
a pimcto
erif^atur
quociinqiéS-
pcrpcndiculum
hnc pcrpcndiculum ubiquc
datae constanii Vvicne
a.
°
87
S o ] fi 'l
Positis
:
Y T X iz: 0,
:
d x rr TTT^^^ --^^ ,
C
minanda constante
— ««)
,
T -*- t' V •y
X ziz a l '^"^—^
7
unde
^-
-f-
coUiiritnr
^i ^
P'o
inte-
deter-
ponamus abscissam x cvancscentcm
y zzia , habcmtis
posito
:
hincqiie p :^ — ^-2L>z:i^^ et sepaïa-
x ^=- al {y ^j^^ ÏX
:
:
cjusquo tangrnte ^^ znz p, ob
va) jabilibus
giando
o
A X iz: x, applicata YX:=y, angnlo
ab<;cis5a
G\\iy^=.aV 1 -\- p p ^
tis
i
C zz: — a
— aa
/
a , liincque
:
•
Corollariumi.
Hac aequatione
3.
§.
sive
pro initio abscissarum,
modo
cadit in oculos , pro
ginariam, aeqiie ac pro
7
sjt
potcst
etiam
y
scribi
et
/ inventa
applicatam esse
/<o,
:zr
abscissam x
— /, (ob/> K j/ —
—
y-hyyy —
y — y y — ua
—
l^
•
cuni
x
facile
,
Ex illa enim patet pio x n: o, fab. ii.
tiactns cnivae.
definietnr
inter
-,
l
a
j
—-^^rz=: ^=z
aa
x r:i -3; a / -^-^^^-^-^
~
l
"
,
a.
Pari
fieri
ima-
a a).
Porro
y-\-y'yy —
^
/-
unde
a-t
,
**
seqiiitur
cmvam nostrain habere duos rainos aequales, RS et RS',
eosque
sine
vergentes.
iillis
punctis singularibus sempcr supra
axem
Fig.
2,
.
as.
Corollarium
§.
Relatio
4.
2.
cooidinatas
inter
cm^'ae
hiijus
YTXz=:(p;
egrcgie exhiber! potcst ope anguli curvedinis
cxpicssionesqiie inde collrctae pro x et
y = ,-.,% et X = « ;
'^ =
Sumto verùce
5.
R
j sunt
+ 0).
pro initio abscissariim
muta-
tisque axibus çooidinataium,
«;
.
tang.
I
o n.
i
qnod
sciibendo loco
efficitur
y et X, X'' -{-a et y\ prodit seqnens aequatio
/—
hincquc patet
-4-
/
fl
cmvam inventum esse Catenariam. (V. Traité
me^ibHbiH H3C^it)40BaHiîi
BepeBOHHOu AHuin,
BacJius
est
Ilnincp.
92- et
180?,
§.
Ana^.
HaynTî.
coi. CeivieHa Typhesa, pag.
T
6.
:
;
-^-
de mécanique par Francoeur ,
§.
:
(90»
î
S c h o 1
§.
etiam
II
e
r e m a
yivioapH-
Tom. U.
I23.)
1
curvaturae hujus curvae
uhique
acqualis
Nonnali.
Demonstratio:
Ex aequatione fundaraentali nanciscimur:
\ yy
lîinc
erit
Radius
— aa
*
•
O
»''
Yy
— •*
^9
9x(i -f- j)j>)^
~~'
cxpressio
^<^<^^
"""
ydy
a V yy
Eadem
'
y'yy--âlx
dp
pio Noimali
oiitiir
:
yy
•
— aa
eiit
enim
Scholion.
dcre
Hinc patet catenariani eadem proprietate
7.
§.
ac
ut
circulus ,
nempe sit Normalis aequalis Radio
Re vera autem ex acquatione
oscLili.
gaii-
:
Norm. in Rad. ose,
si
expressio
pio radio praedita fuerit signo negativo , re-
peiietur aequatio pro circnlo, at eadem, siimta
cum signo
positivo , dat aequationem hic inventam.
Theoremaù.
5.
yîrcus
8.
est
cwvae ,
RY,
aequatur rectae
VY,
quae
pars tangeiitis comprehema inter punctum curvae
Y et perpendiculum VX.
Demonstratio.
Ob dx zz
a^^
dy- -jfJr'^^ unde
;^f^
^^C' =
fTy-y^^Ta — ^yy — aa.
At y r= YX
a = VX, ergo arcus RY — / YX^-VX==:VY.
,
erit
-f-
.
et
Mémoires di rA(4H. T.
H.
12
fit
90
Th e
5,
dvscùpto
VX et VY.
redis
bliiis
m a 3.
ARYX, aequatur rectangulo YYZX
Arca curvae,
9.
r e
Demonstratio.
a y d'y
ay&y
/
— an;
Jydx — /7-:^^f^ = aVyy
—
icctangul-. ';^YZX.
dit ergo Arca A R YX rr YX V Y
.
:
Th e
Ç.
10.
r e
Superficies solidi ,
m a 4-
rotutione
arcus
RY arca AX
geniti,
aequahir superficie cylindri, cujus radius ha-
rz
VX et altitiido acqucdis semisummae abscls^
sis
•
sae et suhtangcntis,
i
Démon stratîov
Cum formula generalis 2
tt
// d s hic abeat in :
y By
-'^fyYsVj^^—Tî^ habemus integrando
ry VJi^aa -^aal y±l^I^If}\
Il
_L
Sup. n: 2 7r
:
"1
-^"^^^^~~ "°
aive , ob al
-
at,
^^
=z x ,
.,
erit :
= 7r(>-//7 — aâ-h«x) = 7r(YX. VY + VX. AX);
quia YX XP rr VX YV, hincque YX VY = VX PX,.
S
:
:
.
.
cïitdenique:S^7rVX(AX-hPXj-7:VX.APz:2 7rVXXiAP.
91
The or e m a 5.
SoUdum eadcm
11.
§.
^mitum aequatur eo-
rotationc
dcm cyîindro.
D c ni o n s t r a
Formula geneialis
'nff/dx,
L i
qiia
o.
determinatur illud So-
lidum, pio nostra ciirva induit hanc fonnam :
— ^frrXvyf^Ta
Sol.
Sûl.rraTT K-J-l
===
«^/>"^^^'Seu integrando:
j-la'n{yVjy^aa'^ax)
^
,
— ïttVX^. AP.(J. 10.)
Pr
f.
12,
b l c
curvam ,
Inrcnire
m a 2,
-
in
intcrvallmn
qiia
ubique acquale constantl cuilihct
VY jit Tab.
il.
^^*
^*
6,
S o 1 u t i o.
ObVYc=ib = YX.sin. VXY— /.sin (j^nr/XTr
djy
ciit
H;:
*
fP
6
p z=z ^^ =_^^-y-_-- ,
hincque
vaiiabilibus
sepaiatis :
y y — bb :=zbdx, et integrando
bx — l {±_y Vyy — bb— bbl(y± /j/ — 66)) + C.
3/
Posito,
.
y
ut ante,
:
x :^:: O pro yz::zb,
erit
C:z::^66/6, unde
calligitur fore :
12*
.
92
26
Corollaiiiim
Tab. II.
V'tCT
°"
5.
Pio
i3.
1.
determinando tractu curvae
valent eae-
S
'
dem fere notationes ac
supra
§.
3.
Liquet praeterea hanc
CLirvam habere cuspidem in puncto R.
Corollarium
§.
y,
exhibentes valores ipsarum x et
Acqiiationes
14.
ope anguli ciuvedinis ,
:c
—
Ll°£_f^
sont sequentes
_ 1 r^tffL^ — 1 (cot.
Th e or em a
§.
Tab. IL
^^'
i5.
2.
:
y =1 —-^ et
(p. cosec. Cp --
L cot. i Cp).
1
V et P jwictis, si normalis YP produu^r/uc ad intersectionem Q. mm recta T Q.
Punctls
catur
^*
ducta parallela rectae
VP:
intervallum
PQ. aeqao-
tur radio oscuU.
Ob Dret
dp^
cum s\ty
Demonstratio:
et pz=-^-^ erit V~i-^pp--=l^
^-^"^"^'
-ij^i-
hincque Radius =:
4-^^*.
At
— XX, 6.— VY et V yy — hbz=z\X, liabe-
mus hanc propoitioncni
:
,
93'
VY^
X Y' zz V X
ob
give ,
XY^ = VX
:
.
YP
Rad. :
:
-
erit :
,
VY':VX.YP=:VX: Rad.
sive
VY^
et ,
ob
VX^
:
YP
izi
V X^ = V Y
:
TV
.
;
Rad.,
fit
,
:
VY^rVY.TV — YP: Rad.
unde
colligitur
VY
denique
:
:
TV z= YP
Sch
l6.
Rad.
= P CL
Ergo Radius
§.
:
PonatLir',
1 i o n.
perinde
ac supra
7.,
§.
formulatn
yy i-f-g^^
exhibentem
lem
formulae generali pio radio curvaturae
esse
in quavis curva rectam
ut, sumta hac posteriore
dire aequatio
pro curva
cum
x ::=: r 6b
cummaxime inventa ;
tur mihi
esse
liquet
in
sin
autem
curva exhibita
^
ubique aequetur constanti
banc mutationem signorum
commendabilem
alia
— yy — hl t±L_^j±yi
est indolis, ut tangens
:
signo negativo, debeat pro-
eidem detur signum positivum, evadet
aequatione
PQ., aequa-
q^^e
talis
b.
Vide-
nonnuUis casibus
ad investigandas, ope cutvarum quo-
modocunque inventarum, aut novas curvas, aut proprietates singulares
curvarum jam cognitatum.
-
,
?4
TJicorcma
Arcxis
17.
§.
curv^e/^Y, aequatur sanidiffcreiiiiae tan-
gcntis et parametii
T'ab. II.
2.
'
b.
'
Fis- a.
.
Demon
Erît
unde
tit
liic
elcmentum aicus
integrando
oblinemus
:
s t r
TV
:
s z=zi (^
a t i o :
,
ds=V ^-^^jl~--^dy'—^l^
—
Pio tangente autem
h).
y y —
= - V"'^'' := ^f
V yy —
(Tang. — Param.). =z T V.
:=:, ^-2^'--±?
,
er^o
bb
Arc.
=z ï
1
T/i e or e7J2 a
iS-
§.
^rca curvac,
3.
ARYX, acquatur = trian^îi TVX.
Demonst ratio.
"
Cum sit pro hac curva eleiiientum yox zz: ^ ^ ^ ^
-
?
nancisciniur integrando':
Aream::z:^^^:=j;^=r|.^VX.^f:=|.ïVX.VT=:fATVX.
7Vi e
f.
19-
;•
c
ma
4*
Supeificlcs ^olldl ci£;quatLu- tricntl dijjfcrcntiac su-
perficicrum duoriim cyiindrorum,
pro radio
bascos
appUcatam Y X
quorum aller Jiahet
et
pro
altltudine
tcingentem TV, altcr vejo radium £t altltud'uwm aC'
quidGS coiistanti b :::::
V Y.
:
95
Demonstratio.
c ^yj-a. := c v-^^^
= ^;f ^ c = (:-^ -. ,6=)
o
I
— (27rYX TY _ 27rVY^).
î
.
Th c
§.
ma
5.
Solidum acquatiir summae
co.
quorum
et
r e
alter habct pro cîîamctro
altîtuclinem
baseos rectam
acquaîem suhtangenti
pro dcametro' rectam
sain
diiorum Cylindrorum,
TX
,
VX
aller vero
VY et pro altitudine abscis^
A X.
Dcmon
s
t r a t i a.
h'Y^y^ry - h-h ^ fr(rr-bb)X ^^-^yiyy-hbf
— fi^rr —
^^)
^yy — bb. dy (pbfVdQ_—V(l—f(XdV)
— y(yy--bb)' — 3fyydyVyy — hb-hbbfdyVyy^bb;
ergo 4-fyy^yyyy — 66 =:y {yy —
-|-6'x
hineque
66)^
(§. 1 2.),
t
5.
2 1.
cnrvaiiini ,
Progredior
quas
nonc
Positis scilicet vel applicatis,
angulis
curvedinis
colligiintiir
ad
comparationem
birraruriï
hue usque singnlatim contemplatus sum..
vel consiantibu.s, vel etiam
binarum crirvariim aequalibus
nonnnllae
relationes
mntuae
ac
qnas sequencibus theorematibiis demonstraba>
inter
se^
proprie rates,
utrique curvarum applicatîs et constan-
in
Positîs
2 2.
5.
anguli curvedinis unius cur'
tibus acqualibus intcr se,
vae
supplemcnta angulorum
eruiit
Sit
y applicata
et
a angLilus curvedinis
ob
rius ; erit
a
et
§§
4
pro altéra vero
a zn
§,
sin.
unde
f3,
lisdem
2 3.
:
:
:
/ rr ^^
y m ^j'-x
a
fit
ziz:
conditionibus
,
hincque
,
90°
—
(3.
stabilitis
zzi
Nonncdl
Subtangens
m
Siibiiormall
et
Positis ut snpra
-
vice
erit:
2**" ciuv.
Tangens i"*"* curvae
-
curvis,
curvae ac p angukis alte-
prioiis
14
pro prima curva
COS.
cpmmunes duabus
constans
et
alterius.
-
-
versa,
erit :
pro
pro altéra
:
a
îin. p»
a
sin. p. COS.
p
o. C»!. |3
"î7ir(F
-
a
at a ziz
§.
90°
24.
—
(3
lisdem
dinis
(J.
22.)^
admissis
proportionales
ergo
.......
etc.
conditionibus crunt radii curvecosinibus
anguîorum curvedinis.
97
Cil m sit
Rad.
1
ciirvae rr: -*—
C9>. a-
n
Rad.
1
Rad.
:
a. ccj^?.
5;n.i3i
COS.
2
m
Constantihus
2 5.
§.
.
a^cas.jB
1"^'
Suit.
2"'*'
Subn.
^-^-^
:
ai
cr
a/rz.'.
zn
^'1'-
-£^ rz: cos. a
nngulls
et
curv.
.
>
aequaJibiis
:
cos
positis
appHcatae
1^'^
ciirvae,
appUcatae
1^"'
cwvae.
p.
erit :
Fx demonstratione Ç. 23 patet esse: Subt. i c zr "-'^-a et
Subn. 2 c =^-3; si eigo fuerit a:=z (3, erit, ob §§. 4 et 14:
•*
.
'
lia.
.
Subt.
i
c .zn. applicatae
2
c,
et
Subn. 2 c
Scliolion
5.
applicatis
scissam
X
Quod
26.
et
prioiis
zz appl. 1 c.
1.
attinet lelationem
conslantibus
.
aeqnalibus
abscissarum ,
positis
dénotante
x ab-
et
curvae ac u abscissam alteiius
+ u — y^^pl^ — Subtang.
2
2""' cuivae zz:
,
colligitur :
Subn.
1"''^
c.
Scholionc.
§.
27.
Mente concipiamus tertiam curvam^ ciijns applicatae T^b ti.
sint aequalcs- applicatis
A-ero
lis
tae
binamm illaruin curvatum, cuilibet
lespondeat abscissa aequalis aggiegato abscissae piio-
curvae et abscissae alterius bissumtae ,
Pro
rcspondentium.
iiac
ttm acquationein algcbraicam
M moiiti ael^Aai.
l
.
T/.
eidem applica-
nova curvd habenuis seqiien:
^ 3
S-
^'
9$
y^ yy —
a'
quae
est
ejusmodi
recta
AY
demissoque
ut ,
indolis ,
A Y, intcrvallum M Y ^it
28.
AJtcniter
r c
hissumto
alteriu?
prohl.
parameter
si
a.
m a.
ramonim curvae
curvac piimi prohl.;
paramétra
X ad ipsam
uhi(iuc acquale constanti
Th e
§.
ex piincto
perpeiidicuh
A et Y
puuctls
junctis
IL est evoluta
iUiits,
hngitudoquc
dat arcum evoîutae constante
aequetuy
6,
fili
excu-
a.
Demonst ratio.
CapiatLir
vertice
sit
ejusdem
concava
horizontalis.
deturque
stitutis
ipsae
priore
curva in
cm vae talis positio
ut
,
supra sumatur
ad axeni abscissarum ,
qui ut
Hune in fuicm,
nova abscissa zr x^ et
nova applicata iziy',
poni. débet
pro
coordinataruin
initiuni
in
positis
aequatione (J. 2) x
y z=. x^ -j- a et xz^y,
nanciscimur
=
a/ -~^^j^-^=-^
quibus valoribus sub'
:
y — al ^1+ + lîf + ^'\
"
-'^
'
Ad investigandam evolutam hujus curvae designemus ejus
ladium osculi, normalem
et
subnormalem
pro evoluta autem ponanius abscissam
literis
zzi t
r,
n et >n;
atque applica-
tam ^^li) habemusque ope formulariim vidgo notaium
:
y
99
At,
r ^z.
ob
"
dV
Y
—--^
t
,
a
/
p' r=: -^A^_=.
-=:
n in
rz X''
+
-
et
m z=z -r^-l^
/
^
-*
+
a)
zn 2 x'' -h a
(x''
—
u zz:
et
seu
Nunc,
si
in
x''
hincque
,
:n '-^
«a
fili
in
çrit
et
—
a l
4a
unde patet longitiidinem
lem esse quantitdti
ar<t-(-x')
->•--
dp'
y,z=z
verlice
\
evokuae
)
aequa-
a.
curva 2 probl. ponatLir
hznia deturque
eidem talis positio, ut axem abscissarum spectet latere convexe, abit aequatio pro eadem inventa, §.12.,
.y
—
in sequentem:
' "
4 a
Sin
antcm initium abscissarum appropinquet vertîcem ver-
sus qujntitate a,
quod evenit ponendo
x''
zz x''"'
+
n,
4 a.
quae aequatio peifecie congruit cum aequatione A.
ceoooc^oocoot
i3
erit:
lOO
M E T H O D U s
A C
F
I
L
O R
I
IXVESTIGANDI NOVAS ILLAS SERIES,
QUIBUS EULERUS SINUM ET COSINUM ANGULI MULTIPLI
POSTREMO EXPRIMKRE DOCUIT.
A U C T O R E
F U S S.
N.
Conventui exhibuit die ii Aug.
§.
calcul!
viri
L.
1-
In
Eidcrl ,
ut
quae
et
et
cosinus
Ucet, laudatus ille
1'
dem, ut ipse ingénue
rum exigui sunt
quibus
ad eas
tatem logis,
:
tlieorfa
mcritissimi
Impériale
in
multiplorum
exprimcre
exhibuciat,
quae qui-
multiplicatione angulo-
quas autcm, ob calculi
fuerit perductus,
des
De sciiebus memorabUibus,
séries
f\itetur;
subsidii,
Académie
angulorum
Geometra
de
Tomo quinto Disscitationnm
de
Sciences) fuit inserta sub titulo
sinus
et
de uni versa malhesi,
nuper
(Mémoires
academicarum
quibus
qnondam
dissertatione illustris
angulomm,
i6i3.
artificia,
obque egregiam simplici-
sccundum quam termini serierum procedunt,
Geometrarum atlenlione non indignas
tem, de quibus hic sermo est , in
nuni nostrarum pag. 63. et 72.
ita
censuit.
Séries au-
Tomo V Commentatioexpressae reperiuntur:
101
>1
C05.2X^=z
— (^
2
\^
sin. (î) sin.
0—
^
Q sm.(p^cos.2(^\
8 Q)sin. (î)^sin.3 0-l- i6 Ç) sin 0*cos.4(î)f
^^ ^^^ sin.Cp^sin.SCp- 64 (|) sin.Cp^cos. 6(p/
(-4-128 (;)sin.4)^sin. 7 Cp4-2 56 (|) sin.CjJ'cos. 8CÎ))
etc.
etc.
Cp—
4 (;-) sin.(|)-s n.2(p
8 nsin.(p^cos.3Cl)-h
16 (^) sin.Cp's 11.445
2 (=) sin.Cp COS.
32 Qsin.(î)^co3.54)— 64 (^)sin.(î)«s
,—128 (r) sin.Cp'cos. 7(p-h256 (3) siii.Cp^s n.8cp)
etc.
etc.
Ubi characteres uncinnlis
tcint
potestaiis
Eulcro et
aliis
séries
procedens
hoc modo designatos.
secundum
tum veio
,
characteres
aliquanto
lîiihi
Cum
sit
(') ,
autem
ista
methodus
piohxior
sed
etiam
,
et
magis directam ,
3-,
non
4*
in
ex
^^~
^^^-
sokim
indactioni
tribuatur,
in-
etc.
(-) ,
(;) ,
termini his coëfficientibus atTecti
quidem videtur, nimis
pliciorem
in
est,
ut pio ces. x
redit:,
evolutione casuum specialium x :zz 1 , 2,
ducantur.
deno-
jam ab
cocfficientes raultoties
harum senerum , eo
vestigatione
fingatuf
binomii
etc.
(-) ,
(^-) ,
(^) ,
Methodus autem, qua Eulerus nsns
2.
§.
x^"''
inclusi
justo
ea ,
ut
viam ahquanto sim-
ad easdem
séries
ducentem.
—
i02
qnod qnomodo mihi
tentare volni ,
successeiit
ex scquen-
tibus pjgellis perspicietur.
§.
stat
Ex
3.
Analysées trigonometricae con-
elementis
esse :
COS. 2n (^ -{-^Z
COS. 2n (P
—
— —
]/
1 sin.
1 sin. 2 m Cf) zz: (cos. 2 CP
iinde conckiditiir fore
—
— /—
=: (cos. 2 Cf) -f-]/
2 n
i
sin. c (J))",
i sin. 2 Cf))'',
:
2 COS. 2 72$=: (cos.c CpH-/— i sin.2 ($>)''-4- (cos.2$>
— /— isin.20)''.
Jam loco
anguliim
anguli
diipli
plicem cp, et cum
cos. 2 <p
2
sin.
sit
z=.
2 Cj)
introducamus
siiu-
:
—
i
0=2
2 sin. (p- ,
sin. Cp cos. Cp ^
his valoribus substitutis nanciscimur
:
/— isin.(p(cos.0-t-l/— Isin.cP),
cos. 2Cp—']/— sin.2Cp^: — 2 /— isin CP(cos. Cp — )/— isin.cP),
cos. 2(P-i-/— isin.2(Pii:i h- 2
1
§.
Statuamus nunc
4.
ponaturque
1
cos. cp
-h
—
atque habebimus
>/
—
I
"/
—
1 sin. (p
2 sin. cp zz. 6,
sin. Cp
rr p ,
=z.
q ;
:
+ / — sin.2Cprz
2Cp —
—
2Cpzz:i
cos. 2Cp
Hinc
gratia
:
cos. (p
COS.
brevitatis
j/
igitur seqnitur
2 COS. 2 n (P
1
1
isin.
fore
~\--
—
bp}^ —
bp'/
1,
1.
:
— {i -^ b p y — l)''-f-(l — 67 /—
1)*,
103
factaque evoludone potestatis
(S + C) b
\
Cnm igitur sit
(p
(/^'
(p'^
—
etc.
etc.
+(:; ^' ip'
)
horum binomiorum erit:
- q)V~l- O
- /- +
_ / - - Q)
(p
h' ip'
_)-(})
rz
2 COS. 2 n
Ji^"^
lii
-h q^)\
7')
1
h^ (p* -+- rr)f
7'}
1
b' {p^ -I- crA
/
:
/—
—
— /— — —
— /—
—
$
1 rr:
2 sin.
7')
1
:
2 sin. 3 Cp
P* 4- 7* .= 2 COS. 4 Cj)
7^)
1 rz:
2 sin. 5 (p
p^ -h 7^ r:: 2 COS. 6 (p
7)
Cp
p- -\- q' :=! 2 COS. 2
etc.
etc.
Si
b^ (p^
valores
snbstitiiantur ,
tiim
vero per 2 dividatur,
pio cos.2n(P emergit hacc séries:
(
1- (") b sin. <P~Q b'cos. 2(p-hQ) b'sin. 3(pj
^
cos. Qn'P:iz<
'
(,
etc.
(-+-Ç)6^cos.4(I)-Ç)6^sin.5CÎ)-(^)6^cos.64)^
qiiae est ipsa
sa
séries
et absque tantis
5.
Q.Lioniam
5.
Euleriana , commodius tantum expres-
ambagibus
valor
eruta.
litterae
n nullo
modo ad nu-
méros integros et positivos restringitur , siquidem evolutio
binomii Newtoniana ,
pro fractis
est
,
ex nostra
cui
praesens methodus
insistit,
negativis , et adeo surdis valeat ,
solcitionc,
seriem illam
etiam
manifestum
veram esse, quicun-
que numeri pro n accipiantiir, id quod ex methodo Eule-
104
rinna
niillo
modo
liei
truditae
ad
videtur (Conf.
numéros positives
c.
1.
pro
n
= —i, atque ob O := —
(''):r:-|-i
tis
et ita
porro,
notabilis egregiam
si
siimatiir
rcstringeie
unico saltem excmplo
numerum negalivum
(^) = +
l ,
1
,
summationem
(^
—
piita
,
(p rz
obdnebimus sequentem
(i-4-bsin.
COS. 2Cp
Ita
et inicgios
pag. 60, 61, 62.).
siimamiis
illiislremus ,
n
quippe qtiae potins veiitatem se-
Quo hanc siimmationrm
6.
§.
patet,
-
1,
seriei sa-
:
^'sin. 30-f- 6^sin.5(I)
—
etc.
j
__i,2ç.Qs,o(p-^.h*cos.4(p~b^cos.6(p -{-etc.
Cf)
zz: 45°,
piodibit
:
0:=H-l— 2 — 4 — 4-f-8-f-l6-H 16— 32— 64— 64 4-12 8-^- etc.
ciijus
Veritas est manifesta, et
séries
ista
discerpatur in tcrnas seqiientes
=
o
<-f-
(i— 4-+- 4^ -4^ -1-4* -4^-»- etc.)
( 1
Si SLimatLir (P rz 3o°,
î zz: 1 -t- ï
si
cerpatur
hacc
:
-4-f-4^-4'-^4*-4^-f-etc.) J
(1
—2
— 4 + 4^ — 4'
habebimus
— — —
séries
ï
si
:
(~i-
(
At
adhuc evidentior evadit,
-i-
4*
.
— 4^ 4- etc.) \
:
1
î -j- î -4-
i-f- ?
in
stqucnies
ei
— — —
ï
1
i -4- etc.
acquivalcnLes
dis-
loS
— + — i-f-i — 1-fH-i[i — iH-i — iH-i — i-h
^ï[i — + — J-f-i — i-h
[i
-f-
1
etc.]
1
etc.]
etc.]
1
1
Veritas sunimationis est obvia.
Si
7.
5.
finité
parvum ,
casa
erit
generali
série
in
Iiabebimus cos. 2 n Cp z::: 1 ,
vero hoc
tiim
:
n
(7)
m
T
tt
(t)
n
(f)
n
zr:
—
2
3
.
—
3
—
'2
^^
"[
r
•
3
y
4 '
4
:
h —3—-
J=coî.2<p
'
Hinc aiitem sequitur
'
2
r
n
h sin.
j
rt
i
unde, facta divisione per n, et substitutione
habebimus
T —
I
r .
et ita porro,
peracta ,
;
—
—
(7)
Easdcm
inventa ponatur n in-
4.
%.
^
'
4
64 COS. 44>
2
4
in
'
—r—
6^001 6 ;J)
,
^-
^'^^^
"^~"
etc.
6
6?j/n.5
^
^
6«coî.--:|>
séries
y^
)'
inter se aeqnales fore bas séries :
63 ;/ i. j^
ij>
64 COS. 4 (p
~~~
5
/:
6"cos.6(p
^^
"^
6
dissertatione saepins citata, pag. 64, Eu-
ex alio fonte, rcmotiore et minus naturali derivavit
lents
atqiie
aequales esse ostendit.
5.
po.sitam
8.
Alteram
qnod
seriem
attinct ,
pro
facile
sin.
2^4) snpra $. 1
inlclligitiir
eam
ex-
simili pror-
,
io6
modo
sus
Cuin cnim ex
inveniii posse.
§.
bab^ainns
3
:
2|/-isin.2//^=3(cos.20-f/-isin.2(î))"-(cos.C!(p-/-isin.24))'*,
loco sin, 2 (J) et cos. 2 (p valores supra
hic
si
veio dcnominationcs b
tuin
stituantur,
,
p , ei q
introducantur, facta divisionc pcr ]/
litae,
§.
—
,
i
3 dati sub-
5.4
srabi-
habebiiniis
2 Sin. 2 ,,^^{iJzlPX^rijr:^~^'i--!y' ,
qnae expressio,
rite
cvolulis
quentein subministrat seriem
.
•^
-
sin
-U
c^
)
6^
Cum igitur sit
p -f- g
-f 9^) -h
*
h^ iP'
m
2 cos.
^
'
(p^
(p*
p^ 4- 7^ :r: 2 cos. 54)
{p^
*
1 (
)
— / — =: —
— q*)V — = —
— V — =^ — 2
q^)
q^)
Q
1
2 sin. 2 (p
1
2 sin. 4 Cp
l
sin. 6 (p
etc.
I
hi valores substituantur, séries qiiaesita
^
7^;
etc.
p^ 4- (/5 =1 2 COS. 3(P
sin. 2n(î) zrz
- r) /- 1/
- />
b'' (/^-^
:
etc.
Si
O
C)
etc.
^
se-
:
(") ^' (p' + V^) ^ — )<
^
(p^
'^ /luj
•-
binoinioium potestatibus,
ita
se habebit:
- (I) 6^ sin. 2Cp - (-")b'cos. 3(1)
^
^4_ (" b* sin.40 +
b^ COS. 5 Cp - etc.
^
b COS.
^
,
)
„
(
cum
)
dissertatione
quae
séries
pai^.
72 exhibita, consentit, de eaque, ob rationes supra
§.5.
jani
itidem
allatas ,
Euleriana ,
in
citata
aequo jure ac de piiore pro cos. 2 /i 4>
J07
inventa, asseverare possumcis ,
n, integro vel
bet numéro
Illustremus
9.
termini
fore
scrici
sm.2n(p,
quidem
si
obtinet
evanituri ,
nolandum est,
mox
tantopere
(p
exempla
increscere ,
rz 60°
et
(p
in
90° ,
omnes
summa
eorum
zz:
ac
Sin
autem
non cvanescit, sed
sin. 2n(î)
eos hoc casu, ob 6— 2sin.(Pzr2,
ut
eorum summa
ut cuique constat ,
seriebus
z^ 45°
exem-
verum idem etiam de terminis
scilicet:
possit finita , cujus rei ,
dantur
aeque
(|)
aliquot
n numeius intcger.
fuerit
valorem ;
seriei
sumto
patet ,
n fuerit fractio, tum quidem
finitum
positivo vel ncgativo,
hanc summationem
Ac primo quidem
plis.
fiacto ,
vel surdo.
rationali
§.
cam verara esse pro quoli-
xid
fieri
innumerabilia
divergentibus.
hujusmodi
iitique
séries
Etiam casus
divergentes
perducunt.
§.
10. Sit igitur Cpr:3o^ erîtqtieb-i etsm.'2n(pz:sin.—,
cujus \alor per seriem
ita
exprimitur:
dn."fr='-^[(:-)-eH-(",)-(;)-.(^)-e + 0-etc.]
unde
si
loco n successive scribantur numeri 1^2,3^4,610.,
scquentcs inde emanabunt valores
sin.
—
3
Sin.
o
—~
z=
sin. l^-
zzz— ^}
sin. 1^
= o,
2
— rr: —
sm. ^^ n:
:
sin. -^
3
*
<[m omncs egiegie eu m veritate ^int consentanei.
J
,
io8
Sumatur
11.
§.
(^) =: -4- 1
(|)
,
sm. — =: —
z= —
sin. -
est
sin.
,
V3
-zr—
12.
(^) z:z -h 1 ,
,
=—
1,
veio
erit :
sin.—
— — ^ [— 2 — 3
,.:
-f^ 5 -H
sit
et
ita
porro.
Tutu
6 — 8 — 9 -4- 1 1 -M 2 — 14 — etc.],
lepraesentemus
ita
:
— 5 8 — + 14 —
^-+-3 — 64-9—12-4-15 — 184-4-
__ ^3 ^-h 2
*
cinn
(")rr~2, (^)r=-f-3,
eritque
(")i=i~4, (pz=+5, (")=:— 6,
^^^
et
requintur.
X
uti
,
Sumatur «
qnod commodius
etc. ,
24-2 — 2-f- Ctc]
—2+2
5
3
5.
1
erit
sin. -ZIZ-^[2
3
hoc
nn:— i, ita ut habeamus (y) = --1,
1 1
1 7
-f- etc,
etc.
Ilarum scriemm, difTerentias primas constantes r=:3 habcntiiim,
siimmae
vero zzz^
ertint :
— l^^l»
^^^
superioiis
"^
^^^
n: |
—
^
:=:i,
~ ^^ "T 1^4+
sm. — zn-^
^^"'
1 ] *
inferioris
^^^
^^^
•
3
«ti requiritur.
Ç.
i3.
Siimatur nziz—3, atque habcbimns (")iiz— 3,
O^H-^, (f)=:~-10, (-^=4-15, (;)i_2I,
(^) 1^:4-28, et ita porro;
4-
erit
per seriem •
— 4- 36 — 66 4- io5 — etc.!
4- 120 —
6 — 21 4-45 —
"4- 3
sm. 7: :^ -
tum vero
1 5
•?8
etc.
109
qnae
cum habcant <iilTerentias secundas
séries
constantes,
modo , ope regulae cognitac , de-
carum summae sequenti
teiminari poterunt :
Pfo priore
12
i--
l53
io5
9999
—
—
3o
21
summa erit |
crgo
66
36
i5
3
39
-f- 1 zr
48
etc.
etc.
etc.
|.
Pro altéra
6
i5
ergo siimma
quitur fore
12Q
78
9999
—
24
erit
42
33
^-^
zzi ^
-|- |
171
5i
etc.
:= -f |
= "^
[|
—
|]
natura postulat.
§.
14. CasLis notatu dignus hic
do n assumitLir
infinité
2 /i vf) HZ 2 « (p ,
omnino
littera
séries
arciim circularem
sinus
multiplorum
per
ut iam supra
e
si
7.
adhuc
se-
se offert, quan-
tum enim
tota
constat
séries per
fieri
n dividatur,
formula expellitur atqiie habebitur
quemcunque 2
per sinus et co-
ejusdem arcus exhibens.
ob hune nuraerutii
n ,
$.
parvum ;
unde
haec
divisone
Hinc autem
.
= o;
rci
sin.
etc.
etc.
:
sin.T
iiti
45
21
vidimus
:
infinité
Facta
enim
paivum j erit,
—
119
(-)
"
= -7
(n \
—
n
n
I
n
—
I
n
—X
2
et ita
pono, unde
^^ v_|_
§.
i5.
2
n.
—
sciies
noslra eiit
b co^
—
rjir_jr
Cam
igitiir
j^
j
4 '
4
j
!j>
_
,
bicos.7^
-^---.3.:r
-
hoc
-
,
_j_
-{-
modo
Çîeoî. jA
—^jj.
^-^
—
—
etc.
etc.
invenerimus
arcutn
circulaiem
qiiemcimque 2 CP vel 0, per seiiem expiessiini
secLindum
sinus
cosinus arcuum multiplorum proceden-
et
lem, non inutile
nunc quoque pioblema inveisum ag-
eiit
gredi et exploraie
summam istius seiiei_, quasi adhuc esset
incognita. Disquisitio haec, non
parum aidua, practerquara
quod nobis *jnsam praebebit
in
usuni vocandi varia
contemnenda calculi
quoque ipsam veritatem stim-
aitificia,
haud
mationis illius memoaibilis , paragrapho piaecedentc traditae,
adhuc magis conoborabit§.
16.
Cum seriem, cujus summa qnaerenda est, jam
discerpserimus in duas,
quarum
altéra scihcet secundum co-
altéra vero secundum
sinus
arcuum mulliplorum imparium,
sinus
arcuum multiplorum parium procedit ,
"
séries
u et
v,
ita
ut ;
vocenlwi; hae
m
u
-
z:^
— -4- — -— — etc.
—^ —
—
V =.
aîque inquiiendiim
^^
habito respt-ctu ad relationeni, quae inter
Qiioniam igitur 6 spectare
17.
non prndeat,
£;rilo
^p
riei,
nihil
tur,
eritqiie
\l
Quem
utriusque seriei summam seorsim investigemus, niillo
in fincni
§.
etc.
valorem snmmne u-{-v.
in
erit
+ — f~ —
si
6
et C^ subsistit.
licet,
quasi ab an-
su ma mus differentiale primae se-
impcdit qiio minus littera h ut constans specte:
— — hsm.
(t)
-L-
h^ sin. 3 Cj)
—
6^sin. 5 Cp
-h
etc.
Hanc seriem jam ducamus intrinomium i-i-2 b-cos.2 Cp-f-b*, et
cum
sit
:
c COS. 2
adhibita
sin- ?2 4^ =1 sin. {n -{- 2)^ -f- sin. {n
hac redtictione habebimus
—
2) Cp
:
— ^^ =: — bsin. Cp h- b'sin.SCl) — 6^ sin. 5 CP h- 6^ sin. 7 4) — etc.
2 6- cos. 2 0^^=;— b'sin.3(pH-b^sin. 5Cp — b"sin. 7(p-+-etc.
— b'sin. (pH-b^sin. Cp — b^sin. 3Cp etc.
— b<||=
-*-b^sin. (p -h b'sin. 3(p — etc.
-f-
-»-
unde
deletis terminis se
( i
-j-
mutuo destruentibus nanciscimur :
2 b' COS. 2 (p -f- 6\
ex qua afquatione
seqiritur
II
fore :
— - b^X—hb)
sin. 4)
112
Qno nunc intégrale hiijtis formulae commodius
iS.
§.
assignare valeamus, loco cos.
2 Cp
scnbamus
g cos. (|)^
—
i
in dcnominatore, eritque :
—
— b{\
bb)d(Psin. $
d u :::=z (i
b h)' -h 4 ht coc.(f)-
—
'
Vocetiir jain '-^^^^zuzZy fietque denominator :
(i
— bby -^ 4 bh
COS. <P^
— — 66)^(l
(l
—;zzjb~^ —zdz,
Biimerator vcro, ob
-\- zz) ;
fiet :
— è(i — bb) d(psm.(p=zi — bby di
(i
unde
statim concliidittir fore
du = i
.
cujus intégrale est
:^-,
:
—
u z= î Arc. tg. 2
19.
§.
hoc
:
Nunc alteram
Arc. tg. '-^"^^ .
seriem v
est ejus difTerentialc ,
1 -f- 2 fc 6 COS. 2 4) -f- 6*,
ï
eôdem mocto tractemiîs,
per d CP divisum ,
atque habebimns
ducamus
iû
:
— 6«cos.4Cp + 6'5cos. ôCp — b^cos. 8(î)-hetc.
6^cos. 8Cp— etc.
â+-2 6='cos.2(î).^Ji=:-+- b^Cos. 4Cp — ¥cos.6(P
b^cos. 0(p — b'^cos. 2Cl) -^ b^coc 4(î)— etc.
-f-
|J=:
6=^008. 2C|)
-+-
•4-
-v-b*.|!=
Hinc ,
hncc
terminis
deletis
acqiiatio
se
H- b*^ cos. 2 (p— b" cos.
40 H- etc.
mutuo destruenlibus
nascitur
^
:
(1 -f- c bb cos. 2 Cp-f b<)^J=:zb^(cos. 2(p-f-bb),
»
Ii3
ex
porro eliciUir
qiia
§.
Integratio
20.
stataatar
:
-'--/t^—
H— àocos. 2-;s
(p
formiilae
IiuJLis
enim denominator
tuni
z,
1=::
facillima ,
fiet
si
fiet :
1
4- 6* nz ( 1 -f- 6 6 COS. 2(py{i
1-4-26- COS. 2
numerator autem induet hanc .foimam
formula jam évadât
ut tota
=
dv
i
§.
seiiei
^
notjssimae
A
^
0-
t>"
.
ex
:zz
ï
!.
'
6 6 S7TI. a <^
-I- 6 & COS. 2 (f)
1
*
-^^ -|_ ^ A
tg.
summa
ambabus confldtae
.
tg.
erit
r-^,,,,,% .
unicum colligamus, ope
redtictio-
:
tg.
^-4-
A. tg. ^=: A ..tg. îj^r-f:.
sit :
:^ 2 bcos. Cj) =1 4 sin.
—
Arc.
ts.
"
O*
modo summa utriusque seriei u et v,
illis
arcus in
eu m nostro casu
TT
X
ts:.
— iA.
Hos iam duos
et
Arc.
propositae
u-Y-v
nis
:
Inventa hoc
2 1.
:
-i—
.
CHjus intégrale est
V zn
:
— 1(1 -f-bb cos.2CP)'Dl,
b- {cas. 2 <p -\r bb) d(p
ita
4- zz),
— 6 6 — —4
n: 6 6
2
n4
1
1
sin.
Cp
r :=: i -^ 66 cos. 2 ($1:121
MfmircsderAcad. T.FI,
cos. (J) ;
'
(p sin. 02 ;
sin.
0^ sin. 2 (0 ;
+4
sin.
(p^
^^
cos. 2
(J)
^
,
numerator
mus fient
tangenlii, cujus
denominatoi'
et
J.
summa
anlem
ad
avcus
reducetur sequentem in modtim.
—
4 sjn. Cp COS. (p (i
1
ita
ut
sit
u
•
et
—
?>
summa sericrum
-]-
V zn
l
cum noverimus esse
1
—
2
sin. (J)^
StatiialLir :
2 sin (p^)
—P
,
Q
:
Arc. tag.
4 sin. Cj) COS. Cj)
formani
~\-^ sin. (p* r^
sin. (^"^
;
:
zr:
2 sin. 2 (p ,
m
COS. 2 (^ ,
«janifestiim est fore :
P =: sin. 4 Cp.
Tu m vero constat çsse
COS. 4 (p r= 8 COS. Cp*
Htnd.e
cum
—8
cos. (p*
+
i
sit :
COS. Cp' =z 1
.CDS.Cp* n: 1
—
—2
et
sin. Cp*
sin. Cp-
-"t-
-f- 8 sin. (p^)
quaesita nosirao sciiei
per unicum arcum ciicularcm;
Iste
2 2.
2sin.CÎ)^)(i -f-t'^sin. (p^)
(l
valoiibus sabstitutis
erit
—
= — 8sin.(p^ H- 8sin.Cp*)(i
_7ro-
^TT
cxpressa
qUiicii-
:
7:r-f- ^cr=:4sin.CÎ)cos.CÎ5(i
quibus
arcum
sin. Cp* „.
>
erit
enini
:
simpî.icissiraam
,
li5
facile intelligitur fore
COS. 4 (p
ita
:
— — 8sin.
1
4^-
-h SsinCj)*,
ut jam nacti simus ;
a = COS. 4
(p ;
unde pono scquitur
fore
u -I- z; zr ï A
consequenter et
§.
arcnm
esse
== 2 4)
tg. tg. 4
.
summa
Cum
2 3.
summiim quaesilani u et v, hoc est
propositae est :zz 2 (J).
seiici
:
— |t'cos. 30 —
6
—
2 Cj) =z 6 COS. ($) -f- ï b^sin. 2
.
ut
hanc
qucns
4- î 6^ COS. 5
siimmationem
statuamus
modo demonstraverimus
duplici
igiuir
:^: 3o° ^^^
4- § 6^ sin.
ï6*sin4(I>
etc.
unico saltem exemple illiistremus,
7 . eritque b zn 1, unde emergit se-
siininuitio :
Z — t?
rn-î
^^ 3
2
*-
3
—
"^T^^S
— — JL-L.X-4-i
modo
commodissime
ï_4_i-4_i
ï
4
5
J10.
çiijus
veiitatem
licet.
Consideietur haec séries generalior :
sequenti
5 z:: 2- -+- 1 z*
qiiae
in
tidla
ddt
—I
z-*
—
2.^ -+-
I
abit posito
ir. 1 -f- 2
— z^ — z* -^
ostendeie
seiies
7,^
-{- z'^
— —
2'
etc
15*
•-
difleren-
:
^,'
etcl
cil^.j
— Y5 2'° — etc.
î x^ -I- 1 2®
zrz:!. Haec
nosLram
'^I3^^^I4
Il
.
1
Est vero snmma huius
que habebimiis
exploïabitur ,
antem hnjus formnlae comtnodissime
eam
si
4
repraesentemus
ita
— 4a + 4Z«
enim
forma
(i
:
— z)-H-32S*
denominatoris
statiin
Limera ton formula e
—
49z
licet
siispicari
negotium absolvi posse statuendo f^;^ iz: x ,
Il
idco-
,
H- sz
SB
Intégrale
24.
hac
—
:
1
Ex
^-—
coirnita zz:
seriei
—
S
Ç.
16
tum enim
fit
:
:f^
(2
—
z)« a X ,
denominator vero evadit.
— 4z + 4zz zz
4
^uibus substitutis adipiscimur
os
^^
unde integrando
j.
Hoc
intégrale
A
:;
fit :
tg.
.
a:
evanescit ,
in— cxhibiiit supra
f[Uod,
^-^
-f- 3;3r)>
2)* (i
=
posito
tg.
~^\
zzizo,
uti
.
zzni,s abit in seriem illam
sumto autem
Bunc
—
,_^,^,
.
^ A
=:
(2
§.
2 3.
valorem
arciis
,
lequirftur;
qnae ,
—,
ita
dticta
ut sit
:
^
=
';î
ob
A
tg. 1/ 3
.
.
^. A tg. /3.
nzy, nianifesto cum vcritate consentit..
117
Anteqiiam huic dissortatiuncLiIae finem faciam,
2 5.
§.
adhuc
monendiitn
Gosinu
arciis
demonstratis ,
tione
muUipli
exhibitis ,
citata
ac
habeo,
hic
ab Eutero pio sinu et
scricbus
2 ii (p in dissertatione cjns
saepius
vero ninlto commodius expressis et
tam ob majorem usiim , quem
divisione angulofum
in
multiplica-
praestare possunt,
siniplicitatem in lege progrcssionis
quam ob
conspicuam , longe an-
jam altiquoties pro sinus
tcfciendas
esse eas séries ,
€t cosinus
anguli multipli, postremo in novorum Actoium
Tomis
séries
IX. et XII.
ita
-
se habent
in
qiias
médium attuli
ac deraonstiavi.
Hae
:
- (|)tg. 4)^4- (f)tg.CÎ)5_ etc.
cos,n(p — cos.(p\L'{j) tg. Cp^4-(^)tg.0*-(y)t§.Cl)« + etc.].
s^n.
n (p
COS. 0'^
[(^) tg. (p
••o«o^^ei»««r^
J-.
118
INVESTIGATIO TERMINORUM SERIEI
EX DATIS PRODUCTIS QUOTCUNQUE TERMINORUM
CONTIGUORUM.
A U C T O R E
F u s
A^.
s.
Convcntuî cxhibuit die 25 Aug. i8i3.
1.
5.
Sint a, h,
Ct
d^
etc.
termini
redit, ut hi termini detcrminentiir,
si
seriei ,
et res eo
vel binorum, vcl ter-
norum, vel quaternorum etc. terminorum contigLiorum producta fuerint data.
plicissinium ,
qnod
Piimum quidem casum , eumquc
sim-
quo nempe produGta ex
binis
attinet ,
terminis coritiguis cognita
pridem
a
icperitLir
que
in
Tomo
primo Opiisculorum analyticorum ,
modo , per interpolationem nimirum
continuas,
Cum
autem
istud
modo memoralum Geometram excipias
quantum qiiidcm mihi constat,
,
accommodatam,
licct
id-
pcr
et
argiimentum ,
a
tractdtum fucrit ,
minus dircctam
si
ncmine adhnc,
opcrae
pretium mihi vi^um est, methodnm priotcm, uipoLe
niagis
j.im
sumino quondam Geometra nostro Eulero soliitum
duplici
fiactioncs
piobicma hoc
assumuntur ,
ciiain
ad
iisui
illos
cnsus extendeie, qnibns pioducla ex ternis, qiiateinis, quinis, etc.
2.
§.
ternùnis contiguis ut data s ,ecLantur.
Q.UO aiUem natiira methodi
progressionis
claiius peispiciatur ,
et formulariim
lex
exordiamur a casn
illo
simplicissimo, statiiendo data esse pioducta ex binis termi'
contiguis seiiei" a, b, c, tf, etc.,
nis
quem in finem ponamus:
A z=: ab, B zz 6 c, C z:z cd, D :zz c/ c
porro,
igitur
iibi
A, B, C, D,
etc.
et
ira
tes
datae, ex qtiibus termines seriei n,
hj,
sunt qnantitac, d, etc.
de-
tciminari oportet.
3.
§.
sionis
lîic
potissimiim débet natura progrès-
spectari
A, B, C, D,
examinando qiiomodo
etc.
utrum
infmitesimi sintcomparati ,
fiant
vel difTerentias habeunt, sive primas,
vel denique
stantes ,
Sufficiet
Ctim.
rasse ,
A'cl
progressionem
quandoqiiidem
etiam
se aequales,
sive srecundas, con-
constituant
autem casum lantum
dilTerentias constantes
inter
ejus termini
termini
geomctri-
postremum considéinfmitesimi
aequales,
habentes, pyogressionem. geome-
tricam constitui assumimtur..
§.
ah
4.
Tu m
vero
m A, 6c zz B, cd
hic
quoque
zzz C, etc.
omnes
mines ex solo primo a atque datis
fmiii..
Elit enim ;.
monendum
est ,
ob
seriei quaesitae ter-
A, B, C, D,
etc.
de-
120
r
ACE
/
aBD
î^
— gBDF
"ace"
etc.
etc.
Protit igitur teimini .A, B,
C, D, etc.
conliniio propins ad
rationem aequalitiUis accedunt ,
ita
etiam
tandem aequales
fieri
simt censendi.
c, ht c,
§.
d:,
etc.
5.
tcrminorum
Qjiodsi
a, b,
io;itLir
c, cl,
etc.
binos
numeri quaesiti
proximos hornm
qiioslibet
aequales statuanius, in-
intcr se
deque valorem primi a eruamus,
ejiis
valor continuo pro-
pius ad veritatem accedet, qno longius ftierimus progressi.
Ita
acqualitas
o* rr:
^
•
az=.h dat
acqualitas
'Hoc modo pro
a*
a* zz:
c z:z d
A
dat
successive
;
acqualitas
a^
zn -^ ;
ita
dat
porro.
émergent valoies sequenles
continuo propius ad veritatem accedentes
a*
et
h zr: c
:
[
121
Hoc nempe piodiictum,
valorem primi termini
quando termini
Uirn
infinitum coniinuatiim,
in
quacsitae, et
scriei
exhibet
qnidcm non
so-
intinitesimi progressionis A, B, C, etc.
rationem aequalitatis tcncnl, ut Eulerus innuerat (Op. anal.
T. I. pag. 5.) sed ctiam, ut
diiTe-
Invente autcm primo termine a, omnes reliqui
metricam.
§.
videbimus, quando
habcnt constantes vel progrcssionem constituunt geo-
rentias
ex
infra
innotescunt.
4.
Ut rem nliquot
6.
5.
statuamus primo esse
exemplis
magis
illustrerauy,
:
A m a 6 :=z.
i
,
B — hc =: 2
C =: ce? m 3,
D —
4
,
cZ
et
iia
porro , ac icperietur
=
«^
Constat
--1
2.:
'
—
4.4
a
sequitur
m/--,
Erit
enim
'
=::
:
l-c
6.6
•
H
S. S
•
etc.
hoc produc^um infinitum esse
autem,
notante ^ pcripheriam
unde
e
fore
circuli ,
primum
quo invente etiam
=^, dé-
cujus diameter est unitas ;
terminum
reliqui
ex
sériel
§.
4.
innotescunt.
:
M.'miris deVAcad.
T. VL
quaesitae
^^
12 2
a^Vl
123
h
y-rr
et
ita
sint
quid
Vfdeam.ns
porro.
Ac primo quidem
pi-itt)ittirae.
"
6.6
20
•
.
-o
•
4=
quod, fiactiones reducendo,
a'
—"
Deletis jam
quittir
fore
CMit
4^
7^
icpracsentaii potcst
1
7-
•
-^--il
.
'-?
6 ziz 2
(/
1
fi zi:
c zz: 3,
,
m
castr
:
.
f.ictoiilHi?
tum vcro ex
j
4 »
e
:
clc
numeratorc ac denominatoïc
in
hoc
nostrac
ita
•
5-«
lii
Li*
evidens est fore
qnalibus ,
forimiLie
—~ 5
§.
clc.
,
,
ac-
4.
se-
uti
re-
quiritiir.
§.
Consideretur nunc progrrs^^io
JO.
trica A —
1
B~ 2
,
C —4
,
D =1 8
,
jam supra intuiimus hoc casa etiam
nes
a, b, c,
d
pro
§.
hae
fraction es
4.
E — 16
,
etc.
,
scrici qtiacsitae
et
termi-
talem necessario constituere debere progres-
sionem, saltcm in
pra
scqucns ^eomc-
Quodsi
infinito,
a, h, c,
cl,
ex postremis su-
igitur
exhibitis valoribus formentiir
etc.
:
T
7
^^
R'iP
fl
A-C-E-"
'
eae intcr se debcbiint esse aequales unde
—
«*
eliciltir
:
A4 C4 E3
-bTuif-; /^^'^^
^
Hinc jam
facile
.
.
ni
"
dénotantibus
inlellif^itur
A^
/^
Z
A- c^
2
-
.
3^
verum valorem
.
__
1)4
et Z^ terminos
•
F4
fore
:
G- 1-
E- G-
c^ K*
•
H4
7.
•
•
•
-'
»
infmitesimos contiguos^
er.it-
,
1G5
que
pro
cnsn Z' =:
nostro
cZ
et
habebimus
valores numerjci subsLiliuntiir ,
n\
"
hoc
est
0*
m
:
2i=.2'â
-8.212
24.28
i4.i4
.,
1 2
*
duodsi nnnc
.^,^zil.
I
...
,4
•
et
^,
a
î'*
'
2-"
*
*
s-8
*
*
2*
*
_,
1
m
*'
:zz
2
'.
Reliqui teimini crunt:
f2
6 :=: 2'/ C ::=; 2',
Undc
hos
etiam
patct
£;eometiicani.
rf
tcrminos
/m
constitueie
h =:zai;C^=z a z^
rr: ï,
d zn a%^,
etc.
',
progressioneni
Sokitio igitur facilior faisset ^
e.xponcntem hiijus progiessionis
iiidc
c =: 2',
:i= 2*,
si,
posuissemiis
e :zz. a z*,
eniiu scquentes résultant aequationes
A z=z a h zz: a- z
:n
1
B
z:z
h c
z^ a^z^
=:z
2 ,
C
ziz:
cd
:=:
a- z^
zzz
/^ ,
D —
f/ e
~
a^ 2.7
~ 8
sumcndo
:
etc.
:
,.
:,
etc.
qiiaium
7,^
lit
si
quaelibet per praecedentem dividatur ,
zr:2, ideoque
7,
zn /2 et
a' zzz -^zzi^-,
prodibit
hincque arr.
—
supra.
§.
Il,
Si
fuerit
in
génère Bi:r Awî, Crz: AmvDzz A m',
E r3 A m*, etc. tum, sumendo ut ante fecimus
hzziaz,
czizaz'^j,
dzzaz^y
etc.
:
1<26
ob ahznA^zici'Z
ergo z
m/m
a
hczrzBirza'^ i.'^ :=: Am, erit
et
et termini scrici
rz:
/A
b :=z -/ A
z* Z21 m.
crunt
.
— / A f m7
/ m / A f m'
y m
.
:
a nz >/ A ; m'>
t.^—
.
qiuirsitac
"
c
c — / A f
.
.
.
et ita porro.
12.
§.
seiiera
Si
A, B^ C, D,
litterae
hypergeometricam j hoc
est
si
etc.
fuerit
constituant
:
A in nb cm 1,
B rr b c =z
2,
1.
C — crf — 1. 2. 3,
D — cZe r= i. 2. 3. 4,
E — e/ = 1. 2. 3. 4. 5,
et
ita
porro ,
tum termini
verum
procédant;
metrice
infinitesimi
quidem etiam geo-
fractio
fit
obrem peculiari evolutione opus
5.
|,
crit.
infmita ,
quam-
Expressio qiiidem
10. exhibita , qua :
a'
~ A^
déclarât
sequentes
accedxîre
:
a zz:
a
a
ziz
zzz
A=C^
"B4~
•
•
f G'. 5
Fdfiî
A c 1. U I
B I) F H K
V
^
V
^'
BDFHKM
K
~F+~
continuo
valores
BDF
E=G'
C'E»
D4
K
4X2
±
•
M
N
Ô
propiiis
ad veritatcm
;
127
et
ita
pono.
Gommodiiis
h
idem xAoï a, verus adeo ,
Vtriiiii
Cuin
eruitur,
ita
- ^
sit
c
=. 2
.
c
=z 2
.
.
ri-zizce oiitur a*rr— -- ;
;.3.4'
f-
ex
a* =1 ï;
fit
.
a
eLc^
etc.
cg prodibit
-zz:
a
m 2 4
i
ex
:
4
S =: 2 .4
a
posito b^ rr: ne
raulto
:=ihd
c^
a* zz:
fit
~
ex.
,
ex e-zzrffnanciscimiir a*zz—^— --
:. 2.4.4»
-^
a^
..
,
.f
.
4
•
6
Continuando hoc
nio-
do tandem emerget vcrus valor
„4
ergo a
~~~
«-J-'?y-5-7-7-9-9- f ^g2.^.4.4. 6. 6. 8.8. la. etc.
—f^
Termiiii
£
tt
igitur seiiei quaesitae
ita
se
ha^
bebtint
4,
î
4/
2
d =:
= 2.4./:^
—
2
g
4 6 / I
e
.
.
.
quomodo
5.
ita
ulteriiis
.
3
.
"
f
/
- i.3.5.|>^
/i
~
'.
1
3
.
5
.
7 1^
V
etc.
etc.
qui
l
procédant perspicutim
i3. Sit A^:=rt, B'zzznb,
est.
C-'zznbc, D'
— abcd
et
pono, et cil m sit A :zz a 6, Bznbc, Czzicd, Diz:de, etc.
habebimus
:
J28
A' z=: a
C = aB
F/ — a^D
G
:=
BDF
n
D
= AC
l-^
=2 A C E
ir =: A C E G
etc.
etc.
ubi termini secundae columnne consLiiuiint tlatam piogressioncni
quae
inteipolari
qtios
tes,
§,
gandi
ex
stipia
14-
o, h, c,
m
B —
ita
d, c,
b c
h c
,
,
nt antea ,
ita
se atquales ;
unde manifcstum
a, 6, c, d,
una cum
datis
assiiniere
esse compaiatoS;,
etc.
data
pLierint
prodiict.»
:
,
A, B, G, etc.
série
si
d,
D = def
,
etc.
invcsti-
Ilunc in fincm ponamus
C =z c d c
Hic
porro.
fl
:
mine problcnia teiminos
terminis contiguis.
A
et
piopius ad veiitatcm acccdcn-
pio a^ exhibuimus
5.
Aggiedianinr
seriei
ternis
§.
opeiaiione eosdcm
qua
potcrit ,
asstqiiimiu- valores continuo
est
ut
liccbit
numéros
infinilesimi sint inter
idem evenire debeie
in
cnjus teiminos ex duobus piimis a et b,
A,B,C, etc. definire licet lioc modo:
iùg
A
c
bC
B
oB
au
j
A
AD
f
a BE
icr
A DG
aBEJl
c h r F
Xdg
bC FJ
JbC
i
B F
H EH
A D G K
oBEin.
cb CFI
A~î) G K
etc.
etc.
fcCFIJJ
etc.
lex progressionis est perspicua, du m modo, ut fecimus,
tibi
formae
tiiplicis
teimini
Sujierest ut deteiminentur a et
primo nzzio, eritque
'b
tum vero
:
m z^ o, fi€t:
ABDEGHKL
Quodsi haec postiema
unde
Hanc In fmem siatuainus
statuainus
7,
toie
6.
A CD F G I K H
•
ÏÏ^ÎT- H- iJ
a
dcletis
invicem distinguantur.
se
a
rite
factoiibus
ducatur in quadratum pdoris,
ftactio
communibus
in numeiatoie et
denomina-
repcrilnr :
a'
A3 D3 GS K3 M
hi î.i Hi lT"
facile
intelligiiur
magis a primis quam
si
ulterius
m^ n et o
progiedi et terminos
remotos
acquales
poncre
velimus,- valores o} inde derivati conlinuq propius ad veritatem accedcre,
quo longius fuerimus
progressi, et valo-
rem veriim pcr sequens productum infinitum expressum iriN.*
A^^ D^Q G^K K'N
«
a
—
/i .
gj
.
gj
.
.
jjj-
Simili modo rcpcrictur quoquc 6^
Mémoires de rAca.ù T. FI.
j^j
.
etc.
Cum enim, posito nzzzht, sit
' 7
,
l3o
c^'b
=
A» n^ G' R!"
B C F, F H L »
1
tum vero ex positione
/i
^
a2 C= D- K^ g- 1- i^Tvîâ
valorem
fiaetionLim
:
_
B4 E4 H4 L4
ambarum
pioducuim
nobis
subministrat
hune
:
El H? U
V — B3
C3 FJ U M2
nnde concluditur
nitum exprimi
1
•
vemm valorem per hoc productum infi-
:
B2J
T»
,3
5.
n: o oviatur
fc2
E=^H
H^J.
L'O
Piogrcdiamur nunc ad casum , qno producta
5.
«X quatcmis terminis contiguis ut data spectantur, hoc est
Tibi
cogniti ponuntur valores :
A r= ah c d
B
zz:
h c
de ,
C m: c d e f y
D =: defg,
hoc casu
et ita porro, atque manifestLim est
^
— ^AE
a B
A
ZH ahcVn
aBFK
À eT
^
etc.
etc.
== 06 cD
TO
A E I
D
c
c
F
A f/
ft
hC
f
fore :
a
fc
,
CG
"b f
—
/
J c: G L
B V R
etc.
P
ZH
D H
"CG^
£D H M
c
"c G l"
etc.
Hi valores sunt quadiuplicis foimae et quomodo procédant
I3t
in qualibet
atur
duod si nunc statu*
columna perspicuura est.
m zn p erit
:
L
C E G
abcc — A-ï,^-„T-M-,
I
,
tum vero, posito n :==. o, habebimus
:
A C E G I L
a
quamm fractionum prodiictum dat
a a C C
m p nanciscimur
Posito porio n
:
M
A D E H I
a
:
A^ C2 E^ Qï 12 L2
*
B* D' F- H^~M~
BCFGKL»
7
fore :
concluditur
unde
aaccx a^^a =1 a^ = A4b4E4f414kTH
.
Hinc jam
— A. -,
a^
Simili
veium valorem fore
facile inte]liD;itur
EU
A^E
*
.
ïT
13 N
N4R
K4- •
-5r • etc.
•
modo repcrietur fore
Inventis
T>
C^
—p
vj
autem
innotesciint
C3G
.
-p^j
hoc
K3 O
GiL
.
-^^
modo
.
L3P
-j^
0? S
PiT
.
-^
.
etc.
a, 6, c, reliqui termini etiam
qnemadmodum tabula supra data déclarât.
Hinc jam tuto concludere
licet,
producta ex quinis terminis contiguis ,
iioc
§.
j 6.
:
:
Fi K
B3 F
j ,
.
•
A zr: a h c d e
,
B zzz h c d e f ,
C — cdefg,
D-zzLdefgh,
si
data fuerint
est si fueiit :
13^2
et ita porro,
tam
:
133
INVESTIGATIO CURVARUM QUARUNDAM;
QUAS DESClUBiT PUNCTUM CURVAE DATAE DATAdUB
LEGE MOTAE.
A UCT
R.
E
COL LINS.
E.
Convcntui exhibait die lo Nov.
Pr
h 1 e
Data airra quaecunque
ita,
I.
TDY mnvetur ^rer recta MN
ut in singulis punctis successive tangatur a hac
recta:
hit
ma
i8:3.
invenire
curvam YS, qiuim
punctum quocldam Y
in
tali
motu
descri- Tah ui.
data curva pro luhitu ^^S*
assumtum.
S oluti o
T punctum curvae datae, in qoo ea hac cjus poaîtione tangitur à recta MN; S aufem punctuii? in quod
Sit
motum snum incipiente
aequalem fore rectae TS.
cadebat punctum Y, curva
spicuum est,
arcum
tcrminentur puncta
thogonalibus
et
TY
:
per-
De-
T et Y in data curva coordinatis or-
G Y, DG
et
TV, DV,
existenle
DU axe
D initio abscissarum; punctum Y autcm in curva quae-
sita
exbibeatuv
cooid.natis
XY et SX.
Positis
nunc
*•
,
134
DG = c, GYrr--/, DV=rp, TV = 7. SX=:Je, Xr = y,
tanarcubus DY =:— a et DT z^fV dp^ ~hdq^ = (^
y
gente
RT m
z;
et subtangente
inter coordinatas
1°.
aicus a per c sive per /, et
2°.
arcus cp, tangens
Ducatur
intersectione
subtangensque
x^,
per
jv ,
/j
q.
recta
TF axi DH parallela
ejus
F cum
MN paiallela
ipsi
ob aequationeni
p et q datam, exhiber! potest:
sive per
FI
RV:=:7i^,
agaturque , ex
G Y pioducta
applicata
denique
erigatur
;
,
,
recta
pcrpendiculura
Ob tiiangula TVR, FYI et FKT similia, erit:
'-^^\
1°. TR
VR rz: FY Y I zn "^^^
lii-J}
—
—
2°. TR
FY F I
TV
-/T
R
TK.
:
m
:
—
=
FK
TR VR = TF
= -V.— =
TR TV = TF KT = -^j^-— nz ^'-^\
:
:
T>
3°.
4°.
:
:
:
:
Ilincque colliguntur
'
'-^^^^^^^
:
-/) g ^)
7 zr Y X =: Y ï 4- K T =
^^^
— F K = l^lzzn±J!LiL-zS.\
et T X =: F
^" r.c
-
fp
I
Hoc vero
TX invento facile definictiir abNam, ob SX zz: TS — TX rz Arc. T Y — TX,
valore
pro
,
scissa
X.
dit
x-(p — a — ^0?-/)-|--^"CP -l) (II.).
:
Rediictis ruine acquationibus
.ingicdiuntur solae variabiles x,
I.
et II.
ad ejnsmodi, quas
y et p (sive
(j) ,
élimina-
135
tciqne dcincrps
hnc poslrcma, innotescit relatio inter coor-
dindtas curvae quaesitac.
Coiollarium
Cnm
sit
i-
I.
n: ''|~ et wzr.'^^^,
aeqnationes illae in-
ventae pro coordinatis curvae quaesitae,
etiam
hac foima
stib
T
..
/
i.
_
:
— (p — 09<?
_^
— CL
(-7— /}3p
^^p
X iiz
II.
e:^hibeti possunt
— a -. ^lJzJl-^(P-Lîm,
Cp
Scholion i.
Cel. IVaring
de
lytica
Lib.
hus,
niotu
egregio suo opère :
in
aequationibus
II,
Cap
oitarcim ,
II.,
algehraicis
pcr quadraturas
Cor
in
una curva super
alte-
1 1
a r i u
m
2.
Y assumatur vertex curvae propositae,
aequatione pio eadem
ita
comparata ut pro c evanescente
simul /rz o, acquationes
plicissimae.
aliasque
vocavit Epicurvoides.
la tanquani basi rotante ,
fiat
curvilinearum ,
primus eas appellavit Curvoides ;
curvas vero gcneratas a ptincto
pro puncto
curvarum proprietati-
docendo rectificationem curvarum tali
earundem proprierates ^
Si
et
Misceîlanea ana-
modo inventae evadunt sini-
Colligitur enim fore
qdp—pdq
^
:
^
ndq-hpdp
136
E X e m p 1 u m.
Sit curva
data circulus dcscriptus radio a ,
curvani qiinositam cycloideni fore cuique noUim
dem etiani dant
ejit
formulae
dq=zJ^^=ML
—
V-.ap
circulo
eodem
et
pp
redit
_,
Ob
nostrae.
ôcj)
— -^_!L-^.
qtio casu
est.
Ean*-
q z=.V 2 ap
— pp
Viap — pp
Nunc , quia
pio
'
*
ubicunque punctum assumitur cur-
vam quaesitatn describens, aequationibus in coioll. 2.
u'tar,
iitpote
simplicissimis.
erutis
His autem adhibids invcnilur:
y — p et x — f^^^^^-y->ap-ppz^f;^y-ZYy-^^(^r -r/
v^a^-w^ _ )/ o j
zzz a
Arc. (sin. zn
— //
«
,
.
haecqiie est notissima cycloidis propiietas,
Co
Si ,
ad
r o 1 1 a r i
solutionem
u m
gcneralîorem
nostram
ponanms punctum Y vel extra vel
colligimus sequentes aequationcs
I.
Pio casu, quo
__ (q a)dp
—
3.
intra
curvam cadere,
:
Y cadit extra curvara
Çp
ubi , céleris manentibus ut
c)dq
reddendam,
:
^^
ante_,
dénotant
— a distantiani
Y ab axe; c abscissain ci respondcntem; k distiinti.ini puncti Y (diini cadit in rectara MN)
perpendicularem puncti
a puûCtQ curvae lacto hac positione ab
ill.i
recta ;
—
a.
137
deniqne avcnm cnrvae
tum
situin inter
et initiiim
abscissaium.
Pio
(]uo
IL
dénotante
casii,
—
a
iterum
Y
punctam postremo
datam
cadit intra curvani
Y
pLincti
distanliam
alla-
:
perpendicula-
rem ab axe,
m vero puncti curvae respondentis abscissae
c distantiam
a
puncto qiiodani rectae
MN,
ciijiis
locus
defmitur peipendiculo demisso e puncto Y in hanc rectam,
ea curvae positione, qua tangrbatur a recta
illo
lespondente abscissae
littera
c ;
arcus respondens eidem abscissae.
eatam y, pio abscissa x :zz o
dam , quippe qui aequatur
in rectam
MN in puncto
a denique designatur
Perspicuum
est,
appli-
jam habere valorem quen-
,
illi
perpendiculo e puncto
Y
MN demisso.
Corollarium4.
Revertamur ad aequationes
îta
ditTerentiatae, ut 3c|)
in
bcnt has :
B^ P
y.
i°.
erutas,
—
c)dp)
a^pCcp
—
c) dq^
^JlP iJ.
[(q—f )dq-\-(,p
d^ dl
^''^ lin—f dp —ip
et d X ^z
d^ dq
tinde dividendo colligitur
;s
coroll.
^•^
.
)
.
—
MfmoinsdtlAcad. T.yi.
,
— a— «)
dq
dq
:
^;
quae
tanquam constans spectetur, prae-
hincque:
^^
'
*
-
138
TX esse Siibnonnalcm cmvae inventae, unde ctiam concludilur ipsain TY fore Noimalem.
indicat, rectam
quae
Coro
1 1
a r i u
Ob radium osculi ciirvae
(cor.
crit
4.)
erit:
quoque
m
5.
datae =:
^,~ et ^^^ =:=
-
Cum aiUem sit d(p=zd{\^^^) + àx,
r^^^^-
~t~ }
r zz:
dX
Co
r
o 1 1 a r i u m
E coroll. 4. reperitLiiunde,
6.
^
:
ohV {q—fy-i-{p—c':zzNoi:mali curvae inventae, erit:
-^-,
ds
^
posita illa Normal»
nz N.
Normalem curvae inventae
Haec autem acqnatio monstrar,
vae propositae, ut elementum
posterioris,
ad Radium curvedinis cur-
esse
curvae ad elementum
illius
manente scilicet eadem
positione
mutua amba-
lum curvarum , quae exstat in figura.
Coro11ar
um sit (cor. 4.) y^ =r ^
a_(lD
—
i
u m
7.
,
erit
^
^ r(a-î--')-(^-^-^) !;
139
hincque invenitur pro radio osculi curvae inventae, quem
designo
litteia
R
-
qiiae,
sequens expressio :
,
{y y -f- (cp
~ a — xY)'
ob j= 4- (CÎ)-a-x/ iz: N-^ (coi. 6.) et ^^— I- (coi-. 5.),
nuitatur in hanc :
yr
— N'
Hiijus formulae ope cognitoque radio r ,
me constmi
radium
r
potest.
curvae
Hune
finem
in
propositae ;
jungantur
puncta
L
et
K
e
facilli- Tab. ni.
puncto
perpendiculum
T
I
K
I ^'o-
I
in,
;
in
YL aequale Normali N;
puncto Y erjgatur perpendiculum
porro
Px
exhibeat recta
demittatur
T Y curvae inventae
Normalem
radius
;
ducatur denique
recta
LO normalis ad ipsam LK et producta Normali TY usque
ad interscctionem ejiis cum I- O
recta O Y erit Radius
TY^
Nam OY-zn ^.r^—,^^
osculi R curvae inventae.
X T
yr
',
1
(Comp. cum
Miscel. anal.
L
Coro11ar
a
coroll.
c.
i
u m
.
I
rY\
IL),
8.
Ex aequatione ds-=i-^ statim dediicitur formula data
pio incrcmento aicus curvoidis.
Cum enim
ïrarins^io
i8*
^-
i4«
sit
(cor. 5.)
^f
— y—^
ds z=i ">'4- =.
^^x—
dx
S C 11
1
o n
i
c.
{l.
.
Prohl.
/.)•
2.
M N rotans aut duos habet ramosr
Cnrva super basim
in
prodit:
,
dx
Cum
infinitum vergentes, aut est curva in se rediens.
motus priore casu
sus
duos
quam
retrorsuni ,
habcre
débet
concavo spectantes
possit
tam a
curva
a
fieri
de.xtra
puncto Y descripta
puncto S ,
atquc in
origine motus, cuspidem formantes axi
Altero
sistentem.
fine
durare
gaudere
potest ,
débet
:
casu ,
curva
infinitate
junctorumque inter
insistentibus
vero
se
MM
tanquain
MN nornialiter in-
motus utrinque sine
quia
curvae
rotationc
ramorum
etiam
ipsam
utrosque
ramos infinitos,
latere ,
sinistram ver-
datae
punctis reflexus axi
genita
aequalium
finitorum ,
MN normaliier
liquet autem curvoidem tune transcendentem
esse.
Hinc concluditur, ne unicam quidem curvam algebrai-
cam
in se redientem algebraice rectificabilem fore,
alioquin ex aequationibus
L
et
II.
quoniam
post
coroll. i.,
climi-
nationem variabilium p et q, evadere <lcberet aequatio algebraica inter coofdinatas x et /.
S c 11 o 1 i o n 3.
Ope formularum hue usque inventarum
venduni
est
Pioblema inversum,
etiam
quo quaeiitur
resol-
relatio
ia-
141
ter coordinatas curvae,
qtie
puncto quodani
a
ciinque curva data.
tas
X
cujus lotatîone super recta qnacira-
et
in
illo
Nam, ob aeqiiationein
/ hic datam
erui possunt
,
praebcbunt
relationem inter
SLiperstint
constantes
p
et
c
alia
qiiae-
inter coordina-
duae aequationes de-
haeque comparatae
aut solam x aut /;
finientes
desciibitur
sito
inter se
coordinatas p et q, ubi autera
f
deteiminandae ,
ita
ut
pr»
ÙAt q ::^f.
z:z c
/
Pr
%loventur super recta
ut
ita,
b l
em a II.
]MN data curva cfuaecunque BDY
quoddam punctum fixum
simul transeat per
B: invenire curvam CY,
a puncto
quae
motu describiturj^^jn^
tali
Y in priore curva pro arbltrio assumto,
S o I u t i o.
Manentibus iisdem
lineis auxiliaribns
ac denominatio-
Bibns usnrpatis in problemate praecedente ,
liquet ,
etiam
expressionem supra inventam pro applicata y fore eandem,
nempe
:
y.
Nunc ,
__
-^(q
—f)-q(p —
<:')
ad \aIorem pro abscissa
addamus adliuc sequentia ;
n
\
ei
respondente eruendum,
^'g- 3.
,
,
142
Demittantnr primo perpendicula
BA, YI, BZ et EF,
designctqne
E pttnctiim curvae propositae coincidens ciim
puncto
Bj diini recta
fixo
evenire
ducta
statuamiis
porro
M N ciuA^am in Y tangit, quod
puncto C ejusdem rectae
in
BZ ad punctmn K iisque
M N.
Pro-
ubi secat rectam
,
KY ipsi ZD parallelam, demittantur denique perpendicula
KO et BL.
BA z= fl, AC = — h, abscissa CX =: x, BZ r= w,
DZ=:t, EF — et FD — g,eritBK — u-/etKY — GZ =:t-c.
Nunc, ob triangula TVR, BKL et KO Y similia, colligunSit
/1
tur
hae proportiones
:
=z ^-^^-^^
TR TV z=: BK BL —
-"^-^
2°. TR YR zr KY OY — ^.'1^=:
1°.
hincque
:
:
:
^^
-
fit :
lY
At
:
— AX ~ BL -f OY — ?(^-/)-^^(Lzr^)
AX zzz — b -i- X, cri;o erit
:
_ + — ^(u-/)-f-..Çr_-^>
6
imdc sequitur
a:
^
fore :
quani acquationcm, acque ac L, tantuni ingrediuntur quantitatcs
a
cuiva cognita pendentcs.
Alia Solutio.
Etiamsi haec solutio
taïuen
nonnulla
sit
attenlione
multo longior priore,
digna
aestimari
fortasse
potest ,
quia
143
monstrat, applicatis ad hune casnm legibiis mottis compoeasdein aequationcs resultaie ac praeçedente solntione.
siLi,
duaie
suin
aiisLis
Ilunc
,ut tangatur
in
finem
a
lecta
générante.
sitain
hanc solvendi methodum hrc impertire.
et
curva
sit
data
primo
fixo
et
modo
dispasita,Tab. m,
M N in puncto illiiis Y, cm vam quaeHanc
ejus positionem
Determinetur illud puncttim coordinatis
simili
ita
ejiisdem
B, coordinatis
,
cum puncto
coincidcns
Incipiat
nunc curva, motutn des-
Y arcuni curvae G Y, Ad viam curvae Tab. m.
ru m altero curva fertur
motu. parallelo
rectae
MN:
per-
spicuum est,punctum Y iioc nvotu describere lincam rectam
MN parallelam
aeque ac
tuin
in
;
altero
motu autem moveatur curva
problemate praeçedente, quo casu etiarn punc-
Y generabit curvam ibidem inventa m, quam in sequen-
tibus
vocabo curvam
iJlius
rectae priore
A.
motu
Itaque exhibeat
ortae,
Yv clementutn
vero elomentum curvae
Yjjl
A posteriore provolutione genitaç
:
liquet ,
punctum Y,
motu ex utfoque composito, describere diagonalcm Yw parallelogrammi
Y,acov,
'
DG et G Y, atque
investigandam deeompono ejus motunr in duos alios, quo-
ipsi
^'
DF et EF, existente ut ante DU axe
D abscissaruni initie.
cribatque puncluin
E
punctLi;n
exhibeat Fig. 4.
S'
ope elementorum Y y
Demisso pcrpendkulo
Cuf
erit
et
Yjm.
complet!,
Yf elementuin abscissae cur-
'°'
144
vae quaesitae, qnod, ob ipsjm abscissam CX r= r, ponatiir
rzdx; particiila
cuivae
culiim
A, quod
(Oj-
igitiir
abscissae
sit
elementum abscissde SX =:i x"
patet etiam, peipenâi-
zr^^x'';
abscissae x, qiiam applicatae lesponden-
x^
cm va A.
in
hac vero rr:/^,
in
eiit
exhibeie tam elementum applicatae cuivae quae-
sitae respondentis
tis
veio
^v
igitur
erit
^/
Posita illa
m
applicata
3 j/ et etiam
rr. y,
yz^y, ut
priore sohitione.
Ad valorem secundum pro Yv z=z 3x -f- 9x^ emendum,
contemplemur etiam motum puncti B, seu potius puncti
quod
cuivae propositae ,
axem
incidit
,
in
,
punctum
hac puncti Y elevatione supra
Perspicuum
B.
fi!xum
piimo curva feratur motu parallèle rectae
tum idem elementum
Y; tum
,
ea
si
curvae
motus
absoluto ,
incidit
in
(tali
scilicet
ipsi
A
terminus
punctum fixum
similis
:
Tcnda, sive, quod eodem
ratur
punctum
B.
ori-
elementi
B.
—
autem
elemento
arcus
DB
necessario
Itaqiie
redit,
in
inquirendum
motu,
terminus
sit
est,
promo-
quonam puncto rectae
perpendiculum AB sit erigendum,
altero
quo
hoc
ad quodnam punctum usque priore motu curva
R'IN
punctum
punctum quoque progignere elementum
tur curva A) idem
cujusdam
motu,
si
MN, hoc punc-
lincae rectae describere ac
feratur altero
est ,
si
curva tum fe-
elementi arcus
DB cadat in
ut,
,
145
nnnc
Sit
élément uni cnrvae
B(3
d»^tae,
A'^B''
positia
peipendicnji
AB icspcciii hiiJLis curvae^ quippe ita motae
ut punctLini
B
to
elementnm B^B aequale elemen-
descripserit
Yv; exhibeant porro curvae Tp et IB aicns curvamm
A similium descriptammque piinctis
curvae
(3
et
B, atque
désignât B'(i elementnm prioris curvae, quo abspluto punc-
tum p
cadit in
His
B''.
determinanda
stabilitis
in finem ponanlur
est
B'B.
lineola
TV 1=7, DV ziz p, TR=i:i', VR
Ilunc
rz: jr,
BZ zizu, DZ—t, (iZ' — u, DZ — t', aie. DT — Cp, BD —
et
/3D
—
autem
Rcctis
BA exhibitis simili modo ut in
a et
problemate praecedente applicata
•g
^ __.
et |3a
hincque
fit
in
<l{f
— —
iV'
— P)--
p)
luju
'^
i^'
YX, eiit
—
g)
—
7)
:
(Pi"obl.
I.)
u) __ gdt
— ivdu
:
n^
imde
v|^
v|^'.
BAzrzÔyzii ?
(f^
—Q—w —
(n'
:
yB=i /BfS^-Pv^^ V av|7ir"^ïI^Hp^— ^^"•;|:'"'^^
Ope solutionis probl.
I-^
A''
=—
[(p^
Mémotm de i 'Acad. T. VI,
praec.
autem invenitur
—
4- ^(u' ~^)±^ u>'ii' - t')^ ^
v|.
:
19
.
—
hincqiic
,
.
:
Va—rA' — A'oL~B'Y — d(ti^-dir. pan. ['^Sy^'Ù^V^ -î\^
posterioie cxpresssione ila ditTerentiata , ut quantitates
Iiac
?/ et t^ tanquani constantes spectentar.
B B - B V -f- vB
—
Eiii;
-^-^)-^-^'>(''-
dCp -h a pai.t. ^ll
.
ergo
:
-
^)j _^ ^^li^jîi^a' ^
^
Hocque va loi e compaiato cum supru pio elemcnto Y y cnicolligittir
tOj
haec altéra aeqiiatio
:
- acp + a part, ['^i''^zJÛ±2lLL:zP)^ ^ n^u-^^
^x'' -^ Dx
.
ax^' zn acp
At, ob
— a c?-/)-^-h p-z^
i
ax - a part.
au
neglectis
u^ et t loco
t^.
a . part. L
—
tum
et
i_^
^^-i^;
^'? C"-J)-^'^(^ -^)-|
_^ lâjL-t-.^lL^
.
si,
^p^.^^^^
at respecta u
Cçim autem
^
J
ii
loco
sjt :
—
H
scribatur
et t ,
——
,
erit :
X
— Const.
-f-
îIlizlL±L^^-A>.
V,
C o r G II a
r
u m
i
.
.
dem esse, quam
pzizc, uz=ih,
in
t zz g,
'
constantem
in
hac solutione ean-
Nam
pro
x.:^0
(sol. prior.);
ergo,
Facile perspicitur ,
casu fore
r f
priore.
vzzzm et w zziriy erit
qui vcyçià est valot ipsius
—^ b,
si
fit
(/:=/,
ponatur eodem
:
Quaie
erit
C m b.
^
,
.U7
Coro1
.
l
m 2.
a 1 i 11
Ad relalioneni inter applicatas q et u
i
,
sive abscissas
p et t, detcrminandam demittatur in axem M
ciilum
Q.Z,
quod
perpendi-Tab. ni
normaliter
secat
in
Ob tiiarii^ula TVR, RZQ. et BZP sitailia erit:
puncto P.
10.
QZ =z^:^ = ii^^:^fit-!l> et
„o
p 7
— U^ J_E —
îi^
•
aZ — PZ =2 AB, ergo:
At
^ __
Cnm autem
t,
BZ
rectam
siniul
>J
g (f
— —
p)
sit
qf
iu
(u
—
g)
.functio cognita ipsins
p
,
u vero ipsius
liaec aequatio reduci potei:it,g,d aliam inter duas
biles
u
g, sive
^ 2i'>:-
et
;
^-
varia-
p et t,
r
e>-.
:.-
Ea^em aequatîo çtiam praebet banc
,fr.^ /^^ :l^ " L) -V .(coroll. 1,).
:
Corollarium3,
^" ?
__
—
7
——
— r^-eutquoque, J_.
— C.'-f)d'T^{f^cydp
Tf
_ g — p)37-C"—
^''
;i^
-^-^
_^
,
^~
.a$:
hincque porro seqoitur fore
JV
unde
— "n
—
etiain
(x
fit
-,
("
„
~~~~ ' ^^ "
—
?)ai>
-
;d>
^
>
:
--f)'dp
-f-
—
— —
(t
c-)?q
(u
-y> +
(t
intuitu
figiuae
a (P
•
-3
:
— + (y - ay '6)^
quae aequatio quoque
ex
solo
-
c)«.
facillime
invenitur.
19 *
143
Corollarium4Aequationes modo inventae evadunt simplicissimac,
si
B sitiim esse in ipsa lecta MN assuniaaequatione inturqne pro pimcto Y veitex curvae datae
ponatur puuctum
,
ter
ejus coordinatas
scquentes aequationes
•^
comparata ,
ita
cvanescat
simnl
nescente
—
ut pio
abscissa eva-
Adipiscimui
applicata.
eniin
:
d^
*
ob u^zq, tzzp,
et a,
c.fzzzO.
b,
S c h o 1 i o n.
Liquet hoc casu eandem prodire curvam ac
Tab. m. tangentibus
Fig. 6, yr^Q
TY, T'Y'', T'Y'',
etc.
ad singula puncta cur-
in
illas
abscissis
dcant applicatae
illis
descripta
lius datae in coroll.
curvae cujusdam, quibus respon-
Curva
ita
quae oritur motu curvae
il-
perpendiculis
eadem nempe
erit ,
praec.
dy-^
aequales.
considérât©.
Coro11ar
Cum sit (coroll. 3.)
AV,
VY, VY^,
perpendiculis
assuniantur partes tangentium
V"Y"s etc. pro
ductis
etc.
ddtae AYY'^ demissisque
AV^, AV",
si,
i
u m
5.
:
'
(^u.^q-^-(^
— c)d*p)dâF~â^^^
— dg — — /) d-p)dq
p
(dt
(u
,
149
^^
^
èq
(d'x.dq-{- (t
.
dCp
— c)dp)d q-hidt. — iti—/)d^p)dp
è.l
d'q
.
d^
.
»
erit :
hincque elementiim arcus curvae inventae
ds z=. V {du,-^ (t
-
c)
';jr
;
+ (at -
{a
-/) if)^
Prohlema III.
AC data curva quaecunque TDY
Rloveatur super recta
semper tangatur
ita y
ut
recta
A B angulum datum BAC cwn illa A C con- Tab. m.
illa
curvam, quam
stitucnte: invenire
puuctiim
ab
Y
quoddam
in
simulque ab alla
tali
motu rfwcnbit
data curva ubicunque as^
sumtuiïu
S
1 u t i a.
•
YG, YX, MZ et TV, exisM et T pnnctis, in qiiibus curva data hac posi-
Demittantur perpendiciila
tentibiis
tionc tangitur ob lUioqne crurum anguli
A M et RZ
tui
lectae
N,
agdturqiie
ad
BAC. Pioducan-
carnm inteisectionem usqne
denique perpendiciikim
in
RO. — Ponantur
:
XY^z/, EXzrx, A E rr — 6, (ubi E dénotât puiictum,
in
quod ,
motu inchoanle,
cadcbat illud Y)
GY
;!::;
—
/,
S- 7*
w
«
.
'i5o
TV — q, T>y — p, VK=zw, TRz^v, aicns
M'A =111, DZ=:t, MN — m, NZ — «, aicus
DGZZ.C,
DT —
4),
BAC
DMr=\|^ siniisque anguli
Cadit
quaesît.je
in
oculos, expressionem pro appljcata y curvae
hic iiemrti eandeni foie ut in Piobl.
__
•
ci: p.
J
1'
-
fit
x definire, hocque effici-
—p
-\-
w erit NR=z« — t-j-p — w
,
OR
—
:
»
•^
D
OR
_^ ^^_
îin.(iSo°— iBAC)
liincquo
iv)
^
•
p« "^^"^^
tt(^n.—^f -h
TÛTiAC r^-
At TX — ^^^-;--^^--;T';?~^^
"Crgo
:
seqiientibus :
Ob R Z rr t
unde
nenipe
^
*
>
Itaque tantum superest abscissam
tur in
I,
—f) — q\p — c )
-wCq
Pr. I.),
(sol.
'-
:
RXmTX — TRi3 l(izz£hn-i(L-a —
— — (ob —
n: —^^^
^^
^^
^
î;^
liincque :
A X r^: x
b
.
.
nÇn— f-4^j
>
—
)
q^ z^ w^) ,
.
unde denique sequitur
•to(f
— — — f^
c
"-y
-
-
.
-w)
*-
fore :
)— Z?
^
G Gro
1
1 a r
i
u m
1
—
Cum sit i8o°— ZBAC^ZTRV Z.MNZ, erit:
— sin. TRV. cos. MNZ— cos. TRV. sin.
sin. Z.BAC —
(3
i5i
MNZrr J I — ^ ^ =n '^^J"—
.
haecquc aequatio inservit
•
.
vaiiabilcs q et u sive
relationi inter
C o
p et t determinandae.
o 1 1 a r i u m
i
2.
Aequationcs înventae pio cooidinatis x
aequatione
= p, m - V^
du
'^=P,
induunt
lias
' ip
aq ^
formas
(1— /)ap
r iina
cum
dp),
sWez
:
- 3u'
et «
"/-',
:
Cjap
f3
pracc, ob
coroll.
in
eriita
V - dq
et
^'
zz
— —
(p
c)3<7
— fa7)ap-t-(cdp-i-/d<î)9<2
„>•
^-
CoroIIarium 3.
Ponatur P=:-J>
erit:
{dp^ -\- ?q^)
hincque coîligitur
d(p
pH -f-
=1 (A^
nnde ,
d\l^
:= k (dt
aù») —
,
dq—du
^^ (at . 09
.
— aw ap)%
.
:
a^^. ap-4- cap
—
.
i) {dt^
.
.
dq^'
at
.
aqr. au 4-a7*. au»
— 2dt .dq.du.dp-^ aa* dp^)
.
radicibiis extractis , erit:
dp. dt-hdq.du—{Bt. dq
quae praebet bas
— du.dp)Vkk—
:
dq-hdprkk —
avb—
LJLL^^.
^
1
1,
l52
His vero valoribus substitiuis in aeqiiatione pro x postre-
mo inventa, nanciscimur tianc
'
L _,
(h
—.f)^q -4- (f
—
:
c) 3 p H- [( u
—
«?)
3 ft
— -p-)dq) Vkk-^i
Çf
Corollarium 4.
Sit
angulus
BAC rectus, erit A,z:ri, hincqiie
—
(u— /)3?-h(f — c)3 p
^
existente :
du
7
,
'^-\-
df
Qiiamobrem etiam
x
a$
.
d^
3<p
erit :
— h + CiLz:Z)l^-i'j=LO
9ji
8xV
<m0 .mt>V>QO*Ç^00tO0M
:
153-
RÉFLEXIONS
SUR LA THÉORIE DU C A L C U
F.
D F V 1> R F. N T I E L.
I
PAT
F.
T.
Prc'senté à la
Malgré
1.
§.
se H U UEllT.
Conférence
nombre
le
i5 Juin
le
à'.^.s
18 14'
plus importâmes décou-
dont les différentes parties des Mathématiques sont
vertes,
redevables au calcul infinitésimal, nn ne ?a[nait disconvenir
que
qui ,
à
c'est précisément
miinière
la
manque plus que
tielles
belle
elle
est
de l'analyse
partie
traitée
ordinairement,
toute autre, des qualités les plus essen-
aux sciences mathématiques, de Tévidence
solidité.
La méthode
férentielles
tes,
dont
cette
c'est
dx, dy,
ordinaire consiste
comme
comme de
à dire,
et
de la
à traiter les dif-
des quantités infiniment petivrais
zéros, et à clierchcr en
même tcms le rapport de ces zéros, à résoudre même des
problèmes de
la
plus haute importance, par ex. celui des
par
\<\
supposition que l'une de ces différentiel-
n7ai7;Hfl,
les
devient elTcctivemÈ'nt égale à zéro, tandis que l'autre
ne
l'est
;5arre
pas,
etc.
de quantités
C'est avec raison,
int'iniment
petites qui,
que
la
notion bi-
malgré cela, sont
i54
comme des quantités réelles, a
traitées
la
plus
infiniment
du second degré, du
ou
in-
troisième, d'un
dc-
petites
même infiniment plus grand qu'un
qu'une quantité infiniment
autre zéro ;
cherche en
comme celles-ci, qu'un
mi-degié, ou dans des propositions
zéro est plus grand, et
science
la
même du bon sens, dans des no-
comme celles de quantités
finiment grandes
ment
On
une foule d'objections.
exacte
vain de l'évidence, ou
tions
attiré à
surpassée par une autre,
etc.
grande
Que
est
infini-
dirait - on
enfin
selon quelques géomètres,
de ces quantités bâtardes qui ^
forment une espèce de transition du fini à l'infini,
les
00%
comme l'ordonnée d'une parabole dont l'abscisse est infiniment grande?
Le philosophe ne
peut être
d'un
satisfait
calcul qui ne donne qu'un à peu près, ou qui n'est don-
né pour exact, que dans le cas où
trent dans ce calcul,
zéro , et par
les quantités qui
en-
deviennent rigoureusement égales à
conséquent ne peuvent plus
être
un objet
du calcul.
§.
Introduit
ment
Pour éviter cette pierre d'achoppement,
2.
les
petits.
limites des rapports ,
Mais
l'infiniment petit,
le principe
il
est
facile
à la
place des infini-
de voir que
En effet,
l'idée
de
est
pas moins
elle
consiste à
quoique plus cachée, n'en
de cette métliode.
on a
155
prendre V<i^ymptote pour
courbe même, puisqu'on con-
la
rapport duquel
vient
que
et de
/ approchent de plus en plus,
est le
^^
ziz o.
des limites ,
Il
le
mais qu'elles
n'at-
faut donc avouer
elles
sont rigou-
que cette méthode
quoiqu'elle donne plus de solidité au calcul
un point de vue purement mathématique,
différentiel sous
ne
de x
moment où
teignent effectivement, qu'au
reusement
difTërences
les
justifie
pas aux yeux
du
ou du méta-
logicien
physicien.
3.
§.
La méthode dont Newton
poser son calcul de fluxions,
par Maclauruiy
est assés
exacte
et solide ,
de ce
calcul.
développée
pour ex-
et perfectionnée
généralement regardée comme plus
pour ce qui regarde
IMais
servi
s'est
ceux qui
se sont
métaphysique
la
familiarisé
le cal-
cul des fluxions, n'ignorent pas que l'idée de l'infiniment
petit
y entre également
,
de
manière
que Newton
lui -
même dénota les fluxions par o
ou leur donna le zéro
pour facteur. Au reste, on ne peut disconvenir que c'est
,
une faute contre
des
la
mathématiques
pes de
la
partie
la
méthode,
de dériver d'une branche
mixtes
mécanique) ,
plus
(la
universelle
des
les
princi-
mathématiques
pures (l'analyse).
20
i56
5.
4.
La Grange à qwi tous ces inconvéniens ne pou-
vaient échapper ,
jugeant que ces êtres énigmatiques de-
vaient oLrc tour à
fait
qu'on
leur
donne
le
expulsés de la inatiiénialique,
nom de diiîérentielles
à démontre,
ou d'asvmptotes des rapports,
vrage qui
est
entre les mains de tous
du calcul
cours à l'infinimcnt petit.
nieuse et rigoureuse
qu'on
Celte méthode
pouvait
dans un ou-
fonctions, toutes
intégral,
différentiel et
fluxiony,
géomètres, par
les
la seule transformation et dérivation des
les vègles
de
,
sans avoir reest
aus^i
ingé-
l'altendre
d'un
pareil
que
génie, et j'avoue qu'elle m'a
fourni
velopper dans ce mémoire.
Mais d'un autre coté,
convenir
que cette méthode
est
sor-t
l'idée
je
vais d(>
faut
il
nécessairement beaucoup
plus longue et moins simple que le calcul différentiel vulgaire,
et qtie les géomètres sont
obligés de se
un nouvel algorithme, sans pouvoir
auquel on doit
les
familiariser
avec
se passer de l'ancien,
plus beaux otwrages et les plus gran-
des découvertes.
f.
l'on
5.
peut
esqirisse des objections
que
contre les méthodes connues, parceque
les^
Je n'ai
faire
donné qu'une
lecteurs sur lesquels je piïis compter , y suppléeront aisé-
ment.
Elles m'ont fait croire
qu'il ne
«l'enTisager cet objet important d'une
serait
pas inutile
nouvelle manière, et
1^7
d'employer un autre principe » pour déniorvtrer rigoureuse-
ment toutes
sa
avec
liaison
je
vulgaire ,
dificrenticl
et
calcul intégral, sans a^'oir recours aux
le
infiniment pelits ;
dité,
du calcul
règles
les
et
ce n e.st pas sans
une certaine timi-
présenter à l'/Vcadémie cette nacthode que
cjue }'ose
comme un
ne regarde que
m'a encouragé,
c'est
la
Mais ce qui
premier essai.
persuasion qu'une plume^plus ha-
mienne,
pourra lui donner un degré de per-
fection qui la rendra
peut - ètic importante pour la méta-
que
bile
\a
physique de ce calcul.
§.
6.
plusieurs
I.e
cdiccil
vue,
de
points-
cfifTcrentiel
peut être
très - ditTéitns
envisagé sous
de
l'un
l'autre,
dont chacun, dépendant du but qu'on se propose dans ce
calcul, exige un raisonnement tout à
le
justifier.
Il
donc nécessaire
est
une idée nette de
la
différent,
usages
pour
pour qui veut avoir
métaphysique de ce calcul ,
parer soigneusement les divers
les
,
fait
qui s'en
de sé-
font dans
mathématiques.
Dans
riation ,
les cas
où
à laquelle
il
ne
s'agit
une fonction
que de trouver
la
quelconque
sujette,
lorsque la variable dont elle est fonction,
est
subit
va-
un très-
changement,
l'emploi
du
calcul différentiel est évi-
demment permis ,
parctque
le
seul but qu'on se propose.
petit
158
dans l'astronomie pratique,
une
Un problème
qu'une approximation.
ii'est
de chercher l'influence qu'-
est,
peut avoir sur
petite erreur d'observation
de cette observation, ce qui
très - commua
se
fait
le
ordinairement par les
formules dilTërentielles des triangles sphériques.
pareils cas,
de
La méthode
donner pour exacte.
que
celle dont
racines d'un
Dtins de
on n'a pas besoin de démontrer l'exactitude
méthode , parcequ'aucun astronome ne
la
résultat
on se
est
s'avise
absolument
sert ordinairement,
la
de la
même
pour trouver
les
nombre ou d'une équation par des approxi-
mations successives
:
on néglige
les
puissances supérieures
d'une quantité très -petite, ce qui est sans doute permis,
ne
lorsqu'il
§.
s'agit
La question,
7.
/ de x,
fonction
que d'une approximation.
est
s'il
en ne tenant compte que des premières
des différences et
puissances
permis de différentiel une
s'il
on peut être sûr de
trouver, par les règles vulgaires de l'intégration, la
tion /, dont on a tiré par la différent iation
pas plus
tion
à résoudre.
opposée à celle de
l'autre
la
suit
les
mêmes
fautif
que
soit le
on
Quelque
la
difficile
différentiation,
re-
fonc-
^rrP, n'est
L'intégration est une opéradifférentiation : dans l'une et
règles dans l'ordre
interverti.
procédé qu'on s'est permis dans
on trouvera toujours
la
véritable valeur
'i5g
Àe
la fonction
y par l'intégration
pourvu qu'on y com-
,
nièraes fautes que dans celle-là,
mette les
qu'on connaisse ces fautes,
et
ou bien, pourvu
qu'on en tienne compte;
comme, en multipliant le quotient par le diviseur, on trouvera
du dividende , en
vraie valeur
la
©pposées à celles qu'on avait
en ajoutant
suppose ^
Si je
en
autre,
les
x"
.
m «x"~' 3
intégrant
les
mêmes suppositions ,
trouvera
y
::=:
par ex.
j,
ou d
n'y
Ix =.
—
,
et qu'un
nx^~^ dx ou —,
formules
il
.
pas de doute
a
fasse
qui'il
ne
y zziîx, quand - même ces suppositions
x" ou
seraient fausses.
en divisant ,
faites
qu'on avait négligé dans la division.
résidu
le
faisant les fautes
Mais ce cas
n'a
lieu
que
là
où
l'on
for-
me la diflérentielle d'une fonction analytique exprès, pour
la
restituer par l'intégration ;
et
il
cas ne saurait être d'aucune utilité,
ser
est clair qu'un pareil
si
ce n'est de propo-
une énigme, ou de s'exercer dans le calcul.
§.
8.
Mais
il
y
a
d'autres
cas
où
il
ne
s'agit
pas
simplement, de trouver la différentielle d'une fonction analytique ;
mais au contraire, où, supposant les expressions
analytiques des différentielles, ou de leurs rapports, comme
données, on les emploie pour résoudre des problèmes généraux.
àes
Dans un
difTërentielles
pareil cas ,
ne
les expressions analytiques
sont actuellement développés , que
i6o
loisqnil
d'appliquer
s'agit
ou à une courbe
particL^Iier ,
sokuion
la
,
générale à un cas
une fonction donnée.
problème étanl donné, par rapport aux quantités
la
première démarche de l'analyse
ditions
Un
x, /, etc.
d'exprimer les con-
est,
du problème par une' équation ;
mais
y a des
il
cas,
où
A er
une équation entre les quantités x,}', elles-mêmes, tandis
(jue
1rs
est impossible
il
ou extrêmement difficile, de trou-
conditions du problème donnent sans difficulté une
équation
entre
nous parlons
leurs
ici
différentielles:
et c'est le cas
dont
qui renferme toutes les découvertes des
,
modernes; lesquelles étaient inaccessibles aux anciens.
problèmes peuvent être réduits sous deux
classes,
Ces
dont la
première renferme ceux qui sont déjà complètement résolus
par réc|uation
^
différentielle
même:
l'application de cette
solution à une fonction ou courbe quelconque, consiste à
exprimer
les différentielles dx, dy,
par
quantités x, y,
les
fonction donnée
les
trouvé r équation
fait
suivant
ce qui se
fait,
la
seconde classe,
pioblème.
les
mêmes
id
ne suffit pas d'avoir
il
faut encore l'intégrer,
Riais,
comme l'intégration .se
différentielle,
le
il
règles
que
la
voit qu'ici tout se réduit à démontrer
mier cas ,
en différentiant la
y de x d'après les règles vulgaires. Dans
pioblèmes de
pour résoudre
ou plutôt leurs rapports,
quantité cherchée ,
et
différent iation ,
que,
on
dans le pre-
que , dans
le
second
-
i6i
son rnpport.ditTérentiel, est en ciïct et rigoureusement
c<\?,
exprimé
la
par
première classe est
tangente
sur
l'axe
seconde classe
1'
x -=
^
est la rectification
fy'[c)x^-\~dy-), où
ne
il
analytique de la sous
expi^ssion
des
Un exemple de
vulgaire.
différentidtion
la
un
;
exemple
de
la
des courbes par la formule
pas des règles qu'il faut
s'agit
observer, pour différentier une fonction, mais tout se réduit
à démontier que l'ordonnée, divisée par le rapport ditTérentiel
^^
par
trouvé
égal,e
à
ces
règles
connues ,
rigoureusement
ou plutôt, que
sous - tangente, etc.
la
est
le principe
duquel on dérive, par des considérations géométriques, la
valeur de la sous-tangente zr:-^^, est le
se fondent les théorèmes,
ces
principes
i^fi,sCQ.uçbe^
'"
zz:nx'^~~', etc. paiceque ,
dilTérens ,
ne
il
serait
si
pas permis,
l'expression générante de 1^ jSous-tan.gente -^^-^ à
cij'jppliquer
t£j?iiyer. la,
étaient
^
même sur lequel
^uelcopc^l^e j^j^païjÇjX. ,^.^^a ^p-abole,
pour en
SQUS- tangeiupj^ 2 jç^^
C'est dont: dans les problèmes
est ^firojTrê'rrie^t^ (Question
tout' te 'Veste
de
là
'
ne' iègarde *-qne
de'
c^tte nature ,
qu'il
métaphysique de -ce calcul;
1'
opération
mécanique du
calcul.
§.^9.
Le principe sur lequel
je
vais fonder la méta-
physique du calcul différentiel, parait simple et évident
Mônohts
de VAcad.
T. VI.
- ^
:
1(52
le
Lorsqu'une vaiijblc x est augmentée ou diminuée
voici.
J une
quantité quelconque que je nommerai Ax,
il
est clair
qu'en général chaque quantité dépendante de x, chaque fon«
ction de x,
que
nommerai y, subit en même tems une
je
augmentation ou diminution
Ay
laquelle peut être plus
,
ou moins grande que Ax, et avoir tous
sibles
à
Ax,
nature de la fonction): mais
les
cas,
grandeur de
la
de la quantité dont x
et s'évanouira
les
rapports pos-
manière dont / dépend de x
d'après la
avec Ax.
s'en
y dépendra aussi
A/ croîtra, diminuera,
changé;
11
(la
évident que, dans tous
variation de
la
a
est
il
suit
que
le
rapport qui
a lieu entre ces deux variations, ^^ , dépend de deux choses,
qui existe entre les quantités x,y, ou
savoir,
de
de
nature de la fonction y,
la
que X
la
li'aison
objets, savoir ,
la
la partie
n'est
que
même
du changement
ou de la grandeur absolue de Ax.
a subi,
pas moins évident que ce
de
et
Il
n'est
le premier de ces àcux
du rapport ^^ ,
laquelle dépend
nature de la fonction, qui puisse servir vice versa>
à déterminer cette fonction. Or, comme ceci est précisément
le
but
du calcul infinitésimal, il suit que, dans ce calcul,,
il
ne
faut
différentiel,
duoique
compte que
tenir
de cette partie du rapport
qui est indépendante de la
grandeur de Ax.
précédente
paraisse évidente
la
par elle - même,
proposition
il
ne sera pas inutile,
comme
elle
est la
i63
'
-
base de notrR théorie, de la rendre aussi claire que possible.
En
voici
ne dépendait que de
^-^
fonctions seraient du
que des lignes
si
en deux mots.
démonstration
la
le
rapport
nature de la fonction, toutes les
la
premier degré ,
droites,
Si
et
il
elles n'exprimeraient
n'y aurait pas de courbes;
au contraire, ^^ ne dépendait que de la grandeur de
,
Ax,
toutes
et
n'existerait
il
fonctions ou
les
courbes
se
ressembleraient,
qu'une seule courbe: donc,
le rapport
^^ dépend de l'une et de l'autre.
§•
lo.
Si
l'on
regarde toute équation à deux variables,
X,y, comme exprimant
la
nature d'une courbe, ce qui est
toujours permis, la vérité de cette proposition est évidente.
En dérivant de l'équation proposée (A) entre x et y, l'équation
(B)
qui exprime
on ne
fait
la
relation
effectivement
de leurs différences
autre chose ,
A x, Ay,
qu' introduire
deux
nouvelles coordonnées Ar, Ay, dont les axes sont parallèles
a ceux des
xety: en efTèt, l'équation de la courbe (A) étant
donnée entre x in; A P
et
PM :=/, on trouve l'équation Tab. IV.
en introduisant les nouvelles coordonnées
MdzzAx,
Q.S rr: A/, l'axe des nouvelles abscisses étant
MN, et leur
(B) ,
origine le point
donné M.
Or, on sait que par cette trans-
formation des coordonnées, le degré ou la nature de l'équation
n'est point -changée. Si
donc dans l'équation (B) le rapport
01*
'^"
'*
-i64
des coQïdonnccs ^^
le
ne
de
(Icpcndait poiiU
dans
ia[)potL des ..cooidouiics ^
l'
Icment indo-pendant des variables
équation (A) sevait çgji-
XjVr et pa»
constant, ce qui donne la ligne dioitc.
le
lappoit
^^^
dépendait uniquement
Ax ou A^;
CL
donné
doivent
IM ,
rapport
toutes
les
regardées
de Téquiition
constantes,
des
les
-^r
Si,
conscqiront
au coniiaifc.
de la grandeur do
non de x ou y lesquelles, dans
(Hre
c'est
Jfeiîctions
à
(x^)
serait
comme
toutes
les
i\n
j)ui!;r
constantes ,
]-.
également indépcndani
dire des coefficiens ,
ou
ou Aj\
Ax-y
de sorte que
équations (A) seraient
mêmes..
Il
ne sera pas superilu^ de donner à cet objet plus de
clarté par des considérations
purement analytiques.
Pour cet
nous supposerons que la fonction y peut être regardée
effet,
comme étant développée suivant les puissances de x, ou
comme ayant la forme yz~fx, ce qui est toujours permis
moyennant l'inversion des
§.
tion
11.
Soit
donc
quelconque de x;
séries.
jr zz: b -\~ (Xx ,
soit
Q. étant une fonc-
de plus A/r:=PA,x, P étant
une fonction de x, mais non de Ax, de
sorte
que^iziP est
indépendant de Axj donnons ensuite à la variable x une autre
valeur
que
y
x'',
moyennant laquelle / devient zz^y\
zzL h -\- Q.^ x'' ,
Q^ étant
la
même
que Q. rétait de x: ce qui nous donne /^
fonction
de sorte
de x^,
— ^^.^^^Q.x^—Q.x. Or,,
i65
^yz=.y'—y, A l'zr x''— x, et Ar::;^PAx, par conséquent
Oa
Qr - P (r - x) ..,<ft:,U^,:^-J.' =z:P,
'
-
-
qui a
ccjujliûn
dans
lieu
tous
"
xmo, on a
Supposant donc
dépend
p. ne.
aussi
que Q.
de x
pas
soit
ou Qlzz:P.
Puisque donc
x,
mais seulement de
,
faut
il
indépendant de «a:', Oii Ci étant ia mciftc
fonction de x, que Q. de x',
pendant de X,
points de L\ couibc.
les
0' x'
~^,-
^
que Q. est indé-
suit
s.op
il
à dire," une quantité constante, pai
c'est
conséquent, l'équation
j' zr
6 -|-
dx. est du premier degré.,
et la
li^ne déllnie par les cooifionnées X,}', est une droite.
Donc
,
néral
dans toutes les fonctions ou lignes courbes en gé-
lignes,
lAx,-
1q
(jirpites);,
ce
C'est
tire
rapport
courbes.
indépendant de
de
^ dépend de
Soit
grandeur
la
c^e
Ax,
X, ou
il
Maintenant,
serait,
et Tab. iv.
si
le rapport
j
^
éti^jt
pour chaque,) valc^ur déter-
M de, 1^ courbe, cm
dans chaque point
rapport constant, de sorte qu'on jurait
A X A j — M (Lî as qz M R-: HT, ^etc.
:
,
..f
.
.
.
.;
donc, toul:e la partie jde la courbet MST, serait? une 'Jign,e
droite, et faisant
droite..
x ::ii_0. Ici, Jigae^ei^tièie
'T
\
-r
.^
.
plus- clai renient piir la
A F eux, PMzrr,
MN. parallèle .à l'axe des abscisses, puis SQ.,TH,
perpendiculaires à MÎS[.
minée
du premier degré ou des
"celles
qu'on voit encore
considération, des
qu'on
de
l'exception
(il
--
j.
A_LM^T serait
,"
.
\
-
2*
'"
,
i66
Avant
12.
5.
qui
servation
suit
d'aller plus loin,
de voir, et qui sera importante dans
le rapport --,
nous fcions une ob-
immédiatement de ce que nous vcilons
la suite:
c'est
que,
si
comme nous l'avons prouvé, ne dépend pas
seulement de la nature de la fonction, mais aussi de la eran-
deur des difierences, et qu'on n'employé dans le calcul que la
première partie qui,
de
Ax
on
,
par
la
en
regarde
supposition, est indépendante
la
effet
comme une ligne droite, et on
courbe au delà de M,
peut traiter comme
la
telle,
tant qu'on n'emploie que cette partie du rapport complet ^.
§.
1
3.
D'un autre coté,
le rapport
^^ ne peut pas
dépendre uniquement de la grandeur absolue de Ax, parcequ'alors, les
le
Ax étant supposées égales, le rapport ^ serait
même dans toutes les courbes, ou dans toutes les fonctions,
de quelle nature
différentes
qu'elles
fonctions de
soient.
Qu'il soit donné
deux
x
jmb-f-Qx, etï^rc-l-Rx,hQ^ et
R étant des fonctions quelconques de x; qu'on aug-
mente X de Ax, dans l'une et
alors,
on aurait
Azr=:A/,
ne dépendait que de
la
si
l'autre
le
des fonctions y^ t:
rapport -dés différences
grandeur de Ax.
Ar = 0.- ^3r-f X. AQ.-I- Ax. AQ,
Azr::R.Ax-}-X;AR-|-Ax.AR,
Or, on a
donc
107
(a H-
AQ— — AR) Ax
I\
-f-
(AQ — A K) X ~ o.
Puisque donc x et Ai sont indépendantes l'une de
on peut égaler sépaicment
deux
les
coëiTiciens
Taiitre,
à
zéro,
ce qui donne
Q_|_
AQ — R — ARrzo, et AQ— ARrzo.
par conséquent CIi=: R r
mêmes
raient les
d'où
il
et z se-
par la considération des
deux courbes passent par un point M (Fig. i.), il
courbes.
Si
faudrait
qu'aux mêmes Ax,
répondissent
dans
c'est
MQ., MR, etc.
à dire,
deux courbes
les
mêmes Aj, dS,
que toutes
les
courbes,
les
qui veut
ce
que /
fonctions de x.
On trouve le même résultat
RT,
suivrait
dire
passant
même point M, auraient aussi tous les points sui-
par le
vans S, T, de commun, de sorte qu'elles coïncideraient, et
aurait qu'une seule courbe.
n'y
qu'il
14.
§.
que
Il
est
la fonction
soit
de deux parties ,
Ax,
donc démoritré qu'en général,
tandis
que
/ de x
dont
l'autre
l'
,
le rapport
une dépend de
en
est tout
quelle
^ est composé
la
grandeur de
à fait indépendante.
Cette dernière partie a, dans chaque point de la courbe,
où X
est
que de
donnée ,
la
une valeur déterminée qui ne dépend
nature de la fonction ;
elle
peut donc servir
réciproquement à déterminer celte fonction, aussi bien que
i68
]cquation fondamentale entiQ x
en cela que
çt
v: et c'csl piéci^'mcnt
du calcul
toute la théorie
consiste
dilTcren-
L'autre partie de ce rapport , "dépendant
tielct intégral.
de la grandeur tout
à
fait
des dilTcrenccs ,
arbitraire
n'a
qu'une valeur vague çt indéterminée, .qui pe ^ept aucune-
ment
à
servir
définir
baser sur cela la tliéoiie du
nous allons
le
faire,
du rapport
partie
calcul
la courbe,
reste
la
^i
infinitésimal ,
comme
faut supposer qu'il est dans notre
il
de présenter 'souis une
potuoir,
Mais pour
nature de la fonction.
1j
forme isolée
.
la
première
durtstiri -p^int donné' de-
laquelle ,
même, quelque* valeuT •qu'è'rï donne aux'
^
différences Ax, Ay, et de la' séparer entièiiefrient de l'an-'
tre partie
qui n'a qu-uri^fënS viv^ié^'''¥tj'^ii4 He- pe^t
t&rrriinér la
nature
faut prouver que
semble par
la
de
ces-
-Èii ^'aiitr?S^ m'btsi
fonction'.-
la
deux
ne sont
parli-es
multiplJcMibfl^ du -tVfi^ autiiè
compliquée ,v, niais _ par
i^tts
il'
liées 'etl^'
fe^ë'i'miQiî'
simple addition; -de
la
dfé*'
pins
^o^rte- que
dans tous les cas on puisse former l'équation
'
.^^
= F.H- QA X + R A x^ +
etc.
Pi Q-i R> étant des fonctions de x.
•
'
_
§.
i5.
Soit
,
•
.
•
t
•
y:^fx, f désignant une fonction quel-
conque: on aura y ^^ Aj :z::/(x H- Ax),
fonction de
(x-f-Ax) ^ui devient égale
c'est
à
à dire, une
yzizfx^ lors-
169
que AxrziO.
donc que r -h Av"
fjut
Tl
-oit
de cette
forme /x 4-XAx, X étant fonction de x et Ar;
donne
"^ '
X
:z=
que
cette
bien
A/ "^ P
où
,
il
faut prouver cjue
X ne peut avoir
X =2 P -f- Q. Ax -f- Il Ax- -f- cet. ou
Ax -f- Q.. Ax* + cet. Or comme il est
forme
.
.
,
A
totijours
possible de donner
vcision
des séries, tout se réduit à prouver^
peut contenir iiucune
c)
que
tion
les
égaux
à
)•
cette
par
forme ,
l)que
de
l'in-
X ne
Ax,
puissance
fractionnaire
coelTiciens
P^ Q., ctc
ne sont dans aucune fonc-
à zéro,
l'exception de cas particuliers.
à
première proposition a été démontrée
sa
ce qui
par
Théorie des Fonctions analytiques pag.
et
La
La Grange dans
7. S.
il
ne reste
donc qu'à prouver Ja seconde.
§,
j
Soit
6.
donc l'équation proposée qui exprime
I.1
nature de la fonction ou de la courbe, celle-ci:
(A) o
d'où l'on
= a -V ,3x 4- y/ + 5x^ + exy 4-
tire
l'équation
aux différences,
x-i- Ax pour X, et r H- A r pour y,
tion primitive (A).
Or,
il
est
clair
et
par
4"/= "f cet.
en substituant
en otant l'équale
théorème
bi-
nomial, que cliaque terme de l'équation (A) donne, pour
coefficient
fiMKtion
de
la
première puissance de Ai: ou A>-,
une
de^,j', moins élevée d'un degré que ce terme;
pour- coefficient de
la
seconde puissance des différences.
s
170
moins
une fonction
élcvce
où
les
.
y
X
.
coëfficiens
etc.
comme-
donne
par ex. le terme x y
-}- rs
de deux do^res ,
A r Ay -f- —^-^
.
x y
A/= 4- cet.
.
Ax et de Aj* ^ont des fonctions de
de
— i) degré, ceux de Ax^, AxA/, et
\x,y, du
— 2) degré,
donc
Ay^ des fonctions du
(y
l'équation (A)
du degré n ,
est
donnera pour cocfticient de
du degré
gré
etc.
{r -{- s
,
(il
{n
—
— c),
1),
etc.
le
terme
son
Ax ou de A/,
le
Si
plus élevé
une fonction
terme suivant une fonction du de-
et le premier
une quantité constante, savoir
de tous ces termes donnera
(3
le
^x-f-y/
terme
ou y.
donnera
Ainsi, la
coëfiicircnt
entier
somme
do
Ax
sera
une
série suivant les
puissances de x,y, depuis o jusqu'à
n—
1.
ou Ay, lequel, par conséquent,
L'équation aux différences,
dîc
cette forme
(B) o =1 p
p, (7,
.
sera
donc
:•
A X -h 9 Ay -h-r.Ax'-h^.Ax Ay-i- 1. Ay' -+ cet.
.
étant des fonctions de x,/,, du. degré (yi— 1), ryS,t^
du degré (n
—
Maintenant
(C)
ce-
de (A),
tiiée
2),
,.
etc..
supposons
A7 z= P Ax 4- Q.. Ax* -h R
.
qui étant substitué en (B), donae
.
Ax»
:.
^ cet
171
—
(D)o
où,
(/)-f-(/P) A,r-t-(/•H-r/Q-^-JP-f-tP^)AI2_^-cet.
Ax étant une quantité arbitraire, ou une variable qui
ne dépend
que
ni
de
coèflicient
le
x, /,
des fonctions p, q, r, etc.
ni
il
faut
de chacune de ses puissances soit égal
à zéro j ce qui donne
:
0:=p-{-qPy O =i:r -f-qQ-f-^P H-tP-, etc.
donc P
Si
était
inzo, la première équation donnerait
ce qui fournirait une équation du degré (n
p r= o
,
outre
l'équation
primitive
du degré
(A)
égal à zéro, on aurait, en vertu des
Si
n.
—
i),
Q. était
deux équations,
o^r + ^P-t-tP^rur-^-f-'^,
du degré
ce qui donnerait une équation
l'un
et
d'une,
(n
—
2).
Dans
dans l'autre cas^ on aurait deux équations au lieu
à l'aide desquelles on pourrait éliminer /,
ce qui
donnerait une é(}uation qui ne renfermerait que x, et qui,
par conséquent, déterminerait un certain point ou un nombre
fini
de points dans
valeur de
x.
ou courbe,
l'équation
Il
P
(C) ,
ni
la
est
donc
Q.,
ni
courbe,
clair
enfin
une certaine
que dans aucune fonction
aucun des
ne peut être
ou
coefticiens
égal à zéro ,
suivans de
généralement
parlant, et que cela ne peut arriver que dans
point ou
est
pour une certaine
valeur
de x ,
un maximum, ce qui donne, comme on
un certain
où
par ex.
sait,
P rz o.
y
112
On
et
donc généralement Aj' zz: P. Ai -+ Q.
a
= P -h O Ax
^J
.
-j-
R A r= 4- cet.
tlont
.
icimc P est indépendant de
Jd
Ax- -h cei.
.
preçiier
le
^^randeur aibitinire des dil»
+
cet.
ne sera pas superflu d'cclaircir cela
pai
férenccs ,• tandis que tous les autres termes Q.
.
Ax
en déppndcnl.
§.
17.
11
les sections
coniques dont l'équation est
(B) o z=i ([3
+ 2 Sx
-f- 5
.
Ax + (y -fAx- 4Ax A/ +
-f- £/)
£
•
Supposant donc P rz; O- ou p
de
équation
m
la ligne droite.
^
+ ^j'% ce qui donne
(A) o ::iz: a -f- 13 X -t- y y -h- ^x* +- ex y
o, on a
Ainsi ,
la
c
x:
4'
•
-f
c ^y) Aj-
A;.--.
o zr (3 +- c ox s- e )•,
courbe n'est pas
une section conique^ mais composée de deux lignes
tes:
droi-
car dans ce dernier cas on a eiTectivcment p z= o et
q zn o.
En eiTct^ supposons deux lignes droites dont les
équations sont
lesquelles,
ozr rt4-6xH-c/^:r,
étant
multipliées
et
l'une
onzf+gx-i-hyzzz.s^
donnent
par l'autre,
réquation du second degré
(A) o z=: af~h (hf-h ag)x~h (c/V ah)y-i- bgxM- (6/1 Ht cg)xy-+ chy\
d'où l'on
tire
(B)o
l'équation
aux
différences
— (b/+aê+2 6êxH-(6/i4-cê)/)Ar
A/ -f- 6g A x*
p A X -f- qAj-4- cet.
-i- {cf H- a /i -f- (b /i -f- cg) x -j- 2 c /;/)
-Jr-
(6/li4-£g) Ax
A/
-}- ch .
A/^ ::r:
.
113
Or, on a p zz: 6.ç 4- !?r
t/zno, parceque
o ziz b g
m
(6
.
.
et
(j
zn es •-{- hr ,
donc p rr o et
rmo et .yzzo. L équation (B) devient donc
A x(b h -j- cg) A X Ay -\- ch
Ay-f-
.
A X + c Ay) (g A x +
.
.
Zi
.
A/)
,
.
ce qui n'est en effet autre chose que le produit des équa-
expriment
tions qui
rcnccs des
deux fonctions
=: 6
J.
relation qui existe entre les
la
i8.
.
r, s,
difff'-
lesquelles donnent
A X 4- c Ay et o zz: g A x +
.
.
/i
.
A }'
Au reste, il est aisé de voir que, si l'équane contient aucune puissance de
tion primitive
rieure à la première >
ni
aucun terme où /
}',
supé-
est multiplié
par X, de sorte que ^ est une fonction uniforme de x, la
série
le
Ay ::^ P Ax s- Q.
.
.
Ax^ -h cet.
interrompue dans
sera
terme Ax'^j n étant la plus haute puissance de x, qui se
trouve dans l'équation primitive.
Ainsi ^
cette
corw
série
tiendra au moins un nombre de termes, égal au degré de
l'équation primitive, de manière que,
la
ligne droite, on aura
si
c'est
o zz: 0.=:^, etc.
P étant une quantité constante;
et
et si c'est
du second degré y qui ne renferme
aucun
Téquation de
A/ zi: P
.
Ax,
une équation
terme de la
x/, etc. on aura R nz o , S iz: o , etc. et
Ay :zz P Ax h- Q. Ax^ C'est pour cette raison, que nous
forme y^ ou
.
nous sommes borné au^. deux premiers coefftciens P et Q.
174
Si
proposée exprime
par ex. l'équation
x
abscisses
l'axe,
du sommet
étant prises
les ordonnées
parallèles
y
Parabole ,
la
les
et perpendiculaires
de
à l'axe,
à
que
sorte
A/m ex Ax
-f- Ar% substituant
-L- R
A x' -I- cet.
A
rA r = P A X -h Q.
A x^ H- R A x' ^- cet.
(n P — 2 x) A X -+- (n Q —
on a o
a/ zz x%
a .
et
.
.
.
.
=:::
fl
1 )
par conséquent
.
P zn ^, dm^, R zz o, S ir: o,
On se souviendra que tout
cela est
absolument con-
forme aux règles vulgaires du calcul intégral.
est
A/ — P.AxH-Q.Ax' + R.Ax'-f-S.Ax*-}-
cet.
théorème de Jaylor, qu'en supposant
le
ne sont autre chose
P, Q., R, etc.
coëfficicns
ou rapports
cocfTicicns
P:=:^^,
stant, savoir,
que
des
diftcrenticls
Q.zi:,;^^J, ,
R
j — a-f-pxH-yx^-fce qui veut dire que ,
A>" zr P
.
Ax -4- cet.
sont égaux
à zéro,
dans hKjuelle
les
que
et
si
l'un
par
y est
celles
de
Ax
que
le
plus
grand
la
-f-
,
conséquent
tous
fonction
degrés,
A)- r^ P
exposant
et
on
nz o
est
etc.
^
de x
de
la
les
suivons
série
uniforme de x,
de x montent au
scrie
les
xx*^-" _f- ,j,.x''~',
des coefficiens
une
ptu'ssanccs
dans
bien,
— — ^-^
de l'équation dilTérentielle
l'intégral
que
différens
dx étant supposé con-
multipliés par un certain nombre,
eait
Car
il
connu par
les
etc.
.
même degré
Ax -f- cet.
est
ou
d'un degré
moins élevé que celui de l'équation diliérentielle ^-^;:^o.
1/5
Nous avons d>n!Té
pement
qu'il
à ce sujet
née-Mire pour nàtrc
n'était
des tout à
àes
port
^=^
diiïérentes.
fait
On peut donc exprimer généralement le rap-
19.
§.
parcequ'iî
btit,
même résultat par des métho-
de parvenir au
et
déveîop^
£;rand
un objet sous plusieurs points
est toujours utile d'envisjgcr
de vue,
un plus
rz P -f- X
.
Ax, P
une
par
différences
de
écjiiation
forme
cette
étant fonction de x, jr, seulement, et
X une fonction de x,y, et de leurs différences. En séparant
deux
ces
parties, la première donnera
^ nz P entre x et
y, laquelle servira à déterminer la nature de
fonction
la
y dont elle dépend uniquement, aussi bien que l'équation;
primitive donnée entre
Il
est
aisé
x
et
/, dont on a
de voir qu'on trouve cette équation ,
substituant dans l'équation primitive, x -\-
au lieu de x
de
^^ :iz P.
tiré
et /,
et en
en
Ax et y -\- Ay
négligeant toutes les puissances
Ax et A^*, supérieures à la première, c'est à dire, en
formant, sa
première
tire,
de
différentielle
substitution
1l\
d'après
donne
manière ordinaire,
-^
les
règles vulgaires.
nz P -f- X
^^ rz P,
.
Ax
,
parccque
La
d'où Ton
Axzro.
P de
l'équa-
tion complète ^^ zz: P-hX. Ax, non pas parceque
Arzzo,,
D'après notre principe,
mais parcequ
on sépare la
partie
X Ax est une expression vague, dépendant
.
n6
grandeur arbitraire de Ax,
de
la
la
nature de la fonction.
est
Il
donc
clair
trouve par
la
vée de
même
la
que P
est
manière , par
g^
=P
chose
même
notre
méthode
multipliés
par
quoicjue
Ax et
que
la
partie
du
toujours
Nous appellerons donc
morne valeur ,
la
L'opération
re-
qui
aussi
n'est autre
des différences complet,
rapport
qu'on donne aux différences
20.
bien, en
Ax et Aj)', tous les
rapport dijférentiel de x et y,
conserve
§.
,
ou des puissances plus
carrés
les
A x ou A/.
de
le
+ X.Ax, ou
laquelle ne dépend que de la nature de
qui
qu'on
fonction
savoir, en égalant
l'équation complète entre
jettant dans
élevées
la
plutôt leurs coefficiens X, à zéro, dans le second
membre de l'équation ^^:nP
termes
que P seule exprime
vulgaiic, et qu'elle est trou-
dilTcrenliation
fondée sur un autre principe:
A/, ou
cl
Ax,
la
fonction ,
quelque
et
valeur
A)'.
inverse qu'on appelle intégration,
étant fondée sur la mcine supposition, n'a pas besoin d'être
démontrée
particulièrement.
Le problème général du
Une
cul
intégral
de
X ou de plusieurs variables
la
fonction
la
différentiation ;
est
celui - ci.
fonction
,
cal-
différentielle
étant donnée ,
P
trouver
/ de ces variables, dont P a été formée par
et
il
est
supposé que P n'est autre chose
177
que l'équation complète des différences de y ,
supprimé
tous
les
de ces diflerences ,
même ,
au
revient
termes qui contiennent
dont on a
des
puissance*
supérieures à la première,
ou ce qui
^
tous les termes de
AxoiiA/, ce qu'on fait effectivement en
multipliés par
formant les rap-
ports différentiels.
On
appeler
pourrait
de dériver
fonction
la
/, ou
^
r=i
— ^s-t-j^ —
étant
cet.
y zi: X*
ou/rz:logx; au
intégral
est ,
séries
-+-
méthode
de sa
3x. AxH-Ar% ou
donné ,
que
lieu
de deviner ces
la
l'équation primitive,
^ =: Sx^
différence complète, par ex.
-
sommatoîre ,
calcul
l'objet
de
trouver
du
calcul
moyennant le
entières
premier terme, ou de déduire la fonction intégrale y immédiatemeiît de ce premier terme, lequel,
n'est
que
primé
tout
le
le
les
Le
reste.
résultat
comme nous l'avons
donc juste,
même
commencement d'une
principes
du calcul
comme on sait,
dont on a sup-
série
de l'intégration
déjà dit
différentiel
7,),
quand
seraient
faux,
{§.
parcequ'au fond, tout se réduit à écrire par ex.
au
lieu
de
3x^ -f- 3x
.
Ax -f- Ax^
par un seul exemple.
démontré que ,
l'équation
Mémoires de VAfad.
J.VI.
^
:z::
3x^-f-cet.
Tout ce calcul
donc fondé sur un raisonnement très -simple,
d'expliquer
serait
Il
est
3 x* -f-
est
qu'il suffira
rigoureusement
3x A x -f- Ax'
.
23
1^^
éteint
donnée,
aise
de
---
y tie peut être que x' + co}i<;t.,
que chaque équation
dëinonlicr
ime^ série recuiiente dont tous
est
sont déterminés par le premier 3 x^,
quation,
"^^
zn 3 .x~ ~{~ cet.
dre changement, en
le
3,x*
+ nx""'
ou bien que,
d'où
:
il
suit
le
moin-
par ex. /zz:x" ou /rrx^-f-x",
sera aussi
-
l'é-
si
que
le
chaneé en u x"
'
ou
premier terme ^^ =z 3x-
pour trouver la fonction de x, dont là ditTérence com-
suffit
plète est 3x'
dt)nc
les
termes suivans
donnée, y ne peut être que
est
faisiint
de
terme
premier
esc
il
aux difféienGes
les
parceque dès que cette fonction subit
x^ -j- coiist.
et
.
Ax
-t-
que l'opération
principes
mécanique
intégral,
:
3x Ax^ -f- A t^
L'intégration n'éiant
.
de
inverse
sont
justifiés
c'est
pourquoi
la
diiïérentiation ,
d'ailleurs ,
il
est
est
au calcul, quoiqu'il la rigueur contraire à
la
la
le
calcul
plus propre
métaplrysique
C'est sous ce point de vuc^ qu'il faut en-
de ce calcul.
\risager la
un pur calcul
permis dans
de donner aux équations la forme
dont
méthode adoptée dans le calcul intégral, d'em-
plpyeï les caractères 5x, dy,
comme des quantités réelles,
L'analyse d'un problème
au lieu des rapports
différentiels.
ayant donné par ex.
cette équation ^^ nz x" -f- ^ * la ques-
tion
est,
quelle
difTéienlicl,
ou
cette fonction,
est.
la
fonction
dé})endant
y de x, dont le rapport
uniquement de
[H) , est égal à x^-f-" ;
et
la
nature de
en se rappel-
179
lant les icgîes qu'on
que
aisément ,
voit
C H- ^'\-- + a
•cul
laquelle
les
commode,
être
que
la
pratique
du
cal-
r~ x^. d x -\- a
du calcul
règles mécaniques
de
et
^
,
à
intégral s'appli»
C'est pour cette raison, qu'on peut
quent plus facilement.
écrire
saurait
de multiplier par âx ,
1 équation cette forme d /
donner à
ne
pour
Mais ,
on
calcul difTérentiel ,
le
fonction
cette
log X.
.
plus
est
il
suit dans
équations différentielles de cette manière ^^:=::;X,
les
ou de celle-ci dy ::=zX.dx,
la dernière se
rapportant tou-
au calcul intégral.
jours
§.
c 1
Le
.
^absolument
le
calctil
fondé
morne que
le
ce principe ,
sur
calcul
est
donc
différentiel vulgaire.
L'équation complète des différences -^ zz P-f-Q.. ^x -t- cet.
étant donnée,
s'aglT'de séparer
il
Ax^ ce qui se .fait
pas multiplié par
terme
le
,
P qui n'est
en formant de la
manière ordinaire, le rapport diflérentiel ^^ r=: P.
Avant
voir,
plus
d'aller
loin ,
il
comment on peut trouver ,
notion de
fonctions,
l'
infiniment petit ,
la
dont la différentiatioir
.
sur cette notion
que nous
sera
'
nécessaire
'
de
faire
sans avoir recours à la
différentielle
est
de certaines
fondée ordinairement
nous sommes proposé
d'ëViOer*
enl{ièrement.
§
22.
Soit n
on a donc Aj-
m
un nombre, entier et positif,
a/i
.
x"~'' Ax -f- a'/î
et v:r; a. x":
^- x""' Ax* 4- cet.
33 *
'
'
par conséquent
^l =1 o/ix'^et
ce
qui
est
Va .Arr'^'^-^x^V^'"--'^^'^--^x^--^ AX4-cet.).
zn nnx
.
;
formule
là
difféi-entielle
connue qui n'a pas
besoin d'être démontrée, parceque le théorème binomial est
fondé
tant
sur
les
que n
est
Soit
règles
de
élémentaires
multiplication,
la
un nombre entier et positif.
m
donc j z=r y x"" rr: x , de sorte que
'^
y -]- A j :z: (x -f- A x)
'^
irz X " ( l -4- \-') " >
ce qui donne
m
Puisque (l -h^^^ devient égal à l'unité, lorsque Ax sem
vanouit, supposons (n- ^'^)'' r=:i -f- A -^--f-B-^ H-cet. ;z:S;
ce qui donne
(r-H Ajr=:x'"S^=:: x"^ [i
+ n{A^^
-+-
6^*4- cet.)
(A^^f -h 2 A B ^^ 4- cet.) +- cet.] et
x""^t^""' Ax= 4- cet.
Ax 4(x 4- A xf ru X™ 4- m
_^
,(:i-.-j}
^-—
'
Comparant cela à
(y-i
A// — x"4-n A x'^-' Ax4-n(B4- -r A^) x'""' Ax=-+-cet.
en obtient
ftW
btr»
A
iir:
B
m —,— HZ
-
,,
-^^^
5
n"
-r
—
i)
l8i
et ainsi de suite; par conséquent
H
1
"l
—
-(^
i
—
l)
"
9
mêmes formules qu'on trouverait par le
théorème binomial , appliqué à un exposant fractionnaire,
ce qui
sont les
CD substituant — à la place de
On en tire
n.
4-Axf^--^î
x"
"-f-cet.
j
ac^")
et <*'
ou
_ -.Î-Jt
ax
Comme nous venons de prouver que
(1 -f.
^r = I -h ^i"^ -t- ^F-'-^ ^' -f- cet.
dans le cas même oh n
y-i- Ay rr -„ (1
^__
OQ bien
est
une fraction^ on a, en divisant^,
-n- - -^,—
^
.
-. - cet. h- «^
^ ^cet.)
r
cet.),
—
182
égal à un nombre
n
Texposant
négatif,
oa
entier
fra-
ctionnaire.
Nous avons donc prouvé ,
l'infiniment petit, qu'en général
soit la valeur
ctionnaire ,
de
n,
de
considération
la
-^'—^=.nx^~', quelle que
positive ou négative, entière ou fra-
ce qui renferme toutes
fonctions algébrai'
les
ne reste, maintenant, que
ques sans exception.
Il
ctions transcendantes,
où tout
ries
sans
se
les fon-
réduira a trouver les sé-
connues des logarithmes et des lignes trigonométri-
ques, sans avoir recours aux infiniment petits.
§.
24.
Dans chaque système ,
faut que
il
le loga-
rithme de (iH-x) soit une telle fonction de x, qui
décroît,
et s'évanouit,
log % zzz o.
en
même
tems que x,
Nous supposerons donc
log (1 -i-x)
croît,
parceque
.
— Ax-{- Bx" Cx^ H- Dx* -f Ex,'
+ ¥x^ 4- Ga;^ + n.v^ -i-lx^~h
-4-
,.
j^
cet.
d'où l'on tire de suite
log ( 1—x) z^
— Ax-h Bx' — Cv' 4-
D.v*
—
'Ex''
-h Fjc*
— Gx'
.4.n.^8__|3;9_^cet.
log (1— x^)
Or,
1
X'
=- Ax»-4- Ba*—
étant aussi
1:
13 X' -f-
2
C.v*' -h
D:^^
rz: (1 -f- .r) (l
D X* -h 2F X
— Ex'°
— x)
« if!
,
-f- cet.
nous avons
2TI x" -K cet.
C
B
i83r
ce qui donne
i)B--A^ 2)1):= H. s., 3)F^- J, 4)H^r:^^ etc.
De la même manière on a
log (1
A x^ 4- B x^
;t3)
—
Or,
1
—
x' rr (i
——
— +
au lieu de x dans
log (i-f- X + X')
(i
a;)
—C
et substituant
a; -fr- x^),
x^"
X-hX^
on trouve
la première série ,
m A X -h A X* -h B
%' 4- cet.
-f. 2
B x' -f-
X* -f-
H- 3 e x« -f- 3 C x' -h C x« -f D X*
X*
+ 4 D X*
H- 6 Dx« -h 4Dx7-+- Dx8-f-Ex^-+- 5 Ex* -^ i oEx»
-f- 1 o
E x8 -4- 5 E X» -h cet. -f- Fx^ -+- 6 F x^,
-h i5Fx8-{-2qFx'-|- cet.
H-
G x'"-h 7 G A^ -4- 2 G x' + cet.
i
4- 11 x8 -f- 8 H x» 4- cet.
d'où l'on
-f- I x'
4- cet.
tire-
iog( 1 -x) ( n- X -f- X») =: ( A -f- 2 B) x^ H- 2 Bx» -f- (B
+ 3C
-+-
2 D) X*
-+-
(3C-f- 4D)x^-^ (C --6D-+-5E-+-2F)x<'
-4-
(4 D' -+- lo E -+- 6 F) x7
G -h 2 Tï) X*
ce|^
G 4- 8 H)
-H {Ù -h 1 o E -4- 1 5 F -f-
^ (5 E ^
€C qui étant comparé a log (i — x') r=:-~
20F H- 2 1
/^
•/
xî»
-+-
x'h- B x*— Cx'-h cet«
donne, outre les coëfficiens trouvés pj is haut,
5)3C^-4Di:zo, 6)4D4-ioE4-6F
7) D 4- 10 E 4- i-S F 4- 1 G 4- £H =: o
,
=
0r,
donc
i34
Er=-+-i,H=— ^,G = -f-y. etc.
Nous avons donc
log (i4.x)
= A(r--4------i---y-+-y---+- Cet).
A étant le module du système. Faisant donc Azzt, on a
log. nat.
(i-f-x)zz:x—.^H"^
— ^-h
cet.
ce qui est la série connue.
f.
25.
Pour ce qui regarde
les lignes trigonoraêtrî-
ques, la géométrie élémentaire donne les théorèmes suivars:
sin (
— 2):= —
cos o nz 1 ;
sin (-{-z), cos (
d'où
il
suit
— z)zi:-H-cos(-f-z), sinoziio,
que
sin z ,
étant
développé en
de z,
série,
ne peut contenir que
tandis
que
la
série
de cos z ne contiendra que les puis-
sances
paires ,
son
premier
les puissances impaires
terme
étant
égal
à
l'unité.
Nous aurons donc
sinx=:Az
+ Bz'-fCï'4-r>z'4-Ei'4-
cet.
cosz zz: 1 -f- az* H- bz* 4- cz^ -h dz* -f- cet.
De plus, on a par la géométrie élémentaire, sin 2zr 2 sinzcosx,
cos2z=zcos^z
— sin^z: par conséquent,
supposées donnent ces deux équations
:
les
deux séries
185
ssinîcoss — 2At. -«-
c!B7.'-+-
cEz'-i cet.
aCz'^-i- cDx'-f-
-t- 2 . Vnz'-t-i B(i7.^-*- 2 Cfl77-H 2
Dn s'
-h2A6zVcB62?-+-2C6ô^
}(A)
-f-2AC77-i-2Bci'
-4-2Adï»
sin22:r:2A2-h8Bï»H-32Cx^H-l28Dx^-h5i2E2;'-+-cet
cos-i— sin*z::i:in-2az^-t- 2 6 î* -h 2 cz* -^ 2 c/z'-f-cet.
-> a^ z* H- 2 a 6 z^ -f- 2 a c »•
6^ x«
-h
— A^z^* — 2 ABz* — 2 A Cz« — 2 ADz» — cet.
- B^z« -2BCz8
(B).
coszz=z i -+-4az^-f- i66z*-t-64cz*-i-2 56(iz^ -+-cet.
Employant donc alternativement les équations (A) et (B),
pour déterminer
i)2rt
4;
I
5
les
coefficiens,
on trouve
— — AS 2)3B=zAa, 3) 146 =: ~ 2 A B,
C " Brt + A
62 =z a6 — AC — BS
a^
b,
5)
2
2
c
6)63D — Ca-r-B6-hAc, 7)2 54d=i2acH-6»-2AD-2BC,
A rf, etc.
8; 255 E =:: D a -f- C 6 4- B c
+
ce
cjui
donne
2)a..---,2)B^-^,3)6=+,^V4)C:=^.-f^^,
^) ^ =^ ~ rj-s-e* 6)D = --^.-, 7)rf^ + -^.-s.
8) E
= — -—
-+-
,
etc.
Nous avons donc
M^'moiresdcrAaid.
T.VL
^4
186
h ~-
k%
sin z:=z.
A=i'
cos z n^ 1
ce
qui
î
conforme
est
A4a4
A^côi
^
a-i-I-
2.3.4.J.6
sëiics
connues,
,
îuix
-f-
cet.
^-
cet,
.
I
si
A -n
l ;
et
c'est
ce que nous allons dcinontiTr, quoiqu'il p»iiaissc évi-
dent
par
géométrie
la
élémentaire.
En
cfl'ét
Euclide
,
ayant prouvé que, par la bisection continuée de
la
péri-
phérie du ccicle, on peut toujours |jtjrvenir à un arc dont
la
de
dilTérence
corde
sa
moindre qu'une
est
donnée, quelque petite qu'elle soit,
limite de la
lative
au
membre
s'en
suit
que
la
corde d'un arc, ou du sinus d'un arc z, re-
decroisscment
de
de
que
l'équation
sin z r~
X pour
il
quantité
limite,
z, est sin
nous
z jr: z.
Le second
de
venons
trouver,
Az
-3 h cet.
par rapport au décroissement de z, le pre-
mier terme Az.
Or,
il
est
évident que, deux quantités
étant toujours égales entr'elles, quelle que soit la
valeur
de la variable z dont elles dépendent, leurs limites, relatives à
Taccroissement ou au décroissement de z, doivent
aussi être égales:
ce qui
donne -z:zzAz,
donc
A rr^ 1.
Mais, comme nous nous sommes proposé d'éviter non-seulement
la notion
de
l'infini,
mais aussi celle des limites, nous al-
lons prouver encore d'une autre
que nous
ni
ferons en
moins grand que
manière, que
A zr l
;
ce
prouvant que A ne peut être ri plus
l'unité.
1S7
— r=
ger,
^-
que
—
ni,
uii
de sorte
— /n-4-m/î(i — ]j)-[-mnpq{i —
r)-}-cet.).
ziuç^lc
permis ,
jours
z tel que
que
vii
m <^ i — ^,
1
—
et
1
1
p,
-f- 1
—
de
,
1
sin 2 zn
<^
'^^
^^ ^"^ ^^^ ^°"~
'
A est une quantité
les
constante ,
valeurs possibles
:
alors
qu'en
' ^^^
yS
m
substituant
etc.
et
on
m, n, p, q, r,
seront positives et renfermées entre
sorte
— P ^^ PS —
2.*
toutes les quantités
et
etc.
r,
-^ z=i q,
g-"- iz: p,
que z peut prendre toutes
aura
disons, pour abré-
1,
etc.
-- r=: « ,
sin z^zAï-fi
Prenons
A>
Supposant d'abord
c6.
5.
1
zz:::
o
— — a%
-^
on aura
Aï (^ -h a= -}- wn/i3- + mnpqy'^ + cet.),
A z (a^ -+- »; « jS^ -f- cet.)
ou bien
sin 2 =z 2 -f-
mes de
cette série étant positifs: par conséquent,
tous les ter-
,
sinz>ï,
ce qui est impossible.
J.
ce qui
27.
donne ^-
— ^—=^r)
Faisant donc A^ z*
La
série
A<i, prenons ^'<^S^-^)»
Supposant ensuite
.
-!- zr
>
^*
a sera renfermé entre o et -<- 1.
,
trouvée pour, sin z
^<f> etA=z^<f,
donc
{§.
25.)
donne
^ ^(l—:^)z^-^.^.^(i—~)%'-h
+
6-^
^^^.3-4.,-^
2.3
et
la
supposition
^^
~
^^''^ ''
<<
4. ç
^-^
—
doux premiers termes i-|-(i'
6.7
fait
-^') 2^^
V
g. 9/
que
la
^st
I
cet.J,
J»
somme des
moindre que ^.
01 *
9
188
Ou*elle soit donc
z=l
^^^x^> ^® sorte que
^-^
4'4-î
Apres avoir
4Î
et
fjit ,
4Î-6
.
— cet.].
T^7V(i — ^)
8-9'
•'
6.
pour abréger ,
4-y-6
4. î. 0.7. 8.
7
'
rr
nommé S la somme de tous les termes positifs, T celle
des négatifs, de sorte que
R
S
.ii:
T — k^z^ {% -f-25-f-
— T, supposons
-f-^-t-O-l- cet.).
-,
Nous avons donc $(
^ =r ^-'-"~
4. y. 6. 7 *
%— ^ — ^^
'^
4.5-
gencrdl 4?-^
56
-^-
4.5 .6..
ce qui aonne
q;
^''
(n^6; (nlf:)'
—
a^
^^
11
.
^^
.(n^ .oJC«-+- ••) "
•>
>
X4T4((n-H .o)(n-+- ..j'^'a^
où restituant les valeurs A -< 1, A*z*«<f, on obtient
t (n-^8)(n-^-9)(n--IQ)(n-^ll)(Cn + 6)Cn-f-7)— i).t5
^ «^
*
û
36 . (n4-ioKnH-n)
û «^
On voit donc
tifs
*
36
,
que le rapport de deux termes consécu-
\ augmente très-rapidement, à mesure qu'on s'éloigne
davantage du premier terme
valeur
de ce rapport,
§(,
et
on trouve
la
moindre
en faisant nzzz.o, ce qui donne
Formant donc une progression
ou
-|>>2o5o.
l^--"-^-^',
géométrique dont le premier terme est égal à l'unité ,
l'exposant
zz: pi^,
on vient de voir que
T < A^z^ S( (1 4- r^^ + ,5^ 4- cet.}.
.
et
i89
Or, la somme de cette dernière série est égale à
•— .ÏTB
-t- £049»
-^
-049
^*
4.Î.6.7
l-t
,
*
".
S T-
p^r conséquent T<?g°.|.;^^, ou T<i.
La
également très-con-»
série des termes positifs S est
vergente ;
mais nous n'avons
somme;
suffit
il
pas besoin de connaître sa
de se rappeller que, n'étant composée que
de termes positifs, elle est nécessairement plus grande que
son premier terme *'^~:donc à plus forte raison
^
—
T est plus
S >*"."— o" S>*io^ ^o" ^1 suit que S
grande que ^
et que R n: S
T est
^^ ou que |^ ,
—
—
toujours une quantité positive.
En reprenant
'ililiiiiil/
on voit que
"-î^^;"^^'^
— — — ^^ R,
ou bien
sin^z (1 -+- z*)^ << 2.%
l'équation
<^ 1 ^
(3'
i
et sin^z(n-z*)<^^-3^, donc à plus forte raison, sin^2;(i-f-2^)<^z*:
d'où
il
dire , tang z <^ z
équation
la
est
absurde , vu que dans cette
%
être
aussi
petit
nous
avons
établie ,
e8.
peut
que
C^^Y'
Lacroix, T.
être ni
ce qui
condition
Af^r-^A^) •
§.
sin^'z),
:
l'angle
seule
^^ "^
—
sin2z<z2(i
suit
I.
^''oitè
ou
-"!^
<
veut,
étant
du Calcul Différentiel
à
etc.
que
par
33. 34. 35.)
Nous
(§.
c'est
qu'on
avons
donc
prouvé
que
plus ni moins grand que l'unité, donc
qui donne
2.^
2 5.)
A
ne
peut
Azu i, ce
,
2
igo
sin
— -^ H
zznz
a.j
cos z =z 1
facile
serait
Il
aussi
bien
serait
d'autant plus inutile, parcequ'il nous
deux premiers
termes.
Maintenant,
est
connaître les
29.
5.
'
il
aisé
(§.
de
cet.
'
développer plus loin
celles des logarithmes
que
h cet.
— — — -h
2
a.3..>.5.6
'
de
9. j. 4. 5. 6. 7
-
h 2J-4
a
—
~
2.3.4.5
I
24.) ;
ces séries,
mais cela
suffit
de
ici,
trouver les rap-
ports dilTérentiels de ces fonctions transcendantes.
Soit
y zz: log. nat. at,
d'où,
nommant
base des logarithmes naturels, ou
la
c
c^ :z= X, et e^~^^^ n: x
x-\-Ax =i e^
ou bien
i -f-
^
Ay = log
.
+A
e''^ zn
rr: e"^^ ,
( 1
x,
X
c'est
.
ceque
les
termes
s'évanouissent,
à dire ,
e^^
par conséquent,
+ V') = " -^' + t^- «'• «• =4-)
^ = .--^M^-^, +
= ou 9/ =r ^
ce qui donne
^^
^-,
stiivans,
étant
3o.
et
(§.
20.), non pas, par-
muliipliés par, à X :==;^ O,^
mais qu'ils contiennent la partiel vague du
à déterminer la natiue de la
§.
,
cat.),
rapport, laquelle n'ayant aucun sens précis, ne peut
vir
tire
Soit
fonction
ser-f
y in: log x.
y :iz sin .v, donc
y -j- Aj:.=:.sin(x-f- AxjiizsinxcosAx-f-cosxsinAx,
.
IQl
'
usage des séries que nous venons de trouver (J. 28.),
et faisant
y~i-Ay:=.s'in x(i—
ce qui donne
^^^ zi:
--!"'- .tn cos X,
•u
-^^.'^
cosx
et B
-cet.)-f-cosx(ûa:— ^-i-cet.)
— ~ sinx — ~- cosx h~ cet. et ~
sinx :=z dx
.
cosx.
.
yzz.cosX: on aura
Soit
;^ -f-
—
^
A j r3 cos (x -f- A x) zn cos x cos A X — sin x sin A x
—^
— sinx (Ax — ^—
m — smx
C0SX+
x
—
—
zn
sinx,
ô.cosxrz:
^x sinx.
zn cosx ( t
-j- cet.)
-^
-
et
'^"^
O
—
sin
/
— ^^ -h
—
X cos X — —Hcet.)
,
—^
.
:
)
—
—y
sin ar
sin.v
cet.)
-}- cet.)/
(
-f-cet.) -f-
— X cosx (Ax — f—
—
AX
'^ +
ce qui donne
X— AX
x cos x — ^
x -^
cos-x (i
-f- cet.)
-^-^
-{- cet.)
siii
cet.
sin
^*
cos^
cet.
cos*x(i
— Ax.tgx — ^
i
h cet.
=:
^-^
-f-cet.)
^
(i
.-h
-
Ax.tgx -f-^--f- cet.},
cos* X
et
ou
(A.v — t^y H-h cos= x Ax — ^
sin^x (Ax — f— -hcet.)C
cet.)
( i
— sinxcosx(i — "^^
cos*
--
f
cos .V ( i
\
,-
et
A y* zz: sin(x-r-Ax)
cet.) -f- cos.v A.l"
^^ -H cet.)
-f^ -h
j
donc
sin 3:
y rr; tan^ x zr
sin .r ( i
-f- cet.
.
^
•..
Sojt
sin
donc
-f- cet.),
enfir7
^^
ou
—
^-^ zz -,-, ou bien à .Xd^n^xzz:
-=-
—
193
De la même manière on trouve les difTérentielles des
autres lignes trigonomëtiiqucs.
riables X, ï,
que
la
être
formule
-T
est
il
clair
A/ ne dépend pas seulement de A x,
A z, de sorte que le rapport différentiel ne
exprimé
p et a
vu que
par ^^ ni par
ni
composée de
T-^- »
ayant
indépendantes l'une de l'autre,
différence
mais aussi de
peut
y est une fonction de plusieurs va-
Lorsque
3l.
§.
1'
étant
une
et
des
fonctions
détermination
la
d'après notre principe ,
aussi
de
du
bien
^
mais
,
autre ,
1'
de x
.
rapport
que
la
par
une
telle
que
Ainsi,
z.
différentiel
différentiation
vulgaire, se réduit à rejetter dans l'équation des différences
complètes ,
sances
des
tous
les
différences,
on ne conservera
ici
termes
multipliés
par des puis-
supérieures à la première
que
les
(§.
ip.),
deAx,
premières puissances
ù y, A z, etc. dans l'équation aux différences, trouvée de
la manière ordinaire a l'aide de celle proposée entre x,/,z, etc.
ce qui donnera une équation de cette forme
O ^=. h
.
Ay 4- M A X 4- N A
.
.
conséquent,
par
„ ^ ^^^«
j^
^
—r- ou ^^
^
'
r
Max
pdx -f- qdî
-t- N.A»
2-,
rrz
—
l.
Soit par ex. /rrxz: alors, si z est fonction de x, de sorte
que
A est un rapport donné par celte fonction
,
oa
a
193
et
ou dy z= 2.^x -f- a'5z.
^^ n: z -}- ""^J y
pendant de X,
rapport ^^ ne peut être exprimé par x
le
ou z; mais, comme
il
arbitraires
fait
est
ou bien
quoique arbitraire, doit
A x,
quel.'e que soit Id grandeur de A X,
ne dépendant de x ,
qui ,
doit
être
de
manière
même
le
que
Nommant donc
entre
il
une valeur déterminée dans chaque cas particulier,
avoir
et
sont tout
indépcndans l'un de l'autre,
et
A X et du rapport ^^ lequel,
de
Ax, Az,
accroissemens
les
A/ de'pend de l'un et de l'autre,
que
évident
est indé-
z
Si
ce
,
^* rr: ^^ ,
rapport
ce
ni
par conséquent de
comme dans
la
^^ zz n,
seule
et les cas précédens ,
cas
fonction de x ,
la
ligne droite.
difiëience
est qu'ici
n n'est pas
mais une constante arbitraire ,
à laquelle
dans
chaque cas particulier une valeur
déterminée, pour que
A/ ne soit pas tout à fait vague.
il
supposer
faut
Nous aurons donc
^^ zr z -4- ?i X
'
A-x
ce
qui
rapport
-f - ?i .
'
Azznn.A x, Ay m A x (z -+-nx-i~u.A x),
A X et dx
/ ru z -I- X ou t"^ :=:- -{~x ;
sens
dans lequel
dilïérentiel
d'un
produit
le
dan''
il
faut entendre le
'
vrai
est
,
'
?2
,
'
de
plusieurs
variables.
Lorsqu'il s'agit d'intégrer, on peut lui donner, pour faciliter
le
calcul ,
^^
=Z
-f-
une
''—
,
autre
forme.
donc
pelativement
Restituant
au
nrz: :.- ,
calcitl
on a
intégral,
dyznzdx-i-xdz; c'est à dire, l'intégral de z^a^-^x^zest-x'^.
Mêmoirts de VAcad.
T. VI.
25
194
La fonction y étant donnée par nne équation
32.
§.
quelconque entre
x, y, savoir
(A)o n a-+ |3x-t-y/H-5x^-+- sxy^ ^j'-4->]X^-+- ^x*/-*-HX/*-f^/'-f- cet.
réquation complète aux diflerences sera
+
(B) O =:. ((3
2 5 X 4- £/ -h 3
-)- (y 4- e:c -h 2
-|-(5-f-3'vix
+
(«^
'/)
X* -f- 2 ^ X/ -+- H/') A T
^/ -f- ^x^ -t- 2 KX/ -h 3 Xj^'; A y
+ e;)Ax'-}-(£H-2ex4- 2k/) Ax Ay
.
-h K X 4- 3 X j) A j^ -f- VI
4- H Ax
.
A/* 4- X
.
.
A x' 4- ô A X- A/
.
.
Aj' 4- cet.
ou en abrégeant,
(B)o^A Ax4-B.A/4-C.Ax2 4-D.Ax.A/
.
4-E Aj*4- F. Ax»4-G Ax* Ay4-H. Ax. A/^'-t-K. Aj',
.
.
.
ce qui donne
^^
— — - — - Ax— - Ar — - ^ Ar — - Ax*
-°Ax.Aj-^Aj^-Ï.^^.Ar-cet.
ou ^ r:: M 4- N Ax4- Q.. A/, M étant une fonction de
.
N, Q,
X, y, tandis que
sont des fonctions de x, y, et
On a donc l^^rMrz — ^, tous les autres
termes dépendant de la grandeur arbitraire de Ax et A/.
de Ax, Aj.
Lorsqu'après avoir donné à x une valeur déterminée,
on trouve
on a |^:=i
A=o
—
on a |^ =z o , au lieu que, si B zr o,
\zzio 3 ou comme on ! exprime ordinaire,
ig5
ment, |^:=oo.
A
X étant substituée ,
leur de
un paicil
fois: dans
o
peut aussi arriver qu'une certaine va-
11
l'équation (B) devient
cas,
— C Ax* H- D Ax A/
.
.
.
B s'évanouissent à la
et
-f-
E A/2 -f- F Ax' -f- cet.
.
.
ce qui donne
— D j:/C D' — CE)
dy
dx
et
l'on
2E
sait
que
indique
un point double dans la
cela
connu par
cela
courbe.
Comme
férentiel
vulgaire ,
tout
,
>
est
ne
nous
calcul dif-
le
nous y arrêterons
plus
pas
longtems.
§.
33.
Passons
maintenant à l'objet principal dont
nous avons parlé plus haut
(§.
qui
et
8.) ,
renferme les
problèmes qui ne peuvent guères être résolus que par les
rapports dilTérentiels.
Nous avons vu que tout se réduit
approuver que ces formules ditlérentielles, trouvées par le
même principe qui est la base du calcul différentiel, donnent une solution rigoureuse du problème, ce qui n'est un
objet de l'analyse,
que dans
le cas
où
le
Dans tous les
est purement analytique.
problème
autres cas,
fonder cette démonstration sur les principes
de
la
qui a fourni le problème, par ex. la géométrie ou
canique.
Dès que cela
est
du problème est obtenue'
démontré,
et dans
la
même
il
faut
science
la
mé-
solution générale
chaque cas
particulier,
25*
ig6
on n'A qu'à exprimer ces
quantités x,y, co qui se
de
r équation
que
la
foinuiles
fait
difTcrentielles
par la dilTérentiation virlgairc
proposée (A) entre x et r;
formule diiTéientielle d'un arc ,
de r espace parcouru
pjr les
par "un corps,
bien
entendu,
d'une surface ,
on
trouvée par la pre-
mière opération à l'aide de considérations tirées de la géométrie
OLi
de la mécanique,
est
fondée sur le même
prin^-
cipe ou raisonnement, que la difTércntiation vulgaire.
Si.
la solution
complète du problème exige l'intégral
des formules différentielles, cette intégration, faite d'après
les règles
vulgaires
parce qu'on y
fait
à la diilerentiation
,
ne peut donner qu'un juste résultat,
la
même supposition
(§.
7.).
qui sert de base
Lorsqu'il s'agit par ex. de la rectification générale des
courbes ,
il
faut démontrer par la géométrie ,
chant du rapport qui existe entre
s et
l'accroissement
rhypothénose du triangle formé par
des coordonnées
x^,
y,
qu'en détai-
de
l'arc
les accroissemens
la partie indépendante de la gran-
deur arbitraire de ces accroissemens , on la trouve ,
dans
toutes les courbes,
^'^*
comme nous
égale à l'unité, y 13 x^ --h
~~ ^'
dW)
avons vu que cette partie du rapport
est
identique avec le rapport différentiel vulgaire, et que
l'in-
té^dtion ne
fait
que
restituer la quantité diffërentiée sui*
,
19^
Viint cette
régie
gaire de
(f)x- -4- 6).r*)
/
7.)
(§.
est
il
,
sur qtie l'intégration vul-
donnera l'exacte valeur
de l'arc:
car tout le reste n'est cjti'une opération de calcul.
Si
lu
solution générale ds zn]/ {dx^ -'r- dy') doit être appliquée à
une courbe quelconque, donnée par l'équation (A) entre x,
y, on tire de cette équation, par la
gaire, 3^:^P,
et la valeur
de
différentiation vul-
l/'(c)x*-4-3)^)r:z5r .^/(l-^P^),
laquelle étant intégrée de là manière ordinaire, donne lare
s
en fonction de x et y»
§.
tre
Le rapport dilTérentiel |^ =: P est, d'après no-
34.
méthode,
laquelle ,
cette partie
étant tout
ou
de I4 fonction y
,
que
de
quelle
ditTérences ^^
indépendante de
fait
la
grandeur
de ces différences, ne dépend que de la nature
arbitraire
la
à
du rapport des
valeur
que
férences
soit
de X
la
et y.
de
courbe
la
P zi: ^^
reste
grandeur
Or,
proposée
:
constamment
qu' on
attribue
nous avons vu
de
sorte
la
même,,
aux
12.) qu'en
(J.
ne considérant que ce rapport des différences, qui est
dépendant de leur grandeur ,
continuation
dxQtdy
de la courbe comme une ligne
droite.
Le
= P,
la-
du premier degré , indique une ligne
étant
regaidées
in-
on regarde effectivement la
même résultat suit de la forme de l'équation ^
quelle étant
dif-
droite,
comme les deux coordonnées.
tomme A x et A r le sont pour la véritable courbe au delà
du
pour Irquel on
point
déterminée, de
X et y
be,
donné à x
a
que, pour
sorte
doivent
la
regardées
être
y une valeur
et
continuation de
comme
la
cour-
des quantités
Au delà de ce point où l'on a pris les diffé-
constantes.
rences ,
l'arc
comme
se
de
courbe
la
confondant avec
est
sa
donc réellement regardé
non pas parceque
corde ,
l'un et l'autre sont infiniment petits, mais qu'en excluant
la
partie
du rapport des différences , qui dépend de leur
grandeur , on
a
réellement
éliminé
la
courbure
de
la
courbe, de manière qu'il ne reste qu'une ligne dioite équi-
valente à la courbe ,
la
Tab. W.
^^S* ^
et qui ,
par sa position , détermine
nature de la couibe.
ALMrrî, son accrois— Aï: il est
sèment ou l'arc MmS z^ As, la corde MS
§.
clair
35.
que
Soit maintenant l'arc
As
est
une
fonction
de
Az,
de
sorte
que
As =1(1. Az-i-K Az^ -\- cet. ou
^' rz a-h R Az -h cet. et ^' =r Q,
.
.
ce dernier étant le rapport indépendant des quantités A^,
Az.
Or,
port des
la
nous venons de voir que cette partie du rapdifférences
est équivalente
à la
supposition que
continuation de la courbe coïncide avec sa corde:
conséquent nous avons ^l =^ i.
Maintenant,
les
par
élémens
de la géométrie donnent l'équation exacte Azzizy' [Ax^ -^ Ay^),
199
donne
substitué dins
étant
qui
€e
.,-.
f ^
.
^ iir i,
nous
l'équation précédente ^
ou lélaLivcment au calcul intccial,
ÔJ ::= V^(dx* -)- dy') zn 3 r
/
( i
-f P')
rapport
le
,
différen-
1^ étant toujours désigné par P.
tiel
Pour répandre plus de jour sur ce raisonnement qui
pourrait paraître à quelques uns de nos lecteurs ne donner
qu'une approximation, aussi bien que les principes vulgaires
du calcul différentiel, arrêtons-nous encore un moment.
Nous avons
fait
deux hypothèses,
l'une géométrique, qu'on
d'une courbe
comme une
ligne droite
peut regarder
l'arc s
2 de la même
longueur (sans quoi on ne pourrait la
fier
du tout),
purement analytique,
l'autre
la
grandeur
des
diiTérences.
L'une et l'autre de ces
hypothèses étant évidemment légitime ,
il
quel sera le résultat de leur combinaison.
prouvé que ces deux
qu'en
nière
recti-
faut faire
du rapport différentiel, qui dépend
abstraction de la partie
de
qu'il
hypothèses
appliquant
la
reste
à savoir,
Or, nous avons
rencontrent
se
dernière
à
l'équation
de
ma-
d'une
courbe, la droite z devient, non à peu près (ce qui serait
réellement le cas ,
si
l'on
considérait
le
rapport complet
des différences), mais rigoureusement égale à la corde de
l'arc s.
9z,
Par conséquent, l'intégration de cette différentielle
faite
en prenant
pour base
la
même hypothèse que
nous avons appeiLée analytique, ne peut donner que l'ex-
200
acte
valeur de
l'aie
Voilà en quoi consiste
s.
raisonnement duquel nous nous sommes
Tab. IV.
36.
J.
Il
l'esprit
servi.
ne sera pas inutile de prouver
de l'expression de
encore
l'arc
du
justesse
la
dune autre manière.
Soit
AP^nx, PM:^/, MCI— Ax, dS :r3 A/, et supposons
que l'équation de
la
courbe (A) donne l'équation des dif-
férences (B) A/ — P
Ax-[- a
.
.
Ax^ -H R
Ax' H- cet.
.
(Voy. §. 32.): donc ^^ rr P -h Q.. Ax -|- R Ax^ -f- cet.
quelles que soient les valeurs de Ax et A/. Prenons un
point quelconque m entre M et S, et nommant Mp = ^,
.
pm^^, on aura par l'équation (B), ^ =: P ^-f-Q. <^' + R ^^n-cet.,
.
et par les triangles semblables
pq -^/J
.
JMQ.S, Mprf,
-V ^ + a. Ax ^ ^K Ax\ ^
.
.
.
-4- cet.
par conséquent^— pf/ ou qm-Çl-^{^—Ax)-i-'R.^[^'—Ax^)-^cet.
Or , nous savons que l'cxclnsion de
des
dilTérences, qui
supprimer
les
dépend de
termes
la partie
du rapport
leur grandeur, se réduit à
multipliés
par
des
puissances des
dilïérences, supérieures à la première, c'est à dire, ù égaler
les
coëfiiciens Q., Pv,
etc.
substituant les diflérentielles
plètes,
l'arc
se
on
a
^
d'où
à zéro:
au lieu
suit
qu'en
des dilTérences com-
— pq zziO, ^rzpq, pmnzipq; c'est à dire,
confond avec sa corde, et on a
d%
il
"" 3^(5x2-|-d>^)
c**/(i-t-i'2)
201
ne
lorsqu'on
tient
laquelle
des
différences ,
deur.
Or ,
calcul
intégral,
leur
de
compte
comme on
l'arc
fait
partie dci rapport
la
indépendante de leur gran-
est
même supposition dans le
la
qu'on
clair
est
il
de
qtie
trouve l'exacte va-
par l'intégration vulgaire de la formule
s,
ax/(i H-P^).
Cela prouve en même tems une vérité impor-
37.
§.
dont
tante ,
serait
il
difficile
de
convaincre autrement.
se
est clair
que,
dans chaque courbe,
jours
plus
grand
que
que
la
Il
différence
corde.
sa
entre
l'arc
et
l'arc
M S est tou-
Il
parait aussi évident,
la
corde sera plus ou
M, S, ou la
moins grande,
selon
grandeur de
corde, et que, la grandeur étant la
cette
la
ne
différence
la
distance des points
peut
être
la
même
même,
dans toutes les
courbes, c'est à dire, qu'elle dépend aussi bien de la gran-
deur
que de
la
nature de la courbe.
venons de voir que
la
seulement de la nature de
différence
point
Id
de
voir
dépend immédiatement
de
Il
est
aisé
la
grandeur,
mais
courbe, est dans toutes les
de
nulle.
nous
différence entre l'arc et la corde,
en tant qu'elle ne dépend
courbes
Cependant ,
que cette dernière
la
courbure
de
la
courbe, vu que chaque courbe s'écarte plus ou moins de
sa
corde,
sens
tle
selon
cette
qu\|le
est
contradiction
Mémoires derAcad. T. F/.
plus
ou moins' courbée.
apparente est donc ,
^^
que
Le
la
202
courbure de ch.iqne courbe est nulle, tant qu'on
que
sidère
jusqu' ici ,
fait
secondes
ditTcrentielles
connue.
Nous
que ,
et
par conséquent ,
exprimée que
peut cire
ne
courbure
comme
rapport des premières difTérenticUes,
le
nous avons
ne con-
par le rapport des
qui est conforme à
ce
:
la
Id
ihéorie
une nouvelle prcu\'c, en
allons en donner
parlant des tangentes.
Tab. IV.
^^
Qu'il soit proposé de liicr une tangente de la
38.
§.
AMv au point IM
eombe
que
ce
seul
une droite T'M't
dire,
à
c'est
,
M commun avec là couibe:
point
qui
n'a
car
on voit facilement que cette condition
définition
donnée par
classique des tangentes,
géomètres,
d'après
qui
passe
par
un
est
impossible
de
satisfait
les
à la
anciens
une droite
la
tangente
de
la
courbe de manière qu'il
mener par
le
même
laquelle
point
est
une
point
autre
droite entre la tangente et la courbe, c'est à dire, qui ne
lencontre pas la courbe dans un autre point ; ce qui sup-
pose
l'impossibilité
courbe
plusieurs
de
droites
commun avec la courbe.
sition
le
même point d'une
n'aient
que ce seul point
mener par
r;ni
Il
s'agit
donc, de trouver la po-
d'une ligne droite par M, qui ne rencontre
que dans ce seul point:
l'angle tMw::ziC{)
et
cette position
que cette ligne
fait
est
la
courbe
donnée par
avec l'axe des ah-
.
203
scîsscs ,
on par celui qu'elle
qui
=z 90^
est.
Pour cet
les
~,
j~,
arii^Ies
jjl,
y,
lesquelles feront avec l'axe des ab-
M J«
[.<.
v
,
M
dont les tangentes sont
/ï ,
que
l'angle
\j/
une
fait
ou
/j.
au point M,
y
la
firandeur de la coi do ,
ou
le
r.ipport
que cet angle change avec
est clair
Il
.
du point
distance
et
M avec l'axe des abscisses, on a généralement
tang \p rr ^^
aussi
que
bien
avec
à dire,
c'est
tans:cnte
sa
la
'^^
complet des différences dépend de leur gran-
La valeur de
deur.
M et d'autres points
tirons par
effet,
de sorte -qu'en nommant
corde par
ordonnées ,
les
4^.
Mja, 'Mv,
les cordes
scisses
—
avec
fait
angle est donc
cet
tout à fait va-
gue, mais elle est déterminée, et indépendante de la gran-
deur des différences ou de
qu'on
substitue
le
du point
distance
la
rapport diflérentiel
~
ja.
lors-
,
—
au lieu de
H est donc question de savoir, quelle est la ligne droite
M
passant
par
dont
tangente est
la
,
qui
Comme nous venons
Mf,
Mf.t,
M'/,
etc.
fait
avec
les
abscisses
=^^.
La réponse
5e voir
que
c'est
la
,
de
est
un angle
<P
tout simple.
toutes
lignes
les
seule dont la position est dé-
terminée, de manière qu'il n'y a qu'une seule droite qui
satisfasse
à cette condition y
il
est hors
de doute que ce
ne peut point être une corde ou sécante^ dont
infinité ,
et
dont
la
position est tout à fait
il
y a une
vague
26
,
mai^
204
que ce ne peut être que
dont la position
est
la seule tangente passant par IM,
unique
ou
gOLueusemcnt démontré par
laquelle
sa
l'autre point
position
jj.
indcpendanle
est
vu que
pas la tangente,
ligne droite,
seconde condition ,
la
de
cette
ment indépendante de
distance de
elle
n'était
dépend
évident qu'une
distance.
11
est
M,
la
position est absolu-
la
dont
d'un autre point par
situation
ne peut en
lequel elle est censée de passer,
par aucun autre point de
si
est ri-
d'après
position d'une corde
la
passant par
une tangente de
de
par lequel elle passerait,
,
essentiellement
la
Ceci
délennince.
Id
couibe: d'où
la courbe en
il
ciTét
suit
passer
que c'est
jM.
Nous avons donc prouvé que la tangente d'une couibe
fait ,
dans le point du contact ,
avec une ligne parallèle
aux X, un angle dont la tangente
deur des
dilTérences,,, c'est
à dire^
de la tangente rencontre l'axe
point T, on a ,
tang
le
rapport diilercn-
indépendant de
coordonnées rectangles ,
tiel des
est
gran-
Si Lv prolongation
^\
des
la
abscisses
x dans
le
MR étant perpendiculaire à la tangente»,
MT P =r tang tMm r= ^| — P — tang PJVl R,
tangPMT-tangPRMi^^Jzz:-^,
smPl\U=^^—:^^ = '/^, smPMR=r,-^^pr,==^^
la sous- tangente
PT
= M P tang P
.
RI
T = | — ^-^
,
la sous 'normale PR — MP tang PMR zz>- P — ^^^^,
.
.
20J
]M R
normale
la
39.
y' [y^ -|- P R^)
Si
M
Iw,azizAj% on
u
et »J|jl;izA_}-:
donc ^It
>;?t :::i:
M
\x
et
-4-
,
.
Ax,
et
]/
cet.)').
.
tangente Mf,
valeur
dilYérentit 1 ,
V (1 -f- P')
ô^
est
il
que ^^
suit
^'exi
est
une
constamment renfermée entre
et ]/(i-f-(P
+
indépendant de
la
Q.. Ax-f-cet.)=):
grandeur
àçs
est donc renfermé entre les limites >/(i-+P^)
,
P'ii"
= a>x
;
+
rz
-/(i-hP^)
1^(3x^ + 5/*),
conséquent ^^ :r: / (i
P^) ,
ci - dessus.
scn
suit encore,
indépendamment de
l'arc
tang tM/?i rr ^^ Ax z=: P
.
( I
\à
diflerences, ,^,
stance
.
.
dont la
le rapport
Il
-fj^
nomme MwrzAr,
— Ax ]/ (l -|- P^)
deux limites v^(i-|-P^)
comme
— ^//,
M;xrz:A.y étant nécessairement renfermé entre la
l'arc
fonction
et
/;z
et qu'on
t,
)/
.
les
^^ ^'/^ "'
— (Ax^ 4- Aj-) rr Ax (H- ^g)
— A X y H- (P Q A X H-
Vi^x
corde
-i P^)
i
TMt et roidonnée Njjl, étant
ttingcntc
Lï
prolongée^;, se rencontrent en
Or,
= y/(
MT - V U" -f- PT-) nz
la iangente
5^.
—
du point
et sa
jj.
,
la
ce qui est dailleurs évident, qu'-
longueur de
c'est
à dire ,
l'arc >
ou de
dans le point
tangente ont Li même direction.
\a
di-
M seul,
En effet, l'arc
étant renfeimé entre la tangente et la corde, sa direction,
•u l'angle
qu'il fait
avec l'axe des x ,
est renfermé entre
206
,^
deiix anfirles dont les tangente? sont
se
confondent en
quand on
^^',
deur de laïc, ou du point
ou
bien,
courbes
il
a la
sans
résulte
'^' ^'
que
de
l'intégration
la
,
rences,
il
s'agit
d'ex-
avons donc prou\c
nous
vulgaire est fondée sur ce principe que,
dilTérentiels,
indépendante de
partie
faut,
11
les règles vulgaires, donnq
Comme
S.
f/wnd/nture des
A P M r= S par une for-
suifacc
dans la formation des rapports
la
fait
mêmes raisonnemens
des
difficulté ,
difTêrence de la
valeur
vé que
l'arc
même direction, que sa tangente.
mule qui, étant intégrée d après
l'exacte
limites qui
par conséquent,
:
que nous avons employés jusqu'à présent.
Tjb. IV. primer la
,
abstraction de la gran-
fait
La formule vulgaire pour
40.
§.
^-^
M avec une droite quelconque le même an-
dans le point
gle,
/;.
«t
pour
la
on
n'a conser-
grandeur des
diffé-
à cette condition, et trou-
satisfaire
ver par là le véritable intégral, supprimer dans T expres-
du rapport dont il
sion complète
tipliés par les diiTércnccs.
égal au rectangle
Or, nous avons ASr:rMPNQ.Sj;2M,
MN,
sont
les trois cotés
tons les termes mul-
s'agit,
plus
le
triangle MQ.SjnîVl
A a:, Aj,
et
Aj;
et
dont
nous avons vu
que, faisant abstraction de la partie du rapport qui dépend
des grandeurs
corde
(§.
arbitraires,
84.),
ce qui
l'arc
A
j'
se
confond
donne ce triangle
:rz
i;
ayec
A
a; ,
U
;A^»
Co7
AS=/.Ar-h^.Ax. A/, ^^^mi^^^, et ~-î,
donc
ou
d S
ciz
y d X.
On peut
cnGorc d'une
s'en convaincre
autre manière
qui nous servira ci -après à trouver le volume d'un corps.
Soit encore
surface
SK parallèle à l'axe des x,
lectanglc ]MS
face
Ax
)'•)
m Ax
]MQ.3mM,
,
dont
la
dillcrence
Or
il
est
A)*.
.
au
évident que la siu-
peut
V MS :=: V Ar
étant
.
.
qui dépend de
fraction
est 'égale
étant une partie de ce rectangle,
toujours erre exprimée par
une
Li
AS est renfermée entre deux rectangles, PO izzj-. Ar.
PS j:^ (>* -f- A
et
de sorte que
nature
la
de
.
la
A/,
V"
courbe ,
ou
une fonction de x,y. Nous avons donc AS.—/. Ax-hV. Ax. A/,
yax
5.
Le volume d'un corps se trouve par le mêmie
41.
laisonnement.
Soit
dont la hauteur
AMBN
r=: 6 ,
îe
la
base d'un
cylindre
rayon
C A r^ a
soit
VWl z=.PN z=. y, P/>rrAx, m^:=:nyz=.
volume du
cylindre.
D'abord
nécessairement de a et de 6,
ment il son axe, une
sion
analytique
croissement
partie
il
et
Ay, h étant constant.
— Ay,
est clair
CP=:ar, ^^8- 4et S le
que S dépend
qu'en prenant parallèle-
quelconque de S, son expres-
V sera fonction de 6
fonction
,
droit Ta b. fV.
x , /,
et
son ac-
de ces mêmes quantités
et
de Aar>
Il-
s'agit
,
donCj de trouv£*r la fooK
208
cLion
du
V de x, y,
non pas immédiatement par
comme Arcliimède
cylindre,
lyse qui s'applique également
connaissait
qui
le
la
on en trouverait facilement
les
la
fonction
que
le
être
que
le
rapport des
cylindre
S même.
Or, ayant
la fonction qu'on
l'une et l'autre eût été trouvée d'après le
et qu'il est impossible
que S ou V
férentes fonctions.
s'agit
Ax, Afy
donnera en
il
aurait obte-
soit
même principe,
égale à deux dif-
AS
par x,
d'après les élémens de la géométrie,
ce qui
Il
donc,
d'exprimer
même tems ^^, et par l'intégration Yz^zfdS.
DCENPM la base d'une partie quelconque X
Soit
du.;demi-cylindre dont la base est le demi-cercle
de manière que
mené CA,
M^npm est la base de AX.
Mjjl, ing,
çbtient les rectangles
jet;' leur
évident
est
V de la manière ordinaire, parceque
nue, en différentiant
y-j
^- ,
moins de difficulté de trou-
trouvé la valeur de ^^ exprimée par x, /,
que cela ne peut
fonction
V même par l'in-
ver , par des considérations géométriques ,
^^ ,
l'on
grandeur des différences Ax,
tégration vulgaire; et on aura
accroissemens
Si
corps.
de cette
rapport dilTcrcnlicl
indépendant de
est
tous
à
nature
mais par une ana-
fait,
l'a
la
diil^ience ,
Nv, nr, perpendiculaires à
Mvziz 2/
savoir
la
.
DCF.AD,
Or, ayant
DE, on
Ax, mr =. 2 ( / -:- Ay) Ai^,
sqrame des deux ipclanglcs
200
^/JL -j-- ;*^
= Aa\ A/,
2
ce qui étant multiplié par la hau-
teur h du cylindre, donne les prismes 'Myzzz^hy.AxzzzV,
»!/-rz 26 (/— A/)
Or
il
est
.
Ax n: II, et leur dilTc'-rence pzzzCib. Ax A/,
.
que AX, étant toujours renfermé entre
cLiii
les
P
et
n
dépend de
la
nature du cercle , de sorte que nous avons
prismes
AX HZ n + Q.
.
est
,
égal à
allons voir.
plus une partie de
qui
/;
Q. étant une fonction de x, /, moindre
/?,
l'unité qu'on n'a pas
que
IT
besoin de connaitre,
comme nous
En elTct, on a AXr:26(/— Aj) Ar-h26Q.. Ar A/,
.
^ — Qhy - 26
(1 - Q) A/, et II — 2b/, ou dX =1 obydx.
que l'intégral de 2ydx est égal au segment
DGENPKl
z:z z (§, 40.),
ce qui donne Xzzibz,
circulaire
et nommant C la surface entière de la base , laquelle,
Or
on
sait
d'après les élémens de la
le
cylindre
entier
géométrie,
zzzhC zziirha^
:
est
n;7ra% on aura
un cylindre
droit
est
égal à sa base multipliée par sa hauteur.
§..
42.
Soit maintenant
conque, tourné sur son axe
équation
entre
C¥:^x
et
APBCA un corps rond quel-Tab.iV.
PC, et qu'il soit donné une
FD=:FEin:/,
qui exprime
A PB, par la révolution de laquelle
•le corps est né; soit, déplus, FK — Ar, KG=:KH=/ — A/,
H/i -- Ec ±r Av.
Nommant donc S une par•Gg rr D(/
la
nature de la courbe
m
tie
indéterminée
AD FEE de ce corps, son accroissement
DGlvllEFD rr: AS sera toujours renfermé entre les deux
Mtmoirts de l'A.uid.
T. ri.
- 7
'°"
2ia
eylindres T)/i et dU, et nous venons de voir que D/irTry'. Ar,
et
dHzz:7r(/
— Aj)-Ax, dont
cylindrique
Dd GghlcUh —
manière que
AS est
tie
-
tt
la
.
diflercnce
e<;t
l'anncdii
A x (2 y A/ — A j-^)
,
de
au cylindre dll plus une par-
égal
de cet anneau, donc
AS i^ TT A r (y^ — 2y A/ -4- A/^) -h Q tt Ax (2/ A/ — A/^),
.
.
.
.
.
d étant fonction de x, y: ce qui donne
— Q) (2 j — Aj) A/,
^/' —
Ax —
(i
TT
et
^^z^TT/^ d'où
l'on
obtient, par
S :zz: Const. -|- 7ryy= 3 X.
intégration vulgaire,
nommant le rayon de
Or,
znfl, la hauteur du corps
1
CPi=6,
la
base
faut déterminer la
il
constante de manière que S devient égal à zéro,
lorsque
y inz a ou x nr o, et ensuite faire x zzz b ou / r^ o.
Soit par ex. le corps un
donc y =: j (b
donne
—
x),
8/
m
PC:CA ^^PF:FD,
cône,
où
°
dx zzi — - By, ce qui
âx,
SznC — 7 /^ rz: — (a^ — /^) et le cône entier, pre-
nant y:=zo, S :=. ^ ha"".
Soit le corps
un hémisphère dont le rayon CAziCPrra:
on aura j^irza^ — x\ S
et prenant
§.
4-^*
z=.
C -\- f (a"" — x^) 3x =r ttx (a* — -'),
-n
x zz a, l'hémisphère
Arrêtons nous
avec attention
un
le raisonnement
pour parvenir à ce
résultat.
entier
riiz^^Tici^.
moment ,
pour considérer
que nous venons de
La
partie
faire,
de l'hémisphère
ADEB peut être envisagée sous deux points de vue, sa-
2lt
voir
comme un corps géométrique S
supposons qu'on ne connait ni
Archimède
vérité
de
d'un
la
même
ait
f.ut
l'un
V;
nous
ni
l'autre,
et
quoiqu'à la
que S
égal
à
ou d'un prisme de
la
même
base et
démontré
hauteur.
ce qui distingue
fon-
est
ait
cylindre
comme ane
que nous nommerons
ction andlyliqne de x,
tiers
et
,
On aura donc une
V de S,
cette décoiive-rte ,
si
l'on
deux
idée nette de
s'imagine qu'Archimède
sans pouvoir définir 'le
du cylindre par une expression analytique:
car,
volume
dans ce Cds,
on conn^iitrait S géométriquement, sans connaitre Vanalytiquement, parcequ'on peut représenter, par une construction géométrique, le prisme ou le cylindre, dont les deux tiers sont de
même trouvés géométriquement, en coupant ce prisme par la
troisième partie de sa hauteur.
Quoique donc V et S soient in-
connus, la géométrie nous apprend,
i) que l'accroissement de
ce corps S, pris parallèlement à sa base, ou AS, est renfermé
entre les
deux cylindres D/t et dH>
de ces deux cylindres est égale
multiplié
par
cherchant
que
pendans de
la
cette différence
un facteur inconnu.
rapports
les
que
la
différence
au rectangle
Ax Ay
2)
Il
.
s'en suit qu'en ne
qui
différentiels
grandeur des accioissemens,
il
sont
indé-
4^Jut rejetter
Ax Ay (j. 19.), et que par conséquent,
.
le rapport différentiel ^-
est
exactement
le
même que le
rapport de l'un ou de l'autre de ces deux cylindres,
27
*
par
.
quo nous nommerons L:
D/i
ex.
Voilà
rait
connnitic
,- rr - -
que
sorte
purement gcométiiquc «jiii ne nous
tlu'orciisc
uiî
pcjs
de
fonction
la
V,
si
la
géométiie ne
apprenait encore que le cylindre L peut
exprime par
cLrL-
une fonction analyticjuc de x ou /, savoir L :=; Try*
que consiste
Tanalyse.
Car ^- étant égal
pour
le
la
lytique, savoir
^-^
ziz 7:
connaissait la fonction V,
il
A r,
et
c'est
dans celte
transition
de
la
géométrie à
à
nous
ttj^,
rapport différentiel du corps S
y'^ :
.
Ax;
quelle que soit la i^randcur de
proposition
fe-
noub-
est
avons obtenu
une fonction ana-
donc certain que,
on trouverait par
la
si
l'on
différentia-
tion qui, d'après notre méthode, est fondée sur le
même
principe dont nous nous sommes servi pour trouver ^-^, la
même fonction pour
ds
dx
dx
par
des
zziTry^'y
,^
que nous venons de trouver pour
par
conséquent
considérations
géométriques ,
et l'intégration
vulgaire qui est encore fondée
même principe^ donnera la fonction analytique cher-
sur le
chée Vzn/TT/^âx.
Cela snffua , ce me semble
méthode toute
la
clarté
_,
pour répandre sur notre
dont elle
pouvait
encore avoir
besoin.
5.
44-
Passons maintenant au rayon oscuhitew.
ïes courbes en
qu'elles
Comme
général différent de la ligne droite, en ce
changent continuellement de direction, tandis que
Ici
droite a
gue par
une
direct ion
l'iiuariabiliu;
invari.ible ;
ûc
s.i
courbiiie,
courbes dont, la courbure change
nVmpèche
cela
que
})as
ia
ccrcîc
le
âc toutes
d'ui) poi^r. à
on ne poiuiait
diminue d'un point à
]Mdi->
n'ait
l'autre:
de
meut dans chaque
pi'ircec[u "autre-
courbure
sa
la
même
d'un corps, malgré l'iircgularité de son
se
les autres
l'autre.
qu*
dire
distin-
courbe la phis- irré£;ulière
dans chaque point une coiirburc drlcrniinée,
inent
se
instant })lus
ou
augmente ou
manièie on dit
mouvement,
qu'il
moins
qu'un
vite
autre coips, que sa vitesse croit ou dccroit, etc.
nous ne puissiqns former une idée nette de
Quoique
ia vitesse,
au-
trement que par le rapport de l'espace parcouru au tems,
mouvement accéléré ou
et
quoique dans
ait
pas le moindre espace qui soit parcouru avec la mèm-e
vitesse,
il
le
retardé
faut cependant que dans chaque instant
il
la
n'y
vi-
tesse soit d'une grandeur déterminée,
parcequ'un corps dout
en repos ,
tandis qu'une vitesse
la
vitesse est nulle ,
infinie
sotis
ne pourrait durer qu'un instant, et ne tomberait pi^s
les
sens
:
ce qui prou^'e que
mouvement même
besoin
est
que d'un
duire son
effet.
,
vitesse n'est pas le
mais une tendance ,
instant
pour
se
un
manifester
effort
et
qui n'a
pour pro-
De la même manière, l'idée que nous nous
formons ordinairement
plus ou moins ,
la
de
la
courbure ,
est
dont la courbe s'éloigne
fondée sur le
de sa tangente
214
en passant d'un point à
sa corde ,
ou de
l'autre ,
vu que leur
paraît contradictoire a la nature des courbes,
courbure ne reste pas la
ce qui
même d'un point à l'autre;
ce-
pendant nous n'hésitons pas à attribuer à chaque courbe
dans chaque point une courbure déterminée ,
parcequ'une
ligne dont la courbure est nulle, n'est que la ligne droite,
et qu'une courbure infinie donnerait
d'une
lieu
ligne:
ce
pas un arc , quelque
prouve que
un seul
la
courbure n'est
mais une tendance
petit qu'il soit ,
dans
manifeste
qui se
qui
un point conjugué au
comme la
point,
vitesse'
d'un corps dont le mouvement n'est pas uniforme.
Ce que nous venons 8e
choses
:
i)
que
qui
elle
sont
nous apprend deux
dans chaque point n'a rien
la
courbure
la
grandeur de
de commun avec
quent ,
dire ,
l'arc ,
et
que par consé-
ne peut être exprimée que par les rapports
indépendans de
la
grandeur
des
accroissemens,
c'est à dire, par les rapports différentiels; 2) que le moyen
le plus simple de
le rayon
d'un cercle qui a la
ment parceque
même
déterminer
la
dans toute
moyen mécanicjue
courbure du
son
la
est d'indiquer
même courbure, non seulecercle
étendue,
très -simple
courbure,
mais
est
constamment la
parcequ'il
y
a
un
de décrire un cercle d'une
certaine courbure, son rayon étant dpnaé.
le problème du rayon
45.
5.
oscillateur d'une courbe
M se réduit a trouver le centre C, ou le rayon IM C Tab. ÎV.
du C'Mcle BM qui en M coïncide avec la courbe A1\1S: *''S"'
en
que ce centre C est situé quelque part
d'où
il
suit
dans
la
prolongation de
d'.iboid
la
normale
MR, vti que le rayon.
ClM d'un cercle est toujours, perpendiculaire à son arc ou
à sa tangente, par conséquent aussi à celle de la courbe coïn-
Mais, cette coïncidence ne peut avoir lieu que dans
cidente.
le seul point
M, parceque, si elle existait d'un bout à l'autre
d'un arc MS d'une grandeur quelconque, la courbe serait effec-
tivement composée d'arcs circulaires: d'où il suit que la coïncidence dû cercle avec la courbe en M, aussi bien que l'expression analytique du rayon osculateur, doit être toutàfaitindcpen-
dante
de
de
grandeur
l'arc
ou de
parcequ' autrement
évidente,
d'ailleins
aurait
la
Ax;
la
proposition
courbe
en
M
autant de différens rayons osculateurs ou différentes
courbures, que l'on peut donner de v^aleurs arbitraires à Ax,
c'est à dire,
une infinité, ce qui
est absurde.
On se rappellera
qu'il en est de même des tangentes rcctilignes,
cles tangents.
avec
est
la
Il s'agit
courbe en
que de ces cer-
donc, de trouver un cercle coïncidant
M
,
de manière que leur coïncidence
indépendante de la grandeur de l'arc, ou des différences
Ax, A/,
en
général; et pour cet effet, notre méthode
nous fournit un moyen
très - simple , savoir ,
de chercher
2l6
d'abord
l'expression
générale du rayon d'un cercle qui a
un
arc
quelconque
MS commun avec la courbe, et ensuite
de
rendre
de cet
arc,
férentiels
',ib.
'='
IV.
*
indépendante
de
en substituant
les rapports dif-
expression
cette
ce qui se
fuit,
grandeur
la
à la place des rapports complets des différences.
donc BMS ce cercle, C son centre situe
MR,
et son rayon MPxCms: soient de
dans la normale
plus, CTB, MCI, parallèles à l'axe des x, MN, ST,
3MQ..-:r:Ax, Q.S n: A j
parallèles aux ordonnées
alors
§.
46.
Soit
)'',
nature du cercle donnera les équations
la
-
:
— = 0, (2)CT=4-TS= — 2.^z=o, oubien
— A xy H- (N M -h Ayy ~ =
— donne
de ces deux équations,
Ax^ + A>'^ ru 2CN.AX— 2NM.A7.
(i)C.V-t-NM'^
£==
(o) (C N
La
En
z-
différence
(3)
vertu
:
de
(2)
condition
la
que
le
tué dans la normale IVIR, l'angle
o.
(1),
C doit être si-
centre
NMC est égal à l'angle
PMR dont nous avons trouvé le sinus 3= 7—
IJp2^ (§• 38.):
>(i-f-P^}
c€
ciui
donne
P
C N rr: -r^ a
t-^-^t
et
N M rz: -7—
"^---jt
.
Substitu-
ant ces valeurs dans l'équation (3), on obtient
Ax'^^r = ^Tri^F'
.
00 bien . := ^;';^^ V(l^P').
Or, nous .avons toujours supposé
(Ji.
Ay =L P Ax-f Q.. Ax= -f- 1\
.
ce qui
donne
16.)
.
Ax^ -f- cet.
217
:— •-<(Ç),.Ax--J-R.Ax3-j-cef.
— :(^-r-K.A.r-4-
•
la
grandeur
les
termes qui en dépendent,
ce
qui
1
4- P^
^'^;-
connu par
est
,
chose que
vulgaire,
z
zzi
^~^tq~
a. 35.), on a
rapport
dx
2;
de
nous
nous
1= --^^^
rejetci:
Ar, etc.
P cri: ~ er
De plus, il
•
tlicorème,
rapportons
sans
ce
à
Comme nous avons
,
une démonstration rigou-
la
considération de l'infmi,
mémoire qu'on peut regarder
comme un supplément de celui-ci.
lieu
.
trouvé par le calcul différentiel
-^J,
étant supposé constant.
ce
2 I\
Substituant
•
faut
il
,
théorème de Taylor, que 2Q. n'est autre
le
le
Ax
2PQ..A.r,
donné , dans un autre mémoire
reuse
'
K'^'T-'^ ]
dc9 diflercnces
arbitraire
donne
=
-^
pour rendre cette expression indcpcnclanle de
I\^jintcniint,
•
^
c?A.)
V^
^
Substituant donc
^J au
de 2 Q, nous avons
3;?
dx ddy
'
.
47.
§.
rriyon
Voici
osculateur ,
d'ifléreniiations.
une autre méthode
même
Soit
^.1
de déterminer le
le
point
dans
la
courbe
yiom lequel on ciîcrche le rayon osculateur:
qxiation
de
la
entre
courbe;
APzrx',
PM=zy,
soient cntin
lesquelles le point
M est donné.
MdtioiresilcrAiad.T.VI,
soit
A M N, Tab. TV.
(S)
l'é-
qui exprime la nature
x :=i a, y:=.h,
^
aux secondes
sans avoir recours
les
Ayant mené
28
valeurs par
la
noim..l3
^^*
'
2i8
RIRZ, nous avons
(§.
normale RIRrzb^^.
et
M pour
B.Vrz:u,
PR rr: b|^
38.) la sous-normalc
la
MZ pour l'axe,
nommons MBmf,
Prcnôps maintenant
rorif;ine des abscisses,
et
MZ; t.mdis
dernière étant peipcndiculaire a
Li
,
même point N, AD = x, DNnj'. Les tri.inglcs semblables FRM,B\C, DRC, nous fournissent NCr ^u,
p
qu'on a pour le
—
^^CR, CR- étant égal
BC=:^^lu, DR:=^;^CR, DC
t
BC: nous avons donc NC=i^'u, BC
à MR
^'u,
—
— —
DR in \'h — '/t — f
C?. — l'h — t~ ^"u
DC — — 3't — l^.^^.w; donc, AD — AP-+-PR — DR,
Di\ = DC + NC,^c'est a dire, x —
+ + ^>,
y:=:zh —
mettre a
place
dx
,
'
dy
dx
fy,
d s
d s
'
b
n
°^^
^j^^^~a's'^>
de X et j^ dans
^^
,^ :zz a^
et substituant ces valeurs
équation (T)
de
la
à
Nommant
/s-— i^' ^^ manière que
m5—
X z:za~\- (It -\- au , /
une
6
les rapports dilTcrcnticls ^^, ^^.
donc ces valeurs données
obtient
^^ f
et
^'^^'^
a t -|- j3 jt ,
.
x, jy, dans l'équation (S), on
du
même
degré
entre t ,
u.
Maintenant, prenons dans la normale un point quelconque
Z, et menons Zi\, laquelle sera =: /(BN^' -)- BZ-).
mant donc
Après
cela,
M Z =r 2
il
,
on a Z N* =:z w* -f- z=^
sera facile
cle osculateur Z,
ou
laisonneracnt suivant.
la
— z
2
.
Nomt -}- t\
de déterminer le centre du cer-
longueur de son rayon 2, par le
U est certain que tous les cercles
M
.
219
MRZ quelque part
qui ont leurs centres clans la normale
en
ou
Ta'
et qui ont
Ti'\
ou Z'''M,
toucheront
M,
couibe en
la
En prenant
le
centre Z^ très-près
une courbure beaucoup plus grande.
la
intérieurement ou
de
un cercle qui , tombant au dedans de
tient
courbure du cercle
mesure qu'on
Z M
mais tous ces cercles ne sont pas oscula-
extérieurement;
teurs.
respectivement les rayons
et celle
de
la
La
la
M, on obcourbe , a
différence entre
courbe ,
diminue à
jusqu'à ce que la dis-
recule le point Z^;
tance IsXL'^ devient assés grande^ pour faire tomber le cercle
hors de la courbe, et rendre sa courbure moins grande
qti.e
celle de la courbe.
Il
faut donc,
d'après la loi de con-
tinuité,
que ces deux genres de cercles, intérieurs et ex-
térieurs,
renferment un Cercle unique qui, formant la tran-
sition
des uns aux autres, ne tombe ni au dedans ni hors
de
la
courbe, dont, par conséquent, la courbure n'est plus
ni
moins grande que celle de la courbe: et celui-ci est
précisénient
le
cercle osculateur
est évident
que
le
ceicle
tombe
rayon z est plus grand que
moins giand:
l'autre,
c'est
l'équation
le
que nous cherchons.
iiors
ZM,
et
de
\à
courbe,
en dedans,
U
si
son
s'il
est
rayon osculateur ne sera donc ni Tun ni
à dire; z sera égal à
%- :=. u- -\~ %-
Z >J.
Ceci nous donne
— 2zt-4-t% ou bien znr"— —
Sous ccwte forme générale,
z serait le rayon d'un cercle.
020
ayant son centre
en
d'in^^
norm.ilî M'^. et cotjpnr
î.i
M et N; m.iis cornue
ne s'agit
il
ciclence
du cercle
iivc-c
où
O
faut
é^-ilcr
en
par. 1 é(]uaLion
t rz:
,
il
de u
valeur
t
courbe;
Ja
à
/
ici
\<\
coin-
point
M,
après avoir trouvé
Id
daîis
zéro,
combe
l\
qae do
seul
le
(T^ ,
divisé
et
u-
-j-
t-
par 2 t.
§.
avoir
On peut an<:;si trouver
48.
recours
ci
l'équation
la
valem- de % ,
Les valeurs
(T).
sans
de x et j',
trouvées plus haut:, nous donnent
a(3,a
—
(3
(x
— —
a)
donc ^^ PC^-")-«p izi).
f3-t
— a (/ —
De plus,
u^
b) -f- oi-t,
+
de la corde MN, par conséquent u--f-t2::=:(x
et a^
+
où
faut substituer
il
(3^ =z ^-^,-t-^^
stitution fait
le
zrzzg,
=
1 ;
x :;:= a
il
donc ^-^^ ,
et
y :zi b.
t^
est
trouve ,
:z= (3 (§.
carré
— a)^-f-(>' — b)',
au
Comme cette sub-
faut différentier
le
numérateur et
dénominateur, ce qui donne z :=z
Or, a^l étant
le
47.) > on a encore z^=:g;
^-
.
mais on
par une seconde différentiation ,
dx étant regarde comme constanC
:
ce qui donne,
a.
cause
,
CCI
de
— 6_o, 2_-_^.,^^ __^-^^_^ ce qm est
,.
pression
§.
mière
n
ne
scva
pas
iatitilc
,
méthode
(§,
47.)
qui
par.ùt
la
49.
Id
pre-
simpl;^ ,
par
ci/cïcîircir
plus
ou deux' exemples.
nti
E X c m pic
Soit
courbe donnée
la
=
= r-
^-:*:/--
[3
l.
parabole conique ,
la
(S)/-=rpT, 6-rzpa, ^|
^-^^ dx% donc
ax^
quelle on a
^^^
^^
1 ex-
viilg.i!te.
f,
—
m
pour
la-
ou 5/ zz; /^ 3 x,
;^
= a =: / 1^-,
— /-^-,
Z^^''-, ou bien a rr ,---i^%,
1^
(3
ce qui dorne, en faisant, pour abréger, p -|- 4 a zn q
X =: a -h t/
+ u/
C
I
valeurs qui, substituées en
(To=:
^-
(S),
,
y — b — 2 / J + "/ J r
f
donnent
^
'^
'a
a
^
'
/J
^ptt-pty'--opuy~
ou bien, substituant bzrrKpa,
(T)o zz pu'-h 4at'— 4tu.V ap~~ qt
Cette équation donne u^ c:z
Substituant
on obtient
donc trzzo,
et
—
li t'
-f 4ta
.
par* conséquent
.
>'^pf/.
/ ^ -j~ t
aussi
.
)/
^;
u nr o>
-
,
222
D'après
^^/
la
méthode vulgaire,
— — "F — — 4>r — ~~
—^l^^y ^=^ v»^p » ^^ 'l"^
vée par notre méthode.
~4-T^x-
^^'^
A^
les
soit
proposée
demi -axes
(S)
Nous avons
z=L
donc
formule trou-
sommet en
dont le
ellipse
^, (2
y [m" n2 -j- (m='
Substituant
la
'
m et n, de sorte que
*
—
x]
— n'^)x{2m —
—
— n")x(v.m —
ii(m
y [to2 „2 _|_ (t7i2
»
x)]
x)
x :=z a -4- ^t -{- au ,
l'équation (S) , et faisant ,
,
— x^)
T:iyx(2m
r*
7<r.Va
l\.
e
l
une
•m2(2 7nx
O
——
m X — x^).
donc dy zn '^^p^ d x
y-
Qydy =:: pdr,
a
con^oimc à
Exe m p
Qu'il
on
•
x)]
y zzzb
— at-}-(3u, dans
pour abréger
^ — ^> —m — =^ 1 —
i'^
ZH /AS
-
on obtient
(T) o zn b^ 4- v^'a^
— ^v'^mà
-f- 2 1 (>/=
4- 2U ((3b 4- v'aa
pa
— ab — v-(^m)
— v'am) -^
f^ (a* -j-
-1-u' ((3= 4-j/2^2)— 2|j.^a[3. tu;
ce qui, après avoir substitué
— /a m — a), a
"-^ 3_5)
Q —
h'
(2
zz:
«2
^
^JI^C'"
-J-
/32
—
I
(/^ |3-)
.
223
et api es avoir fait,
n^ -f- ijL= a (2
pour abréger,
m — o) nz 9%
donne
Cette équation donne
u- zn
.
t
:
4-
vqi
u=-|-f'
--i
a-v(m — a)Va(s-m —
.
^-,
tu
^
n)
.
ix- (n-
t^y
— H-v-) (am —
n
(
a))
,
Faisant donc f zr o et u rz o, on obtient le rayon osculatcin-
% zzi~r zz
'^
:
ce qui est parfaitement conforme à sa
valeur trouvée par la formule vulgaiic zr^:^^ -
En.; elTêt^
nous avons vu que ds^ rz r^^^z'^- ' y'^^X ^^ ^^ ("^
—
ce qui donne dy^ -4-
donc
—
5.
.
3-3- :iz
~
}'ddy:n — v^dx^^ donc
z=z
—
La théorie des RTaxîma
5o.
^) ^'''^>
et
Minima
suite immédiate du théorème delnylor, ou de
la
est
une
formule
qui définit l'angle formé par Li tangente et Taxe des abscisses
{§.
38.),
scion qu'on regarde cet objet analytique-
ment ou géométriquement.
l'autre sans
la notion de
Ayant donc prouvé l'un
l' infini j
il serait
inutile
et
de nous
224
V
En général
pins longtem^.
iiircfer
on verra aisément
,
que, les formules fondamentales ayant été démontrées, tout
le
reste
qui r'^gardc les règles du calcul dilTérentiel et in-
tégral,
on
§.
5i.
dune
pas
sait
nécessairement.
Pour ce qui regarde
fonction donnée ,
nante à la physique ou
à quelque
mixtes,
nue,
mais doit être trouvét; par
partie
apparte-
des mathémati-.
la
de
l'intégration
proprement un objet,
c'est
mais de
Ivsc,
non
dilTérentiation ,
dont l'expression analytique n'est pas con-
ques
férentielle;
la
d'une quantité
mais
sa
non pas de
dif-
l'ana-
science qui a fourni le problème. Cepen-
dant ,v nous en avons donné l'application à quelques pro-
blèmes de géométrie, et
trer
de
il
ne sera pas
que notre méthode donne
mécanique,
la
ce qui servira en
les
de mon-
inutile*,
formules
fondamentales
sans avoir recours à l'infmiment petit:
même tems de modèle pour
toutes les
sciences mathématiques.
iiutres
§,
52.
Lorsqu'un
corps
est
en
mouvement,
il
se
A à un autre B, et la loi de contiil ait par-^
pour par\enir de A en B
transporte d'un point
nuit
^
exige que,
couru une ligne
ces
deux
points
,
droite ,
(soit
A,
Dans
B,
sente plusieurs objets:
j)
soit
ce
terminée
courbe) ,
mouvement
l'espace parcouru
s
il
se
pat-
pré-
lequel n'est
225
(ou,
dntre chose que
l'arc
aucune
li^ne droite) terminé par les deux points
force,
la
le
corps n'étant
sollicité
par
A,B; 2) le tems t pendant' lequel cet espace est parcouru,
parce qu'il faut au tems,
Le
produit.
pour qu'un
mouvement
uniforme
effet
qui
se
physique
fait
soit
selon la
durerait par sa nature éternellement;,
simple loi d'inertie ,
comme la rotation des corps célestes: on peut donc choisir
pour
t
mouvement
t.
du tems
partie
telle
continuant
infini
toujours ,
qu'on
voudra,
croit
sans cesse avec
s
K, k, étant en mouvement, on
aisément que ,
quoique dans chacun l'espace
parcouru s'accroisse avec le tems,
cela se fait, n'est pas le
le
le
tems
mente dans
le
et le rapport
vement de
suivant
celui
parcouru par k n'aug-
^~
> ^^
.
Dans ce
cas,
K plus vite que celui de
s'est
l'espace
du tems,
à
/i,
et c'est
de cette
qu'on appelle vitesse, et que nous
C'est donc le rapport de l'accroissement
celui
du tems,
anah tiquement que par ~^ ou
MdnoireiderAcad.
on appelle le mou-
formé une nouvelle notion, composée de
désignerons par v.
l'espace
At,
K croissant de AS
même tems que de A j, de sorte que AS >Aj',
manière que
et
rapport dans lequel
même dans tous les corps, mais
que, l'espace S parcouru par le corps
de
le
Mais, plusieurs corps
s'apperçoit
dans
et
T.VL
qui ne peut être exprimé
~ z:z v.
-9
226
que
On dit que le mouvemont est uniforme, ïors-'
53.
§.
sur le corps.
force n'agit
a
iiirive,
cas, la
non seulement dans
lieu,
quand aucune
ce qui
Dans ce
la vitesse i? est constante,
suivant^ mais durant tout le
même vitesse
A^ immédiatement
l'cspiice
mouvement s ou t: de
qu'on a pour le mouvement uniforme, non seulement
'^^
sorte
m
i?,
mais j::izVy ce qui est le caractère essentiel de ce mou-
vement.
Ceci a une ressemblance frappante avec ce que nous
avons
(§.
dit
par
En
11.).
rapport
effet,
aux
désignant
combe deviendra
qu'on lui donne sur
AP telle grandeur AB qu'on voudra,
par ex. un pouce, de sorte que AB est l'unité pour le
des
Tab. TV. l'axe
S*
la
lorsque le mouvement est uniforme. QLi'on
universelle de tous les tems ^
l'unité
droites
un tems quelconque , par ex. une minute, pour
choisisse
°'
droite,
lii^ncs
tcms par les abscisses,
le
l'espace parcouru par les ordonnées,
une ligne
des
différences
tems
abscisses
qu'on choisisse ensuite une vitesse quelconque pour
:
avec laquelle les corps
des vitesses, par ex. celle
l'unité
décrivent
une
toise
en
une minute.
se
meut avec cette vitesse zz:J, on
et
tire
la
droite
ACM: alors,
APzz^tj PMzz:.sz^tj
fait
donc
BCi=:AB,
pour chaque lems donné
t:zn minutes, on a A P = ;z. A B, et P
donc,
Pour un corps qui
M=A P-
et là vitesse
A B=
;ï
B C,
vzzjz:z.i.
On
/z
.
.
227
aurait
pu choisir une
espaces
autre ligne qu'un
ou
pour représenter la
nité
des
BC,
au lieu d'être égale à
j,
pouce, pour
ABj
eût été
l'a*
Alors
toise.
BCrrm.AB,
et on aurait eu pareillement AP-«. AB,PM-«.BCr:«;7ï. AB,
donc la vitesse j n: -^ zz. --^y ziz m zzz -^
l
Pour un
ziz.
qui
corps
autre
ne
parcourt
.
qu'une demie-toise en une
BD zi:îBC; et ayant mené la droite
=
A DM, on a PM — PM — s, et sa vitesse — y ru
minute,
on
fjic
?
On
que
donc ,
voit
MAP, NAP.
tangentes des angles
étant
Comme d'après la loi d'inertie, chaque corps,
54-
§.
une
lement ,
fois
en
mis
mouvement ,
l'infini;
mouvement ne peut cire
tités,
la
continue éternel-
par
conséquent,
s,
quantité
la
t,
du
assignée ni par s ni par t seul,
combinaison ou le rapport de ces deux quan-
c'est à dire,
lieu ,
lorsque
force
quelconque.
voir
le
sauf les obstacles extérieurs, les quantités,
augmentent à
mais par
sont exprimées par les
vitesses
les
^
'^^^^
i>
un corps;
le
par
corps
éternel,
quand même
séquent,
l'intensité
par ^ ou
t
seul ,
est
poussé
L'essentiel
et ce
C'est ce qui a également
la vitesse.
par
un choc ou une
des forces consiste à mou-
mouvement est, en vertu de l'inertie,
les
de
mais
forces n'agissent plus; par conla
par
force
leur
ne peut être déterminée
rapport
ou
£9
la
*
vitesse.
i23
L'ciTct
certain
d'un
choc
tiegié
de
une vitesse
corps
telii
veut
le
la
un
11
communiquer nn corps un
a
un choc
vitesse ;
/>
dire,
deux ou
que
trois
l'intensité
fois
vitesse qu'il communiqiie ;
coefficient constant ,
nature
plus gi^nde que q:
donc f inX/j, A étant
sur lequel l'expérience doit con^
fondé sur les loix du
peut
en est de
choisie.
Il
regarder
comme une
a
qu'on appelle /orce dans
^Ce
la
même d'une force P
percussion permanente.
mécanique,
dn choc , en ce qu'acné communique de la
fois,
chaque
une nouvelle
instant
tems^
sera*
At une somme
d'autant plus grande
vitesse,
de nouvelles vitesses,
évidemment proportionelle à
cette
îa
force ne change pas pendant cq tems ,
tous les coups qu'elle donne,
vitesse
non
laquelle
que l'action dure plus longtems,.
qui
La
vitesse ,
par conséquent, dans
et
sera
se distingue
mais d'après la loi de continuité dans
pas une seule
le
trois
mais sur l'échelle arbitraire que l'Auteur de
inôuveflient ,
qu'on
ou
du choc p est proportionel'^
sulter la nature, parcequ'il n'est pas
la
de ux
sera
grand qu'un autre q , s il communique au même
aussi
fois
consjste
sont de la
durée,
si
de sorte que
même vigueur.
Av coi^muniquée pendant le tems A t, est donc
proportionelle, non seulement à la force P, mais aussi
soi.
tems At; donc AvzizKl? .At, ou ^"^zz AP.
^A-^^
2 29
Cette équation donne une idée nette et pré-
55.
§.
cise,
quand P
avec
le
cas,
on peut substituer
une farce constante qui ne cliange pas
est
Dans un pareil
tcms, ou qui en est indépendante.
d.Mis
la
formule ^''^nzXP, au lieu
de Aty A/?, telle valeur qu'on voudra, ce qui veut dire,
que ce rapport
indépendant de la grandeur de Af^
est
Ai': on peut donc ée,alement substituer le rapport
indépendant de ces quantités, de sorte que
aussi
est
ou du ^zXP dt y ce qui, étant intégré,
"^"Uis
si
P
une force variable,
est
c'est
même
plus
le
tems
At
c'est
,
tout
At
tems
le
P, dans
l'instant
:
^lais,
XP
à dire, une fonction
cet.
le
résultat
P qui agit durant
le
AP étant la somme de tous les
d'
n' a
pas
abord
ce
suivant
suite, jusqu'à la force
instant,
^ zr:
P a pris pendant Je tems A t. Mais
P-f-AP
force
cette
ce n'est plus
P-f-AP,
que
accroissemens
:
qui
donne 2;zr:XPt.
du tems , telle que Pi:^a-|-pt-f yt--fn'est
^^
P
une
agi
non
n' était
force
V\
plus
que
et
+ A P qui a agi dans
durant
la
force
ainsi
de
dernier
le
P et P -f- -^ P étant les deux extrêmes, il
même eflet peut être produit par une
force P^ qui, tenant le milieu entre P et P -|- A P aurait
agi uniformément durant tout le tems At; de sorte qu'on
est
visible
que
le
,.
a,
en
vertu
constantes
{§,
de ce
que nous avons
54.), ^^ zz. h.P\
prouvé des forces
Sans: connaître cette foie
230
intcrmcdiaiie
la
force
P
P^
est
il
évident que sa difTérence
d'avec
ou diminuera avec le tcms At, parceque
croîtra
P change d'un moment à l'autre, que par conséquent, cette
difierence sera fonction
du tems At, de sorte que son expres-
sion analytique aura cette forme P''— Przp. At-f-q. At^-f-cet.
fonctions dépendantes de la loi que
des
étant
suit
jt),
q,
la
variation de la force P, fonctions que nous n'avons pas
En effet, nous avons P''rz:P-i-/} At-i-cct.
et^^^:=zXP' zzz'KÇP -{~p. At -\- cet.) valeur tout à fait vague,
vu qu'elle dépend de la quantité arbitraire At mais la
besoin de connaitre.
,
partie
déterminée
de
rapport ,
ce
t
point de la quantité At, est
5.
vitesse
56.- duand
(§.
52.
Tnb TV-deux valeurs de
'S
Fig. 3.
il
n'est
t
et j
tirer
ACM sera une courbe.
notion
que
vitesse
du corps en jM, ne peut
rapjx)rt
qui
nous nous formons
tems écoulé
(§.
entre
comme
dan.s
le
Cependant,
la
appelle
la
de ce qti'on
être
exprimée que par le
l'espace parcouru depuis
52.), ce
ment sollicité par des
ABetBC,
une ligne droite par les points
mais que
le
dépend
on voit facilement que,
étant données^ savoir
A, C,
existe
qui ne
^^zzXP, ou dv ii:.XPdt.
aux forces,
pas permis de
cellt
T
veut appliquer l'expression de la
on
53.)
ri
qui donnerait pour le
forces,
z;
r:^ ^^' zn;
mouvement uniforme
M,
et
mouve-
^
r:: tang «i .M|ji,
{§.
53.) j
ou bien
23l
rnr ^^^ =: tang n M v, de sorte qu'on aurait autant de va'»
leurs
difféicntes,
dans
la
nous
avons
courbe.
jusqu'à
î\l
dit
44-)'
(§.
de
fester
ou produire son
autre
point
de tang
courbe
p.
ou v
ix.
points
ou de
:
il
l'
expression
M m ne soit pus
du rapport
faut prendre la seule partie
de la
distance
At:
J^
au
lieu de —^.
ment, quelle que
soit
la force P,
en
(x
l'idée d'un
mais par la tangente Mt;
quantité
V,
que
faut
Mjjl,
que
écartée de
fait
seul
corps, pour se mani-
le
la
jut.,
substituant
c'est
moment, ou d'un
faut donc
il
tout à
soit
indépendante
^^^
^"^'^
Af '
efîèt
par la corde
dire, qu'il
c'est à
par
décrite
M m ou de ^^,
l'angle formé
pas la
n'est
qu'on cherche;
/,
besoin que d'un
point
la
ou
|x
Ce
38.).
(§.
M seul, laquelle, comme nous l'a-vons
celle dans le point
"'«*
jx, v, etc.
on n'a qu'à se rappeler ce que
l^lais ,
dos tangentes
dit
depuis
vitesse
qu'on peut concevoir de points
arbitraire
et c'est ce
qui se fait
On a donc
v zz: ^y, et
des
eénérale-
l'on
peut se
convaincie de la justesse de cette équation encore par le
raisonnement
tessc
le
suivant.
On comprend
sous
rapport de l'espace, parcouru
au tems employé:
le
mot de
vh-
avec cette vitesse,
par conséquent, dans le point
M, ou
APr^t, PMzi:.?, la vitesse serait -^, ce qui exprime en
efièt
la
vitesse pendant
At on par Mjot.
change continutilemcnt depuis
Mais comme elle
M jusqu'à ^ (paiceque la
232
force ne cesse pas d'agir),
mais tous
tesse ,
A;
-~
n'exprime pas une seule vi-
différens degrés
les
lieu pendant At, ou de IM en
milieu entre
que
toutes
vitesse en
la
la force
ces vitesses;
il
elle
et plus grande
jj.,
que
celle en
si
M, si
elle dëcroit.
^ la seule vitesse qui a lieu en
garder
n'en faut
qui ont
donc moindre
sera
va en augmentant; ou vice tersa,
Pour déduire donc de
M,
de vitesse,
de sorte que ^| sera le
[x,
que
indépendante des
partie
sa
points suivans [x, v, ou de la grandeur des différences, c'est
à dire, qu'il faut po'ser v := ^^.
f.
Cette expression de la vitesse ^'^=^A est une
57.
fonction de t ,
si
le
mouvement est sollicité par des for-
ces, c'est a dire, le corps a
une autre vitesse en M qu'en
A,
M, etc.
une autre en
trouve
par
ix.
qu'en
et cette
première différentiation de
la
la
fonction se
fonction
J,
conformément aux règles vulgaires.
Nous avons donc deux
équations différentielles entre
et s,
dv z=i 'kVdt
(§.
55.).
t,
v,
savoir t;zr^-, et
Pour en trouver une entre
seulement,
il
faut éliminer v, ce qui se
fait,
la seconde
,
et substituant cet
à
intégral
dans la première, ou en substituant
première dv dans la seconde.
f impie ,
Le
la
et s
place de v
différentielle
de la
moyen
est
plus
différence
couir
dernier
parce qu'on n'a qu'à prendre
la
t
en intégrant
la
233
plcte de V,
vu que V
tout
qui
est
est ,
ceJ'i
donnée par
sera
que
la
but
de
de
de ces formules différentielles
les
tirer
Riais
t.
le
par l'intégration ordinaire.
la
partie des rapports, qui est, indépendante
grandeur des différences ,
il
les termes
multipliés par
At,
à la
différentiation
vulgaire
tion
comme
de
règles de celle-ci supposent toujours, qu'on n'a
les
conserve que
de
puissances de At,
fonction
valeurs absolues de s, v, etc.
et
les
faut rejeter de ^^ tous
ce qui réduit cette opéra(J.
Ayant trouvé
19.)
d (^')
de cette manière
^"^
z=z -
^-
on
,
dans l'autre équation ^^nzXP,
substitue
ce qui donne
cette
valeur
— -zziXP,
d t
ou pour la rendre propre à être intégrée (§. 20.), o(^'^)r:XP.3t:
ij preraièie
intégration donne
s — X/at
Pui.'^que
celle-ci,
est
il
dans
-izzX.fPdt, et la seconde
fPdt.
intégrations
les
consécutives ,
,
on prend ordinairement , dans ces
de mécanique, dt pour constante, ce qui donne,
d'après les règles vulgaires, d (^^) rz -^-^ ,
dds z^ XPdt^, ce qui
ment
à
comme
est nécessaire de savoir, quelle différentielle
supposée constante
fo. mules
.
^^^
est la
par conséquent,
forme qu'on donne ordinaire-
cette équation.
MtmnrtidelAiad. T.Vi.
5®
234
X
tales
Nous avons donc trouvé les
de la mécanique
d'où l'on
=^
:
1)
^
q\
dB s
dv
^J
dt'
dt >
tire
la
troij .équations
Br >
,
quatrième dds -nzWdt^.
»—ooooooCoooooo •»»
fondamen-
235
ANOMALIAE VERAE PER .MEDIA]\Î DETERMINATIO.
A U C T O R E
L l T T R O JV,
Convcntui exhibuit die 2 Nov.
i8i4»
Nulliim foisitan, qiia late patet astronomia, invenietiir
pioblcma ,
in
qiio
enucleando plus desudai int
qtlam hoc, quo anomalia vera per
raqiiam Keplerus
leges motus ,
mediam
quo
circa
solem
quadam mente de-
piimus etiam problemati nostio operam suam no-
texeiit ,
ravit
Post-
dcfinitnr.
planetae
fcruntur, fclicissinio successu et divina
gpometiae,
methodumque ad illud solvenduin indirectam in usum
vocavit
utar ,
,
cuui
piopter
ejus solutionem ,
sinus
aicus irspoya^ éicn' y
et
ut ipsius veibis
invcnire
non
Pat rem astionomiae recentioiis , a quo etiam pro-
potuit.
blema
dnectam
nostium
nomcn
problematis Kepleriani
magna sectatorum sccuta
est catciva,
inter
nactus
est,
quos celeberri-
ma nomina viroium de astronomia quam optime meritorum,
Gregnry
,
ÏVolUs, Kcill ,
Machin, Newton, Simpson totqué
aliorum clucent, qui eandem rem variis vils aggredientes,
gcomctricas construcliones
curvarum ,
vcl Cycloidis ,
Quadratricis Tscliirnltauscnih, vel cuivae,
quae vocalur
3o *
vt-l
si-
236
n'irim
tciii
m 'r;nm vocantcs, solvero comri snrrt, qnne hri-
rt
silurio:i.-s
ncqua jm.i.ii
d'i'îi
soltitionibus
>cnit,
non
primo, ni
cjiiae
magna
ita
rcv^cra
fcicrimt
ano.n.il;a:n
cxhibere ,
oiiincs ad calcula u co inioie .ibs-dvcn-
i'cie
diiecta
scrirs,
pu'S<îa
sit,
anomaliae
170^)
n.cdiain
ope
sciiei
intiiuiac
cxccntricitatis
ad
axciii
in»ijoiciii
ratio
et
qiia;n\'is
g
c.
siinplic.is
a
m» ntc
sr
sp( cit lu
l\irc
taiiu n
vi(1( un.
et,
i;i
qu.in-
au-
Ilatc
diversis aucLoiibiis divcisi;iio<lr
Cawcier (am por
rNliibere
quam maxime
stiidiiit
(
(
x-
potcntius siniuiiii
Ikiiincr Jjh.buclv
iixommodo,
ut,
siii-
loge Mniplici, cpuv
intiicatis,
posset, prorsus carcre \id/M(Miuv
incommodo mtdf ri prnno
de l'Acad. de Boilin
iii
commodiori ca'cul') iibsolviinr
qaoLisqne libtt continuari
cui
/VcAt^frjao
nihiloniinus sempor eo laboiavit
gulis terminis
m
ni is:imo
m( llio<io nnenla sit,
ila
liis"
HiIIor,
dain diicctae solntionis prae
ti-m
proinde
Mis.-is
vn.im ptv
si
sit
adapaiac.
Lug'aiige (Mc.n..
conatiis est
qui m
post
F'tc
tt.
quinqite annos secutiis est Oiian'i ^^Opuscoli asirononiici
di
Barnaba
Oiiaiil) ,
grcssionis
clare
1769.),
qui primus
enuntiavisse
omnium
censcndus
liiginta
m noi-lrae proCum autcm,
est.
ltg(
persuasum habeam, eandem Icgera etiam alla, fors.m sunpliciori,
dem
rcni
saltcm brcviori, raîione ex()rimi possr, hanc eaniterujn
rcsuiiiere
et
quae mihi quaeienti scse ob-
tulerunt, hic pioponcic opeiac piclium du.\i.
237
Ac primo qnid(m,
1.
5-
quacidiiius anoni.iliiini
eodcm ordinc pcr
diiuidiiiin
nxt'iii
mcdiiin),
ok m
ptr
piuicLo pciiliclii compiiidti--,
Fx
ex piiina
a^
rxccniiiedin (t vrr.im
h^tbeb.LLU' ,
s*
iid
unoiiialiis
a
consUH^
^
iif'(]ir;itionibns
l)iM!s
junciione ounia, qnae
Jaiu
e,
ut
m lui e -- e sin e
(|trbiis
ordiamur,
xeram.
c et w tl lutioneiii e\ceiUiicitatis
vi,
riidj
f^icilioribus
a
p<r daMii
iMeiijin
DcsTgJUindo-unoinaliiiin
ut
([lUiUcne
r.TiKrqne débita con-
pt t* ndj
cjMnntiir,
iineniLui
siinr.
lucciiodo satis nota
vrl
12
- ZT
"vel
a s;n w -4-
i
—
dm 2 u
'
etMiîi
\
" r- 7 -H a sin <?
°^ "^in C <? -+-f-
nb'
4- etc.
sin 3 O)
J
a
_^T-
^1.
,
tiiiibiis
"
scli(.bLl^^
sin
3^
e
-4- rtc.
(\X)-
\
ut aliandc noLis,
non
ini;noior.
—— f~'*
Ponamns jjm quant itatem
soiicl
so(ju( nii
-A s.n 0)
— Ksin cm
-+-
C sin 3
tinde pio d( termin.mdis lacloiibLis
O
acqtiijlcm
cssa
:
zn.
a sin cj
—
[(
-f-
[^l
I
--h a^)
A
-^ a j B
—a
I)]
a)
Aj B,
sin
—
C
etc.
.
.
habebimns;
w
— a A — Caj
sin 2 0)
—
CtC;.
c3S
conditionum
et hinc aeqnationes
:
A(i -Ha=)==a(i -4-B)
B (l H- a=) zn a (A -f- C)
C(i +a^)^a(B-HD)
etc.
his aequationibus satisfieri ,
ubi facile vidcmiis ,
A zn a.
a^
B
=
poncndo
"
^
C — a}
et
nnde tandem concluditur
—
"" ""
,
zz. afsinw
fore:
— asin 2ûj-i-a'sin 3 u— a'sinAw-fCtc.J.
Ciim aiitem prima aequationiim (I)
)
I
eiit,
—
nos (1)
co^ e\
,\
-\- £v
-~- cos 0)
M -)- co; e'
\i
i^
—
sit :
cruto valore qiiantitatis cos e ,
COS e rz -—^
vel
—
/i
cum
e
—
et hinc
sine n:
;
,
I a
:=
„
I
( I
-h a^) s;n m
-4-
a- -f- I a cos w
Substituto proinde valoïc iiivento quantitatis
.;
s;i w
1
habebitur
'*
:
sin c -— {\
StibstiUilis
qualione
-t- a^ -t- ï a cos w
m
•-
— a") (sin w — a sin 2 w -4- a} sin 3a)— etc.).
Hf nique A'aloiibiis qnanlitatum & et sine in ae-:--€
—
e
sin c,
oblinebilur
239
m zz:
qua prmndo
Aliciiii
oj
—
série
2 e sin oj -f-
2 a
—
—
—
—
(s
—
2 a^ (ê
-f-
2 a' (e
—
2 a-^ (e
-f-
c[c.
ï a) sin
I
I
I
a) sin 3 w
a), sin
4w
a) sin 5 ùj
anomalia nicdid per veram exliibctur.
ejnsdem
dcmonstrationem
sciici^
dédit
(TV. Siipplemeniband der Beil. astron. Jahibiicher),
ncscio
2 (o
RolicW
qiiamvis
quo enore per candeni seriem probleraa inversum,
quod niLilto difTiciliiis
est,
primiim solvisse praefatus
non absque
sit,
ciiin
dcm problema primus absolvit,
vipjjyooix se omniuni
tamen ne nostrum qui-
cujiis
nimirum solutio jam
longe antea ab IlL Laplace (Mec. céleste Liv. II. N°. 16.).
data fuerat,
§.
2.
Simplicissima nostri problematis solutio habebi-
tg ^ ,
tur
si
valor quantitatis
(I)
in
prima substitua tur.
satis
ope secundae aequationum
Invenitur autem per methoduni!
superque- notam ex aeqtiatione secunda:
te
z=: tiz
1-
e
to
—
Anle oninia er^o quaerendi
1.
d
.
(i
cos m)
siint Vtjlores; quantitaluiHi
PrO' quantitate prima.
PositO' bievitdtis- causa :;
—
240
m
2^1
— m) zzzcosnm
— (90 — m) =: — cos{n —
— 4) m
— (90 — m) zn
— w
— (90 — m) = —
n (90
fin
sin (n
sin (n
sitï
.
(n
2)
2)
cos (n
4)
cos (n
6)
6)
etc.
unde demnm concluditnr
fore
^L-lii-rl? :::=--l[,i''-'cos«m-n (rt^2r"'cos(n-2)m
H- n^ (n
— 4)""* cos
(n
— 4) w —
etc.]
et îiinc per triplicem ditTerentiationetn
"^^ =-i[«""^'sin«m-n^(«-2r-^'sin(n-2)m
— 4)"'^'sin(n — 4) m —
n^(ii
-f-
Pro altéra quantitate.
IL
Miiltîplicata
aeqnatione supra adhibita
s^cos" X i^ cos H r -f- n cos (/i —-r 2) a; -J- n cos (n
per 2
— 4)
-**
"+" ®^^
obtinebitnr
sin x,
.
etc.]
s""*" cos"x sin X rr:
'
-\-n
+
—
— x—
— 3)x —
sin (n
—
—
3) x]
sin (n
—
5) x]
[sin (» -^
1 ) 3^
sin (n
[sin (n
1 )
n^[sin (tt
1 ) r]
-j- etc.
tinde saepius differentijndo et, nti pro prima parte factiim
erat,
non
nisi
bendo,
id
Buflicit,
facile
casum primiim, qno » zz: 2 (2 p-f- 1), adhi-
qiiod
ad
expressionem
habcbitur
^eneralem elieiendain
«42
.n-m.an-f-i.csjix îinx
— (u— i)""^'
— i)r]
— 3r"^'cos(/i— 3)x]
4.,ij(,i_i)''-^'cos(/i— i)x—
— 5)"^"cos(/i — 5)x}
-f /iJ(n^3)'"^'cos(/i~3)r—
rrr(;i^- 1 )""*'' ces (/j H- i)x
cos(^i
(/i
(/i
-f- etc.
Posito autem
x
= 90 — m,
cos(/i-f-i)x
•
nit
sin (n 4-
zz:
cos (/i
sin(/i^
cos (/î
— 3)x
sin
zz:
m-
— m
(a — 3) m
— i)x=z —
1)
etc..
III.
Substitutis denique valoribus inventis in acquatione :
^
«bi
signnm
cfise
numéros o, i^ 2, 3
omnibus
indicdt ,
scilicet rite
pio
etc:
n.
ordine
ponendos
erit expressio nostra^ quaesita,
rcductis,
tg T —(.--.) (^ -^ ') ^8 . -- (tz ,)
/
naturali
(n-f-i)""^' sin(/i-h])
•
77777-1^0-^^-
w — 2«"'''' sin./îm-
I
'
«—(n-i)?-^" sin(»r— t) »ih-2:(«.-2)''"^' sin(;r-2)m)t ^_H(,i_3):'-^-».
JL .,sin(/i,-3) m - 2.(rt-4)"^'sinOi-4)m
j_(„^5)''+\.!lL«r^). sin (n- 5) m-^ 2 (/z-ô)""^' sin(«-6)
(,z^7)'-^\^l2i^X-0^ sj„ («-7),
—
etc..
"
m
\
w - 2 (^- 8);"^' sin (»i- 8) m: j*
t>43
Tîac proinde ratione ,
ad qtiintam duntaxat
si
«"XCCTi-
potestatem proceflere animus est, habebis:
^liicitatis
të~=(,i:f(i+otg:— (2 sin 2 m — sin m)
^ - sin m -\
,
,
simplex
'
est
et
_ (33sin3m-2*sin2w — sinwz)^'
^*
^_^
Séries
3.
§.
)
,
~^^^-o
,
.
in
prnecedcnti
J.
calculo
haiid
inventa
oinnino
satis
quidern
inconimodo
absolvi
potest,
eo autein laboiat incoramodo, quod loco ipsius ano-
nialiac
verae
hujiis
quantitatis €xhi-
brat ,
iinde in calculo pertinbationutn ,
quas planetae ab
non
nisi
tangentem
sibi
stat
pioindc, ut anomaliam
qaae scciindum sinns
dit,
quod
id
diiplici
ÇHiae.ratur
nqtiantitatis
nomine
omni
vieinis paliiintur,
aliis
primo
fere
veram
nuiltiplt)nim
modo fieri
ex
pei'
iisu
P^e*
destitiiitHr.
seiieni
expdmamtw,
anoraaliae ^nediae
in.ce-:'
potest.
prima
aequationtîm
w per sinus multiplorum anguli
e,
(I.)
val<Bt
quam seiierti
pr'unae insigniemns.
Deinde ex
altéra ffequationtim
[nus mulîlplorum angnli w,
(I.)
qiiaeratur e
per St-
unde séries a/tcm redundat.
Postremo ope ejnsdem aeqnationis qnaeratiir -sin n« pci
"sinns
muliiplorum
"Snbstitiita
ma, habcbjLur
aTigiili
e,
unde
séries tcrtia orictur.
dfinde série secunda «t postrema ,
seiics 'quart-a>
quiîe Vcjlorem ipsitis
ùj
31*
in
pri-
per
sa-
.
244
crit
séries
m
anguli
nns muîtiploriim
Haec qnarta séries
exprimit.
qua problcma datum
nostra quaesita,
resolvitur.
His constitutis, singulis nunc partibus problcmatis nostri
invigilandum
Prima
I.
ita
ha bot
se
est.
jam
séries
(aequat.
i.
§.
II.)
inventa est et
:
+
as'
°
- zz — -f- a sin e 'a— sin 2 e -f'3 sin 3 e --1- etc.
ubi a ru
4=;.=?
i-\-y 1
II.
'
—
i*
^ methodo nota
Altéra aequationum
tractata prae-
bet sequentem :
e
= m-h€smm-^ ,-^'^a sin^m —"-^^.d^ sin'w -f
.
.
Supra aiuem
(§.
2.
N°. I.)
etc.
inventum fuerat :
^10^—^1^ [n''-^cosnm-M^(«-2)"-'cos(/i -2)m-i-etc.],
qiiae aeqaatio differentiata in
sequentem abit
—
— ^ — 2)""'
— 4)m —
(«
sn-^..^n«m_ j^\""~" ^^^^^^
dm--»
u»^
-|-njn~-4f~'sin(ji
—
tiiid€
demum
2) m)
etc.
J
conclnditiir fore :
jn
«=»w-^-
sin («
rTTFT-n—n
<;i''~'sin«w— n^(>?
^
— 2)''~'sin(n— 2)w2>
-4-nJn-4)''~'sin(/i-4)m-.etc.
ubi n est l, 2, 3, 4, etc. ,
ita
quidem ut
sit
J
s 45
H
sin 2
m
m — 3 sin m)
sin 4 m — 4 2' sin 2 m)
"*^
,~Ti!4^3 (4'
Éi
(3^ sin 3
-3
.
H- etc.
qiiae est seiies scciinda.
III.
Eodem modo ope secundae aequationum (I.) invenitur
^sinne zn^ sin « m H- e sin /i cos n m
7-7-^ 3
-\-
[sin^m cos/zm]
.
-f etc.
ciijus sériai
terminus generalis est
5:1%^^,
.
o
.
m cos n ml.
[sm
Est autem per eandem aequationem, qua supra usi sumus
s'^cos^xcos/im zz: eos7rrcosnm-f- Y.cos(-7r— 2)xcosnm
-f-
Posito deinde
^ ^~' cos (n
x zz. 1 OO
— 4) X cos n 7w -h etc.
— n eut pro
tt
zi: 5, 9, 1 3, 1 7 etc-
cos TTX iz: sin TTW
cos (tt
cos ("Tt
— 2) X = —
— 2) w
— 4) X =
— 4)
sin (tt
sin (tt
'^
etc.
unde
séries
praecedens est :
S^sin^wî cos/iwir: sinirm cosnm
4- ^7.7"^ sin
(i'^
—
— c)cosn»»
—
cos n
^rsin^Tr
" 4} ^"
>»
etc.
^
.
—
'
r
o^
Tî»2f5
et hinc, singulis prodactis
Q'^'^'sin'mcosnm^i
[sin
in
-f- u)
(tt
simpllces resolutis,
factorcs
^s\n(^ — n) m)
m
—
TT {sin (ir—o:
'"+"
^^â-^^iK-TT— 4-4-«)mH- sin (tt
—
etc.
H-n)m •- sin (tt — 2 — fi)m]
— 4 — /z)m]
Comparatis deinde difierentialibus hujus seiici quartis, octaVis, duodecimis etc., «rît
1
,
3
.
3
.
.
if
.
3 m'"'
'
(tt -H »2)''~*s.in(7r -h
t
TT [(tt
n)m -f- (TT—n)"^" 'sin(7r—n)m
— 2 H- /i)'^'~ sin (t — 2
'
•4- (tt
—2—
n)"^"
-(- /?)
>«
sin(7r— 2 — n)m]
•— .... 3..^.. '-^^'^^:~U^~4-^")
sin(7r-4H-/2)m
S
4—•«)''""'sin(7r— 4 — «)«?]
[(t — 6 H- n)
sin'(7r — 6 -f «)m
— 6 — ;/)'^~'sin'(7f— "6 — ;2)?JîjH-etc.,
H- (tt—
—
: -
^
,
H- (tt
-
efTîin'C facîli negotio dedncitiir, posito
sin/!C :=: sinnm
^- Yt^'^t^ 4- 0'"
-f- 7"-"^a [(/i-4-2)sin(nH-2)»i
TiEî
S
^ -f-
sin (?i
— i)m]
— 2nsinnm-4^(»i — 2)sin(a— 2)7M]
— 3 (h— i>'sin(/i-f- i)m;
3 (/V^ r)^ sin(n-i)m - (n- 3}* sin (n- 3) w^
etc.
IV.
*(ex N°.
—
?i.,
('H-'3)'sin(/i4-3)iM
""^3^'
-f-
tm
Substitmis niinc valôribns
II.)
et sin »e'(ex
N^ IJI.)
joullo fere negotio habebitar :
,
inventis
quantitatis e
m acquatiône
iS'o.
L,
845
^ n"""' sinnm
wrr?H-+-!S!
1.2
3
.
.
n. '"
/
s'\vi II
— (n—
1
-+-——(« — 4)"
2)''~'sin(;i
— 2)m
'sin(n— 4)m — etc
m -H- [s in («.H- i)w — sin(/î — 0'"]
,",'-:[('i-H2")sin(/i-f-2)fn-2/îsin»mH-(/2-2)sin(tt-2)m]
^la-i
"'^-,[(nH-3)^sin(/î-4-3)m- 3 (/i-M)^sin(/i-+-i)m
-4I
.
a . 3
-h 3(n— i)*sin(n— i)»i— (u— 3)^sin(/i— 3)m]
nbi « r:r
qnae
est
i,
2, 3
etc.
nostra seiies q^iiaesita^
E X e m p u m,
l
Qnaeratnr terminus sériel praecedentis ,
qui non nisr
excentricitatis potestates continet.
tertias
Ad hune terminum inveniendum,, qua'erendi sunt facto^res
quantitatum e^ae^a^c,, a' unde-
prima pais
seiiei;
dabit pip»
n m^ 3 . .
altéra; pars
.
'J
(3 sin 3 m-
— sin m)'
pro nzn i
.
.
.
2a[sinw-f-g (3sin3m— sinw)}:
n ru 2
.
.
.
a^e (sin 3
nzizS ...
—
m — sin m),
sin 3m.
3
CuTn autem a.=i:-|--f-^
-f- etc.
summa' quantitatum praC"
ccdentUim. erit ;
*g
(3sin3
w— sinw)-+-£'(i-f--)(sinm-f-^^(3sjn 3m — sinm))
-f - (sin 3 m — sin m), h- y^^sin 3 m
94^
i| E*
et
m
sin m
omîsso termine
qnae ,
eadein
rêvera
sin
,
quantitas
in
—
sin 3 m
s
'
est
aeqnationc
ccntri
omnibus
nota TDccunit,
Hac proinde
liitîonem nacti
nec
nirais
ratione
secundam
sumus ope seriei ,
ni mis
autem
vis eadem
forsitan,
sit,
cui
quibus solutio praecedens ob in-
maxima
In
debettir.
solutionis periculum
per
eôrnm
s
Haec autem
ofTeit,
si
n
qua ra-
tertiac
qua nimirnm anomalia vera
m
et
adhuc
graliain
igitur
,
auxiliaribus «dscitis, quaerenda
4.
videatur,
eleg«ifls
pars brevitatis, qua solutio ista
faciamTis,
meras quantitates
5.
progressionis
molesta est, qua de causa haec
tioductionem quantitatis a minus
gaudet
lex
pioponenda esse videtur,
solutio caeteris jure mihi
,
ciijas
composira, nec etiam pro evolntione singulorum
tcrminorum numerica
S.int
problematis so-
nostri
solutio
nullis
aliis
quantitatibue
erit,
sponte
ex antécédent!
se
tantum loco quantitatis a^ ejusdem valor
/
'
N"
^^^
"^
)
> a /
^'
)
C
i.t
\ ! /
~
.1^5
n (n-t-jK "4-6)0-4- 7) /tNg
.
•"
1.34
V j
"^
Vî/f
^^^>
)
(vide Mec. céleste Liv. IL N°. 2 2.) substituatur, ciyus teiDiinus ger>eralis est :
n(n-f- * -(-
I
)
(n -t- X -4- a)
.
.
fn -4- a«
(X— .)
—
i
)
*
o/ £ \ :
249
dua ergo snbstitiuione facta ciit omnibus rite reductis:
|rn"~'sin n ;n— " (/i
— c)""' sin (m— 2) m
4- etc.
H- ( : T^' (A^ -t- A'/z -h A'. "4;t3))
(A)
-+. ri^)"-^' (A» + A'n ^ A*."^-^ ^ A^. ^Jα^Jl
II
Va'
1.2.3
V
'
6
\n4-o
(^)"^^(A9-i-A7/n,Aî
,
1.4.3.4
n(nH-3)
3
n(a-t-4)Ct4-5)
1.2.3
n(t-l-0('»-l-6)(nH-7)
-i-etc.
i.a.3.4
,
ubi n =z: 1, 2, 3, 4 etc.
et ubi
'sin(7r-f ^î)m— Y(7I-f-^^-2)'^
f(7r-t-»)^
(tt-^/z— 6)
hoc
est
sin(7r-+-;i
-3
pro tt rz: o, 1^2 etc.
l
'sin(7r4-?î-2)m)
— 6jm-hetc.^
A° zzz —n sin m ,
;z
A' rr sin(u-4- i)m — sin(a— i)m
A= r= -p^ [(n
4- {n
etc.
M(mohtt derAcaA. T.VJ.
+
—
2) sin (/i
2) sin (n
+
—
2)
m — 2 n sin n m
2) wi]
32
^
25o
Aeqnatio (A) tcrtiam nostri problematis solutionem continet,
quae nihil amplins dcsideranduin relinquere videtur,
§.5.
Expressio
autem modo multo concinnioii
(A)
cum quae vis binamm paitiumj ex qui-
repraesentari potest,
pluies rediictiones
bus conflata est,
parte absqiie negotio invenietiir
7T7TJ~r _
iibi
xsin(/i
J, 2,
Altéra pars diiplicem
qnidem quilibet
r en 1, 2, 3
quae
— (sr— 2))
séries
^
3 etc. signumque superius vel
prout r vel numerus impar vel par
inferius,
iibi
:
(
r ordine naturaîi
Pro prima
admittit.
contractionem
factor quantilatis
(4-)
in
est.
admittit.
génère
Primr?
erit:
etc.
continuabitur usque
dum terminus ultimus erit
pro r numéro pari :
„(,j-4_-';)(',i-}_^*) .. (n^r-4)(n-4-r-3)
—
A'
et pro
r
numéro impari
n (a 4-^^) (n -^^^) (n
A°
+ '^t-O
•
•
('^
+ ^ - 2)
•
1
.
.
3
.
.
.
L-zii . 1=l:
c5i
Deniqne terminus generalis
ipsa
tionis ,
V
ubi
terminus geneiulis
csi
secundac partis nostrae aequa-
eiit :
^^/'i\'^+r-i/ ir-(^2s-i)
5 rz 1, 2, 3
n (n -4-
f n-»-ï4- 1 )(n-4- 1 4-a) .
congestis
pro uliimd nostri problematis solutione
sionem
ubi
pro
meri
i.
r
habebimus
sequentem expres-
:
22\f)".[5:''(|)''"'.
pro
(n -ha ï-4Xt+»i-3)\
etc.
Omnibus pioinde contractionibus
4-
quac
praecedentis ,
serici
|-^^/(''+0(^+^u)-(^+"-3)^ A''"^''"'^j] ... (B)
r,
n,
ordine naturali substituendi sunt nu-
2, 3...
et
ubi
s,
signum
pasitivum
partis
primae
numéro impari locum habet.
Haud omnino superfluum erit breviter indicare
modo exprcssione ultima (B) uti deceat.
,
quo
Ad obtinendani partem prima m calculabis qnantitatem
pro
singulis
Miiltiplicatis
per _\j^
et
ipsius r valoribus ,
puta pro
r :zz i, 2, 3
dcinde
valoribus
quantitatis
positis
singulis
in singulis
his
his productis pro
32 *
.
.
.
C
n nume-
202
ris
1,
3
2,
.
erit
.
.
summa omnium productorum pars pri-
ma aequationis (B).
Pro altéra ejusdem aequationis parte calculabis primo
m:3...(s
^
—
pro singulis ipsius s valoribus ,
•
pnta
W
•
pro .?=r i, 2j 3
Multiplicatis deinde singulis partibus per (^Y
'
,
gulis his productis pro r ponendi siint numeri
.
.
.
in sin-
i, 2,
3 etc.
E^nique multiplicatis omnibus hisce productis per 2 (7)" et
substitutis
n numeris
pro
3 etc.
erit
productorum secunda pars aequationis
(B).
Rêvera ,
institutis
generali ,
erit
y-n
^r
/ f \Ti
V;/
/j^N.
r
—
1, 2,
his
mutationibus
^> n(n — s)(n-4-?- -i)
i
4
*
Va/
summa omnium
1.3.3.. (r
.
—
expressionc
in
fn-t-^^'
— ?)
^r
— (:î —
i)
')
=:zr(^)"X''e'--'[A'--'4-nA^-^+"^^-''U'--^-f-etc.]
= 2:"(^f [A°-f-(|).A'^(f)=(A^-^A°/z)4-(7)'(A^^-nA')^-etc.j
quae expressio cum secunda aequationis (A) parte prorsus
identica
$.
est.
6.
Coronidis
emple
quodam
(A)
4.
§.
loco arqnationes nostras inventas ex-
confnmenius,
adhiibebimus ,
cum
quem
altéra
in
finem
(B)
§.
aequationem
5.
ob nimias
contractiones évolution! numericae minus idonea esse videalur.
—
253
Qiiaeramus ergo
Pônendo
casLi,
brevitads
quantitatum
t,
c» e',
*, et c'.
A °, A °, A ° etc. loco A° eo
caussa
quo n rr: i, n:rzQ, n rz: 3 etc.,
et
eodem modo cura
unde ope aequationis (A) deducitur:
caeteris,
Pro n rz
(\) sin m
sin 2
1 :
4- (|) A'^
Pro n
(I)»
factures
2
zr:
,
=
a.
:
m -f- (|)= (a'' -|- A'^) z= 6.
= 3:
Pro n
— sin/«)4-(|)'(A'*-f A'o-f-A*' + A'°) —
|(|)'(3sin3m
c.
Pro n rz 4:
I
(4)* (2 sin "4 'w
—
sin 2 m)
4- {{Y (a'«
+ A'' 4- A** 4- A'° 4- a'3 4- A'O li
d.
Pro n =1 5:
24 (t)^
(5' sin 5
m — 3* sin 3 m 4- 2 sin m)
•^(t)^(A'*-+-A"*'-+-A'^-^3AVaV2A''-+-AVA'^-+-A'o.2)::=c.
Cum autem, ut in §. 4, invenimns, sit
1
(tt
A^—-^—
4- 7i)''
^{n~^n
'sin
—
(tt
4-
n)
m
0)^— '510(7:4-/1
—
2)
w
^
V
<J
l-^^?-n^-h'i-4r~'>in(^4-^i-4)w
—
etc.
nulle fere negotio invenitur
J
,
,
254
A ° rr sinm,
A rz sin G m
'
,
— sinm),
— 4 2 m)
A'^ r=: i(3sin3ni
a'' rr. i (8 sin 4 ju
A
* z=. r^-
(5' sin 5 /u
sin
—
3* sin 3/7^ -\- 2 sinm) ;
ac porio
A ° rr ï sin 2 m
A z=z sin 3 m — sin m
'
—
A^r=2(sin4jn
A'^ zn i (2 5 sin 5 m
,
sin 2 ni),
—
2 7 sin 3
m 4- 4 sin m)
;
neque non
A^°i=îsin3m ,
3
A
A
'
*
m
sin 4
m — sin 2 m,
r= ?(5 sin 5 m
—6
sin 3
m -h sinm)
;
et deniqiie
A°iiiïsin4m,
A
'
n: sin 5 m
—
sin 3 m,
A ° m |sin 5 m,
His
factis
erit
orz2(^)sinm
h rz ^-^)'sin 2 m
c n:. (y)' (y sin 3
m — sin wi)
d =: (y)*(^sin4m
«
=
(i )* (3-4-, sin 5
— -sin m)
2
m—
-»-'
sin 3
m + | sin m)
255
unde confestim ope aequationis (A)
(li
z::l
inveiritur
m -Y- 2 sin m
e
-|~ /.e-sin2
m
.^ [\ (^-^sïn3 m
—
-|--^--{^^sin 4
m—
~f- -\-
(—""- sin 5 m
sj n
—
m)
.1
1
sin 2 m)
t? sin 3 ki
+
| sin
m)
Unde simili patet, evoîutionem numericam aeqtiationis
(A) commodissimo simplicissimoque
i^a
nt
tricftatis
id
qiiod
inde
calciilo
absolvi
protestatem spatio paiicarnm hoiarum
de
vix quideni
posse,
aequalio centii ad duodecimam iisque excen-
aliis
elici possit,
hiicusque dalis expiessionibus vix ac ne
ai'iinnaie
licebit.
256
OBSERVATIONS
DE LA GRANDE COMÈTE DE L'ANXÉE 1811
FAITES A NOUVEAU
TCHERKASK AU MOIS D'AOUT 181a.
•
PAR.
WISNIEWSKT.
V.
Présenté à
la
Confcrcnce
le
20 Sept. i8i5.
La mémorablG comète de l'année 1811. fat découverte
par Mr. Flaugergues le
du navire,
antérieure
25.
sa,
Mars N.
l'oeil
nu que
mentât
de
Lors
australe.
dans
très
son
et
apparition
difficilement,
29° 3'' de déclinaison
elle
n'était visible
elle
n'a
été observée
qu'en France pendant sa première apparition;
avoir
traversé
la
constellation
à
quoique son éclat aug-
et
néanmoins
suite,
la
partie
position étant le lendemain au
120° 26^ d'ascension droite
soir
dans la
St.
de
l'atelier
où,
après
typographique
et celle
du monecéros,
elle se perdit dans les rayons so-
laiies.
On
pour
l'a
observé
auprès de la tète de l'hydre à
et
5° 1 7^
de
déclinaison
la
dernière
1 19° 5 7''
boréale.
fois
le
2.
Juin
d'ascension droite
La comète
s'étant
dé-
robée à la vue des astronomes, continua sa route géocen-
257
de lecre visse, et
trique dans la constellation
avec
jonction
du
le
soleil
le
en corr-
firt
Aoi\t au-dessus de la
6.
lion, d'où elle se porta d.ins lu constellation
lion.
Les
cèrent
sa
ayant
astronomes
et en
reparition ;
calculé
efFet
son
du
notre comète fut décoct-
148° 20^ d'as-
cension droite et 33° 33^ de déclinaison boréale.
présenterai
pas
puisque
elles
mon arivée
éclat de
la
observations
ces
ont
été
comète ,
faites
de
la
du
grande ourse,
tcte d'astérion, elle
de
très
près
1
de
du
5^.
bouvier
la
tète
en
continuant
sa
je
ob-
ne
Impériale,
dans le tems du plus grand
les
observatoires.
— La comète
petit lion sur les jambes
et après avoir passé
de derrière
au-dessus de la
p^rvmt au maximum de son
y]
et
route
de
la
sa
grande ourse,
le quart
éclat
queue ayant
Elle passa le
de longtieur.
l'étoile
Astrakhan,
à l'Académie
commencement du mois d'Octobre;
au-delà
à
je l'aie
durant lequel on la poursuivait as-
sidûment dans presque tous
dirigea sa course
Je l'ap-
ne pus d'abord l'observer,
je
parcourant alors la mer Caspienne ; et quoique
servée plusieurs fois après
petît
annon-
orbite ,
vcrte pour la seconde fois le 22. Aoiit à
pcrçus le 4. Septembre, mais
tète
2.
alors
Octobre
ensuite entre
de cercle mural ;
au-dessus des pieds
aa
de là
d' hercule
et
do la constellation de cerbère, elle se porta dans celle de
l'aigle,
et passa
Mémoires deTAcad.
très "près
T. VI.
de
la-
luisante de l'aigle yitair
33
255
Décembre.
En diminuant graduellement d'éclat, elle
le
c
se
perdit
pour la
seconde
à
l'entrée
dans
constellation
la
observée en dernier lieu
à
3 12° 53''
d'ascension
dans
fois
les
rayons du soleil
du verseau ; où
à Seeberg le
elle
lo. Janvier
l8lC,
de déclinaison
droite
et
i°
calculé
les
observations' de
lo''
fut
australe.
Mr.
Bessel
comète,
faites
ayant
depuis sa première
jusqu'au
appaiition
Novembre i8il., remarqua: qu'on ne
cette
i.
saurait satisfaire à
ces observations par une orbite paraboliqtie; la déclinaison
étant affectée à la
calculée
reur
fin
du mois d'Août d'une
de deux minutes et demie.
Il
détermina en consé*
quence une orbite elliptique, dont voici
Passage
ara
périhélie Tannée
er-
les
élémens:
l8il. Septembre
12, 25 i 75
tems moyen, de Paris
— ~ — 140^2 4''29'^,9
Inclinaison de l'orbite — — — — -.— io6°57''24^ ,4
g'-'^n
75.0
Longitude du pé;ibélie ^ ^ — -. — —
— — — — — — — — - 0,9954056
Excentricité
Logarithme de la distance périhélie — — 0,0i5ii20
— — — du demi-paramètre — — — — o, 3l5i432
Longitude
du
noeud
ascendant
1''
—
— —
Révolution
du mouvement moyer^ diurne
de
la,,
comète
—, 9,9374598
— — — — —
3383 années.
259
On voit, que l'excentricité, et par conséquent la révolution
aussi ,
grande,
vu qu'elle
savoir
doit
être
une incertitude assez
sujette à
fondée sur une trop petite base;
est
sur l'erreur de l'orbite parabolique de
principalement pour obtenir une détermination
C'est donc
plus approchée de cet important élément ,
nomes
ont
comète
,
de continuer
souhaité
elle
si
Voyageant
née 1812.
de
que
Id
au
tribuer
comète
le
alors dans les
Européenne ,
de
ambulant
cette
le
saisis
l'occasion,
m'offroit ,
pour con-
je
entreprise ,
permettroit.
3l. Juillet N. St. ,
gouvernements méri-
je
autant que
faites
j'ose
les
que
c'est
pendant
la
troisième
mon
Heureusement mes
puisque ayant retrouvé la
l'ai
observée jusqu'au 17.
Comme ces observations sont les seules,
été
astro-
au mois de Juillet de l'an-
soleil
restèrent pas inutiles,
soins ne
Août.
Russie
succès
observatoire
les
observations de la
les
beau climat de cette contrée
le
que
viendrait encore à reparaître après s'être
dégagée des rayons du
dionaux:
2 ï minutes.
qui aient
apparition de la comète,
présenter à l'Académie Impériale, en remarquant:
la
première
comète,
qui
a été observée onze
mois après son passage au périhélie.
33
9^0
Observations de
faites à
comète
la
Nouvea u Tcherkask sous 4-/° 24'' 34^^ de
-
latitude et 2^31^4"^ à
l'est
de Paris.
Après quelques essais, qui ne réussirent pas à cause
du mauvais tems
comète
le
du
et
de lune, j'apperçus
3l. Juillet 18 12- N.
une lumière jaunâtre
très-paie
clair
à minuit.
et ressemblait à
la
Elle a%ait
une [tache nébuleuse
ayant moins d'une minute et
mal terminée,
et
St.
enfin
demie de diamètre. Je ne pouvais remarquer aucune trace
queue;
d'une
et
les
nuages m' empêchant de
observation complette, je
me
faire
une
bornai à marquer la position
de la comète par rapport aux étoiles voisines. Elle formait
UM. triangle
alors
avec
rectangle
les
étoiles
N° 104.
et
N° 102. du Verseau (d'après le grand catalogue de Mr. Bade.)
dcmt l'angle
droit était à la première étoile ;
se trouvait à
peu près
5o'' iiu
sud de cette
Le mauvais tems ne permit pas de
avant le
forme
sa
la
et
8.
d'éclat
position,
8'"''
Août.
je
la
grandeur,
Elle
n'avait
depuis le
la
comète
étoile.
revoir la comète
changé sensiblement de
3i. Juillet. Pour déterminer
comparais avec une étoile anonyme de
que
je désignerai par la
lettre
le
moyen d'un diaphragme
.la
lunette de Dollond de trois pieds et demi.
dci
diaphragme est de
circulaire
14'' 23/''9-
(n),
par
adapté au foyer de
Le rayon
q6i
Différence
le m s moyen
de l'obser-
Nr.
vation
I
l'ascen- Les <ordes
de
sion droite
en tcms
en tems.
moyen
moyen
La comète au nord
Jm.
u centre du diaphragme
Em
Le toile
'
û) au nord
III.
La comète au nord
Tm.
du centre
Em
IV.
nord
La comète au nord
du centre
I
Im.
Em,
du centre
L'étoile {a) au
ii''58'37",i
5927,9 S
58 9,5 l
59 4»>7 S
12
Im.
2 4s' ?
4 25,s S
3 7-9 ?
Em
440.7
Im.
L'étoile (<î) au nord jlm.
Em.
85. ,5 S
Li*
comète au nord
1
3
>
"124643,5 7
483i,9 S
Im.
47 'i>i l
Em
48 5 1,5 S
Im.
Em.
L'étoile (û) «u nord
58 59,1
+ 89,»
3 33,5
+144,8
354,3
-Il 32,8
737,3
— 21,4 +1 54,0
7 58,7
4-1 45,4
»
b
6 40/5
8 H,3 S
7 5,9 >
Em.
12
o'22",o +i'4i",6
12
4737,7 -~o 23,6 4-1 48,4
48
+1 40,4
1,3
Le 1 1 Août. La comète était très difficile a apperce.
voir, l'athmosphère étant chargée de vapeurs; c'est pourr
quoi
je
teuses.
ne pus
faire
plus de deux observations très-dou-
La comparaison
fut
faite
avec
l'étoile
de Taérostat -d^près Je -grand catalogue de
RIr..
(6)
N° 39.
Bode.
s6û
Différence
Tems moyen
de l'ascen-
l.ti cor<i«3
de l'obier
sion droite
en
vaijon
en tems
moyen
te
ms
movcn
L'iitoile
/;)
au nord
Im.
du centre du diap!n-.)gmf Km,
La comète au nord Im.
du centre
Em
II.
L'étoile (/>) au nord
ïm.'
du centre
La comète au nord
du centre
Em
Le
12.
plus
distinctement
avait
a
n'était
29 39,0
3o 40r2
-l-''43",4
»^5«^^^'\^l 12 5925,2
^
i3 o 5,oS
I
1
a
,4 ?
,57^ '3
Km
Le
-Hi44",4
2847,8
2837,8
Im.
Août.
à''.
12''27'
i
1
4>4
que
la
/
I
guères
égal
Comme
39,2
t- 1
46>o
comète
était
nuit précédente ;
elle
Li
peu -près une minute de diamètre ,
grandeur.
2,4-
-H i 19 '6
étant serein,
ciel
visible
,
H- a
à
celui
des
étoiles
le
centre
de
la
de
comète
et
son éclat
la
onzième
n'était
pas
assez marquant, j'étais toujours obligé d'estimer à peu-près
son
Immersion
phragme.
ïostat,
et
et
Emersion
à
circonférence
la
Je la comparais avec l'étoile (b)
dia-
N° 39. de l'aé-
avec une autre étoile anonyme de la huilicme
grandeur_, qui je désignerai par la lettre
Létoilc {f>) au nord
Im.
du centre du diaphragme Em,
La comète au sud
Im.
du centre
Em
II.
du
L'étoile (/) au nord
m.
du centre
La cnmète au sud
Km
Im.
'
,
1 1
1 1
>
14 2,2 S
12 54 y. (
»4 ay.H S
ii'n3
0,6
Il
1341,0
1
16 57,0
i5 59,0 ?
1
17 55,0 S
><-î47,JW
i8a3,i. S
(c).
i7 3'>,4
4-o'37,"4
— 33,6
1
-\-i 56,o
ho 38,4
— 35,Q
1
,
263
Différence
Tems moyen
de l'ascen- Les cordes
sion droite en tems
moyen
en tems
de lobser-
Nr.
vation
moyen
III.
L'éto.ic (*) au nord
du centre
Im.
La coir.ète au sud
(m.
1
Om
2
11
Em
IV.
L'étoile (^)
au nord
1
22 9'4
>
rmT 11 36 57,4.
?
ai 26,8
3ô5o,2 5
Im.
La comète au sud
37 4^,8 C
Em.
39 I7,(' S
L'étoile (*) au nord Un.
1 1 45 î.o,b
l
29,0
M 25,0
Em
La comète au sud
VI.
La comète
au sud
>
Em
5()54.?
S
Im
55 49,8
Em.
57 !4-
Vu. Létoile anonyme (t)
12 25 4y,4
La comète an sud
n.
Vili
L'étoile anx>nyme {c) !lm.
au sud
Em.
Létoile (f) au nord
,Ini.
La comète au sud
12 37 56
IX.
Em.
La comète
Im.
au sud
Em,
Le i5. Août. Lair
était
très
difficile
à
32jO
— 24,4
1
-
1
a4,8
12 38 35; 4
40 47,8
-+-1 58,4
41 20,4
U
1
i
2 5o J7,
1
52 17,8
53 38.^
55 7,4
a 5
1
37,4
54 22,8
— 3i,6
— 20,8
45,4 — 29,2
-{-2 45,0
,
la
douteuses,
La
\
32,6
1
4- a
1
eamète
n'étant pas assez serein, la
lunette ;
observations
les
l
— 37,6.
— i8,4
champ de
rendait
-0 36,4
39 '9.8
elle
dans
48,4-
4-157,2
12 26 3 1,8
appeicevoir
quelquefois
le
1
ôS 55.6
>
4034,6 ^
6,2
1
S
Im.
Im.
L'étoile (t) au sud
/
4' 47-0 S
42
1
56 32,0
m
Em
ro 36,2
47 ï»>o
P
-i^
39 '4. fi
3g 48 6
+
s
37 14,2 S
28 3 1,0 l
3o 8,6 V
Em
1
46 34,8
)
1
Em
au sud du centre
— 33,2
!-o36,6
S
46
4757,0
Il 54 57,0
L étoile (^) au nord
1
-i-i5a,8
38 3o,4
1
— a5,a
-f-o'37",2
3753,8
Il
Em
V.
+i'59",6
i''2o'49",(^
49.4 S
so44>2 ?
disparaisait
c'est
même
ce
qui
comparaison fut
a
1
264
faite
de
avec une étoile anonyme
l'aérostat
une antre
et
(d)
d'après le grand calaiof^Lie de
(e)
N!° 35
Mr. Baie.
Différence
Nr.
Fems, moyen
de l'obser-
de l'ascen
Le cordes
sien droite
en tems
vation
en en tems
moyen
moyen
II.
L'étoile ('i) au <;ud du
rm.
centre du diaphnigme
Em
La comète au nord
Im.
54 7.8 S
53 7,0 ?
du centre
Km
5^ 19.8 S
(m7
Ein
55 40,2 ?
5j 32,(j. >
L'étoile (^) au sud
La comète
III.
lY.
au nord
lit^Sct'
1
i
Im
Em,
(),"6(J
5t3 4o,6
?
57 4»^\h'
Ç
^
La comète au nord
Im.
du centre
Em
L'étoile (f) au sud
Im.
4 4>''
5 58,6
5 i3,4
Em
7 i4»G
La comète au nord
L'étoile (f) au sud
Im.
L'étoile
(f)
au sud
5343,4
1
1
57 i3,6
12
10 40 6
Im
957,4
1
L'étoile (7) au sud
Im.
12 14 35,0
i637,o
Im.
i5 55;8
Im.
Em
La comète
au nord
VU. L'étoile {d) au sud
12
23
22
Em
2-^25,8
Im.
La comète au nord
Im.
Em.
vnr
L'étoile (^) au sud
La comète au nord
Im.
12 56
9,8
57 32 6
56 23,6
58 23.0
i3 19
J,4
Em.
20 5 1,4
Im.
ly 43,4
21 l0,2
Em.
946,0
12 i5 36,0
12,8
I
12,4
+
1
6,0
-1-1 54,0
—2
— Il
1,6
l3,2
-h i 49*«
-2
0,4!
-t-2
2,0
9,8
22 44'^^
+ o34,4 41 23,2
1649,2
12 22
(
1
1,Q
— 146,8
— 44,0
;
1.8 S
2,^
f-o 37,:
10 57,6
12 21 17,8 l
Im.
Em.
1,6
,2
— 152,4
6 14,0
Em
»!•
5
-t-i
i
S
57,8
Em
f o'36",
56 36,4
85i,4
13
Em
Em
V. La comète au nord
12
—a
Il ''53' 7',
1
S
?
12 56 5i,2
)
l
57 25,8
+0 34,6 4-
1
54,4
S
(
•3
.956,4
-^ 1 5o,o
^
?
5
20 26,8
-1-0 3o,4|-(-i
a6,8
.
s
1
^65
Le
AouL Les observations d'aujourd'hui ont ëtc
17.
faites
principalement pour Li détermination de
son ;
mais
que
que
la
le
sont
elles
lumière de
la
avec rétoile
anonyme
quelque incertitude, vu
sujettes
à
comète
r^tnit
(d)
extrêmement
La comète
lunette.
vent secouait la
la déclinai-
fut
du i5. Août, comme
foiblc,
et
comparée
il
suit:
'Différence
)
Tcms moyen
de raioen-Les cordes
sion droite en tcms
de l'obter-
Nr.
en te m
vition
moven
La comète au sud
Im
du centre du di.iphragmeEm
rf)l,n
L'ctoile anonyme
«733^5
II.
au sud
En
La comète au sud
Im.
lEm.
Im.
jEm.
L'étoile (^0 au sud
III.
La comète au nord
Jm.
du centre
lj<:m.
L'ctoile ((/) au nord ;im.
Em
IV.
La comète au sud
3 23 38,3 ^
24 55,9
25 11,9
1
3 2Ô 5 ,9
1
1
3o i3,
3o
Jo ?9,i
Em.
Em.
Im.
Em
l
_3h 46,: S
3947»!
39 54,7
Im.
?
S
"i3 38 «3,1
La comète au nord
•)
gb'44,7
\m.
Im.
L'étoile {d) au nord
P^i» 7 s
i.
1
Em
L'étoile (</) au sud
$
1750,7- (
,
4' 3')9
1344
5,1
45 4'.,9
45 5 , i
47 27>9
1
1837,7
i3 24 17,1
j
266
Différence
Tems, moyen
de l'obscr-
Nr
|
de l'ascen Lescor des
[sion droite en tcras
moyen
en temS'
|
moyen
VI.
La comète au nord
L't'toile
(d) au nord
Im.
Em,
5o54,3 S
Im.
5i 18,3 >
5a 35.5 S
Em
Le
mauvais
tems
comète au-dessus de
,
et
ic*'5o'i.3")i
I
5i 56,9
la trop petite
l'hoiison,
|
— 1'43",3 H-i'î!a",4
'
+ 117,2
élévation de la
ne permirent pas de conti-
nuer les observations les nuits suivantes.
O00eOwO000004
267
DES RI A X
RI
I
D'UNE FONCTION DE
ET R!
A
l
N
I
RI
A
PLUSIEURS VARIABLES.
PAR
F.
Pr<^senté
SCHUBERT.
T.
h
à
J.
1.
La
se
fait
si
facilement
la
fonction
Conferer.ee
proposée
par une suite de différentiations,
ne
renferme
variables.
sujet
(*),
examiné que
et
faut convenir
il
des
distinctif
Euler 5
n'est
pas
pléé (*^*); mais
qu'en
passant,
avec
si
lorsqu'il s'agit d'une fonction
Eiiler,
en traitant ce
fonctions de
deux variables,
Lacroix
que
les
Rlr.
maxima
qui
qu'une seule variable,
Le célèbre
de plusieurs
tère
18 Oct. 18 «5.
recherche des maxiina et des vuninia ,
présente plus de difficultés,
n'a
le
et
(**) ,
des miiiima ,
le carac-
indiqué par
Le célèbre Lagmuge y a sup-
suffisant.
comme il ne pouvait traiter cette matière
je
crois
qu'il
ne sera pas inutile de ré-
pandre plus de jour sur cet objet important, et de dévelop-
(*) Instit.
(•*) T-a':tî
CdU.
(i.i
D'iffer.
XL n». 28(f. sqq.
Cap.
Ccikul D'ffir.
et
(*•*) MifhenUiut analyt. p.ig, 89.
lut
Tome I. pag. QyS.
sqq. et Tbioric ties /«nctions, png. igs. sqq.
34*
per avec
^ni
-
de base à celte recherche.
Ç.
c
ctc
suivi pai
indé^Dendantcs l'une
fuit
[l'est permis de les traiter séparément,
on. fait lorsqu'il' s'agit
c'est
a
Les variables x,y,
se réduit à ceci.
dont u est fonction^, étant tout à
l'autre,
qui
d' Euler
Le raisonnement
tous les analystes j
de
me paiait devoir tc;-
raisonnenrent qui
clarlê le
à dire ,.
il
comme
de dilTérentier une fonction de x,/:
est permis de cliercher: d'abord- la valeuï*'
de X qui donne un maximum ou minimum;, eni regardant.
y comme constante, et ensuite celle de j,, x étant" regardée comme> constante:
quations, ll
Ces; opérations donnant autant d'é-
— Oy '/y=^Oy
qu'il
y a de' variables, on
déduit les. valeurs, de x et de /, desquelles
biner seulement celles,, par ex.
il faut
en-
com-
xz= a, jK in 5, dont chacune
un> maximum oix-uw. minimum:.
rend la fonction
il à. la. fois
î?our cet effet,
iL faut qu'après la. substitution*, de xzzz a,,
yz^b.
les
positives
ou négatives
différentielles
en»
secondes.
^" ^^ d.y~i
même- tems.. Ainsi
,,
deviennent
u étant fon-
vlion de x,y, z,. etc;. la: règle qu'il: faut suivre pour
ver les maxima: ou minima. de
valeurs,
xnz.a,.
^-"2=2 O,. 1^ zz: O;,
w,.
se
jmb,. %.z=lc,. etc..
etc..
rédiiit a
qui:
trou-
trouver des.
rendent ^^ im o,.
et qui! dbnnenf le même signe (-+-ou.—)/
aux. coefficiens différentiels, du. second: ordie^^", ^^1-, ^J„ etc..
259»
Cette règle ne peut ctrc en
3.
§.
sonnement sur lequel
ceux
que
rait
elle
qui ,
comme légitime,
est fondée,-
après
avoir .idopté ce
trouvent la règle qui en
attention
à-
que
nous
tion
que
était
pa-
raisoiTnement
résulte,, vicieuse,
en donnant
Eulcr,
plus conséquent; mais
verrons' d'exposer,,
il
ne
faisait
pas
dans le
Il,
étant
fondé sur la supposi-
variables x, y, etc; sont ennèrement indépen-
les
rigtienr.
il
rai-
une' circonstance très-essentielle. Le raisonTiement
dantes l'une de
qiie
si le
jutte ;- et
es-t
sont en contradiction avec cux-mèincs.
Gctte rcgle>
dcf.tnt,
l'autre,,
cas
où
est vrai
ne sauvait donner un jaste' résultat
cette' condition
a
lieu dans toute sa
que dans une Jonction u de x,y, ces
variables sont tojours censées, être indépendantes, tant qu'il
ii^est
pas donné une ou plusieurs équations entre x, y, etc.,
mais
elles
qu'il"
existe
deviennent dépendantes l'une de l'autre,- dès
une pareille équation.
OV
c'est précisément
ce qui peut avoir lieu, et ce qui cn^ effet arrive souvent,
a:
cause dès éq,aatiQns ^^ zzi^o;
n^"
^^ Or ^t
i^
^5t clair
que
dans un pareil cas, le raiisontienienC sus dit sur lequel" on
a;
basé
la-
^'yji
maxima
et minima],
Cela mérite' d'être rendu plus
pliqué.
§.
théorie dès
4,
etc..
Si:
ne peut être ap-
clair.
dans la fonction proposée u ,
sont: séparées
lès variables
l'une de l'autre,, les équations
.
''."zzro,
elc.
j'nzb, / :z= b'',
forme,
J'
donnent chijcnnc iinmcdiatement par des
iin
de
constantes,
270
sorte
que
etc.
données
les
valcuis
xma, x rz n^, etc.
par
équations
des
de cette
^'zzzY s::zO, n'ayant aucune
:z:iX ::::z o,
liaison
entre elles, on peut les combiner à volonté, sans contrarier
les
^^zno, etc,; pourvu que
équations
combinées,
par
maximum ou un
ex.
a
et
niiiiinmui,
6,
rendent u en
bon d'observer que dans ce
sera
(Il
différentielles
4" second degré
le? y.ariables x, /, etc.
1"^
°^^
ci-
des quantités ^^ , ^.^.
cas,
ce sont les seules
étant, nulle ,
par ce
si
sont mêlées ensemble, de manière
sont fonctions de plusieurs variables, alors,
etc.
les équations
,
comme
de x seul, comme ^~ de /). Mais,
.que ^^ est fonction
.que
(:+;)
valcuis
même teras un
ce qui est indiqué,
dessus, simplement; par le signe
les
|^n:0, ^"nzzo,
etc.
déterminant une certaine
l'une devient fonction de l'autre,
relation entre x, y,
et
par conséquent le raisonnement susdit n'est plus légitime.
Jl
est
vrai qu'ayant autant d'équations ^^ mi O, elc.
on peut les éliminer à une près ,
y a de variables ,
quelle
sera
donnée par des constantes.
qu'il
la-
Mais on ne peut
plus combiner à volonté les différentes valeurs x::=: a, xzz:a^,
j rz 6, yzi^b'',
etc.
Chaque valeur
correspondante de /, par
une
autre
valeur
ex.
h,
et
a de x a sa
valeur
on ne peut substituer
y zzi i^ avec x::z:a,
sans détruire
les
•211
équations
celle
?" -i O ,
etc.:
donc
la
y dépend de
valeur de
/ est fonction de x.
de X, ou
donc ,
dans toutes
§.5.
Il
supposent
les
équations ^^rrro, etc. c'est à dire, dans les
différentielles
secondes et celles d'un ordre supérieur, lors-
s'agit
qu'il
faut
de trouver
les
opérations qui
maxima ou minimay
regarder/ comme fonction de x,
je,
les
il
faut, dis-
y comme fonction
et
de X et de /: par conséquent, du étant •:=:(^")^x-f-('^")3/,
différentielle
sa
rapport
par
à
x
renfermera
diJ^éren-
la
du premier terme lequel de-
tielle
par rapport à x^
vient
(~)Dx=, que du second terme ou
tant
(
—
dxdy:
--^
)
\ d X y
il
n'est
donc pas permis de négliger ce
second
terme,
dans 'la seconde différentielle de u prise par rapport k x,
excepté le cas où ce terme
lapport à X,
c'est
à dire.,
n'a-
où
^~ n'est pas affecté par les
variations de x, étant fonction de
de X, de manière que
les
Nous
voilà donc revenus
règle
suivante.
Si
les
pas de différentielle par
y seulement, comme —
variables sont séparées dans u.
au
même résultat
variables x, /', etc.
qui donne la
sont
séparées
dans la fonction w, de sorte que g" rz: X, |^ zi: Y,
sera
un maximum ou minimum, lorsque
que g^, ^^ ,
ont le
même signe.
etc.
it
X =r o, Y z=. o, et
Mais
si
elles
ne sont
2-2
pas' séparées j
bles,
ne
il
3u
3u
^" ,
^^ ,
des' termes
5.
6.
faut y
5-
J'
Tl
est
,
^, etc. soient uiroctés du
cîjouter
d'autres .conditions, à cause
etc.
clair. que
donc
employé dans
toujours
°-^j,
pas que
suffit
même signe; il
étant fonctions de plasicivrs varia-
le
raisonnement qtvon a
cette recherche ,
et
<jui
est fondé
sur l'indépendance des variables, n'est admissible <\\\e tant
que ces variables sont réellement indépendantes ^
n'a lîeu que jusqu'à la première
donner à cet objet toute
dilTérentifUion.
clarté
la
caractère des m.athé.njatiques, je
ce qui
— Pout
«t solidité qui sont le
me servirai d'un raisonne-
ment qui ne suppose pas du tout
-que les variables ,
y, etc. .soient indépendantes l'une de l'autre.
r,
Nommant u^
ce que <levient la fonction u, lorsqu'on y met x-k-h, y-hk,
% -{- l,
lor
etc.
au lieu de
x,
y,
z.,
etc.
le
théorème de Tay-'
donne l'équation :
- u = "A + %k +|^i +m.] +
+ M^^A' + g^A' 4- lÏJ» SJ H +
(A) «-
[f
Tl-
d'où
il
suit
minimum^
la
il
première
terme , ou
que ,
faut
poi^r
que
l-e
+
cet.
que u devienne un maximum ou
premiier terme ile ce^e. série^
difTérçnti^llc ,
la
cet.]
le
second
reste toujours
positiC
disparaisse ,
seconde difTérentielle
,
que
ou
,et
ou négatif, quelque valeur qu'où donne aux quanlitée
su*
273
bitiaires,
h,
ou que dans
h, l, etc.
terme s'évanouit,
troisième soit
le
de quelque manière que
dent l'une de
comme
4.) ,
(§.
l'autre,
supposition
le
qu'on donne a x une
elle
cesse
quoique
l'autre
dans le cas du
tés
lî,
k,
les
faire
l,
X,
etc.
y,
la
de ces
hors
poins-
xrza, yznb,
maximum , de manière que ,
dès
autre valeur ,
on
comme on
qtie j
dépen-
etc.
dépendance nait de
cette valeur de u, ^t de celles de
peut changer /, %j
Or,
etc.
— = O, etc.
cette
qui ont donné
etc.
y,
,
en vertu des équations
du maximum ou minimum y
ou de
rr o
aussi
variables x,
les
ou ce second
cas
le
etc.
z,
par ex.
veut.
est
Il
a -t- /i ,
donc évident
dépendantes l'une de
soient
maximum ou minimum, les quanti-
sont tout à
indépendantes, qu'on peut
fait
à volonté positives ou. négatives^ ou bien, .l'une
positive, l'autre négative
oa égale
à
:^éro,
etc.
Par con-
séquent le premier terme ne peut disparaître, à moins que
tous les ooëfficiens des q^uantilés
égales à zéro,
ky etc. .ne deviennent
/i,
chacun en particulier:
d'où l'on obtient
les équations
'
qui
(I^)
a.
suffisent
=o
leur nombre étant
xrzfx, X
=
,
3- zn, a, 3-
-p etc.
,
,
pour jdéterminer les valeurs de
a^,
égal à celui
^tc.
y:zzb\ yzizb\
^yiérentes valeurs ou racines données
MtmoimdtiAcad, T. VU
Xj y, etc.,
de ces variables.
etc.
z^nc,
Soient
etc.
les
par la solution des
35
,
^
Ô74
équations (B) ,
supposons que
et
— ^»
— ^b
dy=
dxTz
'
Bxdy
— ^' dz^— ^'
— ^(
— ^i
'
dyd^
de
sabstitiTtion «fime
x rr a, y zzb^ z rz c,
CCS racines, par ex.
,yxï
la
'
donne
etc.
^^^•
^'^^•
llors le second terme deviendra
^A/i^-|-BA^-|-Ci=
.".'
4- 2 A^/iA-4-2 A^/ii -f- 2B^A/ 4- cet. ^
faut donc que, lors des
A/i* -i-Bk- -^ Ci--+-
maxima ou minimal
-+-
lif,
sans pouvoir passer d'un état à l'autre.
"j.
Voici
raisonnement par lequel Lagrange a
le
à cette condition.
tine quantité
D'après la
loi
de continuité»
quelconque ne peut devenir négative, aprèt
qu'en passant par zéro
avoir été positive ,
impossible que la quantité
ne peut devenir nulle.
il
:
est
donc
m passe d'un état à l'autre, si
Or c'est ce qui
a
lieu, lors-
que l'équation mirro n'a que des racines imaginaires.
,1
gardant
elle
h
comme
inconnue
l'
dans
1
équation
Re-
mmo
donne
^-— — / /A*
Aj, (t ^. Aj i •+• .
h -I
m
m reste toujours positif ou néga-
arbitraires h. A, etc.
elle
quantité
2 A^/i^-f- 2A.hl-i-cet. =^
të.«5
satisfait
la
que, quelques valeurs qu'on donne aux quanti-
30ït telle
f.
)
*
-'^
Il
+
La condition
.
/
(^
nécessaire
—
V 4- A, 1-4^....)»
Bk»-+ri*
-f.:B.H^.
^—
pour l'existence des maxima
).
ott
.
275
minîma est donc que
la quantité sous le
ou que
jours négative ,
A {Bk* -f- C/* -h
(i) (AB
Pour que
tive ,
d'après le
— AJ)
O =2 (AB
.
.
)
ou bien que
.)-,
.
— AJ) +
le radical
> o.
l'
cet.
soit
toujours négaV
même raisonnement,
ou que
puisse devenir nulle,
n'ait
(AC
k' -h
quantité sous
la
faut,
il
— Al)
+
-f. 2B,AÎ
plus grand que (A^Â -|- A,./ -f-
soit
radical reste tour
qu'elle
ne
l'équation
C — Al)l' 4- cet.
H-2(AB,-~A^AJ^ZH-ceL
A* -h (A
que des racines imaginaires.
Faisant,
pour abréger,
AB — A^ml, AC — A' = K, A B, — A^ A, =: L,cette équation
ft
il
H
j
—— —
y {
(IK
—
L^)
de
soit
positif;
et ainsi
etc.
zro, on
aura
sonnement ,
suit
en
(s) I
même
être positifs ,
àxx
—
jï
j
;
,
comme ci - dessus ^ que
faut donc,
(o)
donne
l'
+
suite.
cet.
Supposant donc d'abord î,
(i)AB — A^>o, et par le même rai-
K—
L^
>o
,
tems que les produits
ou
les
quantités
de suite ;
et ainsi
AB, IK.
A et B^
I
et
,
K,
même signe.
35
d'où il
doivent
afFectéeff
2^6
Voilà donc
miaima, quand
toutes
IK positif,
li
AB>Aj,
3)
nmxima ou
cks-
fonction u ne renferme que
la
Elles se réduisent
bles.
Gonditidons
les
ces quatre:
tiois^
varia-
AB positif, 2)
i)
1K>L^ Comme la tioi-
4)
AB — A^.zi:l soit positif, Li seconde se
réduit à ce que K ou AC — A^, et par conséquent aussi
sième exige que
ÀC soit positif.
Nous avons donc ces
conditions:'
1)
AB et A C positifs, ou A, B^ C, affectés du même signe
2)
AB> a;,
3)
y.
AC> a;,
- Al) (AG - a;) > (AB, - A, AJ4) (AB
Sans insister sur ce qu'une quantité
8'
§.
au négatif, aussi bien par
ser de
l'état positif
par
le
zéro,
dans
le
théorème de Tayîor,
pour
le
de quatre
cas
par Lagrangc ,
toutes
ait
les
qui
tités
et qui
,
aux
la
recourir
condition
le
racines
nécessaire
savoir que
positif
que dans
positives ,
ou négatif,
une méthode indiquée
de
l'état
lieu
variables
que
usage
bornerai à développer
me parait plus simple
maxima ou minimal
avoir
me
fréquent
maxima ou minima,
que
passer de
je
et d'un
conditions des
besoin
évident
très - connue
vérité
peut pasl'infini
donne
sans qu'on
imaginaires.
Il
est
pour l'existence des
la quantité
m ne puisse
au négatif, ou vice versa, ne peut
le cas
où
m est la somme de quan-
multipliée par un facteur
commun
positif
premier donnant les minima, le second
les.
C-*7
maxima.
renfciment
ces
quiintités
ce
cette
forme
teur
commun
restent dans
ne
soient
})i
:
quantités
qui
composent w,
etc.
est
impossible que
k,
li,
tous les
quarrés
des
-zn n (p^ -)- 9^
+
qui distingue les
que tous
clair
du signe
affectés
les
arbitraires
les
q^ue
U est
comme
Mais
7
-f- :
r^
il
à moins
donc que
faut
-h cet.) ,
m ait
n étant le fac-
maxima d'avec
les
minima.
l'es
quarrés p^, 9% etc. doivent être
car
si
l'on
à
r^
le
sieurs quarrés, par ex.
— r*
:
il
cas positives,
donnait à un ou à plu-
signe
—
la
,
différence des
^ pourrait devenir positive ou négative,
d'après les différentes valeurs de h, ky l, etc.
quarrés p^H-q^
9.
5.
Soit
XL
:ir.
une fonction des quatre variables v,Xyy,7y
auxquelles ayant donné les valeurs vzz.a, x=zb,y:izc, %
les coefficiens
—
rf^
différentiels
39u.
ddin
3-o2f»
d^*
ddu
ddu
ddu
ddu
ddu
ddu
ddu
ddu
d3^* dzT' dvdx' dvdy' dvdz' dxdy* dxdz' dydz*
reçoivent
les
valeurs
«
A, B, C, D^A^,, A,, A^/, B^., B^, C^,
+
xrz6 4-6'', j)^=zc+g'',
de sorte qu'en substituant
2;:zza
z zz: d ~\~ df,
la
que nous avons désignée par la
lettre
dont le signe (-f-oii— ) sert à reconnaitre les
m_,
maxima
et
et les
quantité
minima, devient
+ A^a'd' 4- B^c'
2
Or il
est
2
aisé
a^,
de voir
-f-
q^u'on
2 B^ih'd'
+ C.c'cr.
2
peut lui donner cette forme:
27«
m — Ar(a' -h ab' -h Pc' -h ydy -f- v(b' -h 5c^ 4- téff
*ïni
même forme relativement
autant de termes et de la
a
aux quantités of,h\c\à\ que l'équation (A). Le développement des quarrés donne
(B)^
—
l'équation
a'^ 4- (a^ H- >i') '/'
+
(P' 4- X»5' -f- |a«)c'«
a^b" 4- 2 p a'c'
42 (a y 4- X* e) b'^d'
4- 2 y a^d^ 4- 2 (ap -I- X^ 5} b'c'
4- (y^ 4- X* Ê^ 4- fjL^
-y,^
4- 2 a
-f- v^î) d'^
.
.
.
4- 2 (p y 4- X'^ 5e H- fjL' v))c^ d'.
Observant
maintenant que
les
quantités
a\h\c\à\ sont
la
comparaison des
indépendantes l'une de l'autre
(§
équations
déterminer
ficiens
(A) et (B)
a.^^^
AB — A^
AB,
Ayant
etc.
=iF,
à
seivira
fait,
6.),
les
neuf coef-
pour abréger,
AC— a;
—g, ad-^aj
=h:,x
— A^A.rrl, AB,^ - A^ A^rz K, AC^— A, A^-L,
oa trouvera
1)
les
équations suivantes
:
a^^-, 2)p=::\% 3)y=:',^ 4) V=j-a— J,
5) \'Z
— \ — ap
donc
HZ ^ ,
e
rr ^
7)
,
^=
ou
5
—\
,
6)
X^£ ::= ^^'
— «y,
- ^ _ p^ - V5^ = ^-°Fp-,
— py — X'Ô£, ou
=: ra-îs"
3)
^*<vi
9)
.'=^-v--X^--|-^V=:,:r(t^"-K^^^:^^^')-
>!
Û îaat donc que les quantiliés 4v). 7), 9*) «saiont .positives ^
979
Cf^mme te qtiané A' est nécessairement
et
positif, la pre»
mière donne
F > o;
ce qui étant substitué, l'équation 7) donne
G > o, et F G — I* > o.
Cela posé,
positif et
d'où
il
résulte de l'équation 9),
il
plus grand que
que F H
quantité positive
la
— K'
est
^'qzziz
9
suit
H>o, FH-K»>o,et(FG-P)(FH-K^)-(FL-IK)«>o.
Les
conditions
F>o, G>o, H>o, nous apprennent
même tems que A, B, C, D,
même signe.
en
5.
10.
Il
FH — K* > o
,
conditions
du
H > o et
est
vrai
sont
des suites immédiates de la dernière
et des précédentes;
et
minima ,
les
plus simples,
il
que
doivent être affectés
vaut
et
mais,
les
dans la recherche des maxima
mieux commencer par les conditions
passer
à
celles
qui sont plus com-
pliquées, parceque, dès qu'on voit que les valeurs vzzia,
a in 6,
ons,
ne satisfont pas
etc.
il serait
inutile
de continuer le cjIcuI.
Nous avons donc trouvé
vienne
un
à une seule de ces conditi-
qu*afin
maximum ou minimum,
quantités suivantes soient positives:
que la fonction u de»
il
faut
que toutes le*
£^8o
-
h=ad— a^, fg— i%
(FH — K^) — (FL —
T==AB— a;, g=:ac— a;,
—
Fil -^ K% et (FG
Mais
il
tions
k remplir,
est
permutation
I-')
111)^.
de voir qu'il y a encore
aisé
lesquelles se
quantités
des
d'iuvtres
condi-
manifesteront par la simple
a\ h\ c\ d\ parcequ'on peut
placer les variables v,x,y,z, dans tel ordre qu'on voudra,
et qu'on
(§. 9.).
facilitée
Ûciens
équations ,(A) et (B) par rap-
les
B ou C ou D, au lieu de A
port à
fait
peut ordonner
Dans
cette permutation
,
comme nous avons
qui est singulièrement
par la manière dont nous avons désigné les coefdifférentiels
A, A^,
d'après les principes
etc.
du calcul
il
faut se rappellej que,
différentiel,
on a
B,zi:A^., C,::r:A„ D,=:.A„ C,-_i.B,, D,=:B„D,=i.C,.
Cela posé^ on trouvera
a'',^^ c'^, d^,
la
permutation des quantités
change F, G, H, que nous appellerons quan-
du premier
tités
que
ordre ,
en
BC — B^ — ¥', BD — BJ =: G\ CD — C^ nz
§.11. Les quantités du s,econd ordre,
II''.
FG — l^ctFH — K*;
étant dév^eloppées donnent
FG-P=:A(ABC-f-2A^A,B,-AB;-BA;-CA;)=:A.N,
et
FH-K= = A(ABD-f-2AjA^;B^-AB;^lBA^-^DA^)z=:^A.P,
de
la'
tuant
dernière
desquelles
C au lieu de B,
on forme de suite, en substi-
6
c8i
GII-L^
Ces
= A(ACD-f-2A,A,/C,/-AQ-CA5-DA;)=:A.a
quantités
trois
AN, AP, AQ.,
ont été trouvées dans
A soit le facteur commun de in(§. y.);
et il est permis de choisir pour ce facteur, B ou C ou D, au
la supposition
que
Mais on verra qu'en substituant dans ces
lieu de A.
B au
quantités
lieu
de A, et
trois
A au lieu de B, N et P
ne chan^^ent point, tandis que Q. se transforme en
BCD + 2B,B,C^ — BC; — CB] — DB; — R
,
FG — P devient B.Nrz:-(FG — P)»
que Fiï-K^ devient B.Pr= J(FH~K^), et que G fi — L'
devient B.Il. Permutant ensuite A et C, NctQ.ne chanmais P devient
gent pas
R
donc FG — P devient
C..V — ^(FG-P), FIÏ--K.^ devient C.R et GH-L^ devient
C.Q..z:;^(GH — L^). La permutation de A avec D ne fait
aucun changement à P ni à Q, mais elle change N en R,
de sorte que FG — P se transforme en D.R, FH — K^en
D P =1 5 (FH — K^). et GJI — L^ en D a — ° (GH — L^.
que ]MY conséquent
et
irz:
,
;
.
.
CcJà nous donne ces équations de condition
:
(a)AN>p, AP>o. Aa>o, BX>o, BP>o, BR>o,
CN>o, CR>o, CQ>o, DR>o, DP>o, Da>o;
lesquelles
se
réduisent
a
ces
quatre,
AN>0, AP>a,
AQ.>o, APx>o, parcequc x\, B^ C, D, doivent cire affectés du même signe (§. 9.).
iUmoirei dtrAcatU T. VI.
3
f.
Quant
12.
— Kf > o,
peut être mise sous cette forme
{h)
F
+
permutation des
trois
lettres
résulte les trois équations:
être positives
(5)
il
Mais
(J.
dans
S(
> o, îl étant
quantité
la
ne
ellrs
SI ,
en
il
F.S(>o, G.Si>0, H.Sl>o,
Sl>0, parccque
du premier oidre, F, G, H, doivent,
On a donc
10.).
FG H + 2 IKL -^ FL* — G K^ — HP > o,
faudrait encore substituer B,
il
.
B, C, D, entre
lesquelles ne donnent qu'une seule, savoir
toutes les quantités
9.)
1
K L — Fl.= — G K= — II i^
c 1
produisant aucun changement
où
(§.
(F L
rr FG II
T.a
r équation du troisirme ordre
— P) (F H — K^) —
(FG
elle
il
est
aisé
de voir que
cun changement par
cette
la
C, D, au
quantité
permutation.
veloppement donne S(=z:A*^.9K,
ÎHHI
lieu de
Ai
n'éprouve au-
SI
En effet, son dé-
étant c:=
— ABCD — AB CJ — AC. b; — AD b; — BC A^
~BD. — CD.A^
.
.
.
a;.
H-2A.B^B,Q^2B.A,A^C,;+2C.A/,A„B,;H-2D.A^A^B^
2A,A,B,C,-2A,A,B,B,
- 2AABA-
-^A^c^^-A;.B^-f-A^B^
Cette expression de
rapport
SJÎ
étant tout à fait symmétrique par
aux quantités a,
leste toujours la
h',
c, d,
il
est
évident qu'elle
même, de quelle manière qu'on transpose
283
ers quatre quantités.
Ces
ces q[idtre équations ,
A^ £0? > o, B^ SOÎ > o ,
D^£0{ > o.
rement
transpositions
Or, les qiiarrés
positifs^
il
fournissent
C=^ 20?
donc
> o,
A^ B% C^, D-, étant nécessai-
en résulte une seule équation :
S[)î
> o»
S( > o.
ou
§.
1
Rassemblant ces
3.
maxima ou m'uiima d'une
les
résultats,
on obtiendra, pour
fonction de quatie variables,
toutes les équations de condition, qu'il sera
ou moins grande simplicité.
ser d'après leur plus
Une
proposée,
fonction u de quatre variables v,
seules valeurs de v,
les
rendie u un
bon de clas-
maximum ou minimum,
x
,
y,
dc,
?. ,
y, %, étant
qui puissent
sont données par les
quatre équations
^f^"
-,3"
du
Qu^, paimi
les
^9"
^
valeurs ainsi trouvées, on choisisse quatre
correspondantes ,
V zzi a ,
a:
rr 6
,
y z= c
,
et qu'apjès les avoir SLibstituées
renticlles
•cette
de u,
on
désigne
substitution, de la
ddu _
ce
z :=z d ,
dans
les
secondes diffé-
qu'elles
de\iennent par
manière suivante
:
284
Alors, les conditions anxqirelles
il
u devienne un maximum ou muûmum,
que d'abord
les
soient afTcclés
quatre
cocfficiens
du même
que
faut satisfaire, afin
se
lédiiisent
signe (-{- ou
—
)_,
à ce
A,B, C, D,
dilTéicnticls,
et qu'ensuite,
pour abicger,
ayant fait,
ab—a; — F, AC — a;-g, ad — aJ — h,
BC — B; =: F", B D — =: G', C D — Q ~ H",
B^}
— A^A^-=:Ï, AB.;-AiA,;=^K, AQ^-A^A^^-L,
BQ — B,B^— M, FG — I^— N, Fil — K^r=P,
G — L^ = a, F'G^ — M^ - R,
AB,
II
FGH-4-2IKL — FL= — GK^ — IIl^
— F (G — L^) (K L — HI) H- K (IL — GK) — %
N, P, a, R, %
G^
quantités F, G,
toutes
II
-f
I
II,
les
soient positives.
ces
toutes
F^,
II',
Si les valeurs de v^ x, /, z, satisfont à
conditions ,
la
fonction
lorsque A, B, C, D, sont positives,
elles
i*
sera
un
minimum,
un maximum, quand
sont négatives.
On
vu que toute
la
question
dépend en-
tièrement des quantités X% /m.*, v%
(§.
9.)
qui
doivent être
5.
14.
positives
:
a
on peut donc regarder le problème
solu par trois équations
cines X,
Si
jui,
y;
comme ré-
du second degré, qui ont
ce qui condtîit
une seule de ces racines
les
ra-
à la métliode de Lagrange..
est
imaginaire ^ ce qui donne
«as
on
à Ifmrs qnarrés X*,
ji.oblèine
impossible,
est
ou v% une valenr négative,
fj.%
et
1j
m miiiima, dans l'hypotlièsc de v
pas maximci
fonction n'a
a , x z^ b, etc.
.-zz
le
Mais
on voit en nicme tcms qcie les quantités X% [j:% y', petivent
niilks ,
être
impossibles.
wavimn ou mïnima deviennent
sans que
les
On
dans un pareil cas
auiait
a.
f3
9.)
(J.
m — ^ [{a^ -f- h^ 4- c' -^ y cK)-j — A
w ^z A [n~ ~\- p^) etc.
.
n% ou
,
m resterait toujours positif ou négatif, selon le signe
donc
Les
de A.
conditions
sent donc à ce qu'aucune
ne
soit
des quantités
cependant observer que,
quantités X^ /x^ v^, disparaissent,
valeurs
qu'il
(A) et (B) de
conséquent
(§•
5)t3
m (J. 9.)
9-)
etc.
(J.
l3.),.
conditions'.
X^
=o
rfo^iTcra
,
h\
dans le cas ou les
comparaison des deux
donne
plus d'équations
(3,
etc.
ce qui amènera de
Supposant
par
e.x.
n'y a d'indéterminées,
Douvelles
A
F_,
rédui-
se
négative»
faut
II
mavima ou minima
f\cs
la
a,
F rr o
et
j)ar
comparaison des deux valems de
ces équations
:
= ^, 6)y=z"'^, 7)ap-^^ 8)ay .:_4t9)f3 V + F-=.,-^..
Ayant déterminé
des équations
les
six
quantités a, j3^ y, jjl% ^1^ v^ à l'aide
4) 5) 6) 2) 9) 3), savoir
2!^6
^
«
il
— -A'P — A' V— A' ^ — G
*6
*e
/j
'*<
-,
L
,.j
encore satisf.ure aux équations
faut
donne
mière
m
avec
F
_d __
^Aj^
^^
^^^
t" nz T^
deux
Les
o.
AB ^r A/,
ou
^ rrr -^
_
b
-g^ __
h
OH— L»
A-^G-'
7) 8).
La pre-
ce qui est
identique
i)
donnent
autres
^^ ^^
2
^=U' ^ ==
A='
^
^^
^.^^
-^^
.^
m */
et
^^.^ d'dboid
et puis, substituant A,, =:i/AB,
,
B.=zA,Y^
B,-A,/^
et
ce qui donne
= o,
K = A,^(/ AB - A/,) =0.
et K s'évanouisIl faut donc que, lorsque F est nul,
IrnA, (i/AB-A^)
et
I
même tems: alors les formules du §. 9. deviennent
sent en
a=^Vl
2
V-
^^
(3
_ O
=
V=:'/, V
';,
A*
O
_
G
ç,
*-'
^
A2
^^
'
"^
= 0, 5^g, ^
s
FI-
1.
iO
G»
g,
G/
A- G'
A2
équations absolument conformées à celles que nous avons
A
*^
trouvées
ici,
pas
trent
conditions
FV"^
vu que
dans
I
FG
ce
les
quantités indéterminées
calcul.
zn o et K
m
A^tA'*^
/
Si
on ne
J.
9;
Lorsqu'un des coefficiens différentiels A, B, C, D,
i5.
par ex. A,
viendront
n'en-
pas aux
o, les quantités 5, e, fx.^, y% devien-
draient infinies dans les formules du
§.
J, e,
satisfiu'sait
s'évanouit,
né^^alives ,
Dans le premier
cas,
à
toutes les quantités F, G, etc.
moins qu'elles ne soient
de-
nulles.
la fonction n'est pas susceptible
de
pmxima
ni
de minima^;
aux troisièmes
dtins
le
second ,
faut recourir
il
dilTcrenticlles.
Comme il ;iriive trcs-riirement qu'un problème analy»
présente des
tique
fonctions de quatre
inutile d'appliquer cette
variables,
il
serait
méthode à des fonctions d'un plus
grand nombre de variables.
Lorsque
variables ,
la
i',
fonction proposée u ne renferme que trois
x, y,
toutes
les
quantités qui se rapportent
à z ou d, disparaissent dans les formules précédentes
a donc
(§.
:
o r:: D rr .A^rz B^ rr C^, d'où
il
suit
que
les
quan-
H, G', H', K, L, M, P, Q, R^ S(, disparaissent tout
tités
on
i3.)
a.
Les conditions des maxima et minima se réduisent
fait.
donc à
celles-ci:
les différentielles
du même signe,
affectées
et les
A, B, C, doivent être
quantités
F, G, F'', N",
positives.
Si la fonction
u ne renferme que deux variables v^ x,
quantités précédentes disparaissent,
excepté F;
toutes
les
on
donc que ces deux conditions a remplir:
n'a
les coëf-
^^2>Yx'y <^oivent être affectés du même
signe, et leur produit doit cire plus grand que le quarré
différentiels
ficicns
de
s ;r- '
Il
petit
ne
sera
pas
inutile
nombre d'exemples.
d'appliquer ces règles k uçi
288
i6. La
§.
u
on
fonction
proposée étant
— + x' H- 6 Vf -\-2xz-\- 3y^ -h 2
v^
2.-
-f- 4 z ;
cos quatre équations
a
(a)
ll-3v--^6y=:o, H- 3x- -^ 2z=: o,
lesquelles donnent
,- rz: Aj 1— O,
:r
dyâi
ti
—W
s
,-
—
ij)^
in O,
:,
-,-
zr rîj
2 ,
''-»
étant les valeurs substituées au lieu de v et x, en
et b
vertu des équations
U s'en suit
(n).
F=z36ab, G — 36 (a— 1), Ilrir 24 a, F' rz: 366,
i£fl, L zir o,
G'— 4(6 6— 1), Wz=z24; Izzo,
M.— o; N = 36 x36.fi 6 (a— 1)^ P = 1440^(66 — 1),
K—
•Q.— 6x 144.0 (a
— 1), R— 1446 (66 — 1);
§lz=GP — 36x 144. a^ (a— 1) (6 6— 1).
de
G et G^
suffisent
peut
supposer
que des valeurs positives pour
Les
valeurs
qu'on
ne
î;
et X ,
l'unitô
et
:
que
alors ^
z;
il
et 6 x
est
doivent
clair
que
déterminent les maxinia ou minima
Les équations
(fi)
pour
nou,9
rtie
plus
toutes
le s
(J.
apprendre
grands
que
quantités qui
i3.} sont positives.
donnvHt ces résultais:
,
c89
—
du
^
dv
dont
— 6v
^u
^" zn 3v'
ây
et r rr -*- 2,
première ne peut donner maxima ni minimaf com-
la
me nous venons
y—.
donc v =: o
z=z o,
— zn —
—
V
=/"
de
c.
On
voir.
a
v zzz -^ 2 ,
donc
et
y a de plus
Il
— X — 4 z= O,
^" r:i 6 X^
2
ce qui donne
faut prendre
dont
il
eue
positif.
la
positive ,
racine
parceque x doit
Nous avons donc
Zzn
x:zi:-f-l, et
— |x*=: —
|.
Les valeurs
i;
— -h 2
X
,
donnent donc pour
étant
= H-
la
1
,
j =: — 2 ^ z = — I ,
un minimum, A^B^CjDj
fonction m
Le yninimum de u
positifs.
=:— 7i.
u'
est
donc
X-zzi^h, y "=- — ^-\-\,
En
eiïèt,
zz=i
— \-^-l, on trouve, en négligeant les troisièmes puis,-
faisant
'sances de g, h,
i;
k,
rz 2 -f- §>
l
uc=î/-4-6g*4- 3h^ -^6gk-^lhl-\~ 3^^-4-2/*
— u'-i-6{g-\-}_ky-Jr-2{h-^\lY-\-lk*-h\l'' — u'-^m,
où m, ëtant
sitif ,
et
donne à
la
somme de quatre qiiarrés, est toujours po*
par conséquent
g,
h,
k,
Mtmoirts dcrAcàd.
u> uf
,
quelques valeurs qu'on
L
T. VL
^ "3
.
290
Ton
Si
une des antres racines,
choisi
eut
f iz: o^ à laquelle répond
y
z=. o,
et ensuite, faisant vzzig, xz=z\-\-h, y=:zk,
-
par ex.
on eût trouvé u^'zi:-- 3^^
z:z u' -h 2 h' -\~ (h -4- /)' H- 3 k^- -f- l'
x;::!
—
'4-/..
-^ôgLzn u' -4- m,
m peut devenir positif ou négatif, à cause du dernier
où
Prenant par ex. g=:2/i, A
terme 6gk.
m z:z — g h^
on aura
§.
donc
n'y a
il
=iC zz. o
et
^^^,
j^
m
Crzo,
tité
négative
fonction
§.
u
ce
:
n'est
G
et
qui
pas
zz:
—
h,
A^.
+ y -^r/itJ.jz.
;
=r ^i <* i par conséquent,
quelques *A'aleurs qu'on donne à v, x, /, z,
A' zz: a^,
Izzz
donc ni maximum ni minimum.
Soit u z=. f'H-x'^^^a.zrj^-^^jS.îJZ.
17.
^^—"
:
m — 2 A,
il
est toujours
AC — A* rz — a^,
une quan-
suffit
pour nous apprendre que la
susceptible
de maxima ou minima.
18. Soit proposée la fonction transcendante
u :zr sin (i^ 4- X H- j 4- z) 4- a cos (f 4- X -t-/) -h p log i» — Y X* — 5 y
.
Faisant, pour abréger, v-\- x-{-y-^ zzzzp ,
sin/jmCj), cos^rzvp,
1^ zn cosp
t"
m cos n rz o
:
— 5:r:o,
—
= cosp — asin g o,
on a ^"rrcosp
— asinq — 2'yx nr o,
^"
v-^x-^-yzrzq,
ctsin(/-|~|
zr.
donc
cosjozzo, sin^zzio, xzzo, et rzz:^ , ouCPzzrt: 1* ^^=^±1-
Les secondes différentielles donnent, en faisant cP-t-avjyzi:^,
,
H^
m CD —
.
C!j =: aC^vj^; ce qui suffit pour faire voir qu'il faut
prendre des valeurs positives pour Cf) et \|/, savoir Cj) r: vp — -+- 1
En effet,
positif,
d'où
doivent
être
G nous apprend que ^ doit être
l'est aussi, parceque C et D
suit que
de
valeur
la
il
affectés
du même signe
également être positif, à
leurs
cause
de
(
—
H'' z:r a
donnent , en faisant
:zz 4/ zzz -f- 1
donc
) ;
v|/.
Les va-
+ a zz
l
doit
v{/
e,
et
^:r>,, A3=-(Ê-f->i), B=-(£+oy), C--e, D=:-i, A^-A -B,--e,
^d^^d~f^d — — ^> F = é(^-*-2y)-+-2v]y, G —
F^ == 2 y e^ G^
= a H- 2 y, H^
M =: 2 y N =z 2 y
;
R iz: 2ay (2y -f- f)
Ainsi ,
toutes
les
U=za~^-y),
-V),
L :zz >j,
P rz: (a -f- 2 y)>)=
2aye, Q.
a (e -f- >]) ,
e>)(e H- -vi),
(ae-f- 2 (l -+- 2a)y)'V]
-f-
e>i,
K zz
z:z a^ 1 1=; e v),
;
51
+
~ 2 ay7](£
—
"vj
-f- >j)*.
quantités F, G, etc. étant positives, et
A, B, C, D, négatives,
s'en
il
suit
que
les
valeurs
supérieures
i;
zz j , xzz:o, sinpzz
+
i, cos </ zz: -f- i
rendront u un maximum. Ces valeurs donnent
7
la
lettre
= 1+/» P — f-^r-^^-'
r désignant l'angle droit,
/9zz4«rH-2;,
n
et
n''
étant
des
sin /» =: sin z rz;
nombres
cîo"c
A nw - ^
_
/zz4?ir
d'où l'on
1 ,
entiers
et
2;
tire
zz (4;i^ -|~ i)r ;
quelconques.
37*
Nous
«93
avons tk>nc les valeuri
V
— l, X=:0. y — 4nr~l, =
qui dQnneot le maximuyn de la fonction
effet,
savoii
u,
i,-f-aH-|3/logf3— ,log5— l).
u^çiz
Çtî
(4/1^-4- i)r,
7.
.
supposant
^
(;
et
— l+g, x=ih, y—4nr~l-\'h, z — {4n-\~i)r-^l,
négligeant
seconde
,
les
puissances de g, /i. A, î, snpériemes à la
on trouve u riz:
sin [(4 «-4-4 1/~^ 1 ) y-h^'+- h-+ k-+l]-^-a cos (4 n r -^ g^- /i -h A)
^-|3(loê((3-4-5g)
— log5- i)^Sg-yh'
zr cos (g -I- /i -}- A -f- /) -(- acos (g -t- /i H- A)
^P(lo^P-f logfi-l-Jg)
— log^-i) — 5g-Y/l'
^a^_(l±^±lP__«_(g4_,,^A)^_^/,a
ou bien,
faisant
pour abréger,
^H-/n-A-4-/r3a, g-t-/i-^Ar=:6, uzzu''— ïa^
d'où
il
suit
g, hy A, /,
donc, que
que i/>u,
quelques valeurs qu'on donne à
pourvu qu'elles soient
a''est
— "6* — v/i« — ^^";
très-petites.
On
voit
un maximum, mais qu'elle ne l'est plus, si
cos (i; -)- X -h j) zz
—
1
,
ou ce qui revient au
même
,
si
a est négatif.
Faisant par ex. cos (r.-f:- x -4- /) rz
yzzz 2, 5 zz: 6,
la fonction
u devient
—
1 ,
et a zz: 1 ,
^ ziz 4,
293
~ i-f- 4 log — 4 = -- 4(1 4- log
— '—
—
n* —
zon
Pfcnanl
rr
/m: —
—
—
—
rr
zz
donc
u^ zz j
et
u
2 /i^
n' -f-
3 g,
A -:r: g ^,
^,
/i
tloh.ç
f
I
i/
f/
fy" -}-
^- (8
2
,?,
^;
I),
? ^-.
a
n
11^
-f- g-
g,
b r:: 4 g.
:
1/
n'est
pas un umxiimnn.
§.
Prenons pour dernier exemple
19.
u - X' M- J'
-f-
fonction
la
W + 3/^ 4_ 5xj- — X — ^1/,
^'
même dans les fonctions de deux
règle indiquée par Ruhr ne suffit pas pour
qui nous fera voir que,
variables ,
la
décider des maxinia et minima.
|;;zz3x«
Elle fournit les équations
+ f XH-5/-i = o; |;-3rH-6/-f-5x-i|-o.
La première donne
y-
zz
3 x^ -I- fg^ X
—
1
d'où
,
il
suit
5
9X^
r—
+ ^^x'-H^i^|x=-^x-hi
~-
>
25
ce qui étant substitué dans la seconde, donne
(J'oîi
il
suit
deux
fois
xzzo, yiz:-{-î,
Ozzo7x^^_-/x-f(71^?
d'où l'on
et
ensuite
— 90), ou ozzx--i-^^^x — 1';^;
tire
^ -_
— 'aî±>^('' r-t-?'03i
log
)
'
"~"
— î^±i'6
108
^2Î ^_ o
"•
103
^
,
294
Nous avons donc
donne
/m —
maxima
les
suivans
^
{^^
seconde
J^,
la
et
minima
—
yz^ —
f^^.
fonction
u,
x rz:
et
^^J.
de
la
La première
•
y a donc, pour
Il
les trois cas
:
r = + |; 2)r = + /^, y^-^ll;
j)xirzo,
•^J
= H-
ar
—
—
/
lOS *
•
90
Les secondes dilTérentielIcs donnent
Il
vient donc, pour le premier cas, où
Ar=^f, B —
'/,
ce qui prouve que,
mum.
l'on
voit
A =: -I-
que
9.
§.
Le second
même
premier cas,
le
cas,
xzz.h,
faisant
et
F
la
a
un minimum
011
x z= -4- -^^^
p
—
quoique
A
^
17
,
fonction n'est ni
une
valeur
*
^" trouve
o
t;
—
soient
,
donne
1 5 ^?i
afTeclés
:
du
maximum ni minimum,
nég.itive.
valeur de u dans cette hypothèse,
y :zz.^ 90 "^" ^
B
les
F zm o.
y ziz — ^
17 -307
et
que dans
et
^
s'évanouit, parceque
g -—
'-Q7
signe ,
i/ est
A^
r on voit que ,
parceque
u est un mini-
on trouvera
formules du
d' où
dans
Nommant u^ cette valeur de u,
y zzz^ ~\-K ,
d'où
x rr: o, / =r -f- |
FzziAB — A;=:25 — 25:=o;
Nommant
et faisant
1/
la
x zn -^^^ ~\~ K
295
ce qui peut être plus ou moins
diilorentcs
Dans
viileurs
de h et
1/
donc ,
u'^
on trouve ,
,
est
:
-t-
^
/i^
H- 3 ^^ -f 5 /a
évidemment un maxfmujn.
»'0t>
le:,
donc a un maximum.
comme ci - dessus ,
~ — ^/i^ — f^A^
î/
selon
où xir: — 1^|, yz=z—^^^,on a
A zr— y, Bnz — -^^ F zz:-4^ 2 J 5 ||i
En elTèt
i/,
k.
troisième cas,
le
grand que
OCVOwOCOOOO^
296
DETERMINATIO LATITUDIXIS GEOGRAPIIICAE
OBSERVATORII CASANENSIS,
A U C T O R E
L l T T R O TV.
Convcntui exhibait die 8 Nov.
Observationes seqiientes
quem vocant
multiplicatorio
Instrument uni
hoc
a
cel.
me
a
institutae
diametro
Baumann
i8i5.
circulo.
siint
sedccim digitorum.
ad
Stuttgaidiensi
iin-
giiem usque elaboratnm, columna verlicali fixa instructum
est et iino tantiim
tubo anteiiori gaudet.
Ciim aiitem novuni nostrum observatorium nondiim ex
omni parte finilum
dis
esset ,
observationes pluribiis incommo-
laborabant, quae fere omnes a loci,
tandus
estj
importunitate nascuntiir.
ut observationes
una
fere
cuin
Sic
e.
nisi
mutando
circuli
niajori
nnis
est ,
foie
spero.
factiim
solis
incommotlo
observationurn
ab his similibiisque
poli alLitiidincm ope
me
nie-
Fustellae
numéro mihi exploraie
difficultalibns
est,
incipc-
locnm, nulle modo potni.
turo autem anno, quo oandem
polaris
g.
ciilminatione
rent , obstante fenestrarum jugamcnio, cui
deri,
adop-
ciii circuliis
ani-
liberalum
,
297
T.
Piinsqnam
observationes
méthodes
licrat mihi
"TT
distantia
in
qiiae
aliqiuis ,
easdem cdlciiLindi bieviter
Sit
ipsas
médium
proferam,
mihi novae videnlur,
altin^^ere.
observjtae
stellae
polo
a
boreali
ae-
qnatoiis;
% ejiisdcm" distanlia a polo horizontis, qiiae pro
momcnto
ciilminationis abcat
qnacoiis,
s
in
angulus horarius
et
Z;
sitque
\|/
x
mz—
Z.
altiuido ae-
His
positis
habetur, ut cuivis satis superque constat
cos (Z -j- x)
quae aequatio
ma li
et
m cosTT
vaiiis
cos\|^ -f- sïn 7T sin vj^i cos J,
modis
in séries
convergentes transfor-
potest.
Sit
brevitatis causa
=
-;^^^„,
P
ômsin-^,
ita
quod pro
qfnzcotgZ
,
a=i(/sini'^
Ponamus primo , valorem
esse ,
pzz— J^
quantitatis
x
satis
x sin \f\
ut liceat quantitati sin x substituere
série
non
ita
exignum
id
magna observationum prope meri-
diani planum institutarum
fere
nunquam non
licebit.
Hoc
ergo casu invenies ope aequationis praecedentis
—
-'- p*a'ô«+
-^-^ p^ q» ^'°4- etc.
X :=i p^^ - p^ao*-+- 1.2 p^a^e*'^1.2.3
ï-ï-i^
-
cujus sériel lex pcrspicua
Quodsi autem loco
est.
ipsius
x potestatem quamcunque
ejusdem quantitatis desideres, habebis
Mémoires de l'Acad. T.
H.
^^
29B
nÇn
1-
ubi ,
si
ponatiir
Eundem valorem
+
;)
,
piodibit
4^"
.2
1
n =z
.
i
pi -)- 3 Q3 g» Çb -t- 3)
•" ^^^^
1
j
x
quaniitatis
séries
etiarn
ope
primo inventa.
fractionis
con-
tinuae exprimere licet hoc modo:
X zzz
vel eliam ,
si
logarithmi placent i
logxrzlog(Pl?^)-PQ^^-^^(Pa)^â^-^J(Pa)'^''-^~J7](Pa)^0«-etc.
quarum omnium serieriim. lex progressionis nuUa explicamultas similes
Alias, autem.
tione indiget.
gotio inde deducere
licet,.
qiiibus hic,
eo magis ,
SLipersedendnm esse existimavi ,
nullo feie ne-
brevitati consulens,
cum non nisi
SLipponcndo sinac :=: xsin i'''' valeant et seqiientes aequationeSj
hoc incommodo,
si
rêvera
praecedentibus anteferendae
incommodum est, liberatae
sint^
Ponatar azzzpsin'^ et b izi a
irtùmero
quocunque;
(tang ^y
Accepto
— q et habebis pro n
=
in
cl'
hac
-^ n
a^ -^
série
'{a
- q)
» zz: l,
-i-
erit
"^-^ a''-' (a^ qf
D9P
tangf
Otiodsi
—
pO'-
—
p^ q$*-^(i-^l^ q^) p^ $*
eodem modo ponatur nr^3,
casusqne hi
5, 7 etc.
singuli evolvantur substituanturque in aequatione notissima
T
— ^^ngT— ft^ng'-J + itang^l — jtang' J-H
etc.
habebitui"
^:=:pù'
-+-
(f
quae
—
p'qô*-\-(^^
-f- 1 2(jf^
+ 47*)
1
-f-
;;^i)'°
ùq')p^^-^(3
—
( i
+ 5q^)p*qô«
o -+- -^-9^+429*) p
V+
etc.
a cel. Mollweide data.
est séries
Eodem modo valor quanûtatrs sin — ope expressionis
praecedentis pro (tg t)'' derivari poterit, cum sit
Pro cos * habebitur pari ratione
c5s 2
— — DO - 4- -^
te*i.2.;-^.Os
î
1
tz^ a
'
"-^-^ tg«- -4- etc.
1.2.3.23
O2
'
Porro simili calculo invenitur
1— tg^-
^=1— 2tg^-4-2tg^-— Ctg<'--|-2tg®- — etc.
COSXZIZ
iH-tg^-fX
sinx
=
2 tg —
^= tg - tg'^
2
'
2
-H 2 tgï|
- 2 tg7^ H- etc.
X
tangxr:—^-î-:iz: tg f -^ tg' -^ +
tg^ |
^ tg^ f ^- etc.
38*
3oo
quibus evokitionibus, utpotc
hic imiiioiandi non
facilliinis^
est locLis.
Si
autem ,
ut
lognrithmos
supra ,
adhibere
placet,
habebis
(
4
'^,-3
i
]
l
)
5
2.3
3.^-4
"
5
ubi lex progressionis patet.
Vel dcnique
,
fiactiones continuas adhibendo ,
1
Quarum omnium serierum
quovis in casu ,
rere potest ,
riel
ùm
censeo.
,
-i-etc.
termini
duo vel
très primi
qui leveia in Astronomia practica occur-
SLifliciunt.
Demonstrationes autem liarum sé-
longiores qiiam difficiliores ,
Coronidis
loco
adjiciam
hic noi;ligendas esse
demonstrationes
aliarum
,
301
formulaium
satis
concinnarum
quas antc annum et quod
,
exciurit alla via invcnlas publici juiis feci.
Ex acquationc cosz = costt cosv|/
cili
+
sinTr sin\l/ coss
tiansfoiinatione dcrivabitiir séries sequens
log cos Y znlog cos ^- cos^H-/3cos ^— ^p2j,Qs gj-t-î/^^cosajubi
tempore
stellae a zénith
cum sit
minationis, qiio casLi séries praecedenS:,
hanc
ciil-
zr o,
in
+ P^ — iP*-^
^tc.
.y
abit :
log cos ^ c^ log cos ^ cos ^ -(- /9
qiiavum proinde dilTcrentia
—
i
P"
1
erit
log cos ^ =n log cDs ^ ^- 2 {p sin* -^ — ïp'^ sin^ ^H- 1 p' sin
Pio observatione seciinda
/
vel z"^', /^ etc.
ultimam,
id
— etc.
pm tangjtang^.
Jam denotct ^ distantiam
z'',
fa-
si
s sit
qaod' fere
hnnc
in
tertia
etc.
erit
Facile autem apparet
scmper,
et
_,
parvus et p fractio
angcilus
usuni kxt'
,
^— etc.)
% et s vel
aeqiiationem
satis exigtia_,
praecipue pro Stella polari, quae
£^op^v]v
adhiberi solet, locura habet, in
sequentem abituram ;
log cos ^- zz log cos Y -f- 2 sin=^4 (p
— 2p' -i-Sp^ — 4p*
Est autem
p - 2p= -4- 3p' -etc.:zr -^-^
- sinTT -;^^
sinv|/
4 cos"^
-f- etc.).
r
~
.
302
iindc scquitur fore
sin7rsin\|>
^
,
h 2 sin* —
lo2 cos -- zz. \q>sl cos
-r
A summa omnium numeromm ex tabula notissima
Sit
Dclamhcnana (Connaiss. des tems
l'an XII.),
per
Cum numeri hujus
numerum n obseivationum singularum.
tabulae contineant valores quantitalis
divisa
/2 sin- y\
]
erit
,
pro
V sin i^'' /
omnibus observationibus simul sumtis, adhibendo logarithmios
communes ,
log Fcos- cos- cos*-
,
.
.
sin TT sin \1/
.1
KA/xsmi
logcos-^—
n
Jani sit
positis facili negotio
diiTerentialia
quod saepissime
sita
z'''^
-f- .
.
.
et
z'^
=: -^ Z, quibus
.
demonstratur fore
cos—2 cos—
cos—2
2
siquidem
--^^^
4cos'^—
+
Z =r z -4- z"^
.-
licebit.
.
.
.
Va'
:zz Ccos—
ordinum negligantur ,
altiorum
Ilinc ergo aequatio nostra quae-
crit :
1
logcos|
id
_
— logcos^ 4- A
sin TT sin v|/
p.
sin i''.
_
4 cos^
Eadcm denique mcLliodo invenies
.
3o3
.
,o
log sin { =2 log sin ^
—A
sin-n sinvjy
y.
sin i
.
.
4sin-
-v et
^_^--
—
Iogtang^:zilogtang--~Ap.smi .—--,-^^^4^
ubi log fjL sin i'''' n: 4.3233592.
Cognilo autem ope harum formulariim valore quantitatis ^,
cognoscitiir etiam verus valor quantitaris
latitLidinis
quaesitae
vel
v|^
loci observationum.
rr:
Observationes
aliis
elenientis
ab
meas
adornavi ,
ita
integio
calculandi
ut
ciiivis
potestas
easdem"
stiperesset.
Ego autem, quoad declinationes, tabulis novis solaribus cel.
de Zach , respectu ad Lititudinem
quoad refiactionem. tabulis
sum.
Literae" demum
a
cel.
solis
Bcssel
haud neglecto,
nuper
éditis
et
usns
a et 6 notant divisionem libellae co-
lumnae verticali- aflixae
in utraque
parte ejusdem, a prope-
observatorem 5, et b prope stellam observatam,
304
3o5
«
O
1
3
3o6
ITis
».
observationibus
in Sole
factis
ncrodii:
ob<?ervatio
Aqiiilae, cujus positio ex catalogo ccl. riazil desumia»
Eiat autem haec obscrvalio sequcns:
3o7
F
= „^-',-
dit rediiclio
qTii
Cp :zz
AF
/==P.co.s(4)_à)
— a/,
valor qnantitatis 0, ob
simdam tcmpus
dcnicjne
ô
sidciiile
motum
hoiologii,
incedebat ,
conecLiis
quod fere
sit
tempus horologii pio momento meridiei
T, B status Tlicimometri Rëaiim.
exprcssus.
,
39*:
Sit
(J)^.
veri
et Baiometri dig.
Quo facto habtbitur tabula sequens.
se-
et
ang.
3oS
Sixioo oicoi-.fSl»
]^0
co
4>-
o
c:, CO,
1
I
I
I
I
I
•-
-
Ctx
o
I
I
I
o»
0\
o»
0\
ta
c*
I
,
w
CoO Kj O
(O
05
!
'
05
Oi
4»
I
0>\ 05
Oii
-
»
ko
00
o
1
o
ce
OO
CRi
!
tO
CO
Oi
•<)
o>
co
<o
•<!
w
j
I
^
02
CO
+
<i
i
I
»
co
OJ
o
4^
Oï
'
4>^
I
co
05
oc
I
'
I
I
>I
>
3o9
Tcmpore postrcmae
accolera bat
2""
o''
obseivationis
(Atair)
hoiologiiiin
lO^'', 8.
Cum valor iinius divisionis
bitur correctio coluiiinae
libcllae
veiticalis
sit
5'''',
pio qiiavis
72
habe-
observatio-
mim série
LJ.1 [(a-^a'+ a^^+ ..
.)
quae correctio voccliir
nis
et
refractionis
veram per r
et
per
- (6+ L Vb^V.
dl.
unde p.odit tabula scquens.
.)]
~ ^/- ^ (a-6),
Variatiouem autem declinatio-
d S et ô r ,
parallaxin
.
ipsamque refractionein
altitudinis
per p indicabiraus,
3to
Jnlli
I
6 ^o"
JÔHiio
9
aS
Jîili!
j
— i5 0.75 — 2ù 27.9
—
>
T»
"
55 83
8"
o.'diD
ÔT5
14^04
•_7.5
9 58 :^U7 52 ^QQl^Q5\\i,-2j b'
33 18 .0^ 33 ,5"\^ 6a 3d 35 .8 ï
î>,'7
"~
36"ti2
3642
^9 9'J
— 5 01
— 7a
4
33
î?8
4"'"
lo
-^
Au •ii>ti
lo
,
4-'i,''i
dr
5c)Ç)
Augi'sti
»
17 5o
i
|
i
5 5o".95'4 8"rS''^5".5-) 65b''5't
'
C^
?3 3
3y
'
9
1
1
3(5.90
'5o".o 474'Vi'i 1" 05
^ 4''-4-4|
Tol)8
—
îi3
14 90]
~o8ÔI
8
,
3it
CALCUL DES OBSERVATIONS DE LA CO.MÈTE
DE
1
5
I
FAITES À L'OBSERVATOIRE DE ST. PETERSBOURG,
PAR
F.
Présenté à
Cette
SCIIUBER T,
T.
la
Conférence
où
chaque
nuit
jusqu'au
5
possible
d'à ppcrce voir
May
ciel
le
i8i5»
M. l'Académicien PVlsnefskij
permis,
l'a
nouveau Style ,
,
cet astre ,
depuis le 3o Mars
derniers jour
où
il
fut
à cause des crépuscules
dans notre climat, durent toute la nuit dès le 23 Avril
St.
Après
sa
trouva
trop
peu élevée
n.
2 2 Nov.
comète, digne de Li plus grande attention des
astronomes, a été observée par
qui,
le
conjonction avec le Soleil ,
piur
être
visible.
mète
était
si
faible,
sur
l'
horison
En général,
qu'il
m'était
la
de
St.
la
comète se
Péteisbourg,
lumière de cette co-
impossible de l'observer
avec précision, de sorte que M. de ïï'isiwfiki , doué d'une
vue extrêmement bonne,
ces observations.
gé de
les
fut oblige
de se charger seul de
En revanche je me suis volontiers chai-
calculer.
3l2
Les observations ont été faites avec deux micromètres
annulaires,
dont les diamètres sont de
52'' 58'''', 5.
Le nombre des observations faites dans chaque
nuit
ou
je
de
est
à quinze ,
trois
moins favorable.
les
ai
28^^47^'',
78 et de
selon que le ciel était plus
calcule toutes ces observations,
J'ai
soumises à une critique rigoureuse, qui m'a
fait
voir qu'il n'y en a que trois ou quatre qu'il faut rejeter;
compte du degré de précision que chaque
tenant
enfin ,
observation
droite
ou de
j'en
pris
ai
espérer pour la détermination de l'ascension
fait
déclinaison, selon la grandeur de la corde,
la
un milieu.
ployé la précession ,
résultat
de
la
une
si
les
Le calcul,
dans lequel
aberration et nutalion
ascensions
comète.
Au
grande
hauteur,
droites
reste ,
qu'il
apparentes
observée
toujours
fut
aurait
inutile
été
em-
donne pour
,
déclinaisons
et
elle
j'ai
à
d'avoir
égard à la refraction.
Je
les
avec lesquelles
la
comète
a
été
comparer.
que
je
désignerai
par
les
des
étoiles,
11
y en a en
A,B, etc. K:
culées
six
les
d'après
grand
dix
tout
le
quatre dernières,
le
apparentes
commencerai par calculer
premières,
deinior
lettres
A jtisqu'à V, ont été cal-
catalogue
lesquelles ne
catalogue de M.
positions
IJoile.
s'y
de
M.
Piazzl ;
trouvent pas,
J'ai
calculé
la
les
d'après
piécession
3l3
arinuelle
d'après
l'aberration
mé triques.
et
la
les
formules
niUation
données
d'après
les
par
M.
formules
Bessel,
trigono-
3i4
Prcccssion
de l'observation
en dccUn.
64^3111 -f- 9^4782 -M6''.2o'''',744'-f-2''.24^645
lOj 4600 H-i6. 23^ 009-1-2.39, 660
64, 4597
ôg,
9256 4-
BU 75, 9914
E
en^
de'clin.
JÇ^
A
Frécession jusqu'à l'époque
annuelle en
j-+-
79,
4596 —
79,. 9524
9407 H-i7.47>4i4-f-i.3o, 809
2, 9560 4-19. 21, 905 -4-0.45, 284
o, 1716 4-20. 16, 527 — o. 2, 632
5,
— 2, 4888 H-20. 24, 871,-0.38, 190
i
g!- 66, 3853 4- 7, 2484+16.52, 374'-+-!. 5o, 679
hU 67, 700o| -h
7,
8044' + ! 7. 12, 762'h-i.59, 212
lU 67, 423i| -h 8, 5020|-M7. 8, 878'-+-2. 9, oi5
kU 76, 4850 + 2, 3105+19. 30, 217+0. 35, 407
I
I
3ï5
dûclin.
A
-18 ',47
^ 4".36
B
-20,
C
20,' 12
D
E
F
G
Leur somme
Nutation en
Aberatioti en
J^
36 -h. 3,-95
A\
-2
decliiu
2^2 3 -r.54
-22, 19
fn
yR
I
en decl.
-40^70-0^18
-4. 85
-42,
55;— O, 90
--h
6,
34
-24,
43 -3, 3o
-44»
55 H-3, 04
-24,
60 -^
7,
57
26,,
81
18
-5i,
41 -^5, 39
-25,
72
8,
99
-28,
36 -1, 02
-54,
08 -^7, 97
84 -1-10. i3
-18, 60 H- 5^ 22
-2 8,
74 -o, 17
-52, 58 4-9,
-23,
o5 -4> o3
-41,
65 -»-i, 19
96
-43,
40 +1, 49
,H-
-2 3,
45
-23, 5i
--2,
-3,
96
II
-i9>
89 -+
I
-2 1,
5o -+- .4, Si
-23,
37
-4^ 17
-U'
8*/
K
-24,
97 -^
-27,
07
-1»
-52,
04 -+-5, 81
5,
7,
75
94
H-O,
64
3i6
Le 30 Mars , nouveau Style , premier
comète parut dans
tion,
la
leur
jaune
lumière
la
était-
condensée
où M. de IFisnefskl crut appercevoir un
vers le centre ,
très - petit
lunette de nuit, d'une cou-
la
dont
vive ,
assés
jour d'observa-
noycau, accompagné d'une queue à peine per-
ceptible: le diamètre de la Photosphère fut d'environ une
Aucune
et demie.
minute
dans le voisinage de
avec une étoile de
fois
de
la
la
direction
pu vérifier la
et
de
connue ne
étoile
comète ,
elle
la
grandeur,
8.
7.
de
vitesse
la
fut
sa
trouvant
se
comparée onze
pour
s'assurer
marche.
N'ayant
position de cette étoile, je n'ai pas calculé
ces observations.
Le 4 Avril
faire
vent
le
était
si
violent,
qu'on ne put
qu'une seule observation, peu sure à cause du vent.
La comète
I-e
fut
comparée avec d Persée
5 Avril le
3 minutes,
la
diamètre
longueur de
on put l'appercevoir à
de
la
la
Photosphère
parut de
queue de i5 minutes,
vue simple.
la
(A).
et
Elle fut comparée
quatre fois avec c Persée (B).
Le
7
Avril elle
fut
comparée quatre
fois
avec 2 33
Persée (G).
Le 9 Avril sa lumière parut déjà un peu plus
Elle fut comparée six
fois
avec
2 35
Persée (H).
faible.
3i7
Le
le
blie,
la
1 1
Avril sa lamièie se trouva
diamètre de sa Photosphère d'environ 2
longueur de
parée
trois
fois
la
clair
queue de i5 minutes.
alTai-
minutes,
Elle fut com-
avec 226 Persée (I).
Le i3 Avril
du
sensiblement
de lune ;
elle
parut
encore
plus faible
à cause
_,
son diamètre était de moins de 2
mi-
nutes, et on eut de la peine à appercevoir la queue, lon-
gue d'environ 5 minutes.
fois
La comète
fut
comparée cinq
avec 9 Cocher (C).
Le
2 5 Avril elle
Camcléopard
fut
comparée quinze
fut
comparée dix
fois
avec 24
(D).
Le 27 Avril elle
fois
avec
k
Ca-
méléopard (K).
Le 2 May elle fut comparée onze fois avec 2 Lynx (E),
Le 4 May elle fut comparée
six fois avec 12 Lynx (F).
Le 5 May, dernier jour d'observation,
comparée sept
La
fois
avec la
la
comète fut
même étoile (F).
table suivante présente les résultats de toutes ces
observations.
3iî?
Jours
1
,
319
CALCUL DE L'OPPOSITION DE JUPITER
OBSERVÉE À ST. PÉTERSBOURG L'AN i8i6.
PAR.
T.
F.
Présenté
àl
la
SCHU BERT.
Confcrcnce
le
:?.8
Août 18 iS.
Les observations de cette opposition ,
de
faites
par MM.
H isnefski et Tarkhanoff, n'ont réuissi que quatre nuits,
à cause des nuages.
Passages au méridien d'après une pendule
Tcglée sur le tems sidéral
Vieux Sly^
Spica
Bord occidental
Avril
de Jupiter
1
i3".i5^23^58 1 4. 14''. 31 "',0 8 14''.40''.35^88
12
-
i3
-
14
-
2^, 73 23, 58' -
23, 90
g.
ff.
/y
13. 32, 28 -
-
36, 27
-
-
35, 80
14.
j3.
1,
2,
65
42
36,
20
320
321
322
323
324
325
Dans
Jupiter,
j'ai
demi
employé
la
moyenne de
de ces
observations au ccntie de
parallaxe horisontale du Soleil
au Soleil
ziz
5,20279=^:0,
diamètre moyen de Jupiter
ziz
19^'',! 2
distance
-
réduction
la
2i
=
<i,
rayon vecteur de la terre
-
ziz
rayon vecteur de Jupiter
-
ziz
distance de Jupiter au zénit
-
zzi
ii°Si\Y''
zzi
11° 54'' 35"^ ':^^-
de Jupiter
déclinaison
-
A l'aide de ces éle'mens
donné
-
R,
5,43499
zzz
r.
=
le calcul trigonométtique
,
à,
m'a
:
distance
la
de Jupiter à
la
terre
parallaxe horisontale de Jupiter
parallaxe de hauteur
demi-diamètre
le
1,00738
:zi
•
zzz
de Jupiter
-
zzz
p sin a
zzz
4,428 14 r=^,
-=1:1 ,974 z^p,
zzz
l^'',8
76 =:z /?'',
- d zzz 2 2^^,^6 zzz d\
zzz
même réduit au parallèle zzz -jj- zzz 2 2^\g6 zzz d'\
Il
droites,
faut
donc
et
—
d'
ajouter
// zir 20^^^,
réduire au centre ^ d'où
il
fZ''
zi: 22^'',
96
aux
ascensions
58 aux déclinaisons, pour
viendra
:
les
325
32 7
La comparaison de
ons , avec
CCL1X
que nous avons
le
résultat,
que
les
ter
trop
grande,
tables
Ji
le
conclus des observati-
ces lieux ,
tirés
donnent
Avril de
la
des tables ,
donne
longitude de Jupi-
4'''',6;
le
de 8'^, 6; le
1 2
i3 de 3'\i ; le 14 de4^'',5; et au contraire sa latitude trop
petite,
le
de
i6^\5;
—
1
ii
le
6'^,l5,
Pour
17'''',
6;
14 de i6'^,5.
pour
réduire
faut les
de
Avril
ces
les
le
12 de
Le milieu
le
i3
-|- 5^'',35
et
l6^'',4;
est
longitudes et latitudes géocentriqucs.
erreurs
aux
lieux
héliocentriqucs ,
il
multiplier par
ce qui donne les corrections à appliquer
aux tables, savoir
— \'\2>6 pour
65 pour
les longitudes,
et-f-iS^^,
titudes.
L'opposition a eu lieu le i3 Avril matin
3"48''38^' tems
5''4o'34
moyen de
Paris,
à
ou
^ — — - St. Pétersbourg.
h>~*ooooeoOoooooc*a<^
les
la-
3c28
OPPOSITION DE JUPITER ET OCCULTATIONS
OBSERVEES À LOCSERVATOIR.E DE L'ACADÉMIE
PAR
F. T.
Pr6cnté
à
L'intention de
la
SCHUBERT,
Conférence
réunir
les
le
7 Février 1816.
deux oppositions de Jupitet
empêché jusqu'à
1814
et
181 5,
sent,
de présenter
la
première à l'Académie.
celle
de
des années
l'an
i8i5
piter qu'une fois ,
n'a
pré-
Mais comme
pas réussi, n'ayant pu observer Ju-
à cause des nuages ,
différer plus longtems.
d'étoiles par
m'avait
je
ne
J'y ai joint quelques
la lune, les seules que
j'ai
l'ai
voulu
occultations
pu observer dans
ce tems - là, qui était extrêmement défavorable.
2
329
I.
Opposition de Jupiter, l'an 1814.
Observations de Jupiter , comparé avec Résidus.
Vieux Style Passages au méridien d'après une
pendule réglée sur le tems sidéral
Février
Rcgulus
Bord occidental
de Jupiter
9.58'49^20
- - 49,80
- - 50,62
- - 5 1,60
- - 51,98
10
11
12
13
14
io"-3i^.
9>7
-
3o. 40,75
-
3o. 12,57
29. 43,72
29. 14,96
Distances au zënit, observées Therm.
Barom.
I
au grand quart-de-cercle mural Réaum
Régulus
Bord boréal de :^
10 Février 47°.3^i4^'56 49°.
—
—
—
—
11
12
i3
14
Le
l'air
7''-20''^,89 -i3°,8 2 8^.
- - 12,40
4. 22,57 —16,2 J49.
- - 13,77 49- 1.27,59 -13,9 - - 17,73 '48.58.32,63 — 11,6 _ -18,21 148.55.33,73 -13,9 14, le ciel
était
astres
français
commença
l'observation
de
demain
eut plus
il
n'y
ce
jour
Mémoires de rAca^. T. VL
11, 25
11, 10
9^
30
7,
60
à se couvrir de nuages, et
déjà pendant l'observation
paraissaient sautiller
8^17
si
trouble,
que
les
dans la lunette, de sorte que
est
moyen
un peu douteuse.
d'observer.
4
Le
len-
330
Calcul de ces observations.
331
332
Tc.ms moyen des observations à
St. Pctersbourg
10 Février 12^2 2^. 5^^47
11
—
12
—
13
14 —
— 17. 39,82
— i3. 14,98
- 8.49,35
- 4- 24.37
Pour ces époques
donné
Bouvard
tés
les
tables
les lieux héliocentriques
les
2 2".3o".
7^47
— 25. 41,82
— 21. 16,98
— 16. 51,35— 12. 26,37
de M. Delamhre
m'ont
et celles
de M.
la terre,
lieux de Jupiter, les uns et les autres comp-
de réquinoxe moyen.
au Soleil,
de
Paris
Leur combinaison donne l'angle
ou ce qu'on appelle angle de commutation,
ainsi qu'on le
verra dans la table suivante.
333
334
y sa latitude gë-
A la latitude héliocentiiqiie de Jupiter,
on a R r- ^~- ,
ocentrique ,
de Jupiter, p z:z
~
p =z i^^, gg53 ;
bien
pour
yenne de Jupiter au
plus,
Soleil,
paralhixe horisontale
la
cl
Février
/?
nz 1''^, 995 ;
ou
nommant o la distance moson demi-diamètre apparent
demi - diamètre
son
distance ,
14
le
De
jd zi: 2^'',00.
à cette
et
:r= 5-— .^, et on trouve pour le 10 Février
gëocentrique
sera
d^=:^=z^;f|. Supposant donc a=: 5,202 79; cZ =z 19^''^ i 2
:
on trouve df zzi 0,2^^y 55. La parallaxe p, étant multipliée
par le sinus de la distance de Jupiter au zénit, donne celle
qui doit être appliquée aux observations; et on la trouve
pour
le
10 Février zzzp .sm 49°
donc,
pour
— p.sin48°56''48'''i=i^5o5:
__
14
tous
8^ 38'''' n: 1'''', 509 ;
les
cinq jours,
p'
zz
1'''',
5i.
Ainsi, la
correction des distances de Jupiter au zénit est
Sq"", 55
—
i'\ 5i z= 21^ 04
:
ce qu'il faut retrancher des déclinaisons, parceque le bord
Pour corriger
boréal a été observé.
ridien,
il
les
passages au mé-
demi -diamètre de Jupiter à son
faut réduire le
parallèle, en le divisant "par le cosinus de la déclinaison
qui est égale à
réduit
zz: 55'''', 9 7
droite,
puisque
10° 54^;
;
ce
c'est le
et on
qu'il
trouve ce demi'-diamètre
faut
ajouter
l\
l'ascension
bord occidiental qui a été observé.
De cette manière on trouve
335
336
On
réquinoxe moyen.
m—
i/\.'\2>-j
ziz -\-
1
ger
1'\^ ;
de signe,
apparente
ainsi,
des
la
en
trouve
longitude
en latitude
=10^ l'aberration en longitude
en
z=
latitude
—
o^'',
i6.
Il
faut les chan-
parcequ'il s'agit de convertir la longitude
comptée
longitude
de l'équinoxe moyen:
correction des longitudes est
latitudes
en
niuation
la
:=:
+
o"'"',
résultat des observations.
1
6
:
zn
+
2''^,
g;
celle
d'où l'on obtient ce dernier
.
le 14
dont on
d'oà, en rejettant l'obsen^ation da 14»
i^''\ig:
cîe
a
\u
moyenne
raison ci-dessiis, on tire Icrreur
hi
des tables, en longitude --i-6''\'}2; en latitude =:— 5'''',5 3:
ce qu'il faut encore réduire aux lieux héliocentriques, en
multipliant ces erieuis par
que les tables exigent,
en latitude
z=z -|-
Au reste,
il
^||f-- rz:
serait
La
0,8 166.
correctioft
donc en longitude zz:— 5^'',5;
4'''',5.
est
de conclure de ces
aisé
résultats,
que
eu lieu le 12 Février V. St. avant
l'opposition de Jupiter a
midi à peu près à ii'i7''8'^ tems moyen de St. Pétersbourg.
II.
Occultation de i.^a^-^: par la
Lune,
i8i3
le
Pour
vérifier
a 5 Septembre V. St.
V immersion
J'observai
la
pciKliilc
d ins
a
2
la
1
étaient
nuit ,
et
les
de
là,
de 17 ,54;
et
aberration
/R apparentes
passages de a i^ et de Marcab,
droites
2 i "5ô^i2^'',663
et
j'observai
22 û5 11,72.
a
ascensions
nutalion
leurs
suit
nicine
c4''i 8'''j5.
réglée sur le tems sidéral,
est
JD DD ,34
Les
la
qui
2
li
moyennes de ces deux
2 2''55''2 9'''', 1 8 i
—
ry'',o33
2 i'''56'i 2^^,63
;
L\
étoiles
somme de
et -f- o^'^,334; donc
5
2
9'''',
5 5. Il
et 2 ''5 '2
1
en prenant le milieu, que la pendule retardait
et
tems sidéral de
que l'immersior?
St.
fut observée
à
Pétersbourg.
AUmoircs dr rArnd. T. FI.
4^
20 24^36'^
338
m.
Immersion âc <^n,
de
Passage
di-oite
'
1814
le
i
Février V. St.
7
3'
observée
à
9'
Régiiltis
à
9" 5S''53'''',02.
moyenne =r 9' 58^2
8'^^,
St''^, 8.
Aberration
06.
— -i-o''',igi. yî\ apparente de Réi^ulus
:
La
pendule
Tenis sidéral
Son
et
as;;ension
notation
zrz g 58^28''',25.
= 24^11: ce qui donne
de l'immersion m
avanroit
donc
le
9^833''''.
IV- Emcrsion
de
3.
i
1 8
nr,
le
14
24 Février Y.
St.
observée à 1^' i3'i\.'i^^,L.
Gemma
Passage au méridien
y^^ moyenne
Abeir. et nutation
,5^ 27'.r6",y8
/\.o.'à'j,(\o
i5. 80 4i)>'207
14..
—
— 0,209
o,'..o5
du Serprnt
iy\iJ5'.cJ4.',4>i
^
i5. 35.
7,124
i5. 35.
6,^70
—
\
Milieu
i5. 26. 48,c,o5
- 98,072
—
j
97, 760
I
__ Q7",32.
Tems sidéral de l'émersion zn
V. Occultation de 5 SB, 1814
le
observée à 8^33^55^'',4.
I4''i3''i9'''',3.
18 Mars V.
Emersion à 9
6''. 37'.
^
moyenne
|
6.
3b'.
—
4
'5'
58,069
0,662
Aberr. et nutationj
^J^ apparente G. 36.67,207
7,3o3
La pendule avance)
!
St.
43^22'''',2,
Alpliard
Sirius
Passage au mc^ridien
454
I
i4' 4o-3<3,795
y5\ appaicnte
27 G'>»'>
La pendule avance
Immersion
ce
'
14'^ 4-^ 4-' V't^
9'm8.35", 17
7'^22'.5o",o5
7. 22.^'5f5io
1,029
—
g. 18. 27,216
0,1 13
22,42,481
9.
7.
—
18. 27,103
8,067
7>569
Milieu zz j"y6^6.
Tems sidéral de
—
.
—
l'immersion
— l'émersion
>i^ •••••«C/O'OO'O"'^^
:=i 8
11:^9.
.
33''.
4 7'^^,'? 5.
43'
14' 5^-
II.
SECTION
DES
SCIENCES PHYSIQUES.
43
DE MOXSTROSA GENITALTUM DEFORMITATE
ET S FIXA BIFIDA
COMMENTAFIO.
A U C T O R E
7.
.s£.
A.
Convcntui
Magnam
in
LOBENTVEIN,
exhibait
6 Julii
i8i4-»
humani corporis
constrnctione
raiumque abcnationis
die
naturae
abnormitatemv
plioenomenon ,
eruditoruni
contemplationi piopono , cui simile iiUum in magno monstroruin
numéro, quae vel in locupletissimis rerum naturamLiseoium
acadeniicoram
lium collectionibus
et
vel in exactissimis
anatomiae et physiologiae
riis
thesauiis,,
commenta-
hucusque continentui•, aut connotantur, inveniie haud
licet.
Eminet qiiidem hoc
formitas ,
tis
in
subjecto
mira genitalium de-
haud minor tamen est intestinorum
et
systema-
uropoetici, atque singularis denique caudae equinae de-
generatio.
Praeter
varies
autem
illos
structLuae
lusus«
342
vindxat, plma adluic snnt
iinatomia sibi
<jU03
respoctu physiologico ,
iiiimo
Snppedilat scilicet
foniibus eiLicnda occnrrunt.
heimaphrodismi
do
cjusque inversione ;
foctu ,
de
de
de
foimatione
dcnique
haec ob-
monslrositatis
vesicae
urinaiiae
hernias
connatas
inter
ve.sicLilae
hydrorhacliitidis
hujus
-quadam specie
sitii^ulaii
djlTerentja
lisu
de diagnosi
et
de
spurii ;
exomphalinn ;
solum
sed simul
ralionc et genesi ,
et
non
ai;qiimcntum
scrvatio
qnae
iisdcm hisce ex
mcdico ,
et
alia ,
uinbilicalis
spinae
et
in
bifidae,
nique divmsa hujus lethalitate.
II i s t
Infans monstrosus ,
dituii
sumus
,
r
i
a.
cujus memoriam bisce paginis tra-
quarta paupeiculac familiae
hebraicae pro-
gcnies^ in lucem piodiit Vilnac, in subuibio Zarzecz, anno
1811
die
1
1"""^
Novembris; nata e matie
annomm
viginti
quinque , statuiae habitusqnc mediociis , pâtre autem pusillo,
gracili,
tiicennaiio; parentibus, quibus a natura nor-
malis conccssa fuit corpoiis çonforniatio, et non interiuptae
sanitalis
usus.
Priores
vcl constitutionis
nis,
etiam
physicae corpoiis ,
larium intnmescentia.
In
lies
infantes nuila
vcl icctae valetudi-
freqnentioie glandularum jugu-
afficiebantur labc, nisi
tum gcncalogiae
ipsoiuni
nullo
indi\ iduo
unquam utiiusque paren-
singularis
quacdain
observata
343
ftiil
coi'];)orîs
lis,
scu
dofûi:nitas.
ciiinfcrendo,
occupata doini; pater, merccs cii-
potias,,
ci^^est-alis
diriicili
famirur-
rcr
aclininisiinlioiic
n-]<îtcr
inienLus crat
suslcnt;andae e-\is(cnliae
cjiae; uliiusqnc vitae i^rnus miscriimuin.
Cordi
pcrqiiam
gens mater,
terrores
priortuii
cum
obnoxia ,
erat
qtiio;
etsi
nocua
,
sioncm
objecta,
insolitae
terioics
ilLis
inat'inae
modo potucrint
foetus explicandae sufficeret ,
imaginationis
rc niiibililati
matemae eiïcctus
nornunqiiam
indiil-
tantam ineulcarc impies-
quae
,
si
oiigini
abnorniitatis
uiKjuam naevos inFantura
esse Ciedideris.
Quid, quod
fuerit conscia ,
nihil
sibi
omnium
afïtcisse
mentem
deli-
aniiiii
cxcitaniia, adco esscnt in-
ipsa denique mater bene
singnlari
magnac
sacpius dcjeetioni viiium
subs( qucrte
ut iiiiagina'Joni
nullo
et
quatuor gia\idita!.is mensiuin pcriodo',
cuias
et
int. r
timido
eorum,
ratione , nihilque alio^
rum graviditatis tempore accidisse symptomatum, quod quaIcmcumque cum
monstrositate foetus aleret analogiam, cui-
ve vel minima conceptionis abnormis inhaereret
ratio, aut
remolissima cvolutionis irregularis suspicio.
Légitima gestaiionis periodo incessit irotus infantis
utero ,
ts
vero debilis usque
in
dies
graviditatis
irr
ultimos,
quam justo termine absolvit partus, laboriosus quidem, sed
omnino naturalis, nec non a matre sine ullo
trimento perpetratus^
sanitatis
de-
344
Octnva post nativitatem die inrcuistam piima vice con-spcximus piolem ,
funiculo umbilictili
Yidimiis infantcm a monstrosa
duo.
lune
jain
deci-
rite
vcntris atTectione,
iini
cujus rationem sequentibus icdiliuni sumus, continuis heuî
tantisque exciucidtum doloribus ,
vix quidem ,
in
statu
mam
,
scelcti,
ejirs
aptus csset matris iibciibus.
vitam non
ejulatus
anatomica, qua absoluta
perpessis
p( Ivis
doloribus
instituta
praesertim
cclcrum
corptis, nisi
génitales, spinam
medullamque
viscera
•
qnare
considerabimus , quales
docuit aspoctus,
illa
in
tota
Os.ium
infaniis
tamcn
compji^r?,
stxus videb.itur esse potioris;
abnorme non crat
Tîelvisque
fuit
hodiemam usque
confornuui
Ilipfjocrotica.
p)roportio,
sine con-
et
hujus physîognomia, patri nonnihil consuiiilis,
a
modurti
monstrum, in museo
ad
repositum ,
Bene
adservabatur.
dicm
moitem
Cauta post
ne
hoc
et deci-
in
infetioies paralyticus,
Universitatis
anatomico
quartam
nisi
et
Miserabili
cxicnuatus
lacrymas
et
inter
extinctus.
clissectio
ad dicm
traxit
ad extremitates
vulsionibus
ut stigendis vix ,
quoad imum ventrcm, partes
dorsi,
cxternas
et
interna abdominis
imprimis
abnoimitates
ipsa corporis superficie simplex
dein connotaturi, quae interna partiuni
patefccit dissectio.
A bno rm
i
t
a t e s
e x t e'r n a e.
Cum extcrna capiiis, thoracis et exticmilatum super-
345
-ficirs
condliionis fueiit
triin>o.iimis
non
qu.ie
memaiiibiînu'^,
omnino
Ifgiiitnae,
diiTciebcint
a
nihil coicim
foii;na
com-
solita, ut mo.v
ad ilb, quae stiLictur^e normali extedus
eian.t
conu.iiid.
Abdomen.
vcniebat
conspccUiDi
duos
lillia
parabolicam
in
')
')
ciijns
describens ,
mediac
sliicac
plaida
pollicts Lita,
-)
abdominis icgione notabilis
infciioie,
anteriorc,
Tn
dcorsum
lubra ,
in
penitus
excoriaCa,
circtimfeientia,
lineam fere
ex ima puite
divergens,
regionis epiga-
crmibusqae
suis
*)
uliunique ingncn demissa , coinplccLebatur umbilicuni ''j,
jam pcrs;anatiim
pubcm
et
,
totainquc simiil rcgionem
Kxcoiiatani
ingtiina.
deerat scilicet cuticula
musctili ,
transparoK nt
bi'iculum tiliud
sinisterius ,
^) ,
cutis
;
dicimus
autcm adeo
erat tcnuis,
')
Tah. V. A. A. A A.
-)
parielis
abdominalis
Tab. V. R. C. D.
').Tab. V. C.
•*)
Tab. V.
Tdb. V. E.
6)
Tab. V. F.
M'm$-reir!erAc.id.
15.
D.
T.ri.
ut
Tu-
penitus supeificiale, umbilico superius,
noiatum, nuUiiis eiat moine nti, mère cutantinn.
^)
regionem,
luborem peiquam exaltantes.
tantum
levi
iianc
hypogastricam,
44
convexitate
346
Tegiimenta communia
parietis abdominalis
gae rubiae ambitu verum terminabantiir in
toto pla-
iii
limbiim piomi-
nulum, qui lincam illam parabolicam ') constituens, ccrlos
designabat limites inler pliigain abnoimem et reliquam ab-
dominis ciicumfeientiam , ut adco tota
bus
circumscripta ,
istis
nudaiii fere exhiberet
mam
ciim
et
,
illa
area
tcniiis\simo
aponcvrosim abdominis ,
ibi
tenuissimo
illo
involucro
unum conflatam^ ut ubique hac in
bor musculoium subjacentium ,
limiti-
=),
sub involucro cutanco
tencni-
cutaneo
ita
in
legione transpareret ru-
neque ulium albae lincae
vestigiura.
darctur
P u d e n d a.
Qaod autem primo intuitu eminus cxultaie videbatur,
membrum virile ^)
tamen
excedentis.
etsi
solito in
longum, auricularem
instar
loco posilum, singiilaris
très, -et
quod superat^
polli-
adulti digitum aequans crassitie,
cornu sursum, sinistrorsum, incurvatum,
lissimis,
multuni
Cylindricam illud membrum normali erat mol-
totum eleganter rubrum,
lius,
ces
,
erat conditionis, proportionisque, consuetam
striis
subti-
transversim annularibus^ vermiculorum more nota-
«)
Tab. V.
=)
Tab. V.
A. A. A. A.
»)
Tab. V.
G.
B. C. D.
347
fine
in
tiim,
solito
oiificio '),
miijorc,
liions,
glande carens,
quare magno quidem gentis Tsraeliticae do-
et praepulio ;
loie solcmnis nconati ciiciimcisio celebrari non potuit.
joiem aiitem excitabat necessaiio
qiiod insoliiuin
illud
nicnibmm
,
duin viveret infans,
vam conliniio Icnlamque stillaret alviim, leni motu
ipsius
CLilari
membii provcctam; urinae
?tlembium ilkul spuiium
decursu carebat epi-
tolo in
muçcLiLuis tiinicae intestinalis
Qiiam vile
iianspaicient.
serins ,
cutaneum j
vel inde inlelligitur ,
elToimaveiit, nec fienulum, sed
fueiit adaptatio,
ciuni
qiiod
iit
striae
de qua dicemus
indumentcim hoc
neque praepiitium
ejiis
ad membri
orifi--
qualis est illa dermidis ad labia oris.
Scrolcim *) eadcin, qua
lugosum, sede ,
_,
ftieiit
talis
fla-
vernii-
nihil.
dcrmide , cutc lubra involutnm , sed tam tenui ,
ciiCLilaies
Ma-
attentionem spectantiiim,
membrum, excoriatione rubens,
magnitiidine et forma
adparebat normale,
sursum, extrorsiim, utrinque saccatum ^), testes occultos ibi
nienliens, niillo
attactu
dctegendos.
De parti bus muliebribus extcrnis nullum adcrat vestigium.
Orificium ani solito
guus,
inter
in
loco nullum ,
sed
porpc exi-
postremas seroti rugulas altissime absconditus,
')
Tab. V.
H.
-)
Tab. V.
I.
3)
Tab. V.
K.K.
44*
348
qui,
sursnm introrsiim dcliteicens ,
styliun tcruirm
In
itdiniUcb.''*-
difficilli.'iu:
'),
iiho(]ue iiii^uine
b.isi
insolitum
fixa
cor-
icsidcb.it
pusculum -) tabae magnitudinis, dcftctu tef^uinemoium parilcr
rubiLiin ,
foinui
fere
niaminillari ,
infriiii?
in
papilLnn
quasi miilicbrem dcsinens '), siib qna iluxu Icnlo, std con-
tinuo excernebatur loliiim pcr viain angiislissimaiii, oculos
latenlem
Ipsa
setam
ciii
,
quidem
sciolo attaclu
haec
vix
facile
pio;sLis
per
corpnsciila
dcsidrratos ,
men suspicionem
et interna
*)
interiora
niaminillaiia
iiidicare
infici^it
fiajiccre
tcsLJciilos ,
in
quam
ta-
vidcb.inlnr,
villosa
licuit.
illomm
supcificics,
dcncgavit strucUiia, quani suo loco per-
lustrabimus.
D o r s o m.
In SLiperiore parte rcgionis sacralis oculis scse manifestabat tumor
^)
,
oviim
anseriniim
magnitudine
cxccdcns,
mollis, clasticns, indolcns, cuti sanae concolor, fluctiians,
pression! adhibitae non ila cedens,
nueretur
quidpiani.
Erat idem
•)
Tab. V.
L.
»)
Tab. V.
M. M.
3)
Tab. V.
N. N.
4)
Tab. V.
O. O.
5)
Tab. VI.
A.
is
ut ejus voluinen impù-
tumor
spinae
bifidae.
349
cojm
nostio
dissertât. one
in
mcntioncin
initiii^iiiMli
i
<î i
de.'
D. TTcyhcr<Ki
veiU--
qtiem vidorc esc
Tiuiior,
eJild.
c
ft-cit
hvdiope specds
Mohrcnhcinui obseivar.ionihus '), (juojd extciioia sumni.iin
(juideMn ciiin
11
stui
Vilnae anno
bralis,
in
consensti
ciini
quoad inLcina vcio
nostro anjloi^iam cxhibcl,
ce mini ma m.
Dissectio partiiri:
eodcm
Ut
,
modo piocedanuis
îcrnaiiim,
rile
j.i;ii
in
nisi
icrum ncxu
ille
connotatini,
observabantui
a
pailiuiii
qiioquc in-
opoitct, contenta
in
tlioracis
encephalo nihil
quem pro
paiagrapho de spina doisi
pacto
in
descriptione pai-
discctione abdoininis
quae hac
contraria,
peiluslravimus,
ventriculo quarto',
in
igitur
inteinaium oïdiemur
piimis
.corporis
disscctionc
inferius in
Hoc
commemorabimiis.
n ter n arum.
omnia; ipso etiam
fuisse
innotuit eiroiis ,
tinm
extciiora
ante omnia dicamiis,
constituta
meliori
qcio
i
in
,
ea im-
cavitaie nattiiae Içgibuff
quaeque proxima ducent via ad
indagandas abnormitates, qiiibus interna genitalium ludebat
stiuctura,
cabat
et ad
dorsal is.
et sano
»)
vcrsari
detegendos eiiores, quibus colunina pec111a
vcro
omnia ,
quae
in
statu normali
videbantur, silcntio praeterire duximus.
Beobachtungen verschicd. chirurg. Vorfalle, B» I. S. lya, Tab; II.
35o
Abdomen.
Non
abdomine apeito, qualcm teitia oiTert tabula,
erat
hic enim
viscerum conscpectus ;
sunt
quae
cxposita ,
veio
^rande
oiTondebat
anlrorsum
superius
siio
abnormia.
latebant
abdoininis hepar prae-
adeo
ociilos ,
voliimine
ut
protractnm ,
ventre
in
prima dissectione
Rcapse
a
imo
tantum piae caelciis
illa
et
deorsum
vcntriculum
et
omentLim majus, inferius iniestina maximam partem in pel-
vîm depressa
,
obtegerct,
atque antcriore superficie parieti
abdominali interius ma^^no
infia
ambitu accrctum esset usque
in
umbilicum. Exemto jam hepate simul cum ventiiculo,
omento
reliqna
liene ,
colo
viscera,
in abdomine semivacuo,
et
,
tantum repraesentavimus
pro faciliori demonstratione,
studio
ab invicem dislocata et explicata ,
sursum
protracta ,
inferius, petefi- nt
ralj
ut
illa
omnia ,
atque intestina
quae sub
ils
laterent
visui.
intestinorum tenuïum
qui gressu natu-
Ita
tractus
per
omncm umbilici et hypograstrii regionem cirnim-
duci debuisset ,
arle
'),
nunc de loco motus ,
deoi'sum tend re vidciur ,
a
superioribus
ubi continuo tramite supra pu-
spurium illud menticbatur
bem e cavo pclvis egressus
quod in Tabula ï. occurrit sub littera g.
membrum *)
,
,
«)
Ta; . Vil. a
%
Tab. Vil.
b.
a. a. a.
35î.
Quod
igitur
praegrande apparcbat
rihil
eiat,
qiiam
veriim
membrum viiilé,
intestiniim ilecn ,
aliud
loco jnsolito
super sympliysi pubis ad exteiiora emer^en?, fere nudum,
membranae suae muscu-
annulaiibus
tjansparentibus
stiiis
rubiuin ,
quare
in
vivo
lenem
pcrislultictmi ,
vi
cujus
per oiificiuni ejus
laiis
motum
ilucbut alvus loco
quod nullum adesset intestinum
co ,
')
pio-
intestinalis abnoimitas consi-
tractus
stcbat
in
nullus
appendix vermicularis,
et
nullus
coccum,
daretur transitas
tenuis in crassum, tanla enim illorum ab invicem
erat separatîo, ut intestinum tenue,
riora
vidcbatur
lotii.
Maxima quidem
intestini
exeiceie
a
ventriculo ad exte-
usque progressum, per se Iiiaret exterius loco urethrae,
interius
vero ncc minimum ejus
cum intestinis
crassis
da-
retur vinculum aut communicatio.
Normalis
aberat
vesica
séminales, urethra et prostata
habebatur
vestigium
urinaria ;
:
cavernosi
nullum
aberant
vesiculae
in
pêne illo spurio
corporis ;
nullum glandis
aut praeputii, musculorumve erectorum aut acceleratorum.
Scrotum denique cum sacculis suis duobus lateralibus
'),
dissectionis
ope perscrutatum ,
')
Tab. VII.
c.
^)
Tab. V.
K. K.
I.
totum oninino vacuum,
J332
'branam v'daitos,
nec
ingiiinc,
in
innnem tantum celhiLirem
loco
icKticiilornin
piiium exiuict.im,
contincb.it.
cavo pelvis
abcToniinis,
in
aiit
mem-
qtuisi
,
Sed
ncc
lu-c
ia
tilla
alia
testiculis ,
ita
parte corpoiis inveniebanlur tcsUculi.
auteni
Sictit
vcio
etiam
monstmm
istiid
carcbat
carebat utero et ovaiiis ;
spuria
tanien
iiteii
vcstigia demonstiiibimns poslea.
Quod Tab.
Vil.
adspectus
libcrioris
lit.
adparet intestinum
d.
paruni
gratia
magis
ad
neatum^ totum forma siliquae latuit loco recti
partem
intestini ilei , pt-r
pelvim egrrrsini, minime tamcn
acutius, antc vertebias lunibarcs dccnncrct
dtm partem pro Ime
icctum
batiir
sine
iubendam
uUa sigmoidea
perinaeiim ,
ad
apcriretLir
coli
nt
intcr
capacitas
tinLiit
mucosum, cnjus nulla
rigo ,
cum
)
T.ili.
')
Tab.
Vu. c.
Vu. f. d.
Tab.
Vil.
f.
styli
,
,
qui-
crcdimus, iinde
continiia-
seroti
pliciiKis
notato.
^)
paium
ilLini
dcorsiim
postrcmas
ope
=^)
')
Arcta
excrcmentoriim loco humorem con-
rccti
siiprema
fuisse
inflexione
poro angiistissimo ,
interna
deli-
rétro infimam
Cnm snprcmtim fjus principium
ipsi jnncluin.
crassum,
dextia
a
intestini
siiperioribtis
dabatur scatu-
extrcmitas
ctsi
,
dcficiente
353
coeco, ipsa tamen clausa,
tuaiet
cavo abdominis libère
in
fluc-
')•
multo
Dictu
duo
difficiliora
illa
quae eleganter symraetrica ex utroque
e cavo pelvis
sunt corpusciila
*),
intestini recti lateie
cavum abdominis adscendebant. Corpas-
in
cula haecce, tum habitu, tum structura, penitus abnorniia,
neque
testibus, nec vesiculis seminalibus viri, nec ovariis
faeminae
Olivarum
cunt.
formam
adcuratiorem
similia,
fere
interius cava,
illa ,
extcrius
referentia,
etsi
descriptionem
sibi
expos-
dimidiae vix magnitudinis,
colorem affectabant uterinum,
fundoque suo, deorsum
crassiore,
fundo pel-
vis insidentia, intcrno scilicet perinaei parieti accommodala,
sine ullo
Superior autem cujusvis extremitas conica continu-
mercio.
11
tamen cum perinaeo ipso aut cavitate pelvis com-
m excurrebat in canaliciilura, sursum tendentem, tenuem,
album,
candore,
tubis
Fallopianis
aliène,
nitidiusculum,
gyris continuo decrescentibus serpentino more, seu potius in
modura cochleae, quinquies retortum, fine ultirmo perexiguas
in fimbrias abeuntem, colore, forma et structura fimbriarum
iiterinarum
per canalictilos
brillarura
diminutivas ,
quasi
illos
injectis,
aëri
')
Tab. VIL
Tab. VU. g. g.
Mimoirtidtl'Aiad.
et
fitn-
nuUo tamen modo de-
e.
T.yi.
niercurio,
impervias, ut externuiu
orificium suspicari quidcm,
")
tamen
4^
354
moiistiMie
Liheine'
li-^neiit.
pciitonactiin
coipnsciila
liitrbcinl
p.iitil^us ,
aecjuc
iic
eoiunK|ue Ciinalicnli serpentiiii, nccjua-
olivaiia
Corpusculorum
utcii
pacitatis
circiter
situs
origine, sitn.
inlcrnas
rn^milas
nucis
nuicoso ,
pusculoiuni
parietcs
pistaciae
pcnitus
iitruniquc
inveisus ;
csset
et.
texluiam intimam,
minoiis,
Erat
reftita.
lespc ctn
immo
omni nota ,
eoinm aulem cavitas,
crant simillimi,
parielibcis
pariim
olivarium
minimas
fjiioad
ciijus
vicini';
,
rctro
lii^iimentis
sinft
junciae.
(jn.iiii
et
illae
rimbritic
ca-
hiimore limpido,
i^i3;itm-
hoiiim cor-
stincUnac analogum utero,
canaliculi
dircctionc et fine suo
iLibis
aiUcm
serpentin!
Fallopianis vide-
bantur consimilcs, structura tamcn clastica, colore candido,
ncc non splcndore proprio ,
viri
similiores,
ut adeo in
vasis deferentibus spermaiicis
toto
hornm cospiisculorum
oli-
varinm, canaliculorum, fimbrillarunique apparatii
singlilaiis
quacdam genitalinm
organoruni
sexualitim
commixtio intercederet; ntriusqne
vestigia, nciitrius
ciora
internoriim degeneratio
tamcn perfectio,
etsi
et
scilicet
sexus
plura feminini, pau-
masculini essent generis.
Renum ") et situs et conditio a
aberrasset
')
quidpiam,
Tab. VII.
nisi
nalurae legibus hand
glandula suprarenalis reni dextro
h.K
I
355
defuissct penittis.
Uielcium (luilibet ') iccto tiamite e rené
suo diTficb.itm
])elviiii,
non
essct
suo
in
vesica
Lucre
jam
in
inf^iiinali
lii^amento
cmn
vcio
noimalis piacsto
infLindcient , quivis,
lotiiim
Pouparti egiessus ,
Tabula V.
liteiis
siib
utiinsque
ureleris
valde absconditum
intioduximus cadem via
,
'),
implanta-
villosae, qua-
papillae in^iiinali ~), leibiae,
exloiiis
lebat
ibi
cui
iiiinaria,
siib
singulaii
batin-
Icni
iii
M. M. delincavimns. Laosculum
in
papilla
peiangustnni , cui
qua loiium
lento
sua
sctan) *)
quidem ,
sed
continuo, per inguina dcfluxit stillicidio.
hamm papillarum inguinalium
Quantamcnnqne externa
positio de tcsticulis spuriis
la
tamcn
illas
inter
movere posset suspicionem, nul-
et testiculos
nam
intcrcedebat similitudo.
runi
ulla
locurn
quoad
Neque cum
habuit comparatio,
strueturam
papillis
etsi eniai
inter-
mamma-
forma papil-
larum inguinalium luderet sub specie mammillamm, adeiant
tamen
praeteiea
mammillaies pectoiis
villosae , ejusdem
lecens
in
in
nato
infante
loco solito ,
veiae
papillae
illae veio inguinales,
videbantiir structurae , cujus vesica uri-
')
T.,b.
')
Tab. VII.
5j
Tab. VII. I. l.
VII. i.u
k. k.
) Tiàb. VII. m. m.
45'=
356
nonnunqaam occuirit ad exteriora pubis, quod
naria cversa
ubciius cxplicabinuis in adnotatione VII.
Sufficit
rit
hic
monuisse, quod vesica urinarid non adfue-
nec urethia, nec vesiculae séminales, nec pro-
nornialis,
ncque partes génitales
stata,
constitutae alterutrius au*
rite
utriusque sexus, nec externae, nec internae, omnes enim,
quas hoc in infante desciipsimus , excepte scroro , défor-
mes
ac erroneae 3
erant
ut
judicium, quod in adnotatione
difficile
II,
esset
de sexu
illius
dilucidare tcntabimus.
Tumor Sacralls.
Quod
fidae
tumoris
interiorcm
conditionem attinet ,
sectione contenti, lotam
sacralis
non hujus tantum tumoris
ommino columae
pagem perlustremus , opportct , ipsum
inde
vertebralem
tractu
vertebralis
dis-
com-
prius encephalum,
«t in specie ventriculum ejus quartum ,
continuo
seu spinae bi-
') ,
examinaturi ,
specuni
et
ut
medullam
spinalem prosecuti> perveniamus ad sedem spinae bifidae^
et raram ibi
In
aderat
detegamus caudae cquinae abnormitatem.
ambitu cerebri
extravasatio ;
et
cerebelli nulla
ventriculi
vacui, non distenli^ normales.
ctsi
pariter
')
etiam
latérales
et
tertius
Ventriculus autem quartus,
vacuus , ad capacitatemi
Tab. VI. A.
quidem aquarum
tamen ,
amygdalae
351
majori continendae aptam ,
calami
longitudincm
sciipiorii
trium
oblongatani
posteriorem
rcni
demersum
fuisse
unciae ,
medullam
latum hians, sérum
in-
superficiem ejiisqiie va-
spinalis
sacralem jlkim spinae bifidae tumo-
Hujus ex tnmoris cavi-
videbalur.
tempore sex
tate sectionis
bantur
in
in
retio
quod inde e ventriculo quarto
medullae
ginam dcflucndo ,
fiindo per totam
in
disruptus ,
linearum spatio
transmisit pelkicidum ,
ter
distentus,
aquae limpidae évacua-
circiter
ex ipso tumoris sacco ,
jpartim
partim e
lumbari spccus vertebralis conlignatione redundantes.
Columna
vertebralis
nebatur
vertebris ,
numéro.
Costae
loco
debito
lumbares
utrinque
inserta.
dorsali
dextrum ,
inde
sinisteriora
versus
a quinta
vero
enini
autcm
usque
per
tantum
friabilia
brales e lateribus
lioribus
latus
ad os sacrum
etsi
alias naturae
lege
modum coarctata,
eorum interverté-
tantummodo essent conspicuae.
Ultimae
omnesque, quatuor
scilicet,
corporum
a supe-
tumidiores ,
deorsum
in
Vertebrarum dorsalium cor-
coalita, ut cartilagines
autem vertebrae dorsales
lumbares
erant
quaelibet
duodecimam
ad
ad nonam usque ,
adeo
quatuor
columna vertebralis a
lumbares usque
incurvata.
compo-
tribus
quarum
semper angustissima , hic taraen pcaeter
et
et
nonnisi
duodccim ,
Ipsa
quinta
vertebra
pora
viginti
ka
solitara
très,
ut
incrementi
crassities
proportionem
exce-
358
Vcitebrne lumbnres priietcrea omne?;
dciTt.
protiii?;iiej
nJmis antrorsiiin
iit
perinde miii;na
in
iiltior,
in
niinis
in Juiiibis ori-
vno con\e.\it'as
retnr concavitas poslcrius , nnleiiiis
montorio consiieto
postoiioiibns
a
,
pro-
abcloiDcn protiihcrans, et
hamni qnidem vertebrarum specu potiisima obscivaie-
ttir
aquauim
ciica
medullam
colleclio.
Processus spinosi vertebrarum kimbarinm
sed spinae sacrales très siiperiores,
les,
spmiae, valde
tit
rotiindiis intcr
tcr
lincariun
perpendicLiIaris
OLto.
B'^n
!
circnlum fere describcns,
hiattis,
per qnem
hiatus,
dulla spinalis
ita ,
novem
iina
,
norma-
scii
imperfectae, bitidae, et adco divergentes,
illas oriretur
erant.
ciijus
transversa
cum
diame-
linearum
aquis evasit me-
ut pars ejus posterior , nullam ibi for-
mans caudain equinani, substantiam medullarem ipsam porinstar
rigeret extrorsuin
ovalis,
quasi bifoiiatae
lore pcrlaceo
lamellae
'),
instructa ,
medullaris ,
transversiin
expansam, quae, nitidissimo co-
toto
in
ambitu circumdabatur po-
fiteriore
paiiete spinalis vaginae, sub tegumentis
bus
magnum
^)
in
tumorem extensae, cujus
colligebanfur aquae ,
conrinuo flnminc e
derivalae, foliumque illud
•)
T-b. vni. V'V-
')
Tab. VIII. «. «. ei.x.
S)
Tiib. Viii.
fi. (i. /3. i3.
in
communicavitatc
')
spccu vertcbrali
undique alluentes.
359
ipso deniqne
In
mediillae folio, siib specie coloris
illo
pciliicci cineream ceiebii
substanlijm icTerente, tiii» ludcbant
fomniclla ;
siipciius
mediLini
supiemum
erat
styhim
ipso
in
omnino coecum, fundo
ramelkim
et
-),
et
cohimbini
caLinii
,
infcriiis
posteiioreni
interius
angiistum,
infeiiiis
mcdullaiis
folii
^)j
€|iioiTun
capacitatis^
meduUae parietem
cndem, qua sernm scaturiebat,
médium ,
Itmi
maximain
vaginam
inter
admiltens,
'),
via.
Foiamel-
centio
positcim,
mox claiiso dcsinens,
inter anteiiorem
Fo-
mediillae et
vaginae paitem delitcscens, nullum inter illas transmittebat
vagina
senim ,
ibi
utique in statu naturali sat
medullae
respondcnte.
arctc
Nervi sacrales posteriores ,
posleriora ,
sacralia
parle
abnoimis
deerant ;
portio deficeret.
cum
Ita
ut ipsa foramina ossîs
anteriores vero,
medullae propagati ,
illius
piogiediebantur ,
sic
postenor
tantum
ex anteriore
more
normali
caudae
equinae
nervi crurales et obturatorii, ex tribus
vero ex duobus lumbaribus
primis
lumbaribus ,
ischiadici
iiltimis
et sacralibus
primis cujusvis lateris suborti. Hiatus
triangularis ille, qui inferiori in parte
')
Tab. VIII.
$.
')
Tab. VIII.
,.
3)
Tab. VIII.
i.
ossis sacri
pro exitu
V,,;j,
36o
finis
caudae equinae, id
iiltimi
arteriae
est,
ceu imparis nervi veterum ,
rioris ,
spinalis ante-
destinatus esse
solet,
hic superinducto singulari ligamento transverso clausus erat.
Ep
c r i s i s.
l
Tnquirere in naturam monstrorum in génère,
aeque ac sterilem esse operam, effatum
familiare
philosophis ,
dicas
studia
nisi
enim
Etsi
variae
explicanda
thcoriae
illae
sagaciori
difficultate
speciosae ,
origine
sunt plena.
quas luimanLim in
e.xcogitavit
hiiCLisque
scriuinio
salis
ingenimn ,
haud
fecerint,
quas dives insuper coUegit experientia,
et numerosissiniae,
observationes
quae
et
monstrorum
multis quidem
tamen haud consentaneum,
verilati
iniitilia ,
est,
ingratam
parum
quid
addiderint
utihtatis
scientiis
physicis, et vix iiberius locupletarint rem medicam, muhura
tamen prodest illorum indagatio vcl
in
affirmandis,
vel
in
refutandis variis de generatione scntentiis, et in explicandis
diversis
ejus
phoenomenis.
Testantur id
immortales
virorum, in le physiologica clarissimorum, Stellerl,
ahorumque
vario
labores.
Sunt et nostro
respecta singularcm
quandam
in
Tfolfii,
casu nonnula, quae
mereri videntur atten-
tionem, quaeque sequentibus examini subjicere et propius
indagare
qui
animus
curiositatis
omnia iUis committere,
est,
cetera
vero
pkis ,
quam
utilitatis
studio
delectantur.
36i
igitur
Neqiie
labomm et difficnltattim
omnium tempornm physiologi
humanae
quibus dcsudarunt
demonstrandis et expla-
in
génère
aliammque
abnoimitatum
catisis
et
monstroium
nandis
in
,
lusibus
oiganisationis
participes
nos
reddere, neque observata oninia, qaae nostro ex specimine
redundare possent, funditus exhaurire intendimus.
Quatuor hoc pacto adnotationes ex recensîone infantis,
hisce paginis connotavimus ,
historiam
cujus
animadvertendas proponimus, tjuarum prima
prae ceteris
in definitioneni
et classificationem abnormitatis inquirit, altéra vero
perquam
dabii sexus occupatur analysi. Tertia, missis mon-
diiTicili
strorum rationibus in génère, tractabit de causis et origine
monstrositatis
hoc tantcim
abnormitatis
ejus
promptu
in
cum ratio
in subjecto in specie,
sit.
Adnotatio
quarta ,
praccipuos spinae bifidae caractères inquiiens,
in
operi finem
imponet.
Adnotatio
I.
Abnormitatis Claàsificatio.
Infantem
vimus
monstrum ,
argumentis.
qui
in
in
Non
operum
ipsa
fas
hujus commentationis fronte appelaest ,
ut liunc titulum comprobemus
insistemus hoc sensu definitioni
anatomicorum
Mi.-noires diTAtad. T. VI.
minorum~^tomo
Ilalleri,
III.
4^
p.
3,
3^2
moiîstinm
appdl.Jt
ahcrrationem
anrft::!if
a
adeo
eridehtem ,
ut
Igftarorum ociilos
speciei fabrica
cnoies enim qtianlitatis
adnnmeiat
sitatibiis
nis
intercédât
mitivae
iim
tribiiendi
grave
opinione
striim
abnormitate
individmim
qnod
Que minus autem
conformationi pri-
dummodo formae
oculos cadat ,
qnidem
nostra
qiiarc
viti-
humanae mon--
speciei
ex conformalione primitiva
ma»na
corporis
contraria,
prorsus
aj)ricc)
monstio-
qualitatis
cri-oies
in
mecetur,
borat
illi
an morbo ;
tantum
iilnd
dici
nonnali
ntrnm
sint,
et
sit ,
in
minime advettens, quantum disciimi-
,
eo,
in
ac
aeqcie
sune
consuetci
Drfinilionem hanc nimis esse geneiaKni,
feiiat.
est,
et'uim
vol
et insi<^ni ,
Id-
struciuiae
qdoad qiialitatem partium.
assentimus Ilallero in monstrorum défi-
nit ione,
eo lubentius ejus classificationem amplectimur, qua
rite
distinguit rcspectu partium
illa
per cxcessum
,
in
monsU^a
per defectnm , per transpositionem, et pcr
transformationem ,
classis in
abnormium
addendo
hisce
subdivisiones
cujusvis
specie.
Fixe jam
dubitamus,
ita
recto
infantem,
monstra dijudicandi
de quo nobis sermo
modo ,
est,
nulli
omni jure
ad. monstra référendum esse, omnes enim in eo deprehen-
dimus caractères; qui monstri definitionem absolvunt. Aderat
error
formae ^
confoimationi
error nativus ;
naturaii
error
pcrmagnus
valde contrarias^
crior
et
insignis,
tum
quali-
363
tiim
tiMh,
-
quantitatis,
et
tcitn
extcrnaruni,
cj'iani
fisi
objectionis
vix
,
monsLii
q(ia
ttiia
lari
coiUia stntcnti.iin,
,
quam
etsi
maxima
Acce-
limnani dcfonnitates recenseri .posset,
pars
quod
hoc
in
striic-
servaverit legiiimiim.
corporis
dit,
infanti,
ut inter simplices
corporis
typum
esse
tribLiendiiin
pliaenomenis instar a
abenabat nimium
reliqiia
phiriu;n,
Uisce uiionibus con-
tiinemcis
judicaiTuis
abnonnitas
légitima
pariidiii corporis
iiiu inaruDi.
aliquid
tiliihnii
insii^nis
cnJLis
cjiiidein
subjecto onmes omnino obx'iam vcniant
idque ad qciamlibet
caractères ciijusvis speciei mohstrorLim,
eorntn classem pertineat ;
erat
enim
id
monstrum per ex-
cessiim , per defectutn , per transpositionem , et ptr trans-
foimationem.
Per ctcessum
Membrnm
:
maramillares
papilldc
virile
utroque inguine;
in
praegrande;
spiiriiim
utérus
spurius
duplex.
Per defedum
poribus
:
cavernosis
Dcfectus urethrae
prostata et coi-
vesiculisque seminalibus;
ticulorum aeque ac ovariorum ;
maximae
cum
partis coli;
absentia tes-
absentia intestini coeci et
absentia renis succenturiati dextri et
quintae verlebrae lumbaris
atque
nervorum sacralium po-
steriorum.
Per transpositionem :
Abnormis directio
testini jlei et recti; cjeviatip
weteium,
et
exitus
in-
et vesicae urinaiiae
46»
364
bipurtitae translocatio ;
abcrratio
situs
inversus uteri spuiii geminij
meduUae spinalis.
Transmutatio
Per transformationem :
formam pénis ;
intestini
ilei
in
mammilhuia dimidiatae vesicae
corpusciila
urinai iae; corpuscula oli varia loco uteri, et singularis de-
nique
illa
degeneratio caudae equinae per spinain bifidam,
in folium medullare desinens.
Peccabat igitur structura hujus infantis partium non-
nullarum superadditione,, plurium defectu, aliarum translocatione nec non singulari quarundam contra naturae legem
transformatione, ut tanto deformitatuni
stri
onini jure
numéro nomen mon-
meruerit^
Ad nG
IL
t a t i o
Monstrl Sexus^
Cum tanta
esset
genitalium hujus
abnormitas. atque-
infantis,,
confusio
partium
ut spuria quaedam utriusque se-
xus contineret vestigia , neutrius tamén vera , camque caractères sexuales proprii re ipsa essent ambigui^ etsi primo
intuitu valde apparerent distincti , singularis inde ^
curiositatis indigna
cujusnam. denique
Anceps
in
anceps
igitur
_,,
cuivisj sponte- seÈer obtrudit
sexus
mirura
aeque
ac
difftcilis
quaestio,
fuerit
monstrum ?
genitalium
erat natura,
iilud
configuratione particim
neque
in
determinando
sexa
365
ilactiiabit opinio,
cctLir
donec ad certa de hermaphiodismo revo-
piincipia.
Constat ex praemissa superius anatomia monstri, partes adfuisse génitales utriusque
ternas ,
tum
de loco
solito
internas;
in
sexus complures, tum ex-
praesentes denique ipsas fuisse \ri
alienum translatas, vel a naturali forma
multuni aberrantes, vel singnlari inter se modo confusas.
Exterius corna illud praegrande,
quod tum magnitu-
dine,
tum rubore, priapi gerebat omen, quodque respectu
siius
ad extemam pubis regionem
et propter figuram
suam
cylindricam facile pra virili liabebatur membro, non potuit
primo intuitu non indicare sexum potiorem.
men
illud
non erat,
nisi
Membrum ta-
spurium , seu supposititium , erat
id scilicet iléon intestinum ,
pénis
loco
foras productura,
deerant enim, excepto scroto, vrra omnia sexus masculin!
organa externa, ut supra jam monuimus,, sive> quod idem
est,
erat virilis raonstri caractet omiiina spurius.
merito pénis ille dicitur moastiosiiSj
tum respectu magnitudinis ,
normitatis
intrinsecae ^
cum
esset vero intestine, peni
im--
tum respectu formae,
praesertim vero
interna
Non
respectu
ab*
eju& structura similis
autem nullatenus.
Ita
etiam, se-
xus sequioris partes génitales externas defuisse omnes,
ximus; desiderabantur enim labia^ vagina,
externa omnia pubis femineae vestigia.
clitoris^
di-
verboi
366
Qao.id
loco
snnt duo
dignii
commcmoraviinus coipnsctila
')
tiiram
notiitn
intf^riora,
parielum inteiTcim
duo
ex
hisce
iîdi
illi
€tsi
pcrqnam scrpcntini, oiUi taincn,
fimbriato tiibis
(jii04id
coipusciilis
vasis df fncntibus
utciinarum vices
agentibus.
continiii,
\'iii
siio,
siciit
similes ,
liic
tamen
se-
Dcerant
xui masculino interius vesiculae séminales ipsae,
niineo ligamenta utcri
sLruc-
direciione et fine
situ,
feminae , candoie autem
iiteiinis
et habitLi et structura
tubaium
olivjii.i,
feminto an.do^j^ pono ni-
sexiii
canaliculi ,
qnne sno
i\la,
tx
Patet
et ovaria.
sic
his
ut fe-
omnibus,
quaedara intus adfuisse utriusque, et plura quidem sequioris,
sexus indicia, deficientibus reliquis: ipsa vcro pracsen-
tia
fuisse spuiia,
rum omnium
abnormia, confusa; caiacterum tamen ho-
peifectissimi
eiapt
utriusque uteruli
patietes
et fimbriae.
Si
in
jam cocxistentia paitium genitalium utriusque sexus
eodcm
siibjccto dénotât
maphroditum spurium
in
specie,
ractères ipsi
fuerint .spurii ,
maphroditis
spiuiis
M'nshergil
')
VÎT.
quidem her-
dum parlium
illarum ca-
elucet ,
adnumerandum
peit.inebit
ille
infantem huncce heresse.
ad, classem
')
Tiib.
•^
Ccnimcnt. de singulari gcnital.
fi.
et
hermaphroditum,
Juxta
mentem
hermaphroditoruin
g.
defortTiitate et
hcrmaphrodltis,
Ç.
i6.
367
qnaiCIim,
seu nibnstro^am,
plLiiimcic
non
sf)ùric!é
Ulteiius
aiilém
sae.
moiistroslis
jure
sit^,
iilri(jnc'
si
sinsjul.ire
ac
lio'imn
cjiuieVas' ',' rfn
an
omnino monstio-
heimaphraditLrs
isie
andtogynas
paiitis
hôc natttrae phacnomenon
eodeiii
in-ter
censcbis'
esse,
adpaiet hermàphrodis-
acleoqiie-neEitra' eJLis spocies ,
doncc anatomia partes
illo
eniiu
in
infante
cum externis,
tantuin occurrant viriliaî; simul
iitramcjLie
habebis speeieni-,
pa^rtes
ciim exterius soLi
autem considerando interna
androgyniim'dicas ,
si
in
quo
utriusqoe sextis praedominanfur mascnlae_, an*
drogynam vero,
feste
sed
fueririt,
nccitii- adsci ibendimi
internas ncin cdmbinavéFit
inler
illa/mn gonitalitfirr
parritim
ntilliis
Ncutii:
miis ,
sohnn
andiogynos,
i'iuer
icfcrenctus
cum
qua praecellnnt femineae.
in
Hic mani-
exterius praedominabantiir genitalia masculina; pénis
scilicet
praegrandis,
cientibus
etsi
hiuliebi'ibus
spiiiius,
et
scrotum verum.
deti-
omnibus; interius autem nohibiliores
erant partes femineae, uteri scilifcet duo spifrii, et fimbriaé
verae ,
virilitim ,
posita,
dum
illis
ambigua
illa
intérim
si
hue referas; unde
narum androgynani.
riusj
ut
ita
perparum ^uid ap|^ositum esset
vasa deferentia ,
jiatet ,
tubarum loco
ihfan'tem respecta
Erat îgihir hermaphrodilus
inter-
iile
spu-
ex caracteribus externis et internis compositiis,
seu,
dicere liceat
phroditoa
spurios
,
occultirs ,
distinguere
in
sfquidem placnerit Iiermaconspicuos j
qui aspectu
368
externo spurios utiiusque sexus manifestant caractères,
et
in occultos, in quibus alterutrius sexus vestigia latent in-
visa
dere
enim atque diversae indolis exemplis lu-
Variis
terius.
est
génitales
partes
dum uno eodemque
natura ,
iitriusque sexus ita
ut caractères unius
modo
,
collocaret exterius, intérim
splos ,
in
individuo
nonnuqam
disponeret,
modo altcrius comités,
dum alias sexus oppositi notas
vel seorsim, vel perles organa sexus alterius, intimis hu-
manae
structurae absconderet lepagulis.
Verbo
:
monstrum
illud exterius ad appqrenliam «rat puer, interius androgyna;
ulrumque auten^y simul consideratuçi,
to
sistit
in sensu stric-
hermaphroditum spuriumj monstrosum, cccultum.
Adnotatio llï.
Ratio manstrositatîs.
Duo snnt_, nuperrîmîs quîdem ^analomiae demonstratiolîibus
probe
strositatis
cognita ,
originem
tquae
gcnesim
et
scilicct
intestionoruni
peiiodo
legitimus ;
yesicae
urinariac,
ad expliçandam hujus mon-
extra
et
tune
faciunt piapcipue ;
umbilicum ,
noriiialis
prima
bipartitio
situs
embryonis
atque invcrsio
quoque ad exteriorem imi
ventris
superficiem obviae.
In
dato infante primus jam docct ^spectus,
.
parietcm
^bdominalem anteriorcm >»l?. infçiiore parte regiotiis epjgas-?
369
ad pubem usque ,
ti-icae
tandem coalitione
succedente
antea ,
et
plagam
illatn
in
loco fissurae
labiam contraxisse, qUae longe lateque circa
circumducta
limbilicum
quateniis
erat ;
enim plagae ex-
eatenus locum denotari censemus ,
tendebatiir riibor ,
ubi
qtiidem sibi respondentibus , exteina tamen
musculis ,
rite
tegiimenta
supeiindiicta
nativitatem
in
Talis
fuerant^
restitisse
hic
ante
videtur
fis-
et
vesicae, exterius retardatae, in recens
Patet
superest»
non
abdominis linea
alba
sura, qualis in casu
nato
juxta longitudinem fissum fuisse
prima embryonis aetate ca-
scilicet
Vum abdominis, ut, quod infra dicemiis uberius, extrorsuni
tune
deprehendantur intestine et ipsa vesica urinaria,
sita
quorum successive
nalis
fissurae
ititroëuntium in ambitu paries abdomi-
modum
in
côllimat.
Dum vero
nascitur
loetus ,
stante
adhuc
vesica,
immo
et
oculos ,
penitus
salutata,
non potuit enim prolabi^ quod intus in cavitatem
inversa ,
nondum
retardatae
ac inversae
abdominis
rubra quasi spongia,
destillat.
s;rc ,
improprie prolapsus nornine
siipeificiem
Vesicae
ita
exterius
villosa interna ,
ad ex-
patula ,
lotium
tune
ex
perquam abscondito, extrorsura
rara vesicae, ita
occurrunt cxempla ,
adhuc haerente
et
membrana
fonte
extus
tune vesica nuda cadit sub
susceptum.
erat
Neque nimis
et
_,
intestinis
abdominis
teriorem
fissura ^
extroTsum inver-
ma^no enim auctorum compro^
37a
bantur numéro, inter qiïos classici eminent/îoojie ^) ctHcrder ').
Similcm hic
ttansenn^m tantum conîmeoioiasse liccbit
per
quam,
afcnornïit^tem ,
servavimus anno
sano,
piiioscntc siniul atrosia
1809. in
invcîvsioiws
cujtis
])tiero
intclligitiir
vivo, dcceimi, cetomm
vesicae delineatio cxtat in musco
anaLomico Cacsareae Univeisitatts
Facile
membii, ob-
Viliieasis*
ex ante dictis,
in nvoir^lro, cnjtiîf his-
toiiam scribimus, eandem in linea alba abdoniinis praeexfissuram,
titisse
quae
alias
sic
dicto inversae vesicae
dein
um-
hic aLitem toto in tractu a
sii-
naiiae piolapsui ansam praebere, et circa sokim
bilicum
consolidari solet,
nri-
perioribus deoisum coahût, rémanente tantnm hiatu partis
infimae, transeunti intestino dcstinatae, atque
jecto insinuanti sese ileo inservientis.
cerum abdominaliiim versus
inclinatio,
docet
umbilicum ;
infra
adhaesio
et
hoc
in
siib-
Quanta auteni
vis-
fissurarn
illam antrorsum fuerit
hepatis
ad peritonaeum usque
quantus
in
niusculorum hiatus ,
loco
fissurae
quondam
magnus tegumentorutn,
esse
dcbucrit
ope
intercedentis
ibi
plagae adhuc excoriatae distantium,
testatur ambitus,
etsi
subjacentes hi musculi ipsi perfecle
juncti jam fuerint, et clausus rite umbilicns.
')
*)
De nativ« vesicae minariae inversae prolapsu, Gott
g4> 4*
in puella observato^
De nativo prolapsu vesicae urinariae inversae
1
,
Jenac 1796.
4.
371
Oiiemadmodiim
vesica
tur
illis
tui,
iinLe
intestina
facile
nato saepius observa*
leccir^
abdominalem residua ,
sive
,
et
in
coarctatjonis retardatio a
illa
suam
peregiinationetn
propria iiitestinoium ,
dicemus, procrastinantium
ineitia,
Eniinet tune ad umbiliciuii
laxitate,
magnus
intestinomm quasi prolapsus, qui
pioveiierit.
congenitae
de qua mox
,
sive a n.ima musciilôrnra
ipsoram
umbilicalis
ita
pênes funicnlunî uinbilicaleni
extcrius,
occurmnt
haeieniia^
in
ipse hiatus umbilicalis j«sto serins contiahi-
quibiis
,
igitur
fissuiiim
nomen
vulgo
herniae
obtinet, etsi solo peritonaeo
involutus, et omni velamerito cutaneo destitutus adpareat,
dum
intérim
bus oducta
tam
liernia
Signnm
sit.
id
est
caracteristicum,
adeo enim. inter se
dilTerunt ,
classificationem nosologicam exposcant.
niarum
quod
cer-
duas herniarum umbilicalium species ponit dia-
inter
^nosin ;
tegumentis communi-
umbilicalis vera
in
génère
caractères
propriam
ut
requiritur ,
sibi
genuinos her-
Inter
ut teganiur illae
indumcnto cutaneo; itaque herniae umbilicalis nomen non
meretur,
infanti
sese
quae cute obtegitur,
paulo post nativitatem
emergere ,
decidui
marri:
nisi
illa
jam
aut
a
in
et qualis
nonnunquam
loco funiculi umbilicalis
difiiciliori
partu
evadere
solet
vero species herniae, de qua hic agitur, ipso
oflert
nativitatis
Icmpore ;
portio
scilicet
norum, tune ad cxteriora umbilici haeientium.,
intesti-
solo peri-
47*
tonaeo
involiita
immo nonnunquam vel hoc
Neque herniam dixeiis,
ipso careng.
déficiente cute ; neqiie
prolapsum
intestinomm , quoniam haec intestina tune tempoiis, quod
de vesica diximus, nondum erant intus
etiain
ne ; ut enim
infra
intestinoiLim
extra iimbilicum est positio,
in
abdomi-
videbimus, légitima in embryone haec
quae post nati-
vitatem vertitur in vitium.
Rectius forte hic tumor vecabitur exomphalus, eodern
saltem jure,
berans ,
quam quo bulbus ocuh,
exophthalmus
dicitur ;
extra orbitam protu-
modo enim
nomcn
illud
exomphali usurpatur pro hernia umbihcali, modo pro
versis
tumoribus
in regione
aliis ,
di-
umbihci occurrentibus,
promiscLie.
Exomphalorum horum exempla non adeo qui-
dem rara ,
sed sine medela sunt omnia ,
paucis
post
diebus
nativitatem
plerumque enim
miseri taies infantuli ine-
vitabile subeunt fatum, cujus ipsi tribus in casibus fuimas
testes.
In
uno
illorum
ipsi nativitati infantis,
concessum nobis
fuit ,
assistere
quem, brev^i postea mortis victimam,
conservavimus in collectione anatomica Caesareae Universitatis Vilnensis.
yratislaviensis
tio
adhuc
')
')
aetatis
Viderunt tamen ,
quasi per exceptioncm,
infantem alium,
hoc malo affectum,
anno vita superstitem.
Bresl. Sairnnl. Vers.
17. p. 90»
ter-
373
jam embryonibus hune intestinomm
tenerrimis
In
tum extra umbilicum delineaveiunt Alhinus '),
Soemmerrmg *);
van Doeveren
'),
tio praeterire
licet,
nes meminisse
H'risbcrg *),
plures alios silen-
si
tamen hac in re dissectio-
solertissimas
jiivabit ,
et,
si^
demonstravit
qiiibus
Fridericus
/.
situm hnnc intestinomm usque in tertium ern-
Meckel
^) ,
biyonis
mensem
esse normalem.
duare
status intestino-
si
mm exomphaliciis usque post nativitatem parduraverit, in
eo tantum error naturae videtur consistere, quod id orga-
non
illo
tempore perseveraverit
etiam
evolutionis gradu ,
bus competit.
in
inferiore
adhuc
qualis primis tantum embryonis mensi-
Magnus est numerus auctomm, quorum ob-
servata de hac intestinoium retardatione, seu sic dicta her*
nia umbilicali recens natorum, testantur:
omnes
in eo con-
veniunt, abdominis viscera tune in hacce contineri hernia;
omnes tamen
id
signant titulo.
par
cum
vitium incongrue
herniae
umbih'calis dé-
Bene ceterum animadvertit Richter ^), he-
intestinis
plerumque
in
hisce
contineri
heiniis.
^) Annot. Acad. Lib. I. Tab. V. Fig. 3.
*)
Descript. anat. embryon. Obs, II»
3) Spccim. obs
acad. pag. Sq»
*j Icon. embr.
hum. Fig. III.
^)
Abhandl. aus d menschl
*) Aafangsgr, d,
n. vergleich. Anat.
Wundarzneik. B. 5.
§.
5ôQ.
u. Physiol.
p. a84' 3o©»
374
Onmia
observavit
biûda
Ibdomihis viscera
imiTio
Uuchmann
i-efeit
Aliter
aiitf>in
enim ox proclivitate
teni
n^quc
mïrd
nostro
hkckel
in
monstro
Iiepatis ad iinterioiem
umbilicum
interius
cnm
spina
habuit ;
etsi
siinul
F.
et J.
^)
res
exOmpIialo contenta
tali
Exoniplialmn
').
Saiidifoft
in
').
se
abdominis parie-
accreti ,
esset
facilis
conclusio, hiijus etiam
infantis
viscera
pdiis extra umbili-
cum collocata fuisse ;
in
nato
tamen
infante
consolidata
jam umbilico, intestina cuni he}3ale comprehensa jam erant
in
cavo abdominis ,
phali ,
nilûl jam
ut
ita
observaretur
seu herniae connatae extra umbilicum ,
intestinuni ,
exom-
nisi
ileoii
non forma herniae , sed loco pénis exterjus a
pube pendulum.
Singularis oainino haec erat
abnormitas,
ncmini forsan hucusque observata, quam ad intelligendam
loci theoriam
opus erit commemorare hic
quam de
umbilicalis ,
de usu vesicLilae
structura animalium in génère inge-
nio&issime proposuit Okcn
")
quamque de
,
observatis confirmavit Kieser
').
specie hiimana
Erit illa nobis aiixilio in
')
Ephcm.
")
Obis.
3)
Handb.
+)
Okcn und Kiaei-y Beytragc d. vcrglcich. Zoologie,
p. 3. Heftll. pag 84. Tab. IV. Fig. III. IV.
^)
nat. cur.
auat.
d.
Dec.
II.
6.
c.
p. li.
L. III.
pathol.
Anat. B. 1. p. i35.
Dcr Unpiung des Daripkanals
Gottingcii.
app. obs. 45.
a.
pathol.
aus dcr
p.
54..
i8o6.
vciicula umbilicalis 1
Ileft I.
1810.
375
demonstrarvda origine hiijus inonstri , fors et monstrnm in-
aucLoribns
sciviet
umbilicali
vc.sicula.
m.ie
de
illae
deraonsttavit
in
priniis
ventilata nondiim
iroljjins
diebus extra
res
lit
illo
ait,
adhuc
deprehenduntur
embryone
in
spuiii,
cum de usu ve-
tcnipore inter physiologos satis
ex
piopriis ejus
adeo
prima
imperfectum
aliorumque
illa
periodo,
et
angustum
in
illa
funiculo umbilicali ,
dnplici
dccunentia, quarum iina intestinum tenue, crassum
altéra
dénotât ,
ccns
tenue
,
abhinc annis
ut ejus in cavo intestina contineri nondum pos-
sint ,
série
jain
cavnm abdominis con-
dcductam ,
obseivatianibus
est,
in
incubatis
fucrit.
embyronis abdomen
qua
ovis
in
intestina
') ,
Juxta stntenliain Okcnii ,
aiictorum
exactissi-
iate&tinoriun
cavitate amnios,
iimbilicalis
sictilae
hnc fdciunt
qiiarmn opp quadiagiola
puUi gallinacei
tincri
^laltuin etiam
fain>.itione
obscrvaliones ,
abunde
conûrniandam theoriam de
ad
vic,issi?Ti
iitrumque in cavitatem abdominis delites-
nimirum
fine
interno sursum continuatur ser-
pcntinis ductibus ab umbilico ad ventriculum, crassum vero
per
interiora
intestini
finitur
in
anum.
Arabae utriusque
extremiates externae, paralello situ sibi contiguae,
immediata
*^
desuper
tune
continuatione
Nov. Comment. Acad.
T. XIII. pag. 47Ô«
scient.
hiant
in
vesiculam iimbili-
Imptrat. Petropolit. T. XII.
p, 408.
375
calem ,
tamen
hac vesicula ,
intestina in ipsa
munis quasi bulbus, e
Non continentnr
amnii positam.
cavitatem
extra
sed est haec com-
pênes invi*
qiio intestini utritisque
cem emergit principium, quam ob rem bene docet Okenius,
suam trahere e vesicula
intestina originem
umbilicali.
Ea
jam proportiône, qua augetur imi ventris capacitas, quaque
is
suam magis magisque
cavitatem
in
paullatim
introtrahuntrilr
quo
ut externae
fit ,
elongentur ,
intestina,
haec per umbilicalem finiculum,
eorum extremitates continuo magis
extcnuentur.
et
adsciscit
Tensione hac indies aucta^
vesiculam inter et intestina commune quasi porrigitur col-
lum seu ductus umbilicointestinalis ,
stantia
relativa
vesiculae
donec
successu
temporis
adeo, ut
hac
quodam
cujus
umbihcalis
ipsum
illud
interventu di*
augetur
collum extendatur
puncto obliteretur penitus,
in
continuo,
et absoluta
obliteiatione rumpatur cohaesio> atque intestina dere*
linquant vesiculam, ipsa particulam colli secum trahentia.
Exlemae tune utriusque intestini extremitates, quae semper
sibi
in
situ
paralello erant contiguae, nunc sibi res-
pondent ad angulum, qui valvulam
coli efibrmat in pos*
terum, tractui communi quasi intermediam.
tem particula
illa
colli,
quam
intestina
Exterius au-
secum abripiunt,
mutatur in intestinum coecum, cujus processus vcrmicularis
cxtenuatam
colli
obliterati
caudam
refert.
Post spon-
377
vesiculae
t.iiieam
illam
ulterior
succedit
niinis ,
atque
dantur
ila,
umbilicalis
inlestinoium
musculi
ut
in
scparationem
inirotractio
in
sensim
cavum abdo-
iimbilicalem funiculum clau-
ciica
normali nativitatis tempoie nihil
statLi
jam inlestinoium conspiciatui exterius.
Nostro in subjecto natura huic regulae aliqua tantum
ex parte obtempérasse videtur, ex
conditione
erroneum
cruitur,
facile
impcrfectnm
et
fuisse caus.im
lolius
obliterationis
,
quae consticta ;ialurae le^e
tractu
intcslini
jara
in
e}us
allitudine ,
Cum
scilicct
ut
infima
enim abnormitatis
illius
opus fuisse
huncque conformationis
abnoimitatis.
intestina inteiccdentis^
ipsa
in
Jlla
média
errorera
nimirura obliteratio,
visiculam tt
colli ^
parte absolvitur, hoc in infante ipso
CQntigit,
crassi
colon
inde
et
quidem
coli
tanta
brevissimum.
resultaverit
tantum adesset
in
portio,
recto
jam
proxima, videtur dcficiens ejus principium propter oblitejationcm ,
Exclusa
parte
ita
potius
sive
nimis
loco
alto positam,
cvolvi
excludcbatur
coli ,
futura cjus origo.
non potuisse.
simul et coecum,
Quamprimum enim collum
vesiculae non dchisccbat Icge solita in mcdio, sed ab ipso
canali
inlcstini
proTïima,
et
simul
coli ,
seccssit
cum
sc-d
illa
crassi,
immo cum portione
collum vesiculae intcgrum ;
vcsicula in
etiaiii
MimoirtiitVAcai.
\"el
T VL
vanum
pars
colli ,
cjus
abiit igitiu-
absccssit non soltim pars
quac coeco elTormando
4^
37S
esse
(Sestinata
Intestinum
soict.
quod ab-
obliteraLione colli vesiculae in ipso separationis il-
soluta
quo valedixit vesiculae,
lius piocinctu,
ro crasso respondere debuisset
dam
autem tenue,
valvulam ,
coli
in
ja
m niinc intesti-
continuum ad etTorman-
errore typi normalis seorsim a
collo
vesiculae solutuni fuisse videtur, aut avulsum ; nnde fac-
tum
ut nunc ,
est ,
introrsuni
delitescente,
deielictum
retardatuni,
sedem futuri pénis occuparet, ibi-
in transitu
cum non
q^ue
coeco , et colo praepiopere
déficiente
haberet,
Neque
fine
hiante ,
libère'
cui nec locus
modus valvulae.
desnnt exempla, in qnibus tenue sépara-
alia
erat a crasso.
tunr
et ipso
cuinam adliaeiesceret parti,
lesiduum dependeret a pube ,
erat inseïtionis,, nec
exterius iléon,
In distantia separati ilei et coeci
in-
tercessisse vincula
filamentosa et cellularia, refert DesgraH'
ges
caecos
')
;
fuisse,
ubi
quideni
his
alio
testatur
tractus
dircmta
in
in
intestinalis
fuerit
hi
ipsis
i) Journal
Osiander
nostro
Bulletin?,
erat
adeo'
obversos
bipartitus ,.
intercedente
haud
ut penitus
pancreate..
satis analogi
,,
Sunt
nihilominus
utrunique intestinum erat scparatum, etsi anibo
de Med. par Corv'isarfy an X.. Thermidor.
^ Neue Dciikwiir.'ligkeiten etc.
^
sibi
imma casum notât yJubery ^j,
');
continuitas ,
casus
interruptionis
fines
I.
de la Socic^tc de Mcd.
B.
I. Tli.
p.
1806. J,aav.
17g.
379
abdomine, ut adeo millnm constet •exera-
«continerentnr in
pluin nostio pciftcte simile.
ratio
ex
iisdem
Ctini
tamen illomm qiioque
eo solum dis-
deiivanda veniat,
fonlibiis
iitrumqne intestiiium, abnormi obli-
crimine, quod in
illis
tcratione laborans,
cavum .abdominis receptum fuerit, inte-
Tim
diim
fuciunt
in
alterum
hacc
omnia
tamen
Okeiin de usu
tatis
nostio
retardatum haeserit,
exteiiiis
confirmandam
ad
vesiculae umbilicalis, et nostram monstrosi-
explicaLioncm in dalo infante .comprobanL
Quantumvis doctrinam hanc, ab Okcnio
excogitatam ,
et
ar2;(imenlis
experimcntis oppngnaie
et
et
a Kiesero et Mcckeîio
Jlofstetter (vide
Aiiteniieth,
nint
Band
entianim
annos
cula
l.ucae
hortim
intestinorum
in
Caesaieae Academiae sci-
qnodammodo
htijus
doctri-
animadversionibus de diyerticulis
Lucae anat.
originem
quae jam ante
CoiifunuUur porro Okcnii the-
im Darmcanal. A%rnbcrg,
culorum
tcet
(vide
actis
prima
nae fundamenta posuerant.
intestinorum
tentaverint Enimett
observationibus ,
in
Petropolitanae
rcccntioribiis
excnltam,
ulteiius
iSop.), nihil tamen detrimenti infe-
IVolffii
scx
ingeniosissîrae
Aichiv fur die Physlol. von Reil luid
:
IX.
gravissirais
qiuidraginta
Oiia
doctrinam
Donerkk.
die Diverti'
ïiher
i8i3.)î qnibus ille diverti-
codem ex
embryonibus
fonte , pristina sçili-
bipartitione
/l
redundare
o *
38o
nnde
dorct ,
sehiin
disciiiDino,
tùmis
luiJLis
tcr
monstri
et
ciiiod
genesim derîvavimns ,
nostri
nitnlcMn
j'.ixtii
biparli-
Liicac loctis
cmbiyanibiu non
in
inteslinuiUiii
eo
constan-
iil
idem.
Ties propeinodtim
de
loco
prima
pailitionis slant sc-nk-ntiae :
ilkim
sru
in
parte
inia
et
Okciiii
ad valvulam coll ;
siipponit
valvulam ,
pristinnc intestiiiomm
ilei
;
alicra
Mcdielii,
supra
terlia
deniqiie
Lucac,
modo in tenaij modo in crasso intestino sedem
pio
naUi
re
coiuin
altciLUiLim
bi-
Kic^erl lociiin
indicat,
cvolvaUir
piins
et
nt
ex-
act! us.
Piimae
speciei
fere
adsciibimns
nn^trn'ri
ceito enim adorât separalio
loco
in
fiilurae
val\ulae coli^
adcrat enim iléon,
de» rat
rationem
ipso loco valvulae coli, ad
fuisse
in
coccum,
fbrmandam crassum conspiiare
iinde.
debiîisset
exompTum^
colligimus, sepa-
cum
quam con-
tenui,
Quemadmodum vero ex abnorniitate intrstinorum hujus
iponstri
confiimatur thcoiia Okciiii de migialionc intcslino-
lum
embryonibiis,
in
servit ad
formatione
ita
idem hoc monslrum
qiiocjne
corrobor.indam sentent ia m
vesicae
iléon
intest inum
ï}
Handbuvh d.
uiinaiiae
rctardatione
p^thol. anat.
7.
F.
Meckelii
').
Si
enim
sua
ad
exterioia
1814.
iJ.
L
pag. 716.
in-
de coii-
consideremus;».
pubis de*
3Si
tentnm, et membri et mcthrae occupasse lomm, rorximqTTe
praepedivisse
eiii,
cldsain
T>;
exisU-ntidni ,
quocjue
\'f-!cain
ni ICI
fuisso,
et
Si
,
euni
copd'oiînanLiir
scilicct
at(]ue
/ciaveiit in
faciJcy
quoad
retaidaluni
statu
in
vosica
evolutioni-s stadium^
itltciccdente
usq.ue post
ilca
piohibita
nativilatcni peisc-
enibiyonis.
Con-wruit hoc phacMionirnon
bus
,
bipailitionis primitivo,
statu
coinposilio
infant is
quac
,
inti. lîigitur
pcistit:sse
ejus
sit
vesicae fuisse abnoimeiij non
quoad
lantnm
nlterior
fueiit,
posr.
emb'vonum le^^e
pailes di\isa
in
U:iica:n
sed
vrsicani
du.is
sein[)>M"
V'^«ic.j!ii
monst.ro slatiini
in
Meckelii vo^ica
tncntein
priin tus
in
situ
exiioisum inversa nuuniiiiliae labiae.
villosa
JMXia
jani
norinali
ciiilibf t,
fonnam.
Hientirbatur
sciius
cx-
Quae
Litciik
suus e \cnc lespondobat uirtor, cujus-
insolito,
mciiibiana
Tcm
piimordiis itle£;atarn in
a
sua
sxmIc
m lUiocjive in ini.;njne adjjarcbat papilla, aliud nihil
nali\'ilaLcin
cjue
iiiu.iiddvcitc ndiim
iuiluic
co ipso âc
quain scMnivcsica uiinaiia, qiiartim
eiat,
lioc
m.igis
iirinciiiaiîi
o-bservalionibus
aliis,
qnam
cnm
aptissime
dua^-
quarum unain notât Fohiii
')
-,
akeiam Soemmcrrlii^
-) ;
exemplis- innix.us,
indux,it Mcckcllus, simillimiim
rite
period.
*)
SedHlot Recueil
*)
Tc/^, Qiiatst. mi;d.
at(}ue
hisce
T. XX T. pag. 353
varii
nrgumcmi.
aliisque
monslrorurri
duabus
— 3"4'
Harderovici
lygi-
p. ^3-
382
«X laminis esse cnvrarum corporis humani ortnm
«icam urinariam
inveisain
titam, ut
vi,
inilio
sese et prolapsam sistat,
et intus
trahi
docuit
jam
drtar
in
Si
eiit
:
forsan
et bipar-
dcin convol-
qiio
datnr
sicuti
icciproco hoc in
forsan
quaedam analogia qtioad modiim,
opus peragit
'^^e-i
').
foeta a5cen=;iis vcsicae,
descensns ,
testicLilorum
apertam
exteriiis occurrere
et
,
processu
natura diveisum id
urachus vesicae, qiiod guberna-
culuin Ihinten est testiciilo, et in casLi retaidationis vesiexteiius inversa, sicut a letaidato tesli-
cae
manebit
CLiIo
inlus lalet testicondiis.
illa
Mammillas .autem inguinales hnjns monstri quod
tinet,
«id
omnem
-evitandam
suspicionem,
an
at-
consi-
illae
non fueiint pro supplcmento monslroso mammil-
deiandae
larum pcctoris, transpositionis Insu forsan
ranlium, supra
j<im
in inguina aber-
monuiinus, infantulum papillis mamil-
larum normalibus instructuni
fuifise
superficie pecloris,
in
sede légitima.
Quod
ratione
ilei
contigit
contigisse videtur utero, ocupabat
solite
loçum etiam
uteri,
unde
vesicae
enim iléon
et ille
1.
c.
p. 716.
734-
situ
quoque duo
puscula olivaiia scjuncLus dctincbatur ad
i)
urinariae ,
latera,
idem
suo inin
cor-
non inver-
sis
qnidem.
fandus
paiietibus ,
et iitcrOj- sictit vesicae
tamcn
ininiutato
corpiisculi
utiiiisque
uterini
sitii
esset
adeo
inferius.
tit
,.
Fors;
urinariae, prima embryonis peiiodo^
bipartitio et silus inversas, conditiones sunt staLii normal!
fiimiliares,
AdnG
t a t i o-
IV.
Splna Bljida.
Au tumorem, irr regione sucrali hujiis infantis positiim,,
pro hydrorhachitide,. utrum. pro spina bifida habere
liceat,,
diJLidicanddm superest,. quam: ut exactius resolvamus quaes-
tionem,
propius
examinanda
erit
utriusque-
vocis vis et
significatio.
Spina
bifida
et
hydrorhachitis
seu hydroihachis pro
synonimis haberi soient impropiie,, realis tamen inter iJIas
intercedit dilTerentia:; datur enim hydrorhachitis sine spina;
spina
bifida ,
quondam
autcm
observatur.
bifida
sine .hydrorhachitide
rarissimô
Hydrorhachitis; nlmirum,, seu aqua-
mm collectio in specu vertebrali, locum habet aliquando
sine ulLi spinae dorsi fissnrra;, ubi vero' fissae sunt spinae,
plerumquc' subsunt aqiiae in specu,, vel q^ualecunque de-
mum
nisi
extravasatum
hic
distrudete
uniciis,.
volet,
aliud ;
vix:
enimi
morborum. aliquis,
scnsim sine sensu spinas vertebrarum
ut
fijiddntui instar juguli,
eO'
dum. spinas.
384
irt
Halleii
vcibis ntamur, aut non sinît coire, ant maie
')
dividit
conglntinatas
hdcc
nibus
fissiuae
processus spinosos
^)
ossium
conformatione
aut
,
quasdam
spiuas
quare
penitus ,
esse
spina
ipsa
vèrtcbrarum
in
om-
prima saepe
a
sive potins im}:>erfectos,
fissos ,
aliasve
,
tamcii
abunde cnim deinonstravit
ratio ,
est
l\luiray
Ncquc
oblitérât.
et
\'ertcl)rarura
partes
deficere
pleriimque vcl connata
bifida
apparet, vel primis sallcm infantiae
solct temporibus,
oriri
donec spinae adhuc vcl cartilai^incae, vel tenerioris saltem
oseae
compagis sunt
fissura
visa
rarissime ennn
:
jam
spinis
est,
adultis ejusmodi
in
Qui de
solidioribus.
spinis,
vi externa ruptis, notantur casus , hue rcferendi non sunt,
cum
hic
illa
solum spina
quae
bifida ,
ex hydrorhachitide.
oritux
Eadem
dam
loquamur de
loci
igitur
interccdit
intcr
ratio,
hydrorhachitidem
quae
inter
causam
et
spinani
et eflectum ;
bifi*
iis
ubi hydrorhachitis spinas dorsales dis-
scilicet
in
casibus,
trudit,
erit
spina bifida effcctus hydrorhachiîidis; ubi \e-
ro
connata
aquas ,
in
spinarum
ratione
spinae bifidae.
ctsi
spina non
reciproca
Cum
sit
fissura
temporis invitavit
succcssii
hydrorhachitis
bifida,
T. IV.
distinguenda
erit
')
Elem.
-")
Spinae bifidae ex irala ossium conformatione
pliysiol.
erit
clfectus
tamcn hydrorhachitis existere possit,
p,ig.
hydrorhachitis
87.
initia.
Gotting. 1779»
385
in
clausam et
extiavasatuui aqnarum, in spccu coërcitum;
seu
tebralis,
clausa sistat hydropem specus veï-
fissara, iit
cum evtravasati tumore, ad ex-
vcro spinam bifidani
fissa
teinam dorsi supeificiem conspicuo.
hydrorhachitis
casu
Slante
hac
crat
fissa ;
\era scilicet spina bifida cuni tumore extrava-
siUi
in
est,
frcquentior enini occuirit in regione lumbari; laiissimus
dcnique
nostro
diagnosi ,
in
Raiior quidcm hujus loci morbus
icgione sacrali.
dorso aut coUo.
in
Qiiod auteni majoiis momenti esse, et singulaicm omnino
altcntionein
videtur ,
mereii
sibi
miia
monstio caudae equinae est transformatio, cujus
re
anatomica
notatu
videtur
exemplum
igitur observatio in
et cujus unica
nullibi deprehendimus.,
hoc in
illa
dignissima.
Aliis
enim
iïi
casibus spinae bitidae cauda eqnina, per hiatum spinarum
in
tumorein seu saccum externum egressa, extremis nervo*
rum suorum
finibus interno
et
eo
inseri ,
delineatur
more ;
_,
autem
nostro
abnormi ,
1.
in
vel
lumbarem
c.
.
1I(
id
in
primam
succedente
prorsus ,
res àlio
modo.
parieti affigi
Nullum formabat ,
altcramve
'
'
')
fatiscit ;
idque valde
ut intra
formare
!'
MimoimdetAcad. T.Fl.
solet
Mohrenheithil specimine
collîquàtione
subjecto
liabebat
se
vcrtcbram
')
quo
fere ,
ipsius sacci
49
solet.
386
medulla spinalis nodulum centraîem; nullam pono caiidam
equinam, scd individiia continua batur
nei vos
ut
in
spcciim sacralem,
inde reddcret sacrales anteriores ; paries
medullae posterior, nullos
in
nervos disjunctus,
aiiteni
scd con-
tinuo solidus et integer, per hiatum spinae sacralis bifidae
in
saccLim tunioris externum egrcssus, et sub egressu quasi
huic spinaruni
posterius insidebat
detruncatus
ipsi
instar folii
medullaris explanali, quod cinereae potius me-
dullae
spinalis
fisscnae
substantiae erat analogum.
Connaia haec
medullae spinalis abnormitas, cujus origo nec
erat
spinae bifidae,
tribuenda
lare aquis ,
serius
sicut
foict.
nec vi aquarum ,
Allutbatur
in
sacculo conlentaium,
quidem folium
e specu transcuntibus ,
illud
undique
profccto futurae macerationi obnoxium ,
ipsa
columna ,
medullae
fissurae
et
medul-
continuo,
nunc vcro
nec quoad coloiem ,
nec
quoad densitatem substantiae suae depravatum, quae pluribus in casibus, macéra tione diutius perdurante, vel emol-
vel colliquata, vel corruptione immutata adparere solet.
lita
Aquae, hoc in
quae
aliis
turaore contentae, erant limpidissimae,
in exempîis plus,
minus, cruentae aut ichoio-
sae occurrunt.
Aquaium fontcm
Ti cujus illae,
ler
posteriorem
internas suppeditavit hydrocephalus,
vcntriculo quarto ad infcriora disrupto, in-
medullae
spinalis
paiietem ejusque vagi-
as?
nam desoendentes, per spinam
bifidam ossis sacii in exter-
num tumoiis saccuni insiiniatae, colligebantur.
quod
Notavimus ,
tae
medullae
fuerint ^
quidem extremitatum
hae tamen extie mita tes
nervis ,
infeiiorum
praesentibus
scilicet
paralysi
affec-
spinalis pars infima,
horum
utpote nervoruni origo, aqnis in specu vertebrali contentis
'nimium compressa, non potuit non
quariim
ab incolumitate
functio
explicaretur incontinentia urinae
nervos
ad
intelligendam
recurrere ;
et
inversae
sacraliLim
uni-
ita
illornm
cum sympa-
vesica per totum
in
opas esset ad
incontinentiani
vero in statu vesicae disjunctae
cavum ,
deerat et
quod susciperet ,
si-
et
qui contineret lotium , ut adeo ejus incontinen-
spiiincter,
tia
per
magno anastomosin , siquidem
abnormi ,
mul
nervorum
Ex paralysi porro nervortim sacralium facile
ce dcpendet.
thico
paralysi partes,
afficere
abnormitati
prius
vesicae ,
quam
paralysi
nervorum
sacralium tribuenda fuerit.
Neque
si
mirum
cruciatus
id
fuerit ,
id
vitae
certe
quod vcl
fuerit lethalis ,
praetereundum
infantem
diem
ad
superstitem ,
poscere ,
silentio
cum
tôt
haec spina
stante
quod,
abnormitatis reliquae
decimam quartam
haud minorem
ipsa
,
inter
videtur,
ç.s5t
sibi
,
fuisse
attentionem ex-
bifida
hoc morbo
usque
prius jam non
excmpla
49*
vitae,
388
aliquot
dies
ultra
piolractae ,
sionem tumoris, ipso
quidcin
ignoraniLis
raiissima ob compres-
sint
Non
paitu plerumque letlialem.
siib
casus ,
quibus
in
vita ,
non obstante
spina bifida^ ad aetateni provecliorem usque perducta fuit,
païens
sed
noruin
eoiuni
quin(|ue
Mohrenîicim
Treji^'
Roscnstcin
refcrt
octodecim
adducit
annorum
^) ;
octo
annorum homo quidem ,
sed
mentioncm
fccit
cujus
quidem de spina
quod
illa
')
Anweis.
'•
c.
;
aliud
annorum
viginti
inimo
z.
Kenntn.
duinquaginta ctiam
non ejusdem
aetatis
Joann. Petr. Franc
u.
Kur.
d.
Kindeikrankh. pag. 65g.
pag. 176.
'*)
Nov.
^)
Acrel,
1.
)
Philos,
transact.
act.
Handling.
nat. curios.
1748. pag. 91.
T. II. pag. 3g4*
c.
Nr. 41 O*
Cases of Surgery, pag. 22.
de
Soc.
Roy.ile de
Med. 1784.
^)
Ilist.
')
Ontleed. heelkund. Verhendl.
Amstcrd. 17^7.
'°)
Dekct. opuscuJ. mcd. Vol.
pag-,
la
an-
'°)
morbus
;
qua
singulare id animadvertendum est,
bifida
^), Ye^f-Osk. akad.
'')
^)
exemplum
niedico Badensi, Buch, quinquagesimo
in
')
^);
Camper ^) ;
^).
septcni
annorum diiodccim
^);
Biidgen
viginti
annoiïmi
') ;
annorum octo Acrel
norum quinquaginta Swagcrmann
erat ,
spinam bifidam an-
Ita
annoiiim septemdecini Tf'else
4);
annorum
JVarner
-);
nmucrus.
est
II.
33.. ib
dcmum
389
anno sponte stipervcnerit.
aet^itis
ter ')
(le
spina bifida quinqiiagenariae mulieiis casiim refcrt,
lUiqno vi,
t|uàtn
ossi
sacio
isad
oitiim,
illata,
fractcuas potins,
Ciim cetcium
ad spinam bifidam connatam pertinet.
exempla
longacvac ,
oppido
sint'
Q.aem antem Hochstaed-
aut
illos
spinae
snboitae,
serins
casus
lara ,
bifidae
exceptionibus potius,
pro
quani pro regulis, habendos esse liquet.
Erant
rcm
in
,
in
qnibus pressione in caput adhibita ,
liydroibacliiiidis
aiigeri vidit Hehcm^treit ^);
tiimo-
erant
alii,
quibus, tumore spinae aperto, subsidebat, clauso, intu-
muit caput j
teste Rosenstcin ^);
in
aliis
denique dabatur
tnmoris intumescentia cuivis inspirationi synchrona, obser-
vante Roux *);
nem
inter
ininio
intercessisse
non milteretur lotium, tumoie
notât Mohrc-nheim
observavimus,
^)
geniosissiraam
')
Dissert, de spina
Bell
/.
bifida.
F.
nisi
et
nihil
1.
Journ. de
*)
1.
pag.
175.
hoc
in
infante
bifidae
eodem
Mcckeîil
observationem confir-
Altdorf. lyoS.
Med. T. XXIX.
ut
vesicac
pag. 660.
5)
iirinarias ,
vero
pag.
140.
inversae ,
in
pag. 491-
Lehrb. d. Wundaizn. T. IV. pag. 338.
4)
vias
pleno, aut arte presso,
omnium
liorum
et spinae
iterum
»)
c.
:
Coëxistentia
adhuc dimidiatae,
c.
nonnullis communicatio-
tumorem hydrorhachitidis
utut
subjecto in-
390
nuu, qiia
)
is
teste
Littre,
Revotât, Voisin et Delfinl, ve-
sicam inversani saepius, praesente simul spina
bitida,
occiu-
ad vert t.
lerc
i
Quod denique diversum lethalitatis spinae bifidae gradum
attinet,
expertissimo facile consentimus PortaVvo, sus-
pic ionem
moventi
equinae
minus foisitan inferre periculi ,
erit
*)
,
tumorem
hune
regione
in
quam
enim pressio medullae spinalis eo pejor ,
contigerit loco,
quo
altiori
cum nervi spinales eo sint functione nobi-
quo superiores
.liores,
caudae
superius;
EXpI
i
origine.
c a t i o
Tabu1a
r
u m.
Tabula V.
Partes abnornies abdominis externae, in situ naturali
delineatae.
A. A. A A. Plaga rubra, excoriata, parietis abdominalis, lusu
naturae tegumentis communibus orba.
B. C. D.
Linea
fere
parabolica ,
confines
communium limites denotans.
—
E.
Umbilicus.
')
'•
»)
Aa.it.
c.
pag. 735.
nicd.
Vol.
I.
pag. 3o3.
tegumentorum
391
—
F.
TLibcrcukim scipcrficiale paiictis abdominalis aliiid,
nullius momenti.
G.
—
Finis inteslini ilci,
II.
—
Oiificiuin
menibium
mcmbri
mentientis.
virile
ininae
loco al-
Convexitates scroti latérales, vacuae ,
ceu sac-
huJLis
spuiii ,
viim excernens
—
I.
K. K.
Scrotum inane.
culi
L.
—
sine
Styhis in anum, loco inconsueto inter postrenias
rugulas latentem^ introductus.
scroti
M. M.
N. N.
testicalis.
Papillae duae
rubrae
quasi
mammillares in in-
guine,
poro quaevis unico perforata,
Poi i
duo angustissimi ,
hi
occulti ,
papillarum
manimillarium inguinaliuin, urinam excernentes.
O. O.
Setae ,
papillarum poris immissae ,
viam urinae
indicantes.
Tabula VI.
Turaor spinae
bifidae,
in
nitudineni ovi
rcgione sacrali positus, maganserini excedens.
A. Ejns convcxitas extcrna, turaore adhuc integro a posterionbus conspicua.
392
Tabula VIL
Abdomen aperttim
lien,
cjus c
omentum , hepav, ventricultis,
:
cavo cxcmta ;
sLim
a. a. a. a.
Inteslina
colon,
intestina vero tenuia suriiacta.
tenuia,
altiiis
quid de loco mota ^
ut
paitcs subjacentes magis fièrent conspicuae.
b.
—
Finis
intestini
pans
(vide
sum
spectans ,
ilei ,
Tab.
I.
hic
membri
G.) ;
virilis
in
autem ,
locum occu-
statu naturali sur-
abdomine
discisso,
dcoisum pendulus.
c.
~
Odficium hujus membri
excerncns. (Confer Tab.
d.
e.
—
—
—
EJLis
extremitas
g.
H,).
superiôr ,
cocca , ccu
finis
coli,
deficicntis.
Stylus, per
ti
g.
I.
uiinae loco alvuni
Intestinum rectum, siliculate.
ceteium
f.
spuiii,
anum abnormem, intcr postremas scro-
rugulas latentem, tiajectus. (Confer Tab.
I.
L.}.
Corpuscula duo olivaiiaj penitus abnormiaj structurae uterinae..
h.
h.
Renés, quorum dextro dcfuit rcn suctenluriatus.
i.
i.
Uretères,
k. k.
Papillae
Tab.
1.
mammiliaics
M. iM.).
duae
inguinales,
(vide
393
1.
tid
rn.
urcferam
Oscilla
1.
hisce sub papillis hian-
exterriii,
Tab.
(confer.
N. N.).
I.
Stillicidium ininae, in Tab.
m.
I.
opç setarqm O. O.
indicalum,
Tahula y III.
Tiimor spinae
spinalis
a.a.x.a.
eum transiuis, compareat.
niedullae pcr
Margines
ut spinae hiattis, et
disseclus,
bifidae
communium
tegumcritorum
tumoiis
a
posterioiibus dissectorum.
p.p. |3.p. Caviias
rem ,
depletis aqiiis parietem interio-
tunioris,
vagina
medullae
spinalis
mednllae
spinalis ,
loco
a
conslitutum,
cxhibens.
y. y.
Finis
pcr
spmac
hianim
instar
folii
bifidae
inedullaiis ,
ossis
caudae
equinae
sacii
cgressus,
transveisini
ovalis ,
e.x-
teniiatus.
5.
—
Foramellum super
rcni
parietem
spinalis
sursum ducens,
—
Foramellum
introrsum
in
mednllaii intcr posterio-
niedullae cjusqtie
angustius
cenlro
in
bilidae.
medio
folii,
cocco
T.VL
fine
medullae spinalis brevissime
delitescens.
Mémoint dtVAtad.
vaginam
qua via e specu vertcbrali aqua
saccum spinae
fluxcrat in
£.
folio
^^
394
/.
—
ForatnelUim
angnstissimiim,
anterioiem
medullae
"vaginam
sursum
ab
spinalis
ducens
via
inferioribns
intcr
parietem
ejus
et
aictissima ,
aquis
carente.
-j^;
—
Massa ligamentota , hiatui
triangulari ossis sacri,
per
quem
SGt,
quasi obturaculuni transveisum superimposita.
finis
caudae cquinae
"•MMOC^tCVC
transiie
debuis-
395
COLEOPTERA CAPENSIA, ANTENNIS LAMELLATIS,
s I V E
CLAVA FISSILI INSTRUCTA.
DESCRIPTA A
TIIUNBERG.
p.
C.
Conventui exhibait die lyAug. i8i4-
Coleoptera Insecta , qiiae antennis clava
xit Sapientissimus Creator,
Classis plertimque aestimari soient, ideoqre
Entomologis adamata ,
riosis
pretio acqaisita.
speciosissimi
suis
ille
Pauca
agnoscunt ;
et
Âctaeon ,
Lucani, Cetoniae
pergrandibiis ostentans ,
simes
collecta
et
Siiperbiunt in miisaeis
mae Geotrupcs species ,
instrd-
fissili
inter speciosa et majora hujus
,
maxime, a cu-
non
summo
raro
magnatum maxi-
Hercules ,
Neptunns'.
Coprides,
et antennis
exiguus licet corpore ,
raris-
Ptyoccrus.
ex
hisce
frigidas
regiones ^
plcraque sub ardentiori Siiio
fera adustas
Giobi
terraquei
ut patriam
sitas ,
suam
calefactas
plagas incolunt ,
Africae,
Indiaeque utriusque feliciora climata amantia.
Q.iiae
australem
angulum Africae inhabitant,
usque E^iropaeis innotueiunt ,
et
hue
sequentes «numerant pagi-
5o*
396
nae, qiioriimque desciiptiones illusLr. Impciiali Scient iarum
Academiae submisse
Majorem
olTciuntiir.
partem
horiini
at dcsciipsi duduin
an-nis
17
porc omnino incoi^nitam,
et,
in
Capile bonne spci
17 73 et
2,
"7
1774, eo temnovanu
dici solet,
i\l
collei^i,
Pluies
deinde scientiae cultoiibii5 innotnemnt, paitim in piopiiis
meis editis opusculis, partiin
logicis.
SupeisLint tainen
•descriptae,, qiiae
blici
jiiiis
alioiuin opcribiis entonro-
in
adhuc non paucae
species,. heic
antea neqiie pcr me, neqae per alios pu-
factac siint:
tomologiae heiois
et
quaitimqtie
stiidiosis
idco delineationes
non omnino
ingiatas
È',n-
foie
speio.
iLUCANUS.
L.
cnpcnsis: niger, cylindricus, elytiornm snlcis pnnctatis. *
Lucanus capensis.
Thiuib.
Nov.
Insect.
Spec.
1.
p. 5.
f.
1.
GEOTRUPES..
G. Boas: thorace
retiiso
nu recurvo;
fjcotmpes Boas.
Similis
G.
prominentia duplici; capitis cor-
elytris luevibns.
Fabric. Eleutcr.
luisicorni
1.
*
p.
8.
magnitiidine , glabtitie
,
colore et tota
structura, excepta thoracis prominentia duplici, nec.
triplici.
G. ferrugineus : thorace bilobo, subtus
liiisutus.
•
397
Similis G.
nasicurni ,
neus,
Caput medio
SLibtus
costa
scd quadiuplo minor ,
vilidsiis
'
totus
ferr-ugi-
villo dcnso fenui^ineo.
tiansvcrsa, mcdio subcorniita.
T/iorrix'cOnVexns, àaU'ce obsoleie bilobus, iaevis,
EIftra laevia, coipore brevioia.
43^ r et usas: thonace
retuso^
capitis coinu
e.xciso,
femoiir
bus posticis crassissimis. !*
G oLrupes i^eLti^us.
Faiv/c. iLleuterat.
i,.
pag. 19.
Corpus magniiLidine Melolpnthae t'ernaZ/A', convexum; siipia
glabrtim,
Aiitennae
fissiles
piccum;
Limi.nis
Caput conico - elevatiim
siibLiis
luftsccns, villosum.
tribus uti
in
coinu
palpi rufae,
et
obtusiinij
subexcisLim , obsolète lugosum ,
inarginatiim,
ihorace multo an-
gustius..
Thorax siibangulato-rotundatus, convexus, marginatiis, antice
piano -retusus ,
ineimis
punctis
minLitissimis
impressis..
Scutclhim obuisiim, brevissimiim.
Elytra abdomine brevioia, laevia, glabra, marginata^ intra
sutura m stria unica.
Fcmora
crassa,
postica crassissima, inermia.
Tihiae brèves, crassae; anticae extus tridentatae, inlus uni-
dentatae, apice trispinosae; posticae extus muticae,
apice laminis quatuor compressis obtiisis.'
398
Tarsi ciliati, ungnicnlati.
Obs.
Caput
singuldie, applanatum in
conum erectum, bi-
fidum.
G. cornutus:
thoracis cornu
piTSsam; capite exciso.
Corpus magnitudine Scaiabaei
simplici ante
lacunam im-
*
stercoraril ,
totum piceum,
supra glabriim, subtus villosum.
Caput subquadratLim, depressum, marginatum, excisum,
in-
erme, thorace multoties angustius.
Antennae clavatae ,
fissiles
laminis tribus ,
piceae, articulo
intermedio globoso, pilis aliqiiot explicatis ferrugineis ciliato.
Thorax rotundatus, convexus, marginatus, antice laciina lunulata magna impressa, niiniitissime punctatns, cor-
nutus:
Cornu
in
ipso margine antico erecto,
catOj simplici , brevissimo.
Margo
trun-
thoiacis subtus
feriugineo - ciliatus; in medio linea glabra.
Scutelîum brève, punctatum.
Elytra abdomine paulo brcviora , imprcsso - rugosa , costis
aliquot obsoletis glabris.
Pectus ferrugineo - villosum.
Pcdes
ciliati,
pilis
fcrrugincis.
Feniora cpiîipressa, incrniia.
3"99
Ubiae posticae extns
qnadridentatae ;
apice
iinidenttitae ,
anticae extiis tridentatae, apice unidentatae.
G. Syrichtus :
tlioiace
recul vo
Geotrupes
Corpus
rotiindato glabro ,
simplici ;
elytris pilosis.
Fabnc. Eleut.
syrichtus.
magnitudine Scarabaei
i.
cornu
capitis
*
p.
itercorarii ,
j
6.
totum piceum,.
glabrum, punctatum, convexum, fulvo- viilosura.
Caput subiotundiim, depiessum, maiginatum^ thorace multo
Margo
angusiius.
anticus retuso - elevatus. Cornu
simplex, recurvum, longitudine capitis.
clava trifoliata.
\/4atennac fissiles
Thorax convexus, lateribus rotimdatns,
antice
pro
absque
pilis ,
capite
excisus ,
postice truncatus,
marginatus ,
inermis
margine subtus valde piloso ,
pilis
fui vis.
Scutellum brevisimum, obtusum.
Elytra convexa ,
striata,
abdomine breviora , marginata , obsolète
pilis
raris fulvis pilosa»
Pectus fulvo -hirsutum.
Abdomen
et
pedes fulvo -villosi.
Femora mutica.
Tibiae anticae extus tridentatae dentibus validîs, comprcs»
sae,
intus unidentatae; posticae extus ciliato-ser-
xatae seu pectinatae,
bispinosae spinis longioribus»
4po
Tarsi
G.
nnguiculati.
ciliïvti,
thoracc lotundcito incrmi ;
a/'Jt'>î :
lato
brevissimo ; corpore subius lufo-piloso.
Fabiic.
Geotrupes mies.
G. arator :
capitis cornu
Eleiit.
laevi
thorace
17.
p.
i.
subu*
ineimi niger ;
elitiis
Eleuter.
21.
punctato-
stiiatis.
Geotrupes
Fahric.
arator.
G. globator:
p.
1.
thorace punctato inermi niger; elytris pun-
ccato- stria tis.
Fahric. Eleut.
Geotrupes laborator.
Similis priori,
21.
p.
l.
sed thorax huic punctatus.
SCARABAEUS.
S.
Co)-yphûcus
:
thoi-ace
bicorni ,
corpore fenugineo. f
Scarab'àeûs coryplîaeus. Fahric. Elcut.
i.
p.
22.
APIIODIUS.
A. ater:
capite iritubeiculato, medio subcornutoi elytiis
stiiatis
Aphodius
ater.
glabijs.
Fahric.
*
Elcut.
A. ruficornis : thorace inermi,
1.
p.
elytris
11.
striato-punctatis, pe-
dibus anticis villosis.
A. ohlongus, conve.xus, ater,
pedibusquc
anticis
supra glabcr, subius pcctorc
villoso-rufis.
/^ntennae rufae, uti et femora aniica.
Capiit et thornx laevi.i, incimid.
EIftra
stiiata
stiiis
brunneus
A.
piinctalis, longitndine
muticus
:
thoracis
niger ,
Aphodii
antico elytrisque totis
Eljtra obsctira^ iinmaculata,
A. merdarias
Aphodius meidarius.
A. binotatus:
-Corpus
pediculi
maioris
rufis.
striata.
inuticus elytris testaceis ;
:
antico
ovatus, niger, -anguîo thoracis exLe-
magnitudine ,
riori
sca
merdarii ,
^ngulo
*
elytiisque fenngincis striatis.
iMagnitudiiic
abdomînis.
Fahric. Eleuter.
muticus
thorace
p.
nigro ,
elytris testaceis
pUncto nigro.
magnitudine
statura
et;
i.
sutura nigra. *
80.
lateribus lubro ;
*
Rlelolonthae
hoHicolaEy
depressum.
Caput oblongo-quadralum, marginatum, Tiigrum, glabrum,
punctatuin.
OcJ//z
fusco-glauci.
Antennae nigrae
articulis octo,
clavato- fissiles.
Palpi quatuor, interioribus brevioribus.
Thorax quadrato-angulatus, convexus, niger, marginatus,
lateribus sanguineus puncto nigio.
ScuteUum nigrum.
Elytra testacca,
et
sutura
glabra, striato-punctata.
nigrae
Mémoires Ht VAtad. T. H.
nigredine
versus
Margo
exterior
apiccm sensim
^^
402
medio singuli
In
latiore.
punctum unîcunï
elytri
subquadiatum.
Fectus et
dbdomcn
glabra ,
nigra ^
cinerascentibns
pilis
oblecta.
Pedes omnes nigii, glabii.
Tibiae anticae cxtus dentata?,
extimi paris longioics, spinosae.
A.
contaminatus
signatLiris
Aphodius
muticus
:
ater,
elytiis
striatis
giiseis,
*
fuscis.
contanii-natuS.
Fahrîc.
Eleiiter. i.
p.
77,
ONITFS.
O. apcUes:
capilis Gornu
albis,
Onitis apelles..
O.
aygulus
bievissinio,
elytiis cincrcis,
calli»
*
:
Onkis aygulus.
Fahric.
eapite
Elcut.
28'.
p.
1,
elytiis
tLibeixiiato ^
Fahric. Eleut.
1.
p.
testaeeis^
27.
COPRIS^.
C. oedipiis: thoiacis coinn piano snbtns dentato; capitis
tiuncato tridentato.
Copris oedipiis.
Fahric.
*
Eleuter.
1.
pag.
3o.
C. nonestrinus:. thoiaee bicoini utiinque impresso; elj"
peo
Linicorni,
Copiis nemestrinus.
integro.
Fahric.
Habitat in aceivis ûmi^
*
Elent.
1.
p.
quos peifomc.
Jt^
4o3
Corpus magnitndineScarabaeuin stercorarlum superat, totiim
aLiLim,
glabrum.
Capitis clypeiis liinatus, integer, marginatus, iitn'nque costalus Costa
ab
basi cornutLis.
ducta, teiuiissime punctatus,
occilis
Cornu cylindiiGum, erectum, siraplex,
clypeo brevius.
Thorax convexLis , marginatus
retiisus ,
,
latciibiis
utrlnqae
impressus, medio cornutus cornLTbus duobus ponectis
simplicibus, capite
brevioiibus.
Elyira abdomine vix bieviora ,
striis
Os,
pcctiis
marginata , clausa , striata
tenuissime ptinctatis.
et
Femnra ovata,
abdomen
antice feniigineo - pilosa.
crassa.
Tibiae dentatae.
A itcnnae fissiles palpiqcie rtifescentes.
Similis C.
molosso, a qiio
vix
diflert^
1.
magnitudine minoii ,
2.
elytiis striatis.
Simiîem e China
1°,
habiii,
nisi
et
omnibus partibus majorem :
thorace tiuncato, letuso, costa, transversa répan-
du - dentata ,
et capilis
cornu brcvi latiusculo
bfido ;
'^0.
aliumque thorace, ut
stae
magis exsiantibus
in priori,
sed angulis co*
et capitis coraii
conico , simplici
5i
erecto,
404
C. Jachus: thorace piominenLe bilobo;
Copris
curvo
siinplici.
jdcluis.
Fabric.
C. splcndens:
capitis cornu
*
Eleiiterat.
thor.ice
i.
acneo
pag.
3i.
coinubus
duobiis
C. Jiainadryas :
Fabric Eleutcr. i.
p.ig.
thorace tricorni intermcdio
C. caelatus
:
Fabric. Eleiiter.
ihorace
talo ; capitis
Copris caelata.
trîretiiso
i.
piano
aciito»
36..
p.
tricorni
32.
*
bidentato,,clypeo reflcxo bicorni.
Copris hamadryas.
nigris
*
compressis; capitis eiecto apiee compresso.
Copris splendidulus.
xe-
medio' qiiadriden-
elongato recurvo^ intus unidentatO; f
Fabric.
Elcuter.
i.
p,
37..
C. sexclcntatus: thorace retaso sexdentato*;; capitis cor-
nu recurvo
simplici.
*
Corpus magnitudine Scarabaei vernallSy convexum
,.
atriim,
glabriim^
Capitis clypeus semiorbiculatus, antice rotiindatiis, excisiis,
marginatns ,
cornuto,
dcpressus ;
postice
callis adspersus,.
margine subtus
ciliatus.
truncatus
vertice
latitudine fera thoracis,.
Cornu simplex ,
longitii-
dine dimidia thoracis, reciirvatum.
'y^ntennae fissiles clava triphylla_, piceae..
Thorax rotundatus , marginatus; antice
retiisiis,
praemorso-
sexdentatus^ callis adspersus: Dénies quatuor, in-
4o5
termedii minuti, latcidlos duo majores; postice laelatere iitroqne
vis,
puncLo impressus, convexus, me-
dio obsolète sulcattis.
Elytra clausa, convexa, abdomine paulo breviora, pimctis
impiessis striisqiie obsoletissimis exarala, laevia.
Subtiis
omnia glabra, pLinclata.
Femora mutica, piloso - cilLita.
Tibiae anticae extiis tiidentatae,
apice unispinpgae; posLi-
cae extus unidentatae, trispinosae.
Tarsi ciliato - serrati, iinguicuiati.
C. sagittarius:
C.
sagittarius-.
hyaena:
basi
atitice
mucionato^ capitis cornu
*
e recto.
Copiis
thoracc
Fabrïc Eleut, r. p. 41.
subbidentato ,
thorace
dilatato.
capitis
f
Fabric. Eleuter> l. p.
Copris hyaena.
5i.
C» hispanus: thorace mutico; clypeo
elytris
niito;
tissimis.
Copris hispanus,
Corpus
Capitis
femoribus intermediis remo-'
Fabric. Eleutr. 1. p. 49.
Scarabaei
stercorari
paulo
majus,
nigrum, glabrum.
clypeus
caliis
slriatis^
capitis exciso cor-
*
magnitudine
totLiin
cornu erecto
lunaris,
tectus ,
marginatus,
costis
antice
exciso - fissus,
duabus lateialibus , cornutus»
4o6
Conm in vertice siniplex,
rectum,
thoracis longî-
tudine.
0,9,
colhim
clypcns
et
yfntennae clavatae,
rricirgine
stibtus
fcirugineo-pilosa.
rufescentes.
fissiles,
Thorax marginatns, antice late lunulato-retusus, postice
rolundatus, callis sparsis rugosus, niarginc postico
magis
€um
marginern
Intra
laevi.
lateialem
costa
fovea depressa.
Elytra maiginata, abdomine breviora,
gulo praeler marginalem octo
striata,
in
striis
sin-
teniiibiis.
Pcctus punctatum, margine et jnxta feinnr pilos[im.
segmentis
Abdomen punctatum,
posticis
anoque
riigosum,
supra punctatissimo.
Femora crdssiuscula, angulata, punctata^ intus
Tihiae
secundum
affi^itur
dentatae,
angulatae,
basi
hirta ;
par
longa.
apice incrassalae,
bispinosae
Tarsi arliculis quatuor, triangularibus, comprcssis, dilatatis,
valde
pilosis.
C pcctovalis
:
thorace mutico ;
clytris striatus.
Corpus
m.ignitudine
recurvo ;
capitis cornu
*
Copridis
michicornis ,
totum
atrum,
opacum.
Capitis clvpeus rotundiitus ,
maiginatus , integer
angustior , uiargine subtLis ciliatus,
callis
,
thorace
rainutis-
40T
sfmis
adspersLis ,
brns ,
simplcx
ociilos
Costa
Antennae
tissiles,
Subtus intcr os
et
vcitice
,
fcre
Cornu
rccrinr-
thoracis.
InLcc
tiansN-r-isa.
laminis tribus,
pectiis
macula magna glauca.
Tkoror roiundatus, convexus,
Jaevis^
niari^inatiis,
freqiien-
utroquc maigine
callo glabio in
callosus ,
tissime
enrnutus.
longitudine
notatLis.
Rlytra abdomine paulo bievioia, marginata, striîs obsoletis,
punctis
octo
minutissimis
exarata ,
nigra ,
imma»-
Femora compressa ,
mtitica.
Tibiac
anticac
cuLita.
Pedes piîosL
extus q^uadiidentatae, apice
intiis
unidentatae, com-
pressae ; posticae angulatae, ciliato-senatae.
brevissimi ,
hinodis:
capite
imiiinguiculati^
antici
biiinguicnlati,
postiei
C.
angustissimi,
Tarsi
thorace
miitico
bicostatOj
antice
elytris
transverse
laevibns.
costato ;
*
Paulo major Copnâe nuchicoriù^ totus ater^ opacns, convexus.
Capitis
Thorax
clypeus
rotundatus ,
Costa
mcdio transversa
in
convexus ,
versa
antice
subbiloba.
pEessLim.
intcger ,
retusus
la
reflexo-marginatus,
et alia versus
costa
utioq^ue
in
basin.
medio
trans-
latere puncttuii
im-
40 8
Elytra vix manifeste
C.
stria ta.
thoiace
clllatiis:
miitico
occipite
ciliato ,
tuber-
*
ciilato.
Magnitudine paiilo
minor
Copride nuchicornl ,
totas ater,
opacns.
Capitis
clypeus
integer margine
rottindatns ,
medio costa transversa obsoleta ;
reflexo.
In
in occipite tuber-
ciihim crectum, minimum.
Él}1:rn
l.ievia,
vix manifeste
striata.
Femina paulo minor tuberculo
minori.
capitis
ATEUCnUS.
A. saccr
clypco
:
tibiis
Ateiichus
thorace
scxdcntato ;
posticis ciliatis ; elytris
sdcer.
Fabiic.
Eleit.
p.
i.
incrnii
lacvibus,
54.
A. lacvis: cJypeo sexdcntato ; thorace gibbo
gine punctato-crenidato.
crenatoj
*
laevi, in^jr-
*
Atcuclio sacro duplo minor, totus ater.
Clypeus
Ciipitis
sexdentatus.
Thorax gibbus, laevissimus, margine crcnulato
ciliatns.
Elytra convexa, marginala, laevia, obsoletissime
A.
))iiis:
clypeo
elylris
scxdcntato;
lacvibus.
*
thorace
striata,
pvmctato ciliato*
409
Sîmiîls
omnino Ateucho saov ,
sed quadixiplo minor ,
lo-
tus ater.
Capitis clypeus sexdentatiis.
Thorax convexus, punctatus,
ciliatus.
El/tra convexa, lacvia.
A. minutus: clypeo sexdentato, pedibiis posticis elongatis.*
Ateuchiis minutus. Fabric. Eleuter. i. p.
56.
A. Intricatus: clypeo sexdentato ;.thoiace punctato coselytioiuin callis quadialis. *
tato;
Ateuchus
Fabric.
intricatus.
Eleuter.
A. bacchus: clypeo quadridentato;
que
glabris.
Ateuchus bacchus.
i.
pag. 56.
tliorace
gibbo
elytris-
*
Fabric.
Eleuter. i. p.
5 7.
A. barbatus: clypeo quadiidcntato; capite tliorace pedi-
busque
barbalis.
*
IMagnitudine ateuchi sacri ,
sed magis gibbus ,
totus ater,
laevis.
Capitis clypeus angulatus, quadridcntatus, antice cuin incisura laterali
Tliorax
minori ciliatus.
valde convexus, punctatus,
erecta
barba postice
lonoiori.
Elytra gibba, marginata, obsolète
Tibiae valde
ciliatus
striata,
punctata.
hirsutac.
A. ciipreus: clypeo exciso supra ciipreus, subtus violaceus.
Mémoires ne l 'Acad. T. 11.
^2
•
410
Atenchus cupreus.
Fahric.
i.
p.
59,
Krnm - livier et alibi.
Habitat in stercore ad
Corpus
Kleuter.
magnitudine melolonthae horticolae
paulo
majus^
subdepressum, totum snpra riifescens et aencum for
veis impressis; subtus violaceiim, glabriim.
Caput angulatum, excisum, arcu coslaque
elevatis.
trifoliatae.
j!4ntennae fissiles^
Thorax angulatus, maiginatiis, pro capite
lotundatiis ;
singulo
in
lateie
cxcisiis,
punctum
postice
maJLis
et
profundius impressum.
Elytra abdomine
paulo brcviora,
Dens
clausa..
absqiie piinctis,
striata,
lateralis nullus,
licet
elytia co loco.
contracta..
Femora
latere inteiiori
T'ihiac
iitrinque denlatac, conipvessae.
dentata, crassmscula'^
Tarsi spinosi^ minimi.
A. flagcllatus
scabris.
Ateuchus
A.
clypeo cxciso niger, thoiace elytiisqne
*
lldgellatns.
c allô sus:
pillosis.
Ateuchus
:
Fahric.
Eleuter.
i,
pag.
clypeo exciso ; thorace laevi ;
*
scabratus.
Habitat juxta uibciii
Fahric.
in
Elcut. 1. pag.
sleicoïc equino..
59.
Sp.
elytris
pa-
*
411
Totus ater, opaciis, magnitudine melolonlhae hortîcoïae, depressiis.
Capitis clypeus subtiiangularis, marginatns, antice retusocxcisiis
cum incisara laterali obsoleta
,
postice
ro-
tundatus.
Thorax convexus,
i
m marginatns, punctatus, antice retusus,
lateribus dilatattis, elytris latior, postice rotundatus.
In
medio costa glabra inteniipta.
Elytra marginata, abdopine paulo breviora;
rie
sextiiplici
papillosLim papillis globosis nitidulis.
Femora mutica; anteiiora
ex pilis
singiikim sé-
macula splendenti
latere intcriori
fulvjs notata;
Tibiae anticae extus denti-
hus quatuor validis armatae; posticae utrinque dentatae
dentibus
minimis
pluribus.
Tarsi valde te-
nues, unguiculati.
ATspinipes: clypeo exciso, femoribus posticis bidentatis.
SimUis
omnino ateucho
Sclicfcrij
sed paulo major,
totus
testacco - fuscus.
Clypeus excisus, rotundatus, niarginatus.
Thorax convexus,
Elytra
ciliatus,
striata.
Pedes intermedii elongati;
femora tibiaeque spina simplici
magis elongati^
armata.
Postici
bispinosis
spina baseos majori.
femoribus
crassis,
Tibiae ciirvatae.
52 "
412
A. costatus: clypco exciso fuscus, elytris
Inter
tiicostatis.
*
minimos, magnitudine Pipeiis, totus cineieo - fuscus,
pulveiulentiis.
Capitis clypeus cxcisus.
Thorax convexus.
Elytnim singulum
tenu bus notatum.
coslis tribus
i
Pedes postici elongati, curvati, ineimes.
Cetoxta.
C. piihcscens :
obscure
niaigine albo
Cctonia pubescens.
acnca
thoracis
segmentorumque
bipunctato. f
Fahric.
Eleuter.
2.
pag.
i38.
C. hirsuta: obscure aenea thoracis marginc albo;
tricostatis.
elytris
*
Similis cetoniae puhcsccnti,
scà minus virescens, et minor,
obscure acnea^ supra pubescens: su buis aenea, im-
maculata, hirsuta.
Thorax marginatus, postice
intra
marginem lineola
alba.
Eljtra punctata costis tribus in singulo niiidioribus.
C. atra:
atra,
glabra elytris obsolète tricostatis.
Habitat prope Svarlkops rivicr
et
*
Zout-pann.
Corpus cctonia aurata paulo minus , dcpressiusculum
inm glabrum, atrum,
sis
tcnuissiiiiis
culatum.
,
to-
punctis lineolisque transvcr-
flcxuosis impressis
rugosum ,
inmia-
f
4i3
Caput
thorace
pas?im
angustius ,
miiltoties
aeneo-nitens.
Thorax octangnlatus^ marginatus, convexas, postice latior
carina in
ta
Scuteîhnn
medio obsoleta ;
in
margine postico punc-
duo impressa.
miilto brevius costa
elytiis
Eljtra abdoniine breviora
obsoleta.
aliquot
costis
obsoletis,
postice
coeiintibus intermediis in calliim.
Feuiora compressa, mntica.
Tibiae compressae, extus iinidentatae, apice qiiadrispinosae
C, eus pi dat a
c]ue
nigra
:
cinereis.
iitrin-
f
Cetonia cuspidata.
Fahr'ic.
cordata:
nitida
C.
clypeo porrecto basi
capitis
thoracis limbo elytrorumque margine
sinuato ;
atra,
Cetonia cordata.
Fabric.
Eleut. 2. p.
capitis
i38.
clypeo cordato. f
Eleut. 2. p.
189.
C. strigosa : nigra thorace lobato lineato ; elytris
abbreviatis ferrugineis.
Cetonia strigosa.
strigis
f
Fahiic. Elcuter. 2.
p.
1 39.
C. raitcci: nigra, obscura elytris obsolète rufo-maculatis.
Cetonia rauca
C.
cornuta:
Fabric.
nigra
Eleuter. 2.
143.
obscura^ immaculata, thoracis margi-
ne antico subcornuto.
Cetonia cornuta.
p.
Fabric.
f
Eleuter. 2. p.
143.
4«4
C fasci cul arts
thoracis
:
,
quatuor albis ^
liiieis
viiidibus ; abdominis lateribus
Cetonia fasciculaiis.
*
baibitis.
Eleuter. 2. p.
Fabric.
clylris
144.
Magnitudine celoniae auratac, plana.
Cnpiit quadiatum, nic;rum, punctatum, giabriim, paulo rctusiim,
ante oculos iitrinque sulco, lateiali.
Antennae nigrae, clavatae,
Thorax niger ,
fissiles.
glaberrimus ,
punctis minntissimis
:
latera
elevato-marginata ; lineis quatuor albis pictus.
Scutcllum
nigmm, glaberrimum, lUiinque sulcatum.
Elytra viridia, rugoso-lincata, f)onc costas coarctata, abdo-
mine paulo breviora ; costae nigrae.
Pectus
nigrum,
pilis fulvis
Abdomen nigrum
,
glaberrimum ,
Latera
fulvis.
dense obtectum.
et
incisuris
anus teguntur
ad
latera
pilis
pilis
fulvis
in
penicillos collectis.
Pcdes nigri ,
et
glabri,
secundi
paris
tertii
Femora crassa ,
paris
sulcata.
Tlbiae primi
extus dentatae denlibus quatuor ;
spinoSife.
Tai-si
quatuor digitis nngvi-
culatis.
C. aulica:
viridis,
maculis albis.
Cetonia aulica.
G.
Capcnsls
:
nitida thoracis niargine elytrorumque
*
Fabric.
hirta,
Eleuter. c. p.
lufa,
144.
albopunctata. *
415
Cetonia
capcnsis,
Magnitudine
Eleuter. 2. p.
Fahric.
cetoniae
auratac ,
tota
144.
glabra ,
ftisco -
m-
fescens.
Caput subquadratum, punctatiim, anntennis
fissilibus.
Thorax sexangiiLuus, maiginatiis, punctatus, luber, maculis
nigris oblongis
.
Scutellum nignim, punctatum, elyliis triplo breviiis.
Elytra abdomine brevioia,
punctata,.
mfa,. raaculis nigiis
adspersa.
Abdomen
fusciim niaculis
Fcmora
nigia,
ciassa,
riibn'y.
rufo- maciilata.
Tihiae spinosae digitis unguiculaùs^
Sternum porrectuni,
C. signât a: thorace nigro margine albo; elytiis testaceis
sutura margineque nigris. *
Cetonia signata. Fabric. Eleuter. 2.
'
p.
145.
Habitat prope Rict-talle}" et BulTeljdgstrivier..
Magnitudine cetoniae auratae.
Caput subquadrat[im, laeve, nigrum, antennis
Thorax
angulatus,
fissilibus
convexus, laevissimus, niger,
albis lineaque
lateribus-
ferruginea.
Elytra abbreviata , lacN ia , ferruginea, sutura nigra. Linea-
snbulata
a
costa ad
utrinque nigra.
In
mediain et macula ante
basin;
margine externe guttae aliquot
4i6
Dens
albae,
lateralis
niger punclis albis.
Scutel-
liim nigrum.
Pectus et abdomen
Anus niger,
nigra
maculis
,
glabia,
lana dcnsa ferruginea.
oblongis quatuoi punctisque duobus
parvis albis.
Femora
C.
nigra,
fenugineo-pilosa. Tibiae et
interrogCLtionis
atris ;
elytris
:
biunnea
Fahric.
nigri.
thorace maculis quatuor
macula flcxuosa
Cetonia flavo-maculata..
tarsi
*
flava.
E'.leut. 2.
p.
14^-
Habitat propc Swatlkops Zout-pani.
cetonia
Magnitudine
aurata
major ,
depressiuscula ,
tota
glabra, ferruginea.
Caput oblongo-quadralum, subexcisum, thorace anguslius.
Thorax
subocto-angulatus ,
postice
lalior
latitudine
fera
elytroruni, marginatus, conxexo-planus, laevis ;
in
medio raaculae quatuor, magnae , nigrae, quarum
par
posticum
unica
et
majus ;
praeterea
in
latere utroque
postice quatuor obsolète nigrae.
Scutellum elytris mulloties brevius, maculis nigris duabus.
Elytra
abdomine paulo breviora
,
lacvia ,
linea
arcuata
nigra in singulo, figuram signi quaestionis formante.
Incisurae abdominis nigrae.
Femora mutica.
prcssae.
Tibiae latere
extcrno
tridentatae ,
com-
4n
C. slnuata: fusca, thorace clytrisque margine et maculis
duabus
*
fia vis.
Cetonia sinuata. Fahric. Eleiiter. 2. p.
Cfimhrlata:
viiidis,
147.
thoracis etytrorumque
marginibiis
*
ferrugineis.
Magnitiidine cetoniae auratae, paulo major, dcpressa, glabra.
Caput quadrato - oblongum, marginatum, subcxcisum,
viri-
de, prominens, thoiace multoties angustius^ puncta-
tum, oculis olivaceis.
Jkorax angulatus, convexus, marginatiis, tenuissime punctulatus , viridis, lateribus ferrugineis, antice angnsdor, postice latitudine fere elytrorum.
Scutellum viride, brevissimiim.
El/tra abbreviata, tenuissime
striata, postice
nodo iitrinque
elevato, viridia, lateribus ferrugineis.
Pectiis
et
pedes virides, punctati.
.Femoray imprimis postica, crassa, inermia.
medio unidentatae.
Tibiac apiee spinosae,
G. trilineata
:
nigra,
fascia flexuosa
Cetonia trilineata.
C.
thorace lineis tribus albis , elytris
scutelloque albis.
Fahric. Eleuterat.
semipunctata
:
viridis,
M/moirct deVAcnd.
T.VI.
Fahric.
,f
pag.
147.'
thorace q^iadrilineato; elytris
basi lincatis, apice punctatis.
Cetonia semipunctata.
2.
Elcut.
*
2.
pag.
148.
^3
C.
af ricana
sterno
viridi - nitens,
:
ponccto;
Cclonia afiicana.
C.
acuminata
aciiminalis.
Fahric.
minor cetonia
hiisuta,
Clypcus capitis
2.
p.
*
149.
pallido-maculala, elytiis
*
Cetonia acuminata.
Paitîo
P21euter.
obscure aenea,
:
inciimbente'i
punctis nigiis imprcssis.
eJytiis
Fahiic.
spiha
capitis
Eleut. 2. p.
aiirata,
nigro
-
154.
aenca, subtus cineieo-
supra undique cinerco - variegata.
fissus.
Elytra prope suturam apice acuminata, lateribus
et apice
depressiuscula extra costam curvatam.
Abdominis
latera
albo maculata.
C. hçiemorrholdalis
:
margine anoque
Cetonia haemorrhoidalis.
Habitat
in
Swariland et
nigra,
rulis.
elytris
viridibus; thoracis
*
Fahric. Eleut.
2.
p.
l54-
alibi.
Variationes plures occurrunt varie maculatae.
C. car m élit a: nigro-viridis; thorace elytrisque testaceis;
ano biguttalo.
Cetonia carmclita.
*
Fahric. Eleut.
G.
p.
1^0.
*
C. velutina: nigra, elytris fascia lata ferruginea.
Jlahiiat piope Svartkops
Ma^^iiitudinc
Zout-pan.
cetoniae auratae,
depressiuscula,
tota glabra
419
et
nîgra, excepta fascia elytromm,
callisquc duo-
bus Lueralibiis pcctoiis.
Caput
tliorace
77/c/rflx
sLibiingulato- rotcind.itiis,
vis,
incrmc, laeve.
multotics ungiisticis,
marginatus, convexus^ lae-
poslice Jarior, latitiidine fere elytrorum, ineimis.
ScidtHuui elytiis miilloties brcviiis,
Eljira ubbicviata,
obsolète sulcata,
apiceque nigia ,
in
mf dio
basi
fascia
prope scutclkim
latissima
liiteo -
feiTUginca.
Fascia interduni simplex, interdum in
mcdio
fusca notata tiansversa, sic pt f^sciae
fascia
feniigineae binae vi^egptur,
Subtus omnia
atra.
^asis dentis pectoralis lateraiis et callus ante basin elytri
feiiugimea.
Femoya compressa,
Tibiac latere
C.
externo unidentatae, apice quadiispinosac,
adspcrsa:
fcirnginea, elyiris viiidibus albo-gmtatis,
f
Cetonia adspcrsa,
C.
alhopunctata
gris;
inutica.
Fabric.
elytiis ferriigineis
C. cinerasceiis :
j54.
Fabric.
alborguttatis, linibo atro.
f
Eleiiter.
2.
p.
i55.
thoracis dorso atro, linea cinerasccnte
;
cinereis nigro - macniatis.
Cetonia cinerascens.
pag.
2.
tliorace ferriiginco, punctis qciatuor ni-
:
Crronia albopinicta.
elytris
Eleuterat.
Fabric.
Eleut.
2.
f
p.
i56.
53*
420
C. irrorata:
nigra, elytiis striatis ferriigineis nigro
CLilads.
Cetonia
ma-
f
irrorata.
Fabric.
Eleuter.
2.
pag.
i56.
C. furvata: thorace elytrisqiie testaceis nigro - punctatis;
abdominc hirto
Cetonia furvata.
incisLiris
riifo,
Fabric.
Eleut.
2.
atris.
p.
*
i56.
Habitat in SvarLland.
Melolontha horticola panlo major, tota ferruginea, sed
sii-
pra magis pallida.
Caput angustum, lufo - fuscum, marginatam, antice rotim/
datum.
TJiorax convexus, laevis, rotundatus, antice angiistior, maculis pluribus nigris et intersparsis albis
variegatus ,
quarum
in
raedio
quatuor
minoribus
quadratim
positae.
Elytra abbreviata, tenue striata, ornata maculis nigris, per
séries positis,
Vectus,
abdomen
Abdomen subtus
et
pcdes
et supra
Femora macula nigra
C.
puhera:
stercori
muscarum
pilosi.
anum cineritie alba maculatum.
notata.
thoracis marginibus albis;
abdomine albo - maculato.
Klagfiitudine cetoniae auratae,
culis
similibus.
viridi - aenea,
elytris
viridibus ;
*
depressa ,
tota
pilosa pilis albis.
exceptis ma-
421
Capiit paivum, angustum^ subquadratum.
Antennae
lamellis tribus.
fissiles
Thorax marginatus, octoangiilatus, antice angustior,
liinu-
lato-excisus, convexus, punctatus; linea alba utiin-
que
intra
margines latérales.
Scutellum médiocre, punctatum, sulco utrinqne ante apicem.
Elytra abbreviata ,
punctato - rugosa ;
Ante
hiimeros
albo.
Dens
sqiianiula
lateralis
hunieri rufescentes.
separata
viridis,
piincto
mediocris.
Ahdominis segmenta ad latera utrinqtie duplici ordine ma-
cularum albarqin notantur^
uti
et
anus fascia et
gutta duplici alba.
Pedej spinosi, punctati.
teriora linea
Fe»iora antica fovea impressa; pos-
alba.
Ohs. in ano deficiunt interdnm
C. hirsuta :
birta,
fascia
guttaque alba.
aeneo-atra , scutello sulco duplici. *
Magnitudine C. auratae, depressa, tota atro - aenea,
nitens:»
villosa, punctis frequentissimis minimis.
Caput rotundatum , thorace multo angustius, marginatum,
antice quadridentatum: dentés latérales instar
ctorum
eminenlium
Palpi quatuor.
:
intermcdii
paulo
pun-
longioies.
Antennae trilamellatae.
TJiorax subocto - angulatiis, inermis, marginatus,
medio li-
428
nea
obsoleta
margincs
intra
:
pone médium
latérales
linca
alba
diinididta.
Scutellum elytris miilto bie\iiis, acutum, utiinqiie siilco insciilpto
medio ad apicem,
a
hnmeris
abbrevita
El) ira
postico, singiila
et calio
costis
quatuor obsoletis, eo^untibus subriigoso-piinctata.
Capiit, thorax et elyti-a
pilis
Anus supra gutta utrinque
Pectus
et
abdomen
sparsis
erectis
villosa.
ville
longo
alba.
valde
hirsuta
subfer-
rugineo.
Fcmora
crassa, angulata, conpressiuscula,
mutica,
Tihîae cxtus unidentatae, apice quadrispinosac.
C. lii^uhris:
albis.
glabra, elytris
atra,
macula
C. hottcntotta :
duabus
atra ,
albis.
glabra,
Mucorosa
:
i58,
elytris
postice maôull^
f
Cetonia hottentotta. Fahric. Eleuter.
gris y
anoqu^
*
Cetonia lugubris. Fabric. Eleuter. 2. p.
C.
laterali
2.
p.
159.
thorace elytrisque sangvineis, micilib' ni^
abdomine rufo nigroque.
*
Magniiudlnc cetoniae auratae, tota obscure rufa seu sangvinea, glabra.
Clypeus capitis quadratus, subcxcisus,. marginalus,
piceits.
423
Thorax angulatus,
convc.xus, punctatiis, niaculis
pliiribiis
nigris.
El/tra
stii.it.i,
Abdomen
punctata, maculis sparsis nigris.
nitiilnm,
liiteribus
maGLilis njagnis atris seu poiiu3
rnfti,inj
nigitiin.
Obs. vaiictas adest punctis raaculisque thoiacis obsoletis.
C.
gutatta:
nitida thoracis raargine iiifo; elytris
atia ,
albo-guttatis. *
Magnitudine cctoniae sticticae,
atia,
ejaSque similitudine,
tota
thoracis margine solo rufo.
nitida,
Cîypeus capitis excisus.
Thorax elytraqiie albo-giittata, guttis sparsis pkmmis.
Elytra abbieviata, sulcata.
Âbdominis incisurae ad latera
Pedes
miniinis albis notata,
giîttis
pilosi.
yariat elytiis viridibas.
MELOLONTHA.
M. aîopex: thorace abdomineque hirsuto ;
ferrugineis.
elytris gîabris
*
Habitat in remotis regionibus, terram perforans.
Magnitudine
melolonthae
elytris,
Cîypeus
vulgaris ,
dense hirsuta
capitis antice
pilis
ovata
tota ,
exceptia
pallide ferrugineis.
marginatus, nudus, excisus.
424
Antcnnac et
glabii, ferriiginei.
p<ilpi
Pilous capitis, thorax et pectus conspici
non possimt,
prae densitate villomm.
Klytra glabra, abbreviata, marginata.
Abdomen postice fenugineum, minus hirsutnm.
Feniora
la ta ,
dentata, intciiori latere nuda.
Tîblac
filifor-
mes, trispinosae.
M. longiconiis
nigra,
:
Melolontha longicornis.
Magnitudinu
fere
elytris
pectore hirsuto. *
riifis ;
Fahric. Eleut. 2. p.
melolonthae
solstitialis ,
166.
cylindrica-
Caput rotundatiim, retusum , depressnm, intcgrum, punctatum, pilosnm, thorace angustins, nigrum.
Anntennae
fissiles
laminis tribus, piceae.
Thorax subangulatus , convexus, postice truncatus, niger,
marginaïus,
punctatus,
pilis
minutissimis cinereis
tectus.
Scutellum nigrum, brevissimum.
Elytra abbreviata, conve.xa, ferruginea, punctata, cinercotomentosa.
Pectus valcle pilosuni.
Abdomen nigrum,
Pedes
villosi.
pilis
brevissimis tcctum.
Fcmora mutica.
tus unidentatae.
Tibitie
extus tridenlatac, in
425
Differt
a
hrunnea
nielolontha
non
elytris
striatis ,
sed
punctatis.
M. pilosella
rubrcT,
:
pectore hirsuto. *
Maguitudine melolonthae
solstitiaîis ,
cylindrica.
Caput, thorax, elytra, scutelluni et abdomen pnnctis minntissimis
confertissimis
impressa,
pilis
bievissimis
cinercis obtecta.
Pcctiis hirsutiim
ville ferrugineo pallido.
PedcS pilis
villofi.
raris
Caput sLibiotundum, dcpressum, marginatnm, integrum, Innula
in
medio
transversa ,
elevata ;
thorae
an-
gnslius.
Thorax subangulatus, convexus, marginatus, margine sub*
tus ciliatus.
Elytra abbreviata, çosta elevata, absque
striis.
Femora mntica. Tibiae extns tridentatae, intus unidentatae.
M. hicolor:
glabra ,
apice
anreis. *
Melolontha bicolor.
M. pallida:
nigiis.
viridis ,
subtiis
testacea ;
Fahrlc. Eleiiter. 2. p.
glabra, testracea, capite elytrorumque sutura
variolosa :
riolosis.
166.
*
Mclolontha pallida. Fahrlc. Eleulcr. 2. p.
M,,
pcdibus
v i Uosa ,
n igra ,
168.
tho race ely t risque va-
f
Mémoires Hel'Acad. T. FI.
^4
426
Melolontha variolosa.
M. ru fa
:
Eleut. c.
Fahiic.
169.
p.
glabra, lufcsccns, elytris testaceis, clypeo qtiin-
qucdentato. f
Melolontha
rufa.
M. virons:
Fahr'ic.
hirta ,
Elciit. c.
fasco-aenca,
dibus ; elytiis testaceis.
Pauîo
minor
melolontha
p.
171.
capite thoraceque viri-
*
solstitiall ,
acneofusca,
subtLis
hiisutj.
Capitls clypeus transversus ,
integer ,
maiginatus ,
viridi-
nitens.
Thorax convexus , viridi-nitens, puncto
in
utroque latere
impresso.
Elylra convexa,
laevia nodo anali cxstanti, testacea cutn
viiedine interlucente.
M. vÏTldis:
Melolontha
glabra^ supra viiidis, subtus ainca. *
viiidis.
splcndida
Fabric. Eleuter. 2. p.
atra,
elytiis
Melolontha splendida.
Fabric.
?.'!.
"M.
:
prohoscidea
:
vitta
166.
abbreviata aurea. f
Eleuter. 2. p.
hirta, nigra, elytris
1
74.
testaceis
margine
njgro. *
Mfclolontha proboscidea.
M. fuliginosa
:
Fabric.
Eleut. 2. p.
179.
glabra, supra nigra, sublus picea.
*
Qiiadruplo fere minor melolontha variabili, cui similis, ad-
427
eoqne inter minimas tota glabra, subcylindiicû-coi>
vexj, supra nigra, siibtns picea sen infescens.
Pedes lufesccntes, femoribiis posticis
crassis.
Clypeus capitis angulatus.
R'L
hirta, nigra, ano rufo.
'
melolonthae
paulo minor melolon-
analis:
magnitudine
voriahilis ,
tha brunnea, ovata, convexa,
postice latior ,
toL»:
vel nigra, supra glabrata, subtus villosa.
fiisca
Clypeus capitis marginatus margine refîcxo,
integer^ qua-
d rat us.
Elytra laevia.
j^bdomen postice sanguinenm.
RI.
picea
:
glabra, fcrrnginea tlytris
Melolontha picea.
Fabric.
M. haemorrhoa:
hirta,
ticis
riifis.
Eleiiter. 2.
f
18 3.
tibiisque pos*.
*
atra,
elyt risque
p.
atra, elytris postice
Duplo minor melolontha brunnea,
siibtiis
striatîs.
convexa,
ovata ;
villosa; supra glabrata, capite, thorace
basi nigris.
Clypeus capitis excisus, marginatus.
Elytra basr et sutura nigra, ceterum rufa.
libiae posticae
rufae.
M. caffra: glabra,
tota
rufa, capite
pedibusque
nigris.
54*
*
428
Mclohnthae bmnnrac magnitudine
nicn magis
satiiraLe
,
ciiî
similis ,
colore ta-
rufo.
Corpus ovatum, convcxum-, glabium, poslice
latins.
Caput nigrum, clypeo angulato,
niarginato,
Thorax obsoletissime punctaUis,
biiinneus, marginc fusco,
El/tra temiissime punctata ijbsquc
stiiis ,
subcxciso.
biuanca, suuua
fhsca.
Suhtus corpus et pedes nîgia, ano sanguineo.
M. dimidiata
hirta,
:
nigra, thoiace postice clytiis pedî»
busqué testaceis. *
Ouadruplo minor melolontha hrwmca^ convexa.
Capitis clypeus excisus, marginatus, niger.
T/iorar coavexus, glaber, iintice niger^ postice sangnineti?,
EJytra laevia, glabra, pallide ilava» marginibiis aniico et
laterali atque suturae
Abdomen et pectns
basi nigris.
hirta, nigra,
ano lufo.
Pedes valde liirti, nifescentes.
R^.
totta:
hirta,
pallidis.
Habitat prope
nigra> elytris
plaga nifèscente, margine
*
Cap in Taffelberg,, -vulgaris.
Magnitudine aphodii
crratici,
seu plagiata major_^ tota
ovata.
Caput nigrum, punCtatum^,. clypeo exciso.
Anteima& nigrae,. fussiles^ laminis. clavae c^aaUior.
hirta,,
429
TJiorax nigeiv pnnctatiis^ maiginc antico pilis erectis' cilia-»
tus; fascia jntcrduni poslice aicuata, rubra.
Elytra
nig^ia,
pcinctata absque
stiiis_y
abdomine paulo
viora, pilis spaisis canis eiecLis hiita,
teiioii
tcnuissime pallide flavo.
ta ntur
plaga postica lufescente.
Pecfus et pedr-s Higii^ valde pilosi
pilis
bre-^
margine ex-
.Saepe
elytra
no-
erectis.
Abdomen nigium^ incisuiis .brevissinie pilosis, .albidis.
Anus intetdum aiibet.
Variât, i.thoiace fascia elytrisque plaga rufa.
12.
thoiace nnicolore, elyttis' plaga rufescente.
3. thorace elytrisque iinicoloribus.
4. tliorace unicolore, elytrorum, plaga «ancque
Dijfert
riibrif,
ab apiiodio pïagiato:
1. pilis corporis, thoraci? elytroriwnque .erectis.
2.
margine elytroriim pallido.
3.
stnîtura
ovata magis,
qaam cylindiica.
4. magnitudine saltem .triplo majorL
-M.
gihba:
gibba, testacca, tomento cînereo nitidula. f
Melolontha gibba. Fabric, Eleut. 2. p. i83.
^l.
seti^era: snpra :binnnea pnnctato - pilosa,
ncreo - hirta.
Major melolontiia
snbtiis
ci-
*
iidgari ,
supra tota brunnea punctato -
43o
siibvariolosa punctisqiie setigeris ;
siibtus
cinereo -
tomehtosa.
Capitis clypeus marginatus, excisns, antice concaviis.
Thorax convexiis, angulatus, marginatus, medio
siilco
ob-
soleto et mac[ila utrinque nitida.
Eîytra convexa, marginata, irregulaiiter punctato - vaiiolosa , Costa et postice
nodo elevato , abdomine
bre-
viora.
Pectus et femora hirsLita villo longiori.
Tihiae quadiispinosae.
Femora crassa, inermia.
TRICHIUS.
T. punctigerus
ni gris.
:
hiitus, testaceas, elytiis punctis quatuor
*
Magnitudine melol. hortkolae ,
capite, thorace oninibusque
subtus densissime hirsutis, cincreis.
Eîytra testacea. abbreviata: puncta parva, nigra in medio,
in
singulo elytro bina.
Variât situ punctoruni in
T. lineatus
tris
:
pubesccns, thorace fulvo-nigro-lineato; ely-
testaceis
Trichius lineatus.
T.
nigripes:
elytris.
:
sutura fui va, f
Fabrlc. Eleuter. 2. p.
hirtiis ,
i33.
fuscus, elytris testaceis;
apicis cincrascente.
f
margine
431
Trichius nigiipes. Fahric; Eleuter. 2. p.
T. macnlatiis
134.
glabcr , cinereo-maculatus, capite
supra
:
thoiaccque nigris ; elytiis piceis.
*
l34-
Tiichius macLilatiis.
Fahric. Eleuter. 2.
T. villosus:
supra niger, sublus albidus. f
hiitus,
Trichius hirtus. Fabric. Eleuter. 2. pag.
T. pilosus:
p.
i34-
subtestaceus, capite thoraceque nigris;
hirtus,
elytris piceis.
f
Tiichius pilosus. Fabric. Eîeut. 2. p.
134.
T. llmbatus
fenugineis
hirtus,
:
triangulari atra.
Paulo
minor
trichio fasciato ,
Cnpitis clypcus excisus,
Thorax
ater,
niger,
elytris
macula
:
*
totus subtus ater,
villosus.
inarginatus, niger.
macula flexuosa brunnea intra singulum latus.
El)tra test.icca costa longitudinali ; marge cxternus, sutura,
macula
trigona et suturae apex nigra.
disci
Variât maculis thoracis obsoletis et omnino nullis
T. hipiinctatus: viridis ano biguttato;
elytris testaceis.*
Trichius bipunctatus, Fabric. Eleuter. 2. p.
Elytrorum sutura
marge
et
viiidia.
T. saxicola: villosus, cyaneus,
omni
Habitat in
nigro.
l32.
elytris
*
summo monte Witsenberg.
testaceis:
margitie
432
Quadrupla
major melol.
horticola ,
fusco-cyaneus,
subtus
hirtus, immaculatiis.
Capltis clypeus viiidis, margine valde elevato-reflexo.
Thorax subangulatus, convexus, maiginatus, viridis, villosiis.
El/tra abbreviata, marginata, testacea costa elevata, stïiatomarginibus suturaque nigds.
piinctata,
Similis melol. abdominali.
T. campicola
brunneis ;
nitidus, thorace
niger,
:
cyaneo ;
elytris
*
abdominis latenbus albo maculatiF.
Similis melol. horticolae, sed
minor et totus glaber, subtus
niger, capite thoraceque cyaneis.
Clypeus reflexus.
Thorax
m medio unistriatus,
Scutellum nigrum.
Elftra
stiiata,
tota rufa, immaculata.
Abdominis lateia albo-macnlata.
T. carhonarius :
yillosQs ,
nigro-vaiiegatis.
Duplo major melol.
ater, clytiis testaceis:
costis
*
horticola, totus
ater,
opacus, hirsutus
subtus, capite thoraceque atro punctatoque.
*
El/tra testacea , costis paulo elevalis nigro - irroratis.
yariat elytris magis nigris et fere
totis.
T. rupicola : villosus, virescens , capite nigro.
Rlelolonlha rupicola.
Fa6ric.
Eleuter. c. p.
17 3.
*
433
T. ursiis: hirsutissimns,
Melolontha
ater,
pcciibiis
qnatnor testaccis.
184.
Fabric. Eleut. 2. p.
iirsus.
'*'
Elytva glabra.
T. hombylius: pilosus, niger, elytiis testaceis:
bus apicis
albis.
Melolontha bombylius.
T, capicola :
Variât
Valde
Fahric.
trichio
urso ,
tus,
atenimus etiam
1°.
totus atenimus.
2°.
ater pcctore
sunt
affines
tum
i85.
Eleut. 2. p.
*
Melolontha capicola.
Duplo
Fahric.
hiisutus, ater, immaculatus, clypeo acumi-
nato bifido,
minor
lineis tri-
*
Eleuter. 2. p.
alias
179.
simillimus ,
totus
elytris.
aibo - hirsuto.
trich.
capicola
forsan
et cliscoîor ,
tan-
varietates.
T. cliscoîor : supra ater
Mi}wr paiilo melol.
subtus ferrugineo. *
villo atro,
horticola, totus ater^
vellere
hirsutus ,
supra nigro, subtns ferrugineo.
Clypeus acuminatus,
fissus.
/Jnus cinercus.
T. crinitus
Melolontha
hirsu-
:
hirlus, supra
crinita.
viridis,
subtus niger.
Fahric. Eleuter. 2.
T. capucinus: hirsulus,
ater,
elytris
pag.
pictis.
Minor melol. horticola, lotus hirsutus.
M(moin-ideVAcad. T.Fl.
^^
184.
*
*
4^4
r'')'7?(''^yiiciiminatiis, citer. ^Itibrr.capite b.isi
Tnorax
villo
hiisiitus
aler,
nigro'j
hiisulo, villo ntto.
cincuis Liiulique ciiculo
villomm alboium.
Elytra biunnca^
^'///.v
|}ilosa
pilis
alris.
albidus, hirsutus.
Audonieii nigrnm, atio - hirsiitum ,
uti
latcribus albo - villosum
pcdes, altcro laterc albo-villosi
et
,
altero ni-
s^ro - villosi.
Pcchs posiici clongati, inermcs.
T. Ursula:
hirsutus, supra
maiginibns
Magiiitudo
et
statura
pcctus
omnino
albus; elytiorum
subliis
trichii
sed
capicolae ,
subliis
\'ellere
çiim
abdomen
villoque
albo - tonicnlosa
tecta; supra niger
Clypeus ponectus,
atci_,
*
convcnit ;
proxiiiie
et
albis.
laiioii
albo
qiio
huic uti
longioii
nigio vcstitus.
bifidus.
Elytrorum margo omnis cinerasccns.
Pcdes omnes
hirti;
elongati ,
post.ci
latere altero vellcie
nigro, altero albo ciliati, incriiics.
T. vittatus:
pilosus,
cyancus, clytris testaceis: lineis
bus albicantibus.
Melolontha
vittata.
*
Fabric.
Eleuter. 2. pag.
i85.
T. lynx: hirtus, niger, elytrorum margine aureo. *
Melolontho lynx.
Fabric.
Elcutcrat. 2. p.
184.
tri-
435
'J\
liirtus:
Melolontha
capite thoraceque viridibus ;
hiiUis,
Fnhric.
hirtj.
T» ovinus:
Eleuter. 2. p.
cin( reo - hirsiitus,
Duph minor melol. horticola
hirsutie densa
Caput
atriim,
Thorax
ater,
elytris
*
fuscis.
,
niger,
lS5.
elytris
subtus lotus
bninneis.
niger,'
*
tcctus
cinerca.
pilosum, acuminatum, fissum.
pilosas.
Elytra briinnca, immacnlata, pilosa.
T. tricolor : albo-hirsutus, capite atro; thorace cinereo;
anoque
elytris
Mlnor melol.
testaceis.
horticola ,
*
totus hirsutus.
Capitis basis hirta; clypeus integer margine elevato réflexe.
Thorax cinereus
pilis
erectis nigtis
Elytra brunnea, immaculata,
Abdomen
.-Iniis
et
pectiis
sparsis erectis nigris.
albo - tomentosa, hirta.
ferrugineus.
hirtas,
T. depressiis:
Duplo minor
pilis
pilis
sparsis.
ater,
subtus flavo-hirsuttis, supra pilosus. *
melol. horlicola ,
raris
totus
ater ;
supra
pilosus
sparsis; subtus cinereus densa villositate
tcctus.
Capitis clypeus aciimiriattis, fissus.
Elytra in mcdio doiso versus sutJitram fovea depressa.
Anus ciher^us
faseia
atra.
55*
436
Pedes postici elongati, inermes.
T. jnojiach us
niliil
Clj'pciis
ininor
Lhorace iiigio,
hirsutns,
marginibus
biiinneis,
elytris
bls-j
Non
:
lineis
duabus
atris.
*
al-
melol. Iiorticola.
acuminatuSj
lliorax atcr, hiitus,
pilosus, niger.
fissiis,
cinctus villo albo j
in
medio lineae
binac abbreviatae niveae.
Elytra briinnca, fusco-pilosa, marginibus exterioribus atris.
Pectus albido - liiisiitLim.
Abdomoi potias albo - tomentosiim^ immacalatum.
T. bis triât us: hirsutus,
bus suturalibus
ater, elytiis
atris.
Magnitudine melol. hortlcolae,
Clypeus capitis integer,
Thorax
totus subtus ater,
villoso.
ater,
hirsutus villo atro.
intra
Pedes postiei elongati,
T. vulpes
:
hirsutus.
marginatus margine rellexo,
basi
Elytra brunnca;
brunneis: lineis dua-
*
suturam utrinque
stria
atro^
villosa atra.
crassiores.
aurcus, fulvo hirtus^ abdomine ferrugineo. *
]Melolontha vulpes.
Fahric.
T. marginèllus
albo - tomcntosus,
:
Eleuter. 2. p.
gine albo; elytris brunneis.
Melolontha marginella.
i85.
thorace nigro, mar-
*
Fahric. Eleut. 2. pag.
181.
437
T. tibiaîis: albo-tomentosus, thorace nigro hirto;
fusco -
brunneis.
elytris
*
Similis trichio margincllo,
coipoie subtns albo - tomentoso,
sed pcctore magis hiisuto
Caput
et thorax atra,
FJi'tra
brunnea, basi fusca.
villo
diffeit.
atio liirsuta.
Tihiae posticac elongatae, curvatae.
T. fcuioratus:
glaber, ater, elytris brunneis; femoiibas
*
posticis compressis spinosis.
l'ix
Oryzae magnilLidinis totns
Clypcus capitis acuminatus,
ater,
glaber.
[issus.
Scutellum album.
Elytra brunnea, immaculata.
Siihtus ater, laleribus
Anus
ater,
abdominis albo-guttatîs.'
fascia alba.
Pedes postici elongati.
valide
dente
Femora
aimata.
compressa ,
crassa ,
Tibiae curvae ,
basi
terminatae
spina insigni.
T. pusillus: glaber, brunneus, capite nigro.
Octics minor melol.
ab
illa
ginea
et a
*
bninncay adeoque sufficienter distinctus
A mel. ferru-
melol. mclanocephdla.
Fahricii Eleut.
pag.
170.
quoque, quod minime punctatus,
n°.
56.
distinctus
sed^ laevis»
438
Clypcus
intrger,
rotiindcitiis,
marginattis, niger,
rrflcxus.
Thorax, Elytia^ corpus, pcdes brunnca, laevia, immaculata,
T. costatus: glaber,
siipia
duabiis. *
tosus, elytris costis
Dimidio niinor melol.
ctoreque albo
cinerens, subtus albo-tomen-
horticola,
-
tôt us albo - tomeniosus
pe-
villoso.
Supra cinerens, thoracis lateiibus albidis.
Elytra exciso-angustata, costis
in singulo
duabus tenuibtis.
/inus obtusus, spina terminatus.
T. siilcatus:
hirtus,
subtus albus ,
brunneis sulcatis albo - lineatis.
supra niger elytris
*
IMagmiiidlne circiter mclol. hortlcolae.
Clypeiis subquadratus, marginatus, integer.
Thorax im macula tus.
£//tra fusco-brunnea, basi
villosa- sulcata
latiora,
tenuissime punctata et
sulcis lineisque pluribus
albis ;
in
ipso apice lunula alba.
Pectus hirsutum villo albo.
Abdomen tomentosum, album, immaculatum,
PedeJ
atii ,
-u>4
•'
'J'
•'
iHiti.
Femora postica
ct'assa
Spina- exteriori^latere terminata.
ermes-,
s|^ina
iitrinque terminatae.
Variât atio^fliïvtscente et
tibiis
rufi?.
,
obtusissimiim.
mutica ,
apice
Tibiae drdssae, in-
09
T. multi^iiitatus :
tomcntoso - cinereusf,
neis,
niiiCLiIis
orto cineieo-iilbidis. *
nielol.
hoiticola,
Minor
minus
densissimis
tolus pilis
feiiiigi-
brevissimis'
flavcscrns.
tectus,
Caput
elytris
toin
lUosum
_,
clypeo parum exciso
fiiscuni,
nuui^inutum.
Thorax
Elflra
cinti.eiis
maculis tribus ferrugincis.
ferrugineo-tomentosa ,
maculis
in
singulo quatuor
ablongis, albidis.
Scutellum cincico-
albidum.
Pcctus hirsutum villis albis.
Ahdowen tomentoso- album, immactilatum, iiti et pedes toti.
Fcinora postica ciassa, inermia.
Tihiue inciassatae, ineimes,
spina utiinque tcrminatae.
Ungues nudi, mfi, validi, cuivi.
T. cliiragrlcus: pubescens,
ater,
elytris albis: linea atra;
femoribus posticis bidcntatis.
Magnitudine mclol. horticoLie, sed
tis
*
latio», totus ater
excep-
marginibus elytrorum, tenuissime nigro-pubescens.
Clypeus excisus.
Elytra
alba ;
linea
in
mcdio
lata
obliqua atra y
apiceni
non atiingcnte.
Pcdbs
postici
elongciti ,
monstrosi.
Femora
crassa ^
basi
dcnle obioleto et intra apicem spina valida armata.
440
posticae curvatae, compressae, spina valida
Tïbirte
terminatae.
T. rufîpes: glaber,
ater,
femoribus posticis
Intcr minores,
ater,
palpis pedibusque anticis
maonitudine scarab.
arenarii,
totus glaber,
palpis solis pedibusque anticis
Femora postica
crassa,
iiifis;
bidentatis. *
rufis.
basi apiceque dente
parvo armata.
Tibiae incurvae, extus ciliatae, spina teiminatae.
T. cancroides
:
albo-irroratus ;
aler,
femoribus posticis
elongdtis crassis ^ tibiis unidentg^js.
Melolontha cancroides.
*
Eleut. 2. p.
Fahric.
Latcra abdominis albo-maculata,
181.
médium totum tomentoso-
album.
T. crassipcs: glaber, nigcr, capitis clypco quadridentalo.*
"Melolontha crassipes.
Fahric.
Eleut. 2. p.
180.
Corpus totum nigrum, glabrum, laeve.
Caput marginatum clypeo antice rotundato, quadridentalo
denlibus obtusis.
Antennae nigrae,
fissiles,
clava trilamellata fusca.
Thorax convexus, marginatus.
Elytra abdominis longitudine,
convexa, marginata.,
sulcis
tenuissimis.
Femora valde
crassa, angulata,
parum compressa,
inormia.
441
Tiblae anticae compressac ,
dilatatae , tiidentatae ;
posteri-
ores dentatae, ciliatae, ungviculatae.
Ohs.
Thorax subtus
ata,
capitis clypeus postice
et
subtus
nigris.
villis
T. arthriticus: niger
elytris
giiseis;
clypeo tridentato^
fcmoribus posticis incrassatis subinermibus.
Melolontha
atris.
*
180.
p.
albo-farinosiis thorace canaliculato atro ;
:
abdomine albo
fuscis ;
elytris
Elenter. 2.
Fahric.
arthritica.
T. atomarlus
cili-
:
punctis lateralibus
*
Melolontha atomaria.
Fahric.
T. dentipes
elytris testaceis ;
:
niger,
Eleut. 2. p.
177.
clypeo qiiadriden-
tato ; pedibus tibiisque posticis spinosis. *
Melolontha dentipes.
T. spinipes:
Fabric. Eleut. 2. p.
niger, elytris
brunneis; scutello toto lateri-
busque abdominis albo - punctatis ;
cis elongalis.
180.
pedibus posti-
*
Corpus magnitudine melol. hrurineae ,
glabrum, nigrum*
Caput depressnm, punctatiim.
Ocull et antennae
fissiles
nigrae ; os pilostim.
Thorax convexns, punctatiis, postice sulcatus.
Elytra marginata ,
abbreviata ,
striis
et punctis,
albis
brevissimis.
M(moires de rA.ad. T. H.
subriigosa ,
brunnea
:
glabra absque
lineis obsoletis
^^
ex
pilis
442
Pectus et abdomen pilosa.
Anus pulverulento - flavescens.
Ahdominis
latera
albo-punctala ,
ex
scilicet
pilis
albis
quatuor utiinque.
piinctis
Pedes anteriores quatuor fusco-ferruginei , spinosi ; postici
elongati, crassi, longitudine corporis.
Fcmora crassa,
extus convexa, intus concava, basi dentata, margi-
ne
pilosa ,
ferruginea.
Tibiae
inflexae ,
falcatae,
medio unidentatae. Plantae ciliato-spinosae.
T. gonagra:
grisea,
crassatis
muticis.
Melolontha gonagia.
Corpus totum
rufis
pedibus
rufis;
pedibus posticis in-
*
Fahric. Eleut. 2. p.
180.
tomentoso - flavum supra infraque ,
pedibus
glabris.
T. ahbreviatus:
villosus, niger, clypeo tridentato, elytris
abbreviatis testaceis. *
Melolontha abbreviata.
T. podagricus :
Fabric. Eleut.
2.
niger, clypeo tridentato;
biisque posticis dentatis.
feraoribus ti-
*
Melolontha podagrica. Fabric. Eleuter. 2.
T. deustus :
pag. 181.
p.
180.
glabcr^ thoracis lateribus albis;
elytris lu-
nula apiceque nigris; abdomine albo - maculato. *
Corpus magnitudinc melol. horticolac paulo minus,
glabrum.
totum.
443
Caput angustum, marginatum, punctatum, antice rotundatum, nigium, antennis
rufescentibus.
fissilibus
Thorax convexus, angulatLis, maiginatus, antice attenuatus,
glaber, marginibus lateralibus
pio capite excisus ,
linea intermpta alba.
El/tra abbreviata, testacea, glabra,
exterior, sutura
stiiis
Pone mediurn lu-
et apices nigra.
nula subtriangularis
communis
punctatis; margo
nigra.
Scuteîlum nigrum.
Pectus et
abdomen nigra, subpilosa ; abdominis
bo - punctata.
latera al-
Anus supra maculis duabus
albis
pictus.
Tibiae fusco - rufescentes.
Femora rufescentia
pilosa.
T. calcaratus
niger, elytris flavis:
:
bus tibiisque posticis spinosis
Melolontha calcarata.
T. sexlineatus
nereis.
:
Fahric.
fascia atra; femorirufis.
Eleuterat.
pubescens, niger^
2.
f
pag.
i8o.
elytris lineis
sex ci-
*
Qiiadniplo minor melol. horticola, totus pubescens, niger.
Clypeus excisus.
Scutcllum cinereum.
Elytra lincis sex cinereo - albis picta.
Pectus, lalcra
abdominis strigaque ani cinerea.
Pcdcs antici tiideniati, intermedii
ciliati;
postici elongati,
56*
444
valde
incrassati,
spina bascos valida.
Tihiae curva-
tae, spina teirainatae.
T. mïnutus : niger,
giiseis;
elytiis
nioribus posticis acnte
Melolont.ha minuta.
Fahric.
T. fus eus: glaber, fuscus,
ineimibiis.
crassatis
Pedicuîo duplo major ,
pedibus testaceis; fe*
dentatis.
182.
Eleiit.
2.
elytiis
biunneis; fcmoribus in-
p.
*
tiichio
minuto valde
similis ,
sed
*
obscurior, femoribus muticis.
Caput, thorax et omnia subtus nigra.
Rlytra testacea seu fusco - brunnea, immaculata.
Pedcs antici
picei.
Fcmora postica
incrassata,
inermia.
Ti-
hiae posticae incrassatae, spina tcrminatae.
T. thoracicus
duabus
:
hirtus, thorace nigro
:
maigine lineisque
*
lateis.
Paulo niinor melol. horticola.
Corpus nigrum, subtus albo - hirsuinm , supra anusque
fla-
vescenti - tomentosum.
ClypeuS subquadratus
integcr,
Thorax niger ,
_,
niger^,
marginatus, margine valde elevato,
capite basi hirto.
hirtus, lateribus
et margine postico flavis ;
lineae duae in medio dorso abbreviatae, flavae.
Elytra hirta ,
flavis.
laevia , biunnea, sutura et margine postico
445
Pcdes antici picei; postici elongati,
T.fulvipes:
hiitiis,
nigri.
Ihoiace cinereo; elytiis ferrugineis ;
margine postico flavo; pedibus mtis.
Magnitudo, statura
Corpus
subtils
et similitiido
tiichii
*
thoracici.
nigrum^ vellere albo tectum, ano llavo - to-
meutoso.
Clypeus integer, concavus, margine erecto, niger.
Thorax
hirtus, cinereo - tomentosiis.
Elytra ferrtiginea, laevia, margine postico flavo.
Pedes
pilis
raris
hirti,
basi
villosi,
anticorum tibiae
nifi ;
bidentatae ; postici elongati, inermes.
T. fuscipes:
hirsiitus,
subtus albidus, supra ferrugineus,
elytrorum margine postico flavo.
*
Statura et similitude trichii fulvipedis et tJioracid, eorum-
que magnitudo.
Corpus subtus nigrum^ hirsutie alba tectum, ano lateribus-
que
fulvis.
Caput basi hirsuto-fulvum ; clypeus subexcisus^ concavus,
marginatus, niger.
Thorax hirsutie fulva longiori
tectus.
Elytra ferruginea, villosa, margine postico lunula flava.
Pedes omncs nigri, pilosi;
elongati.
antici extus tridentati^
postici
446
T. setosus:
tiis
villosns, subtus albus, supra
nigris stiialis,
pilis
testaceus,
ely-
*
Qitadruplo minor melol. hortlcola, subtus hirsutus, albus, ano
fieuugineo.
Clypeus integer, marginatus.
Thorax fusco - cincieus,
Ehtra
villosus.
seriebus aliquot c pilis
testacea,
nigris erectis.
"
Pedes
nigri,
hirti.
Pcnlcillus ad
oculum utrinque piloruin nigrorum
singularis
exstat cristatus.
T. hilateralis :
hirtus ,
subtus
margine nigro alboque.
Duplo minor. melol.
hortlcola,
albus,
elytris
brunneis
:
*
hirtus totus.
Corpus subtus antice albo - villosum, abdomine nitido atro
segmentorumque marginibus
albis.
Clypeus integer, concavus, marginatus, niger.
Thorax nigcr, valde hirsutus.
Elytra
brunnea ,
angustata
:
margine nigro
fmibria
alba,
suturaque dimidia postice alba.
Anus
ater cingulo albo.
Pedes antici
rufi,
bidentati ;
reliqui nigii, postici elongati
inermes.
T. hilohus:
lineola
hirtus,
thorace gibbo sulcato } elytris nigris;
punctoque
ferrugineis.
*
447
PecUcuU
tripla
magnitudinc^ totus teniiissime hirtus.
Thorax
v.ilde
gibbosus, fuscus,
dio
fcrruginco-pubescens, me-
striatLis.
Scutcllum ferrugineum.
Elytra
nigia ;
lineola abbreviata et
singulo
in
punctum
ferrnginea.
Suhtiis
ferruginco- villosus, niger.
Pcdes
ferrugineo - hiili ;
Aphodil
validis ;
glaber , supra cinereiis, thorace lineis qua-
trillncatus :
tuor,
spinis
elongati.
postici
T.
bispinosi
antici
elytris
tribus fuscis.
oblongus ,
statura ,
*
quadruplo
pediciilo
major,
totus tcctus.
cineritie
CJypeus integer, marginatns.
Thorax
lineis
quatuor
fuscis.
Elytra linca costali abbreviata et sutura
In pectore juxta
Pedes
rufi,
fuscis.
pedes intermedios macula magna flavescens.
antici tridentati ;
Tibiae posticae
fuscae ;
ul-
timi elongati, inermes.
Scutellum minimum, nigrum.
T. ruficaiidis :
que
Pedicuîo
rufis.
glaber,
ater,
elytris,
abdomine pedibus-
*
quadruplo major, totus glaber.
Clypeus quadratus, marginatus, integer, niger.
448
Thorax
convcxii.';^
l.itciibus
ni,i;cr,
piincto impicsso, postice
obsolcta.
stria
tes ta ce a,
Elytra laevia,
im macula ta.
Pectus nigrum.
Abdomen luhm), immacnladim.
Pedcs omnes
et
rufescentes ;
toii
bidentati j
antici
postici
elongati femoribus inciassatis inciniibus.
T. araneoides
:
iTigineis
ilavescens clypeo subieflcxo,
T.
hinotatus
:
Fahric.
hirtiis ,
Duplo minor
horticula ,
melol.
domine
rufo,
Elciiter.
cinercus,
punctis diiobiis nigris.
fcr-
*
fiisco- fasciatis.
Welolontha araneoides.
clytris
c.
clytiis
p.
l83.
testaccis ; ano
*
subtus pcclore nigro ,
ab-
cinerco villo tcctis.
Clypeus transversLis, marginatus, pnbescens.
Thorax valde convexus, olivaceus,
hirtus.
Elftra angnstata, testacea, immaculata^ glabra.
hâtera abdoniinis albo-rnaciilata.
Anus
ferrugineus^ lonientosiis, punctis duobus
Pedes
nifi,
hirii ;
ribus
atris.
antici tridentati; postici elongati,
inermibus
crassis.
T. sexstriatus: subtus albo-hirsutus, supra niger
sexlinealis ; ano flavescente.
Similis
in
multis
femo-
trichio
elytris
*
sexlineato ,
impriniis
elytioruni
449
lineis ;
non vcio
AJagnituduic
quadruplo mjjor,
scd
clavatis.
ci ici ter
nieloi.
totus niger, sed
hnrticoîae ,
siibtus
tecttis
brevior
secl
latior ;
hiisnu'e alba;
anus
supra cinereo - pubescens.
flavescens ;
Clypcus
femoiibus elongatis,
bifidiis.
Thorax niger,
piinctis
minudssimis albis
griseiis,
margine
posiico albido.
Elytra fusca, lineis tribus in singiilo cinereo -albidis.
Scutellum cineremn.
Pcdes antici tridentati ;
ti
intermedii ciliati ;
postici
elonga-
liirsuti.
,
PTYOGERUS
P.
niiistaclnus. * Act. Stockholm.
1.
fig.
2.
1806. pag.
1.
Tab. 0.
3.
TROX.
1\ sul catiis :
niger thorace snlcato alato ;
octo marginequc serratis.
Trox
luridus.
Habitat
in
Fabrîc.
collibus extra
Corpus Trosabiiloso
Caput
parviini,
Aiûcnnac
*
c.
pag.
111.
nrbem.
iiuijus,
loium cinereo- nigruin. ovatum.
nodoso-inaequalc, glabrura.
tri la niella tae.
Thorax convcxiis,
AUmoira
Eleutcrat.
elytris costis
.-U
rugosus,,
rAcad. T. VI.
anlice late
excisus;
57
postice-
45o
rotundatus ,
ciliatus ;
et utrinque
lateralis
in
medio sulcus
Scutcllum minimum.
tenuissime ciJiatas pioducta.
Elytra
pioftindus
cuivus. Lalcia in alas planas,
abdomen undiqnc includcntia ;
in singulo
costae,
quatuor crenatae, coalitae, intcr quas duplex ordo
punctorum; maigo cxterior seiralus, postice ciliaLus.
Abdomen planum.
Femora
ra
anlica macula fenuginea notata; Tibiae spinosae;
tarsi
'J'.
angulata, punctata, pilis hispida; femo-
et tibiae
articulis
sil phoides :
quatuor cilito-spinosis.
glaber ;
niger,
laginco-ciliatis.
ihorace elytrisque carti-
*
Habitat juxta urbem Cap.
Magnitudiiie ^ilphae grossac,
oblongus,
supra convcxus,
subtus planus, scaber, fuscus.
Thorax convexus, nodosus nodis pluiibus parvis; latera complanata, dilatata; margo omnis cariilagineo ciliatus.
Entra clausa ,
marginata ,
rugosa
et nodulosa
nodulis
quibusdam
apice
cinerascentibus
laevissimis fere
penicillatis;
margo
nereo- ciliatus.
Femora
crassa ;
tibiae
spinosae.
Silphac faciès, sed antennae trilamellalae.
per séries,
e
tenuissime
pilis
ci-
451
DECADES TRES ELEUTHERATORUM
NOVORUM DESCR
F.
/.
r S IT
I
ESC lise UOLTZ.
Conventui exhibuit die 25 Jan. 18 15.
Nonnullas eleiuheratoruni
parlim nova
partim
,
in
desciipliones
nova
gênera
gênera Cetonia
nent
tt
ciebus nova condidi gênera ,
siiisse
arbitrer.
:
demque animalcukim
absolutam
addenduni
Plinimi
vel
frustra
cjus
in
allati
historiam ,
tradere
vel
L.
ne
in
quid
parti-
amplius
—
supersit.
Livonia
et
ean-
sit ,
omnibus
niutandum
eleuthcratoium
indigeni,
duo quoque
e
sunt,
Leth ru s
1 .
curam impo-
saepe
singuiis sectari, et
corrigendum
descriptorum
difficile
nonnulli in regionibus Caucasicis lecli ,
Surinamo
rei
Constat inter entomologiae peritos, multis-
qne comprobatiir exemplis , qiiam
bus
adhuc pkires
inde nonniillis e spe-
si
non
Conti-
indigna.
Melolontha Fahric.
species habita valde ditTercntes
quaedam
distiibuta
continent entomol5giae peiiùs non plane
quae
ofTero ,
f e r i u g i n e n s.
corpore oblongo, ferrugineo.
Caput fcntigineum, scabrum,
pilis
paucis instrucnim;
57
*
aii-
452
îice
maigine
l.icvi,
ciilisqne duobiis
Ociili
in
mcdio clevato, tuber-
trijnc^iilo
m.ugine antico
atiis.
miigni, ^lobosi, atii.
Antennae
fcrriigincae,
limae
Lethri
pilosae,
ante octilos insritae, simil-
cephaloiis ,
claxa
at
t.xcavala
(ur-
ceolatd).
Labrnm
brève, tiansversiim^ latc niiaii^inatum, ciliaKim.
Mandibcilae magnae, poiiectae, validae, intcgeniniae^ apice
obtnsae , extus pilosae , .intus nudac , fcrmgincae;
angiilis
Rlaxillae
longitudinc capitis.
nigiis;
brèves, niembranaceae, recrée, pilosae, integrae.
Palpi qiiatnor filiformes:
qiialibns, glabris^
bus
antciiores
aiticulis fjiialuor
posteriorcs
brèves;
inae-
articulis
tri-
pilosis.
ligula membranacea
,
intégra,
pilos^u
Labicim corneum, rotundatiira, inflexum.
Thorax fernigineus, magnus
aniicis dtflexis,
lat«rali
Scutelliirn
mujori
triangtilare,
,
gibbtis,
iiiargine
piinctatus;
citrinquc
(
lex aïo ,
angtilis
piincio
irnpresso, nigro.
pilosum.
ferrciginetim,
Elytra ferriiginea , pilosa, marginata , convexa , haud con-
nata^ punctato slriata;
striis
dominis, siiUira nigricante^
Aîae magnae.
octo;
humero
longitiidine
elevato.
ab-
,
453
PecUis et abdom^f?n feiiLiginea, nitidd,
Fectoris
punctatis,
Pedes
fcriiiginc'i,
ticulis
triangularibus
laminis
latera
miiltis
in
facie
elytromra
pilosi;
tibiis
dentatis, tarsis omnibus ai-
qiiinque elongatis, pilosis.
Uliis. rer. natur. Uni-
Dorpat.
Cacsar.
spccics
Difleit
_,
marginatisque tecta.
Habitat in icgionibus Caiicasicis.
vers.
seLis sparsis instriicta.
partibiis
haec
(magnitudine Aphodii fimetaiii)
cum Lethii
génère, quo tamen separan-
dani non putavi.
2,
Geotriipes thoracicus.
G. muticLis, briinneus, capite thoraceque
atris,
elytris
piinctato striatis.
Caput atrum, nitidum, laeve, glabrum; clypeo piceo, pimctato,
emarginatOj margine elevato.
Oculi picei.
Antennae pilosae, piceae.
Thorax iiter
i
,
nitidus ,
glaher;
pirnctis sparsis lateralibus
m p rassis.
Scutelkim brunneiim, laeve, nitidum.
Elytra brunnea, nitida, piinctato striata^ lineis quinque re-
454
<;iiliiiibus,
spaisis
l'ectus,
.
inegulaiibus,
cactcris
humero
impressis,
laevi.
abdomen pcdesquc picea,
Habitat Surinami. Mus.
Valp'i
at corpoïc
cylindrico.
Scotodes.
3.
genciicus
nitida, glabra.
naiur. Univ. Gaes. Dorpat.
ler.
Magnitudine G. IMonodontis,
Cliaracter
punctis nonnullis
:
quatuor inaequales
:
anteriores secniiformcs ,
postciiores clavati.
Rlaxilla
membranacea
,
bifida.
Lahium coincum, tiansveisum.
^Inteitnae
filiformes.
Scotodes annulatus.
Corpus oblongum , elongatum , pubesccns
taidum, Blapibus
_,
immarginatum,
afiinis.
Caput insertum, inllexum, elongatum, complanatum,
griseo
pubescens.
Oculi magni, globosi,
Antennae
filiformes ,
longiorcs ,
tertio
atri,
rcticulati.
versus apiccm
ante oculos
increscentes ,
thorace
pilosae;
articula
inscrtae ,
elongato.
I.abrum corneum^ subquadratum, pilosum.
4^5
]\]andibulac coineac, iiniilcnuilac, brèves.
Maxillac membi\inaccac
pilosis:
biis,
icctae ,
,
cxteiioii
bifidac;
laciniis
aequali-
magna, tiiangulaii,
inteiiori
païA'a, lineari,
Palpi qiiatuoi- inacqiialcs
gati,
ciilo
Ligiila
secLiiifoinies ;
magno,
ino
:
anteriores
qiiadriarliciilali,
elon-
ailiculo secundo clongalo,
ulti-
compiesso: posteriores
aiti-
Iriangiilaii,
majoii,
iill.imo
niciiibranacca,
ovato.
bifida;
laciniis
quadiatis, pilosis.
Labiuin coineum, tiansveisum, pilosum.
Tiiorax siibquadratus, giiseo pubescens, immarginatns, antice lOtundatLis,
tiis
elevatus, capilis basin tegens, ely-
angastior; margine postico medio levitei emai-
ginato.
ScLitellmn
paiMim, oibiculatum, pilosum,
albunr.
Elytra lincaiia, libéra, giisco pubescentia, dense punctata,
immarginata
rigida,
,
abdomine longiora, lateiibus deflexa,
foinicata,
laevia, apice lotundata.
Alae magnae, diaphanae.
Corpus subtus nigro pubescens, nitidnm.
Pedes femoribus nigris ^
nigris ;
culatis ,
tarsis
teretibus ,
griseis,
posticis-
tibiis
griseis ;
annulis
quatuor anticis quinqne-arti-
qUadiiarticulatis ^
articulo
primo
456
tiltimo
et
inciirvis,
elongatis ;
iinguibus
duobus
bipaitilis,
cum
Blapis ge-
fernigineis.
Habitat in Livoniae locis iimbrosis.
convcnit multis
Scotodes
paitibus
in
ncic, ditTcrt tamen satis antennis filifonnibus, palpis ante-
rotundo).
— Noinen gmeiiciim
Carab
4.
C.
Caput
labioquc
securiformibus ,
iioribus
apteiTis,
11
ater,
s
transverso
a
Blapibus
c-œTcCdy^, tenebrlcoscis.
c y a n
elytiis
(in
i
p e n n i s.
violaceis,
stiialis,
nilidum.
aliiim,
Oculi grisei
Antennae piceae,
Thorax
basi
nigrac,
pilosae,
ihorare longiorcs.
nitidus, cordatus, canaliciilatus ;
atcr,
marginibus
externis elcvalis,
ScLitellum parvLim, atrnin, nitidtim.
Elvlra violacea, fere plana, libcra, marginata,
ata ;
striis
piinclis
noveni ;
margine
toto
It-viier
apiccqne tribus
iinprcssis.
Alae nullae.
Corpus
siibtus
Habitat
in
stri-
pedesqiic brcinnea. glabra.
rcgionibns Caucasicis.
Species hacc magniuidine C. leiicophlhaiini.
457
Hydrophilus chalcaspis,
5.
IL
griseiis ,
elytiis stiiatis ,
_
capitc aeneo,
C.iput viiidi acneum, nitidiim, piirictatum, a basi ad mc-
dium usque
Ocnli
carinatuiti.
niqri.
Antennac
flavae,
thorace breviores,
Thorjix feiru<;ineus, punctatus, nitidus; disco nigro aeneo,
feiLigineo carinato.
ScLitelliim
niininuim, griseum.
Elytia grisea, valde convexa^ crenate striata;
striis
e pun-
ctis
impressis, basique lina inter primain et secun-
dam
abbieviata ;
medio marginis
PecLus et abdomen
disco
punctoque in
nigriçante ,
nigio.
nitida.
atra^
Pedcs fenuginei ; feinoiibus quatuor posticis basi
Habitat
in
Livoniae aquis stagnantibus,
atris.
plantis
_
aqua
submeisis adhacren?.
Species haec^ magnetudine H. marginellij facie subalie-
na, qua de causa organa cibaria exaininavi, at Hydrophili
characteiibus
gcneiicis
aequalia
chalcaspis a j^^^Anaainç',
MmotmsderAcad. T. FI.
inveni.
aeneum clypeum
Nomen
gerens.
58
triviale
458
Dyt
6.
i s à 11 s
(Dytîciis
illiger)
D. thorace elytioriiraque margine
f 1 a
flavis,
v i c o 1 1 i s.
elytiis
cincreis,
scmipunctatis.
Caput
alriim ;
macula
antice
duabus juxta
coidata
fcirugineisj
positis
posticeque
lineis
punctisque utrin-
que tribus ante oculos impressis.
Oculi
grisei.
Antennae,
palpi
labiumque fenuginea ;
antennis longitu-
dine thoracis.
Thorax
laevis ,
duobus
latcialibus,
ticum minimis
macula mcdia ,
glaber ;
flavus ,
duobcisquc
punctis
ad marginem pos-
nigris.
Scutellum parvum, atrum.
Elytra
grisea ,
ultra
late
glabra ;
punctis
rivulisque
médium usque impressis,
suturaquc tenerrime
parvis a basi
margine
exteriori
flavis.
Pectiîs atrum, nilidum.
Abdomeiî
fcrrugincum ,
glabrum ;
segmentis
fusco
mar-
ginatis.
Pedes quatuor antici flavi;
tarsis
simplicibus ; postici fer-
luginci ; tarsis natatoriis.
Habitat in Liyoniae paludibus.
Statura D. cinerei,
at
magnitudine D. bipustulati.
4^9.
"J.
.
D y/Ci s c
Li
s
(DyticLis.
D. livido seiiceus, capite,
fuscis.
Cjput fuscum, glabrum ; postice
linca semicirculari nigra.
Oculi nigii.
r
Antennae longitudine
atcr,
marginibus pe-
clytrorLiin
dibusque
Thorax
ser-iceus.
illig.)
th6racis,
•
^
fciscae.
"..)ijj;gn^ Jl
punctatus ; disco lacvi, nitido, limbo livido
sericeo ,
marginibus exterioribus brunneis ;
postice
loco scLitelli productiis.
ScLitellum nnllum.
Elytra nigra, livido sericea ; raargine exteriori fusco.
Pectiis et
Pedes
abdomen
atra,
*
nilida.
fusci ; tarsis posticis nataloriis.
Habitat in Livoniae aquis stagnantibus.
Inter
at corpore
minores
hyjus
generis ,
magnitudine D. ovati,
magis complanato.
8.
T.
T
i
1 1 u s
a t e r r i m Li s.
hirsutus, ater, elytris punctato striatis.
Caput atrum, hirsutum, nitidum, punctatum.
Oculi fusci.
Antennae atrae, longitudine thoracis.
Thorax ater,
Scutellura
niiidus,
hirtus; pilis atris; transverse rugosusj
parvum, rotundatum, glabrum, opacum.
58*
46o
Elylia atra, nitida, piincLato striatà;
pilis
atiis»
no.vem;
striis
pilo-^a
;
.
Pcctus et abdomen atra, pilosa.
Pedes
atri,
Habitat
pilùsi;
in
Longitudine
tit)iis; quatuor
posticis
flavescentibus.
Livonia.
circiter
9.
quatuor lineaium.
Corynetes
•
.
a e n e u s.
C. nigro aeneus, thorace elytrisque pilosis.
Caput nigro aeneum, pilosum,
nilidum.
Oculi atn^ opaci.
Antennae longitudine
fere filiformes,
Thorax nigro aeneus,
thoracis,
pilosae, nigrac, perfoliatae,
versus apicem
pauUo incrassatae.
pilosus, rotundatus,
marginatus; lim-
bo exteriori elevato^ scabro.
Scutellum parvum, nigro aeneum.
Elytra pubescentia, pilosa, laevia, nigro acnea.
Pectus ,
abdomen pedesque nigro
aenca ,
glabra;
tarsis
piceis.
Habitat in Livonia.
Antennae a Corynetis génère panllo diversae,
tura et magnitudo
omnino Corynetis
violacci.
at
sta-
1
46
Canthar
10.
i
p 1 u m b e a.
s
C. ihorace mclrginalo: limbo^ oie, pedibus abdomineque
pallidis,
elytris
cinereis.
Capiit nigiunij pubescens; oie palpisqae pallidis.
Oculi
atri,
nitidi.
Antennac fenugineac.
Thorax
maiginatus; limbo pallido.
ater,
ScutcllLim cineieum.
Elytra pubescentia^ cinerea.
Alae nigrae.
Pectiis
cineieum, sericeo nitens.
Abdomen pallidiim; segmentis nonnullis nigro maculatis.
Pedes pallidi;
femoribus
posticis
geniculo
nigro,
tarsis
ferriigineis.
Habitat in Livonia frequens.
Affinis
videtur
C. nigricanti
illig.
et
C.
pellucidae
Fahric, diffeit tamen elytris cinereis^ abdomineque pallido.
11.
Cantharis litterata.
C. thorace marginato, ferrugineo: medio
elytris
Caput riifum,
Oculi
atri.
basi nigro
testaceis.
maculatum,
M nigro,
462
Antcnnae nigrac,
Thorax
basi feiriigineae.
utiinque
mcdio
feiingineus ;
marginatus ,
diiobus
M
punctisqiie
versus marginem posticum nigiis.
ScLitellum testaceuni (interdum nigricans).
Elytra testacea, immaculata.
Alae cinereae.
Pectiis nigrum, sericeum.
Abdomen nigrum ; margine rufo.
Pcdcs
ferruginei ;
omnibus
femoribus
striis
duabus longi-
tudinalibus nigris.
Habitat
in
Livoniae betulis.
]\Iagnetudine variât;
at
macula thoracis média constans,
puncta duo postica interdum in
macuiam iinam con-
fluunt.
12.
Canthar
i
s
me
1
a n o d e r a.
C. thorace marginato, nigro punctato, pallida, capitis basi
corporeque subtus
Caput pallidum;
Oculi
atris,
ano ferrugineo.
verticc atio.
alri.
Antennae ferrugineao,
Thorax
ferrugincus^
basi rufae.
marginaïUa, angustalus; macula longi-
tudinal], nigra.
463
Scutellum cinereiim.
Elytia pallida, immaciilata.
Alae albac.
Pectus atiLim, nitiduni.
Abdomen atriim; ano feirngineo.
Pedcs pallidi;
feiiioiibiis
posticis
macula nigra.
Habitat in rcgionibns Caucasicis.
Magnitudine C. tcstaceae.
l3.
Cantharis melanoptera.
C. thoiace marginato, rufa, capilis basi elytrisque
Capnt rubrumj
Oculi
vertice atro.
atri.
Antennae nigrae, basi
Tlîorax
rufLis,
riibrae.
marginal us, immaculatus, nitidus.
Scutellum rufum.
Elytra atra, nitida, immaculata.
Alae nigrae.
PectuSj
abdomen pedesque pallido
Habitat in Livonia.
Magnitudine praecedentis.
lufa^
immaculata.
atris.
464
C
14-
C. coleoptiis
racis
c c i n e 1 1 a
m a n a.
punctis rnbris quatuor, capite, th*-
atiis:
lateribus pedibusque anticis llavis.
Caput
fiavum_, nitidum, glabium^
Oculi
nigri.
Antennae
r u f i
antice laïc emarginatum,
flavae.
Thorax gibbus , glaber ,
magna, triangulari,
nitidus ,
atcr;
lateribus
macula
fia va.
Scutcllum parvum, atrum, nitidum.
Elytra atra ,
nitida ,
subpubescentia ;
puncto altère disci
maculari, altero apicis miiuito, rubro.
Pectus et abdomen
atra.
Pedes
quatuor postici fcmoribus nigrisj
antici flavi,
tarsisquc
Habitat
in
fia vis.
Livonia.
Statura parva, magnetudine
1 5
.
Coc
i
C. rufipcdis.
n c 1 1 a c x c 1 a m a t i o n i s.
C. cassidea^ coleoptris
tionis
atris
:
signis
transversis,
atri.
Antennae
flavae.
duobus cxclama-
ru bris.
Caput rubrum, marginatum, nilidum.
Oculi
tibiis
,
465
Tliorax angulis anticis productis^ atcr ;
disco nitido pun-
clisqnc duobus impressis, latciibus opacis.
minimum^ atium.
Scutclliiiii
Elylra atra,
glabra ;
nitida,
punctoque
formi
disci transversa cunei-
linea
versus
margineni
riibris ;
abdomine
supra mbro,
late
niarginata ; limbo punctato.
Corpus
atruin ,
sLibtris
opacum \
sublus rufo marginato.
Pedcs
atri
;
geniculis tarsisque ferrugineis.
Habitat
Livoniae pinis.
in
C. arcticae, at coleoptris magis convexis.
R'IagiiiLudine
16.
Chrysome1a hume
C. viridi acnea,
r
a 1 i s.
thorace elytrisqiie punctatis,
ano
ferrugineo.
Caput viridi aeneum, punctatum.
Oculi grisci
Antennac longitudine thoracis ;
ridi
primo magno vi-
aeneo, glabro; sequentibus quatuor ferrugineis^
glabris,
Thorax
articulo
ultimis nigris, pilosis.
pl'anus ,
immarginatus ,
punctatus , viridi aencus,
transversus.
Scutellum parvum, acncum^
Mémoires Hel'Acad. T. n.
lacv^e.
^9
466
Elytra mnrqinatn, puncUila, viiidi ncnc.i ;
nullis clcvaûs obscuris
basi
lincis
non-
humcio eleva-
abbre\iaLis,
tissiino.
Alac nigrae.
pcdcsquc
viiidi
Habitat in Livoniae
alnis.
Corpus
Anus
siiblus
aenea, laevia, nilida.
lufus.
Stdluia magnitudineqne C. lapponicae.
17.
Ciyptocephalus bicolor.
C. vioLiccus, elyiris limbo lluvo.
Caput \iolaceum, nilidum ;
Oculi
oie flavo.
izrisei.
Antennae corpore brcviores, obscure violaceae ;
culis
Thorax
tribus
basi aili-
fcrrugineis.
violaceus, nitidissimus_, immaculatus.
Scutelluin violaceum, nitiduiii.
Elytra pnnctato striata ;
striis
obliquis
novem ;
violacea 3
tenuissime violaceo marginata.
Pectus,
abdomen pedesque
violacea, immaculata.
Habitat in regionibus Caucasicis.
Variât elylris limbo basi abbreviato,
nullis
fiontis.
impressis
limbi
nigris.
punctisque non*
— Rlagnitudine C.
ilavi-
4^7
C ryptoccpha1us rn f man
1 8.
i
ii
s.
C. violaccLis, oic, antcnnariini basi pedibnsque anlicis
Caput
violaceum ;
iTifis.
antennas
inter
fascia
rubia ,
labro
violaceo.
Oculi
atii.
Antcnnae longitLidine
Thorax
corporis, pilosae, nigrae, basi rubrae.
violaceus, nitidus, laevis.
ScutellLim, violaceum, laeve.
Elytia violacea ,
strias
nitida ,
punctata ;
punctis
nonniillis in
singLilares congeslis.
Pectus et abdomen atra, nitida.
Pcdes
aniici
flavi ;
femoribus
stria
nigra ; caeteri atri \
femoribus basi paullo rufescentibus.
Habitat in Livoniae salicibus.
Magnitudine praecedentis.
19.
M me
i
t e s.
Character genericus:
Palpi
quatuor
inaequales ;
articule
ultime
majori ;
truncato.
Maxilla bifida: lacinia exteriori cornea, apice
Liguîa membranacea, bifida.
Antcnnae setaceae.
59*
fissa.
4^3
Alimctes unicoJnr.
Corpus ovatiim^ elon^atum, opacnin, lacvc.
Caput inseitum, inflexiim, fcrc loslratnm, cyancum, nitidum.
globosi, reticulati, lalcrales, ni^ri.
Pciili paivi.
Antcnnao setaceao, thoiace longiorcs;
nimo;
I.abmm
atrac.
qiiadratiim,
ciliatuni.
Mandihilae coincac, exsertae, apicc
Maxiilae bifidae
fissa
:
lacinia
inteiioii
;
arliculo secundo mi-
fissae.
exlcrioii coinc a ,
membianacca ^
lincaii ,
intégra,
apice
bicvioii,
ciliata.
Palpi quatuor inacquales:
ri,
anteriores articulo ultimo
compresso, triangulari; posteriores brèves,
culo ultimo
iTiajori,
majoarli-
cylindrico^ truncato.
Ligula membranacea, bilida: laciniis divaricatis, rotundatis,
pilosis.
Labium corneum, integrum, rotundatum.
Thorax
ater , nitidtis ^
angustatus;
antice capilc mullo latior,
lateribus
rotundatis ,
poslice
margine posiico
elevato; laie canaliculatus.
Scutcllum parvum, rotundatum, atrum.
Elytra atra, opaca, ligida, fornicata, haud connata, abdo-
men tegentia,
ultra
médium
basi
defloxa,
latitudine
thorace duplo latiora,
incresccnlia,
apice loiun-
469
data, marginata, punctata;
nalibus subelcvalis,
isfî.'.ncio
striis
quatuor longitudi-
prominentc.
Alae niagnap, diaphan.ic.
Corpus subLus atrum, opacum.
Pedes
quatuor anlicis articulis quinquc, primo
tarsis
atri;
clongato;
posticis
articulis
quatuor, primo longis-
simo; unguibus duobus incurvis, simplicibus, rubris.
Habitat
in
Livoniac sorbi aucupariae floribus.
Genus habitu proximum Mylabridibus
,
spccics
haec
magnitudine Mylabridis decempunctatae. — Nomen generis
(.(.L;j.ijri)ç,,
simulator, capitis inllexi causa.
20.
Character genericns
Stenodera.
:
P((//j/ quatuor aequales;
articulo ultimo majori, truncato.
Mavilla cornea, apice mcmbranacea, pilosa.
Li^iila
membranacea,
bifida.
yiiitcunae setaceae.
Stenodera sexpimctata.
Corpus oblongum ^
immarginatum ,
laeve ,
subpubcscens,
tardum.
Caput magnum, depressum, rotundatum, exsertum ,
xum, punctatum, airum, subtus pilosum.
inf}e-
4*/0
Oculi niagni, ovati, marginales,
Antennae setaceae, nigraj^
leticiiKiti,
"ante
ociilos
alii.
inscilac ,
coipore
bieviores ; ailiciilo secundo minimo.
Labmm poirectiim, cornetim, ovale, atrum, ciliatum.
brèves ,
intiis
integiae ;
apice
]Mandibulae corncae ,
membianaceae ,
extus
pilosae.
Maxillae
corneae ,
membranacea
lamina
geniculo tiunco inserta, pilosa.
Palpi quatuor aequales; articulo ulLimo majori, compresse,
oblique truncato.
Ligula
membranacea,
bifida :
laciniis
elongatis,
truncatis,
pilosis.
Labium corneum, ovatum.
Thorax
antice angustatus, posticc
ater,
nitidus, elongatus,
latior
margincque elevato ;
punclo
magno prope
marginem posticum medio impresso.
Scutellum parvum,
Elytra
ovatiuii,
atrum, opacum.
immarginata ;
molliuscula ,
fornicata ,
abdominis ;
haud connata
rubra ;
glabra ,
juxta
nigris ;
positis ,
,
thorace
latiora,
puncds duobus inaequalibus
ultraque
subrugosa ;
lineis
médium
macula
basi
sinuosa
nonnullis obscuris longi-
ludinalibus elevatis ) humero elevato.
Ali de daphanae.
longitudine
duplo
471
Pcctus et abdomen nigrn, seiicea.'
Pedcs clongati ,
aniicis
tis;
articulis
tarsis
elongatis, quatuor
posticis
quincjne ;
ungnibus diiobus
qUadriaiticiiLi-
lubiis,
bifidis^
incurvis.
regionibus Causcasicis.
Habitat
in
Gtnus
intcr
haec
seiicci ;
nigri ,
niagnitiidine
Lyttam
Mylabridem
«et
Fahr. ;
spccies
— Nomen
Lyttae erythroceplialae.
ste-
nodera a cTS.cg, angustus, et èécy, cervix.
21.
Moidclla flavifrons.
M. ano inermi,
atia,
antennarum
anticis
Capnt atrum, nitidum ;
Oculi
basi,
oie pedibnsqiie
feiingineis.
oie palpisque fetriigineis.
'
atri.
Antennae pilosae,
atrae ;
basi
articulis
tribus feirugineis
glabris.
Thorax, scutellum elytraque
atra,
nitida,
immaculata.
Alae nigiae.
Pedes antici ferrugineij caeteri
Anus
atri;
spinis tibiarum fia vis.
inermis.
Habitat in Livoniae sorbi aucupariae floribus.
Magnitudine M. thoracicae.
472
22.
M. ano
ineinii,
Mordella punctata.
oie tlioraccque feniigineo
nigia,
:
puncto
nigio.
Caput nigmm ;
OcLili
oie palpisque feirugineis.
alii.
Antcnnae
pilosae, nigrac, basi ilavae.
Thorax feniigineiis ; puncto
niedio nigio.
ScLitellum elytraque nigia, immaculata, opaca.
Alae
nigiae.
Pectus et abdomen nigra^ nitida.
Pedes quatuor
antici
flavi
;
geniculis nigris
:
postici nigri;
geniculis tibiarumquc spinis ferrugineis.
Anus
incnnis.
Habitat
in
regionibus Caucasicis.
IMagnitudine praeccdentis.
2 3.
A n t h y p n a.
Character g-cncricus :
Pal}3l filiformes.
Maxilla
bifida,
apice setosa.
Manclibula cornea.
lÀS^ula
membranacea,
bifida.
Lab'ium tridentalnin.
yîiitennac
clavalo lamellatae
:
clava orbuculala.
:
473
novo grneri scquentes melotonthae- Fahf". speci-
ITnic
es,
coipoïc
lîirlo,
lis
cLiVcUjue
antennamm
Aathypna
a)
oibiculata différentes, ^dnumero.
ursus.
Rlelolonlha
TricJiius.
anguslis, pLinis, apicc divaiica-
clytris
Fahr.
ursus.
illiger.
.
syst.
IMagaz. 4.
eleuth.
84-
184.
2.
140.
14*^-
Aathypna hombyliformis.
h)
Mololontha bombyliforrnis. Fahric.
p.
M.
Ilerbst.
illig.
Anthypna
cj
eleuth. 2.
141.
184.
Giinita.
Tnchius.
syst.
Col.
Mag.
4.
tab.
3.
84.
25.
14.
fig.
141.
arctos.
Melolontha
arctos. Herbst.
Col. 3. tab. 25.
fig.
il.
d) Aathypna- lynx.
Mclolontha lynx.
e)
Fahr. syst. eleut. 2. p.
Mag. 4. 84, 1^2.
Trichius.
illig.
Anthypna
crinita.
jMeloloUtha crinita.
Trichius.
illig.
184. 142.
Fahr. syst eleut. 2. p. 184. 143.
Mag. 4. 84. 143.
Anthypna cyanipemds.
f)
Melolontha cyanipcnnis. Fahr. syst. eleuth. 2. 184. 144.
Anthypna
g)
Jilrta.
Melolontha
"
Trichius,
hirta.
illig.
Mimoh-is derAcr.d.
Fahr. syst. eleulh. 2.
Mag.
T. VI.
4.
85.
i85. 145.
145.
^^
474
h)
Anthypna
vulpcs.
Melolontha vnlpes. Fahr.
Corpus elongatnm,
hirttim,
Caput brève; clypeo
Ociili
.
syst.
cîcut. 2. p. i85. 146.
immargihatiim.
quadr'ato,
niarginato.
globosi, latérales, niagni.
Antennae longitudine
capitis ,
clavato lamellataej
clava
orbiculata.
Labruni nicmbranaceum, clypeo tectiim, integrum.
iMandibulae corneac, brèves, compressae, acutae, intus membranaçeae, extiis barbatae.
Maxillae corneae_, bilidae; lacinia externa geniculàta^ pilosa.
Palpi quatuor filiformes, subaequales; articule ultimo majori,
ovato, subtrutieato; posteriores hirti, elongati.
Ligula membrahacea,
elongatis,
Labium corneum
_,
labii
apici
inscrta^,
biftda :
laciniis
divaricatis, pilosis.
tndentatum.
Thorax transversus, marginatus.
Scutellum latum, brève, rotundatum.
Elytra fere plana, marginata, abdomine breviora, apice divaricata.
Alae magnae.
Pectus sterno nulîo.
Pcdes elongati;
tarsis
omnibus quinqnearticulatis.
articulis
475
•omnibus elongaiis ,
paiillo
filifoi^mibus;
iinguibiis
duobus
incurvis.
Anthypnae orgnna cibaria a nielolontha valde difierunt,
auteni
tiicbio
multis in partibus conveniunt,
hic
quoque
ad
ab
anthypna
dilTerentia_,
comparationem
trichii
exposai
JMandibulae membranaceae ,
qua de causa
instrumenta cibaria,
:
-angustae ,
rcctae ,
clypeo
brcviores.
LigLiIa cornea, labio
sis,
subtus adnata, bifida: laciniis cras-
medio
triqiietris ,
fossa
ad
maxillae receptio-
nem magna.
Labium corncum, elongatum, apice emarginatum.
Anthypna ab dv^^oç,,
floribus
(anthypna
et vttvocv ,
flos,
bombyliformis
in
dormio, quia in
tulipa
gesneriana)
pernoctare soient.
An
24-
Character gcnericus
IMaxilla cornea,
cundo
t
i
c h e i r a.
:
tridentata:
bifido, tertio
dente primo intègre,
se-
trifido.
Lahnnn corneum, tridentatum, clypeo tectum.
Antcnnnc cîavato lamellatae.
Pertinent ad hoc genus sequentes Getoniae Fahric. specics,
clypeo rotundato,
sctitello
magno,
elytris
60*
coriaceis,
41^
apice tiibcre niillo, sterno lato incnivato, pediimque anticoriim
c)
iingLic
intcrno lato, bifido notatae
^ntichcira tctradactyla.
Getonia tetradactyla. Fabr.
i5i. 80
syst. cleut. 2. p.
Mololontha tetradact. Herbst. Colb)
:
3. lab.
27.
fi^.
i,
bicoloi:
Ant'ichc'ira
Melolontha
Herbst. Col. 3. tab. 26.
bicolor.
fig.
4.
(Melol. bicolor. Fabr.'syst. eleut. 2. 166. 33.?)
c)
Anticheira smaragdiLla.
Getonia smaragdcila. Fahr.
Rlelolontha
syst.
eleut. 2.
143. 44.
p.
Herbst. Col. 3. tab. 27.
virens.
fig. 2.
Getonia smara^^dula. Herbst. Col. 3. 265. 62.
ci)
Aiiticheira fiicata,
Getonia
fiicata.
Fab.
eleut. 2.
syst.
G. cincta. Herbst. Col. 3. tab. 3i.
e)
Melolonl'ha
syst.
syst.
cleut. 2.
elbiiit.
Herbst.
chrysis.
5;
81.?
i5i.
2.
140. c8.
Col. 3. tab. 26.
fig. 6.
.înticheba. vircm-.'
Getonia virens. Fab.
Jf)
fig.
AnticJicira chrysis.
Getonia chrysis. Fab.
§)
i5i. 82,
Antichcha clavata.
Getonia cldvata. Fabr.
/)
?
Aiitidieira
Gcti^nia
syst.
clcut.
2.
141.
29.
splendida.
sj^-Irndida.
Fabr.
syst'.
clcul
2.
141.
3o.
477
B^clolontha splendida. Ilerbst. Col. 3. tab. 26. fig. 7.
i)
^ntkiicira îucida.
Cetonia
liicida.
Fuhr. syst. eleut. 2.
141. 3l.
Corpus ovatum, supra ^labmm, subtus plerumque pilosuin..
ifiiitiàrginattim, farddrn,
Caput îOttîndatum> feVb éxsertùm ; clypeô
rotundat'o,
mar-
'
ginato.
Oculi
latérales.
glfobosi,
Antennae distantes, clypeo SLibtusr ad mandibnlae insertionem
insertae; longitndine capitis clava oblonga, elongata.-
Labrum corneum,
tatLim
:
sub' capitis
clyptum reconditum, triden-
dentibus paullo prominentibus.
RîandibLilae eorneae, crassae, compressae, intus iinid,entataeS
extus margine crenato, reflexo.
Màxillae corncae, crassae, tridentatac ;
tis ;
primo magno , integro,
dentibus acumina-
secundo
bifido,
tertio
trifido.
Palpi quatuor sabacquales
:
articulo
ultimo majori,
ovato,
obtuso.
Ligula méinbranacea, labio subtus adnata, triangularis^ bifida:
Labiuni
lociniis
comcum
ginatum.
,
divaricaiis. pilosis.
lateribus ante apieenr,
apiceque cmar-
4T3
angiUis anlicis deflexis, poriecfi-j, an-
T-hairjx 'tTansvcisuo:
Liteiibusque m-arginatis.
lice
magnum,
Sciitellum
triangulaie, nonnullis in speciebus ely-
dimidio breyius.
tris
Elytra laia, coiiacea,
gine
integro
tbrnicata,
(non
infia
abdomine breviora;
hiumernm
ut
niar-
Cetonia
in
aurata etc. emarginato), apice taberc fossaque média nullis.
Alae magnae.
Pectus steino magno , depresso, elongato,
triangulari, in-
cuivo; pectoris lateia non (ut in Cetoniis
thoracem et elytra supra producta.
intcr
Pcdes femoribus quatuor posticis complanatis ;
ds
pro[)riis)
dentatis, poslicis spinosis;
interne lato,
compresse,
tarsis
bïfido:
poslicis
lacinia extcriori
ungue externo elongato
deorsum remoto,
—
Articulo
ungue
anticis
acuminata, interioii compressa, truncata;
tuor
anti-
tibiis
ultimo
qua-
tarsis
,
ab altero
tarei
anlici
spinoso, pedcs antici tetradactyli apparent.
Ad meliorem Anticheirae generis dislinctlonem ab Aielolontlid
(cum Cetonia nunquani
permlitare potest) instru-
menta cibaria Melolonlhae , ab Antichcira
ponere volo
ditïcrenlia ,
ex-
:
Labium oiembranac^um ,
clypei apici
insertum
,
infle-
xnm, bifidum,
medio
SLibtus
intcr
mandibulas pio-
ducUim.
Klandibulae comeae, crassaci triangulares, intus subdentatae,
exlus edentulae.
Maxillae brèves, coineae, apice truncatae, miiltidentatae; deniibus brevibus, simplicibus^ acuiis.
Anticheira ab àvrlx^iç ,
25.
poUex.
Elater depressus.
E. lineariS) niger, thoiace inargine ferrugineo,
testaceis
:
elytris-
sutura nigra.
Caput atrum, nitidum j palpis
GcLili
•
testaceis.-
nigri.-
Antennae
Thorax
testàcèae;-
depressus, niger ; margine ferruginèOi
Scutelliim parvum, nigrum.
Elytra linearia ,
punctato
striata ;
striis
octo pubescentià;»
testacea j sutura margineque abbreviata nigra.
Corpus subtus nigrum, nilidura ^ ano
Pcdes
testaceo.
testacei.
Habitat in livoniae betulis.
Simillinuis
E. pusillo ,
at corpore
depresso, ferrugineo marginato distinctus.
lineari
thoracequè
48o
E 1 q t Çii" ^l.a V e s c evïj s.
-g6.
E. pallidas, thorace feiriigineo,
Cjpul
rcMiiigiiiciun ,
glabmm'^
elcvatû, puncto
Ociili
magno
clytri?, téçtapeis.
Clypco truncaLo ,
niaigine
iriangulari mpdio impresso.
atii.
Antennae
fuscae,
pilosae ;
Thorax fcncigineus
,
primo feirugineo.
articitlo
nitidus, ^elongatus, complanaîus, sub-
pimctatiis ; margine antico <;iliato.
Scutelliini
paryum, testaccLim, pubescens.
Elytra, testacea, pubescenùa, panctato stùata; stiiis novem.
Pecins glabriim, niiuium, fciiugiûeum.
Abdomen pcdesqtic pallida.
"Habitat
Affinis
in
regionibns Cancasicis.
videtur E. fcrn.igineo, at corpore tninori, ;tho-
racc depicsso clongata satis distinctiis.
27.
E. atf
i-,
E1a ter atr
i
p e n n
i
^5.
thorace convexo, ncneo, elytris crenatis, pedibus rufis.
C.ijJtiL
aeneunij niiidum, convexutn.
Oculi
a tri.
Antennae longitudinc thoracis,
Thorax convexus, aeneus,
ScLitclliim
atrae.
nitidus,
siibtomentosus, laevis.
parvLim, atrum^ concavLun.
4^1
Elytra atra , siibpiibescentîa, crenato stiiata ;
excavatis novcm.
ctis
Pectus et abdomen
Pcdes
e pua-
striis
taisis
riifi ;
Habitat
in
DilTeit
ab E.
atra,
opaca.
testaceis.
regionibns Caiicasicis.
cui
riifipede ,
oblongo, thorace convcxo,
afîinis
acnro,
vidctur ,
corpore
crenato
striatis,
elytris
antennis atris et magniludine E. pusillum aequante.
Cerambyx acanthopterus.
28.
C. thorace elytrisque bispinosis,
Caput
fldVLim, punctatLim;
fia
vu s,
elytris
costatis.
verticc lineaque inter antennas
scabris, ferrngineis^ dentibus duobiis elevatis,
tis
inter
antennas,
duobusque
ad insertionem
aliis
mandibtilarum productis, feriugineis;
bus
magnis antc antennas impressis ;
apice
Oculi mngni ,
acu-
punctis
duo-
mandibulis
atris.
atri ,
aurco nitentes ,
oxcavati.
versus antennas latc
.
Antcnnae corpore longiores, piceae; articulo primo majori,
•
ilavo^
glabro,
tereti,
scabro, secundo minimo, ro-
tundato, piceo, punctato, glabro, caeteris angulatis,
elongatis, piccis, scabris, tertio, quarto quintoque
pilosis.
Mémoires de rAcad. T. 11.
^^
TiioiJX
sc.ibrr ,,
fl.ivu?;,
postnioïc mijoie;
sccibii.s,
{Vnii.uiiK i*^" ;
iitrinqne
duobiis tlcvjtis,
dio c.iiina
Sccitrlliini
spin^s. duabl^s. ,ob;nsis;
iitiinquf^
sc^ibiis
uiiDe^iciiIis
i'cmi^intis ^ uie-
elc\'dta scabid, feiiui^inea,
coidalum, fldvum.
maiginata ; costis tribus longitii-
siibm<;osd,
Elylra ilavj,
diiuilibiis
eUiVTçi^tis
.çoncoloribiis laevibiis, marginibus
«
spinisquc duabus apicis
tei iore
bmnneis, acuminatis; ex-
lon^iore ; sutura elcvatii.
Prctus fenugineum, seiiceum.
Abdomen pallidum, glabrum,
Ptdçs
testacei,- g^Iabii ;
femoribus quatuor posLio's ad
Gulationcm bispinosis,
Habitat Suiinami. Mus,
:Afftnis
ceite
nitidum.
C. bicoini,
tibiis
aiti-»
pubescentibus..
natur, Univ. Caes. Dorpat.
rer,
diiTqrt
tamcn antennis
piceis,
cgpite qnadiidcntato, thoiacis spina posteiioii majori, piac-
cipue clytiis bispinosis,
immaculatis, abdomine pallido et
pe.dibus- oninibu^ testa ceis.
29. S a perd a
S, violacea, scutcllo sliiisque
pectoral! s,
duabus lateralibus pectoris
niveis,
Caput violaceum, punctatum ; labre
pilosor
Oculi
atri,
Antenrieie carpoi-e lonpores, nigrae; aiticnlo
Thorax
primo violaceo.
Irnerrime punctatus, glaber, sublus ad
violacciis,
pedes anticos nlbo maculatus.
Sciitelkim niveum, opacnm.
cyaneo nilida ,
Elytra violacea ,
dense punctata , glabra,
apice ciliata.
Pectus violaceum, piinGtatum, glabram; lineis duabas late-^
ralibns longitudinalibus niveis^
Abdomen
Pedes
opacis.
violacetim, nitidum, glabrum ; aiio -villoso.
atri,
opaci ;
Habitat
im
tibiis
tarsisqae
rcgionibus
Caucasicis.
Univ. Caes. Dorpat.
AlTinis
S.
pilosris.
'
violaceae ,
at
"^
Mus.
rer.
natiir.
distincta ,
signis
'
minor
et
caeteris exceptis, corpore fcre toto glabro.
3o.
Ca11
i
d i Li m
v e n o s u m.
C. thorace piano, inermi, elytris
antennis
rtigosis,
viridi
aeneia,
ferrugineis.
Caput cupreum, punctatum, canaliculatum.
Oculi
atri.
Antennae corpore breviorcs, pilosae, fcrriigineae ;
apice nigiis.
61 *
articulis
4^4
Thorax planus ]
cordât us ,
antice
posticequc
medio cupreiis, laevis, lateribus
marginatus,
et subtus scaber^
viridi aeneus.
Scntellum viridi aeneiun
pimctatum,
Elytra viridi aenea, plana, punctata ; lineis duabus longitudinalibus
rugisque
transversis ciiin lineis cocLin-
tibus elevatis.
Pectus ,
abdonieii
pedesqiie
picea j
clavatis.
Habitat in Livoniae pinis.
Magnitudine C. violacei.
femoiibus
conipresso
485
PLANl^VRUM NOVARUM AUT MINUS COGNlTARUî^l
P E N T A S P R I M A.
A U C T
C.
R E
TRI y I u s.
B.
Conventui exhibait die i5 Fcbr. i8i5.
Qiiod
nus
si
BotanicoiTim
quibus terras australes et mi-
ij,
adiré concessum ,
cognitas
novis indies copias ditati,
scientiae
ambitum recens
plificare
et
possunt;.
nobis^ ad hoc hiemale coeluni relegatis, quibus
splendidioribus
neque natura magnam
horti
aitis
floruni
operibus
abundantiam submittit ,
in
herbariorum nostrorum
que studium
usum
aditus
nec
praeter diLifere
relictum
Qua ratione parum plerumque ab'
homine privato praestaii potest, nisi
copiolas
nihil
facile
sese nostrum exerceat et experientia
qualicunq.ue edoceatur.
sticas
exornare
Kewenses largas suas opes explicant,
gentera
est ,
detectis pLintarum speciebas am-
si cui,.
praeter dome-
ad Musea publica et Acaderaiarum
uberiores coUectiones feliciori
quadam
sorte
reclusus fue-
lit.
Itaque nihil profecto exoptatius
luit,
quam quod ilL Scient. Academ. Petropolitana. veniaiix
mihi contingere po-
bénigne concessit inspiciendi et usurpandi, q^uae vaiiis peu
486
oibrm
KuthenicLini
institiuis
quondam
tnije scrutiitoiibus roportata
etiam
ciica
Jam
herbaiia.
locupletissima
itinerib;is
in
possidet,
est
eximias bas collectiones probari de novo
iiis-
ut
,
eo
praestantitis ,
ficii
bac
fado
agmine
piaestaniia^
tamcn
rapacitas
voracissimoiLim
in
non
,
mihi videor,
nissimo
Academiae
qnibns
Sibeiiae
Botanicorum
ad
eos
pcivcni ,
inicr alios
visi
indigcnaitim,
qui
descentes ,
plantariim fasciculis, ex variis
satis
'dïgni
nobîs
exculiantur.
Etsi
enim
hacc
parum accurate, plantas
praecipne
in
tus,
nec Piinus alrox vcl
ma
raro
cXiTtas
piovincia Gilanensi
confundat, nec locus natalis pluribus
foi
et
ceféi'is
sese
color et
cognitartini,'
prao
asservai-i,
diligcnter
Ginelini fairago,
Imperii Ruthenici et impri-
qui éx itinére infelicis Gmélini 'junièris
bene multos
sunt ,
dernceps edcndis huma-
operibus jam
nostioium
digna de-
et cognitii
consilio satisfacere conabor.
Inspectis itaqiic pluribus,
mis
aut
,
hoc gencie fumni panlo clc-
pauca nova
piehendisse
ill.
qnihus aut tempus edax
ea ,
inter
pepercit
allici et,
undique inumpere animadvcitimus ;
,
cqiiidem
nientius
quid
solct, qiio
ipsa
plnres omnis modi Iiostes, ad perdenduni paiatos
quasi
nn-
oniiiino
génère
siio
collecta
et
dolendum
clsi
tissimam illam expeiicntiam, qiia
est
cclrbrrriniis
a
inicgia
illis
ilIis
satis
lectits,
rite
pepe'rcei'it
manscrit,
et sponte
sit
inlcr
adscnp-
ita,
ut
et
anctor deniqOfe
4^r.
njr.iinn
pI'^Mnirjnc
g.ilciiij;
la 0(11
[)Kiies
jx
tdiii jUciin
no\ .is
.uit
qj.is ,
una
Pentaues
singukis
piopiio eoq-ue
obtriiserit
iis
.
mira sane et miixi'nf sin-
expedivisse
iis
non
Siillem
ciim
cognitas,
pro
per
qnas in
editurus siim ,
illis
ainplo hcibaiio
salis
satis
videor,
inihi
novis agnoscendas
esse intclicxi.
Br
1 .
B.
m
II
t o
s
m c n t o s u s.
j^^^ ^^^
paMJcula eiecta, spiculis lanceolatis subcompiessis glabris,
aiistis
gluma bievioiibus, culnio
foliisque
strictis-
moltissime tomentosis
Habitat
in
Provincia Gilan. Perennis.
Radix repcns.
Culnii pédales aiit scsqtiipedales, adscendentes, teretes, striato,
tomento albo
vestiti,
inferneque geniculis alU
quot inteicepti.
Folia
in
ciilmis junioribiis
approximata,
alterna,
linearia,.
subpungenlia ,
striata^
lantigine
patenlia ,
crassa ,
niollissima
imdiqiie tecta.
Vaginae
teretes,
striatae,
aeqiie lanuginosae,
Ligula brevis, lacinulata, glabra.
Panicula palmaris, crecla, contracta, panciflora.
Rachis intcr ramos inferiores paniciilae tomentosa ,
su-
perius scabra, teretiascula, sthata,. parura flexuosafr
4S2
Rami simplices, flextiosi, erecti, scabrî.
subcompressae, 6
SpicLilae flavescentes , lanceolatae ,
florae,
flosculis
—9
imbricatis.
Gluniae calycinae lanceolatae, compressae, glabrae, inaeqtiales
:
nervis tribus ,
niinori
exterior elliptico-lanceolata ,
glabra,
majoii
acutiuscnla
acuta nervo unico notata.
Gluma
corollina
superne
niargine
pidiusculis
gluma
membranacea ,
sub
percussa,
bifido
terminata ;
breviori
triplo
apice
nervis tribus hisarista
Gluma
exteriorem aequans^
paulo angustior, apice
ad flexurae angulos
ciliata.
recta
interior
bifida,
Axis scaber, truncatus.
Gerjîien hirsutum.
Explicatio Ta bu la e IX.
a)
spicula intégra
h)
calyx m.
c)
corollac
d) corolke
e)
Tab.
A.
n.
gluma exterior
a.
gluma
a,
interior
Arist
i
d a
pauicula erecta ramosa ,
arisfis
n.
PistiîUiin a.
2.
X.
m.
p e n n a t a.
ibliis
aequalibus plumosis.
liliformibus longissimis,
489
Patriam
ignoro.
Inter
plantas
Dauricas
praesertim
b.
absque nomine locique natalis indicio in-
Pallasii
veni. Perennis.
Radix in arena
late repens videtur.
Culmi bipedales,
conferti,
erecti, geniculati, superne ra-
mosi, teretes, glabii, ad inium usque foliorum vaginis
tecti,
Folia alterna , patentia , convoluto - filiformia ,
longissitn»,
incurva, retrorsum scabra, glaucescentia.
Vaginae
teretes,
striatae, scabriusculae.
Ligula brevissima, truncata ,
villis
brevibus dense bar-
bata.
Panicula longa, ramosissima, erecta, ante anthesin contracta.
Rachis angulosa, leviuscula,
Rami
striata.
tenues, elongati, divisi, subflexuosi, scabri.
Spiculae compressae, lineares, glaberrimae, uniflorae.
Calyx aristas subaequans: glumis lanceolatis
longum
riori
attenuatis, glaberrimis,
nervis quinque,
interiori
in
acumea
inaequalibus; exte-
paulo minori nervis
tribus leviter notata.
Gluma coroUina calyce multo
brevior, linearis, gldbra,
convoluta^ basi fasciculo pilorum brevissimo stipata.
KUmoirc, dt VAtéd.
T. VI.
^*
490
terminales, patentes,
siibarqiiaîcs; pUimosae,
coroILi quadiapto longiores,
calycein vix stiperantcs.
3.
Aii-'iJf"
T.
Allant.
nijs
oninino yJrlsticlae
PanicuLi
Obs.
Ceterii'ii
35.).
t'ilifoimibus
puii^ciitis
grainen nosliLim
flaccidis abiinde
0< sf.
foliis
(FI.
longissi-
diveismn.
Explicatio Tabu^^ic X.
Tcon graminis, qtiale in herbario asservatur, paniculam
conversio
Jiacc aiitem
cxhibet nutantem.
ratione
magni-
tndinis plagLdae, in qua siccandiim rcposuit inventer, spe-
cimini
data
\idetur;
esse
adfneiunt
vioies, panicula
instrucLi eiecta,
curavimus apud
a.
.^
et
culmi
spicula m. n.
h)
glumae calycinae m. n.
c)
corolld intégra m. n.
d)
cadem
é)
inseitio aiistavnm,
absqiie aristis a.
earcinique nna
<r,
Crucianella stylo s a.
C. procnmbens , capitulis terminalibiis pedtincnlatis ,
bus
bre-
quoium unum liguide addi
a)
3.
Tab XI.
cniin
qiiinqnel'idis
pentandiis,
cauleq^ue hispidis.
foliis
/lori«
subnonis lanceolalis
491
montium Sanamisicoium ;
Habitat inter saxa
floiet
Julio.
Perennis.
Radix brcvjs horizontalis, lignosa^
Caiilis dodrantalis,
diis
atque
pedalis et
fibiis
brevibiis ramosa.
procumbens,
ultra,
ex nodis lignosis
nu-
infra
emittens tenues
fibras
radicantes, snlcato tetragonus, angnlis aculeis bre-
ramosus
Folioium
sursum hispidus,
raiisque
vissimis
:
rarius
ramis oppositis patentibus.
veiticilli
compositi
simplex,
infeiioiibus
remoti;
foliis
senis,
Infra
bievioribus reflexis;
superne pleiumque no-
nis, lanceolatis, aut ovato-lanceolatis, mucionatis, raar-
gine revoluto caiinaque aculeato-hispidis.
Pedunculus ex summo
maris,
verticillo
pollicaiis, interdum
pal-
reclus.
Flores in capitulo terminali hemisphaerico plurimi, ?luridi,
bracteis sulTulti,
mentientibus,
exterioribus perianthium
ad
basin
commune
singuli,
flosculi
singules
lineari- lanceolatis ,
acuminatis ,
margine
aculeis
longiusculis rarisque
ciliatis.
CoroUae
infundibuliformis
longior,
fililbrmis,
Limbus quinquefidus
tubiis
quam in congeneribus
limbum versus
,
païens:
paiilo dilatatus.
laciniis
brevibus
62 *
li-
492
angastis ,
neari - lanceolatis
nec un-
obtusiusculis
guiculatis.
Stamina
Stylus
5.
—
racta
corollae adnata.
faiici
? ante foecundationein tubo brevior, ea pe-
—
coiolla duplo
fere
longïor.
Stigma clavatum, rugulosuin, bicorne;
siib foecundatio-
ne apicibiis. callosis patentissimuin^ ante et post eam
'
claiisiiiiîo.
Obs.
Hanc ex Rubiacearum.
I.
gantissimam.
a
Gmelino
in ejus hereditate
Laxmcuinia
famiîla
plantam
fascicuîata
ele-
dictam
botanica sacpins videre mihi Gontigit ;
specîmen majus, idque ramosum delineari cuiavi - sed ob
analbgfam pîantae^ nosnae
cum
Criicianellis:
maximam ab
harum tribu eam, diifoeiare non ansns^ s«m, etsi staminum
«iimerus ,.
ceteroquin
quinns,, limbusque
in
pîmibiis Crucianellae
speciebas
noa imgiiiculatus seionetioncitt suadere
videantur.
Obs. 5. Cunt Cr. capitaîa Biîî. (Pl.Syr. Dec. i.T. 3.)
a qua folioriim niimero» ahitirdine caiilis, floiumque colole >
ut cetera taceam
,.
satis. diffeit ,.
eonfiuidi
ExpIicatiO' Tabulae XI^
m.
n.
•)
fios-
h)
ejiusdem faux apcrta êu
non patcrit.
/
493
c)
stamen
a.
d) stigma clausum o.
e)
idem hians
f) germen
a.
a.
g) tubi basis bractea mimita a.
4.
Criici anella Gilanica,
C. procumbens,
foliis
Tab. xtt,
quaternis lineari-lanceolatis scabiis,
floribus reraote spicatis,
bracteis ovatis subciliatis.
Habitat in montibus Sanamisicis et Gambu dictis. Perennis-
Kadix tenuis, fibrîs ad nodulos Bgnosos parvis repens.
Caules spithamei »
pédales», et ultra, geniculati, infra et
imum versus nudi ,
subtetragoni y lèvissime
striati,,
gjabri> basi ramulos foliiferos, supeme ramum unum
alterumve floriferum emittentes^
Folù
in
medio canle congestaj qtiaterna^ lînearia ant lî-
neari-Ianc^lata, acnta, paletitissima, saepe reflexa,
margine infiexa ,
facie punctis piorainentibus sca-
bra, glaucescerttia..
Flores in spica racemiformi
pîeruraque
simplici ,
subinde
composita remotiuscnli, oppositi^ divergentes.
Bxacteae
ad
âoieDût
singulum ternae ^
qûaium. extimai
494
paulo major, ovatae aut ovato-lanceolatae, acutae, lubi basin obvolventes, marginepilisbrevissimisciliatae.
Corollae tubus
linibus
lidLis ;
extrorsum incuiviis,
longiis ;
satis
atiombens quiquefidus
pal-
;
laciniis li-
proxima ,
bractearum
neaiibus ungiiiculatis patentissimis.
Stamina quatuor, fauci corollae
Stylus tubo brevior.
a
Ohs.
Cr.
forma earumque
inseria.
'
ciliata
Lam.
niargine
vix
cui
evidenter
ciliato,
sicut
et
florum magnitudine distinguitur.
Explicatio Tabulae XII.
n.
flos
b)
bracteae ad basin tubi
c)
germtn
a.
a.
4) tubi faux aperta
cum
genitalibus a.
Achille a
v e r
m
5.
Tab. XIII.
A.
m.
a)
i
c ul a r l s.
semiteretibus lomentosis glaucis,
foliis
pinnis oblongis
spinoso-dentatis imbiicatis, corymbo simplici.
?
A.
tcretifolia ,
bus,
pinnis
foliis
pinnatis terelibus cano-pubescenti-
transversis truncatis dentatis dense imbii-
catis, coiymbo simplici. Willd. sp. pi. Tora. III. p. 2198.
Habitat
in
Provincia Gilan. Pcrennis.
Hadix lignosa, subfusiformis,
uiuliiceps.
49^
fasciciilat', pcddlcs, crecti, teretes, tomenCo>
Cailles pîtirimi,
dlbido
s.m[)licis^imi.
tetti,
Fûlia vix pollicaiij,
pinnata
pinnis minimis (infcriomm
:
faciem
lateraque
arcte
obtegentibus) oblon^
sub lente spinosa-dentatis ,
gis,
mar-
distinctis
snperioium serratuiam argutam meriticn-
ginalibiis;
tibns,
apice paulo Litiora, obtiisa^
linc.iiiii,
tomento ^Ibo in*
teitexlis,
— Ex hornni
petiolati
foliorum semipollicaiium, ob pinnas aicte
alis
fasciciili
sessiJes
aut
imbiictitas semitcietuira.
Corymbtis teiminalis, simplicissimus, panciflbms.
Flores magniUidine flonim ^. Ptarmicae, ochroIeticL
Calyx
imbricatiis
margine
ovalo - lanceolatis carinatis^
ciliatis.
Flores radii circiter
ci
squamis
7.
lacinia
reflexa, emarginata; dis-
pkirimi satLiratiores.
Receptaculi palrae Linceolatae, pilositisculae, longitudine flosciilornm.
Ohs. Ob.
lis
cl.
WiJIdenowii descriptionrm mihi non
planam AchiUcae suae
teretifoliae ,
eujiis
sa-
pinnas apicc
truncatas dicit, nostram, pinnis oblongis aciitis instructam,
cura planta
cimen
poteiit.
ejiis
herbdrii
conjungere non audeo ,
viii
claiiisiini
cum
usque
dum
spé-
icône nostra comparari
496
Explicatio Tabulae XIII.
m. n.
a)
flos
b)
squama calycina
c)
et d. flosculi radii a.
e)
flos
f)
palea
disci
a.
a.
a.
g) pars folii
inferior a
tergo visa a.
h) faciès partis folii pinnis obtecta o.
Moooeo^oooooc
497
DE PISCATa VOI, GENSI.
AUCTORE
N.
OZERETSKOFSKY.
Convcntui exhibait die 22 î^ljrt. i8i5.
Pisc :atutn Volgensem descripturus operae pietitim duxi
limine de piscibns ipsis aliquid piaefari;
a
st.itiin
cognitif >Tiem
cum mdgis ad
moddta
m
quae
istoricus naturalis,
h
;
ideo
vulgi judicium
quorum
habeam acco-
neque ea momenta hic proferre possum,
ichthyologus praecipue,
primum
in
hac
Tiumerabo per
prae
stitisset.
Itaque
nomina
pisces ,
quos Volga
vulgus
format , monstrabo, tempusque, quo cujusque celebrio-
re
ris
or copia
niaj
omnia
simpliciter
alit ,
dein divisionem ,
quam
capitur , declarabo, post haec jam reliqua
suo ordine procèdent.
.quis
Volgensibus circa Astrachaniam ducuntur pisces
seque
ntes:
GeAjTâ, ocempb, ceBpiora, comId, craep-
,iH.^i
3^
-^
haec
casanb, ôb.iaa pBi6niJ,a, jrococb
species occurrit) , LL^yiia, Ôepillt),
(rarissime
cy/liaKl),
nCh,
napacB, .niHt, OKynt, ro-
•^er
jj'b,
uo/\At)iiJ,in\b,
•'tOT
ijiB,
KpacHonepKa, mapaHL, epmb, GhmeHâH,
ca sô^K, ycaMb, BOÔJia,
Mémoires ^t rAcad. T, VI.
mepexb, hohh,
ce.ib^a,b.
^^
493
O.nnrs ho^
pcll.uur
I
ccciioea,
cLisscs
frrs
iii
ap-
priji^i
paCi.a;i p:::La (rubr.i),
quo KfiMldr Or:.:/^
coj.'ji-vt
Sccundu iiicninhOLaR (drpur-
ciitip.;jiih.
^jpfKi ,
niiniiiuîi
dc^cj(uiin.nid.i) ;
cauurh,
C-ÈdiÂ
phiOumiy Jocori,,
Tt'ili.i
vrn;:;n:
di\iJ;i!>t
^
'{,
crrj.iyh,
lioc
nomine
l'cniiinr,
ujj[Ka,
ôrpiuh,
ciiîcikl.
siib
audit .iLlL'Linhl (usualis sive parva), ad
quam
rtli-
qui nt i^nobilts vilioicsque icicgantur.
^li:cinjiKG6aji et .i/Ij.iorna/l (juolibct
•viis
tx fo nuipcio tantum duobus,
liibeino
nuario
Tenit ,
tcnipore
in
maxime hamis
aquarnm
ôfjMHÂ pblôltlia et
Prior non
piscis).
Volga glarie probe obdiicta
Posterior
extialiiliir.
plena
Ja-
tantum
tiirgentium' et tnrbidaium intindatione sub oculos
cum
qui
gppellauis
est
saepissime ex iisdem
G'ÈlUCHaji ,
Ejus turc temporis tanta
Astrachanenses
elongati
in
quod
infixis
in
latine
altum piosiliat,
furentcm lirsignat.
multitude conspicitur,
pontibus stantcs
pio unaqiiaque
corripiant extiahantque.
sis
se.
Mai Balyk (pinguis
tatarice
C'hmnd'iR ,
ciili
flu-
aut lacubtis obvri siint, et nunquani non capinntiir, ex-
ctpiis
nisi
anni lenipore in
ut pucii
nnculis extremitati bafcre
mcrsione
A Tataiis is comeditur
,
pisccnv
a
Ros-
minime.
K}aCHa/i phiôa cerlum emigrationis, quae apud pisca-
tores dicilur xO^lh pbiCk,
tempus agnoscit.
ga soluia, q^uod sub ûncm Febiuaiii vel
Glacic in Volinitio
M«utii ac-
499
ciderc sotet ,
o;ciin
scquitur CCùpiOiCl
niaxima
hac
ditui
peiqne
,
copia capiUir ,
in
spccics
Vol-
in
Aprilis
et
si
CtliepAli^lh ;
XO.lOeaA ,
mare
tendit ,
appellatur
dein
et
iterum
Dum
vero
circa
ad
occùltatnr
versus
duo tempore
piscis
Ccepioza
vero
sesc).
quae diebus jam
frigoris,
aquae
,
inukis giegibus
médium Augusti
tempus
frigore
octllip'b et CCbplOiCl, ôi.lij-
dicit.
(volvens
audit,
(calida)
lumni
CCCpiOlCl
vulgus
JiOKivnnaJl
iiiapKan
finem Julii
ut
tempore
aqciis
(juando occunit, nominatur tu ne
(enans , seu niigrans),
rétro
s])ati(iin
ex parte jam gra-
majoii
iteïum
inundationis subsideniibus ,
vcTO lum laiius,
mensis
nominanuiique eo tcmpore am-
conconiiiantc
on'Uipji ,
intfginiii
tempus vero ipsum audit XO.yb
ù'Linuh;
médium
Circa
Ô'h.lÂKil'
iCl
Caspio ultro
m.iri
pdssim ivl)ir. IJanc diiabus ciicilcr hebdomadibus practer-
iapsis
bae
ex
lklui:^a
stniirn
rigere
Béluga
vero
capitur ;
calidis
si\b
initio
au-
ut loquuntur, emigrat.
incipinnt,
OCCiUpb cuiii
remanet, quaerens sibi
lûca proptcr liiemandum, ut loquuntur, profunda, quae
xime
ad concursum
ficri.
Omncs hae
duorum vel
très
diciLur
fia
fluviorum
soient
specics unà sub oculos veniunt na-
tantque in aquis A oJgae.
Allia
trium
ma-
Circa loca ejusmodi natans ôk-
JiMhi .10;Mmc/l
(in
foveas deponitur), quae
loca versus mare tan lum observantur. Celebriora ex illis sunt:
tazmcKOJii ifeLipfnicKihi, nijMip/iucKCtJiy KO^weepinna/i etKO.ucna/î.
63*
5oo
Qnomodo ex
his-
3clugae
locis
extrohantur ,
suo loco a
me desciibetui\
AutLimmiIes pisces veirsalibus eijLTsdem specier pingui.
oaes- sLint,
tempore
tur,.
veinales veto acsLivaîibus postpom.iiitui.
Aestivo
oeciiirentes pleiumqiie absqiie ovis (w^pa) capiim-
unde dhcuntuf jUa^an veL xù.mcmaj%
(coelebs); vere
veto autuinnoque majort ex. parte CLtm.^ ovis. undc audiunt
.
Miignitudo-
pisctiinv. vaiia*.
et dfversar. obsetvatar.
ïuga non excedit uliia 2 S spitbaraas Kossicas;
lum
Luilù
casum-
nadirabijiit^ qiio
33. spithanTaïum. longam.
umcum! tan-
piscator. Béluga
ad ostiiim
Bïcsan
m aiitumno
extraxit;
veïo 4, spithamas dod. descendit. Oidinaiie capitur
.1.0
Be-
infra
7, 8, 9,
ad 12 spithamas loDga,.
Ocemfby. J3nî- raaxrmiiSj non;
thamas 3
roinor.
vero
crdinaiiae
pliis
quatn 9 spi-
3 spithmarnm, dictus taAÔhimis non
extrahitLir ; * usitatoque
Ceepioeci
atititrgit
5,
6 et 7 spitharais longiis
irretitur.
maximae 8 spithamaxum. miniraae 3,
niensuiae
5 et 6, in Volga capitur»
Reliquaiuui
paucis potest.
in. venditione
,
piscium
ccvta^
raai.;mtudo-
determinari
a
cum eoEum- niimerus magis quam; miîgnitudo
aut piscatione: spectetui.
Ex varia. BeUigae magnitudine vaiiav iterum ejus denominatia oiitor l quae. 1 2 LintLiai spithamas. attingit, appellatur
.
5oi
Jtiipnaa, infra hanc mensiiram descendenç, jio.îipi-Èpiiajl,
inferior, caJlKÔmJt diciuir;
hue
a i3 ad i5, \6 spithamas ^p.f/ûwz-
mn^ a 16 ad 1 g Jia.lfpiamepttM^ qiiae ultra, Mmnepan audit.
i3
Topùijma
x^aj^uia
spilh.
ad
magnum corpus tenue prolongatum
cunque obvium.
let
de Béluga
tiones
est
Volga degluciens;
valde vorax, quod-
hoc tantum va-
et
in reliqvarum Laensuratione
:
hae appella-
apud
piscatores atque-
nanr uterqiie
ex ea praetium
est
rrBomenli
irragnr
herum (xO-SAIIhI))
piscibus sumit,
licetr
,
nonnnnquam heri ad trulinam pisces
aliis, quanti singulis^^ pud^ contraxerint/, vendant.
rantuL-
habct,
non habcat locunis
Mensura
eocuiTï
jn
;
Capat
8.
pisees a dimidio" ociili
Belugae
débita
niensura^ aestimatur
6 spithain. ceepmÈ
Mensu-
ad extremum pinnarum: ani.
12
débita mensuia 'Ron
spitham,. ocempif
statuitur ;
piscis,.
qui debitam' dimensionem non attingit. voeatur ue^OM^pOKIir
quare
pio eodem praetio- duo ejusmodf loco unius, mea—
suram: debttam
non adiraplentis,
da-ntur..
-
Sed hoc totum pendet a contracta herili cum pisca—
tonbus,
a quibus sa^pius piscitim spectatur numerus, non
mensura consideratur.
De his fu^ius alio loco agetur.
Instïumentorurn^ quibus in Volga piscibus insidiantur,,
triai
SQOt.
gênera:
sepimenta-y
Imml
seu.
wici ,.
et
i-etia,.
Soi
'Sepîmcntiin)
duplex
est
/lepcôOMllcl, aliicr KO.loe.ii :
ij/jouin y
rhiiKH y
ceimuwinn ,
singLilis
his
nunc
transvcrsnm
lUHHb
ita
iit
pâli,
unus ab alio
iibi
aqiia
stieniia
tota
eorum
séries
porriguntur.
recto
fluminis
cursn
paritcr
crassis
ram
ceje
qucm
sinuin
ritu
mçdo aicualo
consertis, ab adveiso
his sic
ad fign-
efformati ,
disccdentes,
icctius
a
seque
inviceni
quod spatium ab une
audit.
In
apcllo ,
pâli
carccris
inlroilu
obturata
est
possint.
conliniiis
3
in
car-
patente,
laxius figuntur ,
ut
si
P.i-
sepibus
viminc tribus in locis transversalitex vinctis, quae
palis disjungantur,
cum laqueis supra
tiintur.
Carccium
pro spalio
flu\ ii
alicubi
i3,
lo
•ne a
ordi-
ex palis
omnium intercapcdo
baculalis,
et
serpentis ad extrc-
MiWlcpan introivcrit, ejus magniiudini cedcrc
loruin
ap-
quos U36bl appellant ,
alinm Jiojc
ad
est,
in dimidicim
per inflexionem extruuntur,
carceres ,
e.liam
orgyias
De
primo figun-
placide aqiiae marient,
iibi
Palis
cxovato-cordalarn
circiter
uceO/j-b,
axawb.
et
modo:
fliivii
mitates iisque decnrrat;
ne
jiosou/iû,
jiO'bdAuxa
conficituy sequenti
lemoti ;
flexuoso,
aUnnm
uncoium sunt ciiûcniH,
s.
retium
:
eo.wrdimay
3(l6om:a ,
sigillatim.
3a.6oHKa
tiir
audit
liamoiLim
caHAÔôhe
et
.f//f/iù ,
iinuni
:
iiide
et
et infra demit-
numerus varius
Ji aedificantur.
est
:
Médius audit
So3
aquae
m pote mcciiiitri
ex co ,
f|nod
pi'^Tirncii ,
H3'~l
MCttllPpciH
cxcipienLc , pleiLimqLie Bclui^a matcraja ex-
cuisiîiti
tiahi solcat,
Sepes
du m
lant;
ultra
sese
lum
vcl
ingreditur,
carceiis
in
|)iscis ,
scpi menti
piiloriim
interslili.i
converti
ostiuin
dcxtrorsum^ vcl
sit
i;.i
impertit.
ostiurrt
sinistrorsuire
angiistus,
rét-
ut
ita
aut inflecti non pcrnii'tat, co-
gitur exinde in tali statu manere,
carceiis sinus
carceiis obt.ir-
aqnis promovens ,
in
sinum ejus descendit, qui cum
ro ipsi ad
et
IModus
iste
qualem
latera
vel ipse
capiendi pisces in Vol-
([uatvor tantum locis ,qruie Uczugi noininantur, maie versus,
cclebris
de quibus suo loco agemus.
est:
Ex diversis officiis diveisis quoque nominibirs operarii
Primus
insigniuntur.
mane
hic bis de die,
débet 7abojkas lustrare, an quid piscium detur;
et vespere
autem
scrutatur
est ômopii^ilK'b:
unco
niagno
quorum munus
sunt duo JlOj6mopiL[lîKI/,
vigio
ad
ostia
xis ,
et
malleis
la nt,
et
carceris
cum
ligneis sive
Huic
acutissimo.
iincis
clavis ,
est
parvo
quas
subjecti
stare
in
manubrio
renijUia
nainfi-
appel-
quem piscem ôaiopuilth'b ex puppi pendens ex-
si
traxerit,
mox
ctim
oncis
ad cymbam eorripere et
frontcm
perculere ,
alque
sic
Rclifj^uorum
operariorum ,
qui
captum ad
sunl
yTl|^h
TeKl/UiCt
deponere..
€0.lM.UlLillKh ,
JiHpÂ-
5o4
côopiunn-b ,
KJceen^iiKi, ,
iiHK-b ,
pioa.JLilJim'D ,
munera ,
alio
loco exponentur.
annis zahnjka reficienda est, primo statiin
Bis singulis
veie, et initio autumni,
nonnunquam etiam
vice
tertia
se.
post inundationem. Reficitintur aiitem non ex integro, sed
tantum
ab aquis cormpta sunt.
qiuie
locis,
iis
lus e radicibiis eviilsiis est, novtis
jam
rimosae
evadeqt, novis
infigitui;; iibi
zahoikae ,
aquambulorum, qui de
uczugis
alunlur,
munus
sepimenti
fundum,
inersionis
pluriinas
refi-
duo
industiia
in
mergi
per A'iccs
singulas
in
partes
et
manibus
quod conuptum invenerint, mox cmer-
ubi
conlrectarc;
est
sepes adeo
Antequam
resaiciLintur.
ciantLir
Sicubi pa-
gcndum, inspecLorique dcnunciandum, qui eodem tempore,
dum
hi
ad zaboikam
lustrant,
cis
lacsis
tis
altéra
an
orr.nia
in
navigio pracsto
fit.
Lo-
ab aquambulone demonstialis atque iisdcin refccvice
mergendum
ei
bene rcsarcita
genliam
inrcfecium
uczugis,
qui
certoque scrutandum,
ne vero quid per ejus neglivocatur
relinquatur ,
omnia
socio
a
sint;
est,
alter
ex
aliis
bene scrutata experimento,
nimiruin mersione, testetur. Taie testimonium alteri de.altero
jnvicem agendum
fccte
tangant,
est.
Fundum maxime^ an eum sepes pei-
exp>niri debent.
cuiun dctur, saccis lerra
turatur.
Ut
hoium
Si
refertis,
laborcm
quo Loco spatium va-
quos n'ÈMUbt vocant, ob-
arduum
ob
oculos
ponam.
5o5
dcscribam
niinc,
dunt.
Ante
paci,
spiritLis
paratiim,
qiio
oninia
vini
cyatho unico,
cxhaiisto ,
Iii
rnorans,
ca-
balneum calidissime
introït
quod eu m ob finem proxime ad zaboikas exLriiicom-
dum corpus satis calidum sit, pellcm ind[iit,
usque
navigiumque ascendit,
lustrandum
et ubi
signoque crucis ter
ta ,
accc-
4 circiter unciainm
hic nndus, per spatium unius horae vel duariim
tur;
in
ad liistrandas zahoîkas
ritu
veste dejcc-
est,
pedetentim
corpore elTormato ,
in
aquas descendit, et fundum
petit,
quem pedetentim
ad
tendens sursum attollitur, semper manibus structuram operis
contrectans,
nis
vicicibus
demittensque
cessitas
dein iterum deorsum abît, atque sic alter-
nunc
in
urgebit,
manet, usque
aquis
quam prima
simus et robustissimus ad
put
attollit,
pus riguerit tremueritque ;
ori
in
dum respirationis nédemersus
in
superficiem
intermittit,
calefacto,
promovcndam
vel calidis-
aquarum ca-
qua
dosi
usque
dum cor-
quod dum senserit, statim
bdlneum deponitur, cjathusque
admovetur ;
iterum
attollens
haustoque aliquoties aëre libero iterum opus
suum agere peigit, quod non
rum
vice
sese
momenta saltem continere po-
7
urgente,
Respiratione
test.
nunc deorsum
sursum
sumpta
,
spiritus
ite-
vini alter
corporeque in balneo
pariter
pelle induilur, ad operam suarn
cujus
continuandac modo supra dicto
exit,
fmcm tum jam co die
Mimohtrsdcl'Aca^. T. II.
facit,
cum sanguis ex naxibus a"^4
506
scmicjue animis extiactus in
lluxeifr,
rfr)iisqi;c
i'uerir.
Qui
roiiiisLiis
balncum
yiost
frii;{is
seinper scciticntc, piostratus
tuor
et
jvist
balncum
cjiiinf.|ue
c-t'
balnei
et
dcbilcm
tur.
Ad
minimum
frigorisque
pevlustrandam
dicium
7
opeiis ,
poiem
anitni
tumra
post
et
casus
tolam
spatium
niolcm
eigo
dalum ,
stu-
qiiieti
perpeti hi aqiiambulones cogun-
est ,
qui
non
vitam
suam
cum
morte
commutaiit.
tempus
ante
hoc muneic fungi potest.
totos
concomita-
Singulis
eoiura
q-uatuorve
membris laxatur ;
corripitur.
Leviora damna sunt ,
ffingatur,
aurium
cfficacia
alius
Alius post très
tuniore
strationis
piunt.
capiiisqtie
est conditio
intolerabilius nil
potest.
ilLi,
ad palos et stirculos sepium
Haec
unquam
corporis
cum oculorum acies
minj-iatur ,
dolores nec numciantur vulnera
imma-
Nullus nec
vertigines assiduique tintinnitus postea sentiantur.
ter
vi-
jani
NuUus
plus 10 annis
lies
sepimenti UL
rcquiritur.
unumquemque
corpoiis
iiliiraus
ille
frigus
tamen naluiam
Utranique
patitur.
robustam
et
vei
eiiir»',
qua-
es!",
Dcbilior veio vix
tolciaïc potcst.
diebus
lur.
\icil)us
n>nit»io-,
in-
pcrpelui
At
in-
quae tenipore lu-
in aquis
illisi
acci-
aquambulonum , qua gravius et
in
pisca.tu
exercendo excogitari
Eliguntur ex iisdem operariis^ qui proprii iiczugo-
runv sunt ;. praeter solarium,
singulis zaboïkae lustrationi-
bus^ ainphora una spiritus vini ipsis dalur.
5o7
llepeÔOllKa. Hoc genus st[jiiiiciui a primo niulliu»
pioisusciiic
ditleit,
in
Pcili
alius
tr.insN crsiini
se
a
ordinc»ii
conncxi, quao
in\ iccni
altcKiin
in
cis
solct
ficii
timim
iniani
circitn
ciassis,
modo
fidli
ne
,
paloiLini
cum dimidia
orgyiam
Onines
pâli
fjxi
aliis
aquamm
sedibus
elocenLur.
Interstitia
per
qui
3 vices tiansveisaliter
Ne vero
ope viminis conligantur.
tenuioiibus,
autcm , quos eliam
iluvii
6,
}i36bl
ctiam
hune
a
versus extremitatem supremam baculis ad
paies clavo tiansveisaliter insertis comprimuntur.
inde
siif-
claudunt sepcs, confectae ex baculis abietinis, ad
palis discedant,
spatio
aeque
oblique, ex ad\crso fuiminis cuisti sunt
impetu
3 ciiciter digitos crassis ^
bacillis
fln\ ii laUis apprinie con-
dediiccnda, quod cLiam in zaboi-
rclinquunt.
,
Irabibusquc in toluni sui
tralics
libciuni piopter navigia
scivatur.
inodiis
flm il scinper lecti figuntnr, spaLio
dislanlcs,
ori^)iae
(ingiinl;,
sliucndi
cjiis
in
Carceres
appcllant j quorum numerus pro
varius,
ut
zaboika
in
modum conficiuntur
:
est,
alicubi
4,
ex opposite duo-
rum sepimenti palorum figuntur frontaliter alii duo in spatium
etiam
orgyiae,
ita
ut
carcer
latitudine et lengitudine habeat.
trabibus trabem- transversaliter
nia
latcra
caiccris
dunt; quaiUim
latu!^,
quatuor
angulos pari
Herum summitates etiam
tangcntibus sunt colligatae;
ad proportionem
scpis
quod sinistrum erit,
si
paratae occkir
sccundum
64*
flu-
5o8
occupât ctiam
ciirsum considères ,
vii
sepes, srd
enm
in
moduni confccra, ut suisum exlolli deorsiimque iterum dcmitti
autem per fiinem trochcae injectum,
AttoIlitLir
possit.
quaé
trabi
médium caicciis occiipanti infixa
veio
onere
piopiio
ei
appensis.
lUOlilKO)
se
In
fundum caiceiis
angulos
dcmitiitur clathrum,
piaeparalum ,
langentibus
ciijiis
singiilos
fila
qualia apud siitoies
,
calceoiuni
nsu, plicantur (CHHLKII apud piscatoies audiunt),
quae a fundo ad
instar
extremum
in
alligantur»
Ne vero
fasciculura^
inter
choidaium piotensa atque versus
collecta ,
se
fusti,.
interposita
jpaulul» crassior,
A
est^
trabibus adnexo,
invicem contorqueantur, tabel-
la parva tenuis^ quae zpeôCHKa audit,
fasciculo
versus fascicu-
illis
adnectitur
funiculus
vix unius ulnae longus, unco parvo
gneo ,
quem lumiKh. appellant
hujus
hiachinae,
modus
sequens.
sublata
ad
sales
ad
clatimim constituentes secundum
veio
baculos
mediam latitudinem
lum
(pe-
propter extrahendiun. snnt accommo-
longi
conti
ad
sunt in
lapidibns hnnc in fmcni
ex baculis tiium ciiciter pollicum crassis cruciatini
invicem
dati ;
adjuvantibiis
Labitui
est.
,
terminatus.
li«
Totius vero
propter pisces incarcerandos instruendae,
est.
Janua
infimam. sui
carceris
ligUuram ,
per trocheam suisunL
quam
bacnli transver-
ope viminis constituunt, ut anlea monni, in medio ex-
cipitur
tigno
manus humanae
crassOj unius ulnae iongo»
5o9
extrcmitatcm
iînjns
aeqtialis
cuni ad niodiim
lono;i-
accommodan-
iiansversim, supeiius longitudinaliter,
infenus
ut
tignum
aliiid
ambo tigna
tudinis deprimit;
tur,
alteram
quae palos connccttint,
trabes ,
infia
in
suis,
trabibiis
aliis
jaceant.
Inteinum tignum, janaam tenens, trabi anleiiori per
laxum fiinem unico tantum loco est copulatum ;
quod
inferni alteram
piemit ,
tingentem.
aliquantisper cohaeiet ,
vus
per
ab
utraque
transversnni
cxtiemitasin
qui
funiculo
versus
per
laqueuirt
at-
firmuni
alteram relaxatur. Cuneus; par-
iniicitur,
extrcinitate
januani
illaqueatur,
tiabem posteiioiem
extreiuitatem ,
iina
siipeini,
ne de ipso prosiliat,
infra
simpliciter
trabem decurrente
per nodum^. versus
laqueum cunei hujus extremitates
chordas
vero
nentur-
Supra laqueum huncce cuneum. detinentem. impo-
per
ritUE uncukis ligneus,
te-
a chordis supra memoratis in funi-
culo protensus, qui tam caute huic applicatur,
ut,
si
vei
minimum retrorsum chordas moveris^ laqiieus,. cuneum tigno
per
uncum illi injectum de-
haec
machina eflectum suuni
superiori impositum detinens,
trahatur.
edit..
Atque
Effectus
Piscis^ adversus
devenerit ,.
quam
longe
litur ^
sed
tota
sic
autem
hic
concomitatur
sequenti
modo..
aquam tendens, ad scpimentura hocce dum
rostre-
scrutatur
sibi
ultcriorem. progressionem^
aliquanda scpimentum acerrime quatiens mosentiena
omnia
iii
incassum,, tendit recta, adi
SU)
cl.iutLnim ,
•stpiniciui
-
•rans
Ciirccrc
ywn
prcniil
prGtcnsns
m
choidas,
reLiovcisuiii
totnni
caiccicni
dum teligen't, iinciilns
quns
,
pcr
tiiiclus
vum detinentcm,
simiil
cxplo^
si-bi
scmtl ingrcssus ncccssaiio
<]uo
ini;rc(litur ,
(xitus
lucnin
sic
at(jiic
ch trahit
qui tuni ptosilit,
a
trcinsvci?um
in
prcssione piscis
J.iquciini,
cuncum
tignum supcrnum,
\)a\--
in-
fernum picmcns, laxatur; infernum vcio, lr;insversale scilicef,
cLim a superiore jam non
vitale januae elisuni.
mit, atque piscem
sit
Qno
jani
iit
impcditum, smsum exilit, gia-
janua libcrata deoisiim praoceps
modo, dtîm
faeiit incaiccraUis piscis,
submersiim
pro
quatuor contis
illi
ciathmni
Médium
vacuum pioptcr
tas,
haeicntibus e.xliahitur,
tum
sacco ,
est
JïP.pc-ÔOlhlH
acrius hic loci
circiter
cau-
oxcint
appellant.
Parant liunc ex
cannabinis digito circiter crassis in initio,
tremum
v-ero
ad
circiter
8
quo saccus
ab
fundum duplo tenuiorihus
modum cuculli,
ad
Jiiat,
orgyiam
vero pisces transcendai e possint,
in
funibus
ijutem
sursum
soli-
qucm
(jus
!
jQuvio agi
iindas,
Ne
relinquitur.
spatium
fcindum
in
piscisque vcluti in patora^ jucunduni sjiectaculnm
-dcproniitur.
Hoc
cdvca tcnct clausiim.
in
oris
;
ad expleclitur
extremitate quadrangulari,
profundus ;
ad
orgyias
totus
annuli
viminci, intcrstitio spithaiiiac iinus
latcra
oris,
altero, pcr tcnnia funiciila applicantur; ad palos vero,
viicuuni inlcrsiitiiim ilu\ ii pieraentcs ,
ligiintiir
in
fundum
5^1
conti
loiii^i
arcte
(|iie
ad-
ibidem
Lipide
d-eiiicri^uiiMir ,
pei
lios
ctis
veio
ut
liqtii
LUiini-i
ani^iiH ,
abire
dobcnt
piscis
si
rc
(jiiorum
pjiiDiii
u'iiii-
liberi
stint,
in
fundcuiî
cnn-
eum
fnnibas longr
saccuin intraverit ,
ipso jam aquao cnisu cxtcnditin
ut
aiilcin
seqncntia
aqua-c,
hr,^c<'
omncs
(jui
,
In
opportuiK
extiahi collii^icpie unà in contis possint. Sac-
illi
,.
im-nioiiiti ,
jni\i;itnr ;
inspiLo
hisccn-s ;
corTstet
cie
contos
merr^cndi.
facilcquG
cmn
supeina palis arlnevi.
cxtremiCd-fe
,
injiciuntnr annuli
ootUor)
I
in
sij^^ni
saccuni
appiime pcr clavos
ccrto piscem
in
loco adbibcnttir.
fkientis,
juiieta.
utpotc contra'
,.
s.icciini
In
ipsa superfi-
tiansvcisini' jacct trabs palis
In
médium
trahis firmitcr in-
quercinus non' adco magnus, similis
ligitur arcus
illis,
bus parva dolia vincke solemus,
eum in modnm,
extremitas ejus haereat in trabe ,
altéra,
tenuior
pectantem
sacci
chordae,
nexae^
quibus
similes
caicerinis,
atquc a fundo protensae,
copulantur ,
Itaque
dum saccum
movet, arcus
inflectitur,
operariis nunciat
una
et
mcdiae latitudini
parvum eidem arcus
piscis
qui-
Ad hanc pros-
tintinnabulum
plicalur.
ut
quae brcvior
saccum quasi naso prospecte!.
est,
inlrasse'
eum
extremitati ap-
intrat ,
chordasque
statimque campanula sonum edens
piacdam in sacco dari, quo audito mox fu-
ncs ultimis angulis sacci applicatos corripiunt, collcctisque
fais
omnibus saccum foras extrahunt, praedaq^ue potluntur.
5l2
Hoc genus sepimenti non est ita
perrenne uti zaboi-
ka , sed singulis annis de novo cxstruendiini.
ex
initio
autumni ad
congelationein
a.qiiae
quod temporis spatium non nisi
très circiter
Usus ejas
tantum valet,
menses compre-
hendit; nimiram, ex initio Septembris ad cxiuim Novcmbiis;
aquis
sub
riae
ad
obdiictis destiLiittir
Sex
p( rcunte.
glacie
_,
noctcsque
vigiles
quantilate
opcrarii
tempore piscatus
cimbis
hi
ad
ad eam sint,
qui
alternis
vicibti.y
piscemqiie incarcera-
machinam ilerum mox apparent.
cxtiahant, et
tiim
mate-
dimidia
JlcpcÔOÏlKaMh piaesto esse debent,
dies
in
gelu
sepimentum navigant
,
Non
sed in una rate
longa, remiimque aut coniim niilliim adhibenr, at manibus
Ap-
palos apprehendentes ratem^ qiio vokint^ promovent.
pLilsi
ad hune aut illum carcerem trabes ascendunt, qui-
bus cum etiam asseres
pisccs
extrahere
chordasque
nec
sint
superimpositi, nullo ncgoiio et
et
januam
non
rcliquos
attemperare possunt.
Pisces
demissam
aitus
machinae
,
in
te.
exinde
Jipopijh
invicem
capti vivi deponuntur in
vigium , cujus carina de industria rimis perforata
ditque
cuneos
attollere ,
(excisa) ,
na-
est, au-
aqua semper récente
eo permanente, perque dies aliquot pisces vivos servan-
Ex hoc dcin jani vel vatagam saliendi, vel
singularcm
vivi
ad
lempus
fiigojis
niittendi
in
lacum
depoitantur.
5i3
Propter Zaboicas
nimiiuni taies
pium hiant
apeids et spatiosis, quod
reliquis
magis
profundis
quae
verno
tempore
per
,
piscium graditiir,
in
mare Cas-
tanta
multitudo
nt saepiiis manus piscatorum
prae pis-
cibus dcficcre censenda
sit.
Grcges
SLint^
ut
si
cymba per
ad remos saepe saepius pis-
flnxinm fueris practervectus,
cis
plana, opportuna,
loca
siint
ostiis
qui
flcivii ,
est , prae
capiit
clccta
nec non in aquae superficie dorsa eorum con-
iJlidalur,
spiciantur.
Itaque prae omnibus Volgae locis, quae vul-
go
[phiôUbin)
piscosa
tam quaestuosa sunt, ut de
stantissima
et
rubellorum
lucri
annui ex piscibus
nense rationum conclave {phiônan
Propter Jicpeôonna
stiorcs,
oslio
zaboicarum loca prae-
appellantur ,
his
dev^enditis
40
Astracha-
Kanmopa) capiat.
eliguntur
sive Ka.jôea
fluvii
latus profunditatis majoris, ad alterum
sint
eum
trunci
arenoso
demersis ;
non
angu-
inundationem
(post
pius intercipiunt,
minoris sint, fundo
evulsi
hoc
accidere
solet,
fiindum fluviorum sae-
quos KapïU piscatores appellare consue-
verunt) conspurcato.
si
unum
puro, nullisque arboribus in
lutoso,
enim cum radicibus
mcnii, ut,
—
profundo in Volgam veram decidentes, neque
adco iindas acres agentes, ad haec ejusmodi, ut ad
ut
millia
Ostium
fluvii
eligendi tanti est
mo-
profunditas cjus profunditali proxiniae Vol-
M(m«ireideVAcad.
T.VL
^^
5i4
gae non respbndeat ,
sepimentum
arena
aiit
si
cjsu
aliqiio
post.
quam minimum
obiiiatur
fjctiim
;
non
jani
modO'
qiiaesUim ulliim, sed ne piscem qiiidem unicuin ca{)ere herus possit.
Talem jacturam audivi
fecisse mercatorcm Czei-
nojarensem, qui per très autumnalcs menses unicum Gccinpb
ceperit, fluvii , in qtio erat KO.lOôCt fixum , osrkif non satis
electo profundo.
Ejusmodi commoditatibus instructa loca
adeo
ut ab Astiachània
rara
sunt ,
nimirum
riczin observentur,
nan
8pyT,jcl ,
non
nec
tionem, Ka.MllHCKaJî.
pisce? capiendi;
fîiivius
dua
flinins aujaq/î
locis
Cza-
Enotaevka, versus tepCaiilKOe.Ka
Non speinendum vero
gênera
tantunr ad
oppoitunis ,
versus sta-
liicrum,
heri
vx hoc
aequiiunt,
Pra tribus mensibus ad minimum jam mille rubclloruni de
piscibus lucrantur
,.
eperariis solvunt,
et
erogant.
lèbre est.
In
p»raeter
eani pccuniae
quantum
in
summam ^ quam
exstrucndum sepimentum
ûiwio Kâ.u a hoc genus sepimenti maxime céPrimus ejns inventor pracsul Kasaniensis T/Yco-
fhilact habetun.
Ad extruendum intcgrum na-lôea spatium duarum septimanarum requiritur.
ciïiîi
Instrumenta adhibentur tantum rates
fèstuca y mallei et securis.
Mateiia lignoruiiï ex ur-
bibus Volgae superioribus dcportatur..
In
sepimentum
fa-
ciendum Èum dmni àd id. peitiiicnti apparatii suratus 800
tiaiaellL erogatur..
5i5
Et hacc sunto de gencre instmmentorum primo dicta;
.igcndiim est de altero se. de hamis.
Tiinc
iur
de cnacnih.
Cnacwh in
lingiia Rossîca- latiori sensu désignât
producendum accommodatum. Apud
apcite
piopiium nomen
nibus
reliquis
quens
est.
Praeparandi
distinguitur.
cannabino
Fiini
(a
per
nodum
funiciili
piscatoribus
distantes,
cjus
,
piscatorice
horum singulorum exlremitates
modus
xpejJWllHa
se-
vocatur)
digitiim crasso, implican-
pennam anserinam
quam duae spithamae longi
in\icem
piscatoies vero
quo hoc instrumentum ab om-
obtintiit ,
septcm vel octo orgyias longo ,
lur
quem-
apparatuin ad aliqnem efTectum vel per insidias vel
libet
in
minus
crassi
unam cum dimidia a se
JT0e041l,bl y
filis
ductores.
Ad
tenuibus etiam canna-
(piscatorice jipn6ll6HLhï JipfiMa) annectuntur arctissime
binis
et
In primis igi-
firmissime
unculi
ferrei
(piscatorice KaeauUbl) ,
extremniii probissime inacuati.
versus
Horum sinuationi mediae la-
queus parvus ex setis equinis contortus innodatur, oui versus
extremum
inseritur sudes seu cortex salicis aut
populi
nigrac jam olim vetustae, ecpiMOKl, mensurae Rossicae crassiis
et
longiis,
[ôa.iùitpna
figurae
piscatorice
vel quadriangularis vel subrotundae
audit).
Funis
iransversalis ,
65
*
«ji-^s-
5i6
modi nnculos numéro 60 excipicns, audit
4.1/liHlilK'b'y
duo vero aut
très
aptid pisoitores
in
/j.iHHHHKJi
luiuiii
copulati
vocantLir aa.ll).
Itaque hosce CciUh
fluvii
modo
transversum pluribus
oïdinibiis,
ad extremitalis
adplicantur ,
a
quas
aquaium loco
cant^ dcmittunt; ne vero cuisu
tur ,
quibus ctiam
alii
JiOpii/lKH
fixo
vo-
movean-
lapides ponderosi
transvcisalis
funis
fundum
dicto praeparatos in
funcs suisnm in supeifi-
ciem aquae ab utraque extremitate ducuatur, supia aquas
signi loco tigna, innatanlia
Sitas
în
tcnentes.
hamorum
aqua
hic
funis
est :
transrersaîïs
ipsam fundi arenam tangit, funiculos vero ciim uncis sur-
sum
siiblatos
sum vorsum ludibundum.
dit[ir
aquarum cursu perpctuo hor-
tenet, in
siiber
Cum itaque piscis in fundo gra-
aquani dissecando, et nunc hue nunc iihic sese
fle-
motum aquae perseqaens, uncum
se-
ctendo,
suber levé,
cnm ad piscem
Piscis vero,
trahit ,
atqiie
acie ejus punctus,
dum petere rncipit
,
sic
eum
magis undas qiiatere
locis
et fun-
ad quarum raajorem impetum proximi
etiam liami ope siiberum pertrahunUir;
tis
corpori admovet.
vulneraUim jam
ii
enm miserum mul-
tantum hami tenent, qui pro-
fundius sese in corpus ejus insinuaverunt.
iastrumentuin est praepardtura, »
ut
(jtio
Ita certe
hocce
acriua sese piscis
5n
defendat atque tiigam moliatur; eo
Kon iinprudens atque
ïiictui'.
foi tins
et
rudis videtur
dmius inha-
is
fuisse, qui
piimus has insidias piscibus struendi asum invexit.
Tiiplicis generi-s CHacïïlH usus in Volga datur;hafc, qnarrrdesciipsi,
suborum
cam
audit ôcUÔl-ipouiHCUi vel ciUtaAOenan (ipsa capiens),
vocatur
alicia
Ki[,CKOGaJl
fiu.sla
cainis
sed funis
:
in
hujus uncos loco
aut Behigae
aut
Som in es-
hanc minus soient
in
fundum de-
piscini
piscibus figuntur ;
nicigcie ,
(fmstulenta)
transversalis
hamos possidens^ funibus
pcrpcndicularibus indice instructis applicatus, in aquis mediis
Hoc modo soient praecipue circa Vatagas ca-
nianet.
pere Calmuci
re.i/S,
ducitur.
Teitium;
scilicet
pi«.ciculus
nonnunquam
genus
et
HaJRlîenaÂ
ôCMlia in fraudem in-
(ad
viviim
capiens)
parvus, mapciHh vel go6m dictus, unculfs
accomodatus, pisces praecipue Belugam allicit^ perque suuni
interitum illum interire facit.
versus tantum
niam
et
tali
ritu
Versus ostia fluviorum' mare
pisces capiuntm-.
Inter Astracha»
Czariczin nullibi mihi videre contigit.
Tribus perdiem vfcibuff CHùcnih lustratnr, nîniirum mare, meridie
rc.
et
Lustratur
vespere, aut duabus saltem, mane et vespe-
autem
hoc
modo.
Ad funein indicem ex
cymba dejecla anchora , quam KOUlKa appellant, compreiiendit cxtremitatem ejiis dentibus ciaMb, atque
eum extra-
5i8
ctum
-in
friicum piippi cymbae inseitum
iinciim
împonîf,
dein jnccns in pnppi sensim funem liansvcrsiilem ciim
mcnsuranlis
nianibi.is
fiontcm
pcrcussiim
in
molis
solus ,
niajoiis
niLini
sedet.
Si
que
ulterius
eumdem
totiim
in
cymbam
veio cuni operario ,
niilkis
Cïilih
riim navigat ,
Si piscis fucrit inJiamatus
lecolligit.
clava
donec
iin-
lotamque cjcis longiuidincm ad modum
CLilis a fiindo attollit,
fuerit
et
sic
Uno
lustiavcrit.
niinoiis
qui tiim ad le-
ftmem demittit ,
piscis ,
corripit ,
attiahit
at-
continnarc pergit,
perlnstiato ad
allc-
scrutatisque omnibus ad stationcni ciim pis-
cibus reveititiir, quos in cavcani seu piscinain, quaiii ïcieuh
appellant, ex viminibus contextam deponit, aut ad funem
ligatos in aqiias miitit ,
/linilh
audit.
Si
jani
qiiod piscatoiice na VdiKinii Jioca-
decem aut plus piscium per dies
aliquot ceperit, ad vatagam déportât, et hero reddit.
duilibet piscator ciaM) ad
bere débet,
numerus
40
propter
manum semper praesto ha-
ut jaceant in aquas demeisa ;
permutationem
servandus.
lem singulis septimanis madidos extrahendo ,
loca
par eoruni
Mutant auet siccos
in
eadem inimergendo.
Hoc gcnere instrumcnti utuntur piscatores a subsessione
aquarum ad initium autumni
;
ponuntur etiam hicme Vol-
ga glacie probe obducta; scd hoc majori
in
usu est ciica
Siçf
fluvioninT
ostia
mari
ncc non
exponanc
enticleabo
scse ,.
,.
ipso Gaspio'
in
quo qtianto peiiculo piscatores ,
in
,
mare flucntia ,
iir
dum piscantar,.
posteaquam de
ofTiciis
eorunt
agarrr.
Fluvii
fundo declivi et arenoso magnani piscium copi-
am pisciit()iibus largiuntur^ profil ndi taie eoriim
pioficna
aut ceite paiiini ;
C'f'pioitï,
ïn
aestate enini pisces, piaecipue
profiindo rarissime nec non tempore nubilo et
tuibiilento solum
graditur,
magis vero ducitur arena, per
quant sese volvit, acclivi et non satis alta.
eiibi
oppoitnniLa& loconim detur ,
liaec
piorsus non
Q.uare
si
ali-
non nisi in hisce
arcnosis dcclivibus ciUKlIin demergi soient,
Alteruni genus iincorum: constftimnt jytKIf (arcus), uni
tempori
et
piscantur
bris
ad ivnnm; piscem capiendum inservientes ,
6'L.U'ia
pbl6uiJ,Q
ncc non JancTario,
Wodus
Primnm
eajn
tantum sub finem mensis Decem-
quo tum larga ejus copia apparet.
ejus coniiciendi est seqaens;.
secnri
aut alio instrnmentO' excidifur in gla-
cie ad aquam lîuidam
sa,
fosaiila (jipo:w6î>)
non adco spatio-
niinirum qualis pisei extrahendo est apta,
in
se,
P'rope
ipsam
glaciem deligitur arcus parvus et humilis vimine-
ns, cu}us cornua nfve'
stimgutttui",
lit
madida applicata adeo
fiigore con-
ne rohustissimus q^uidem a glacie absttaheic
520
Pone arcum hune
avellcrcque possit.
minimum
tervalliim
sic
fiimatum, in in-
locantur très conti ad staturam
huma-
nam
simul alli, figura triangulari conica, situ tali, ut infer-
ris
extrcmitatibus
remoti
inque glaciem
In
conncxis
sic
ad
aliquod spatium
infixi,
supernis per
sint
suspenditur
laqucus
aliquantum
ciassior,
duplo longior
et
modum
inflectatur
ut
,
si
cadens,
tis ,
sursuni
anteriorem
sex vel octo
filis
rctro
si
attoUat.
extremitati
vectis
anteriori
nodum
connexi.
cni vectis ,
contis
adstringilur
eum in
demittatur posterior a
addilo sibi aliquo pondère ,
aut
gravitate ,
invicem
anterior ejus extremitas , super
arcum fossulam prospiciat ;
sua
,
se
Dcin
Jus
rite
confec-
tenuioribus contortus, ejus longitudinis,
fluvii
non tan-
hujus funiculi annectitur uhcnlus ferreus
Fini
ut qui in cuacuih
valde inacuatus. Truncus unculi
et
offunditur stanno aut
plumbo
figura
vi speciem prae se ferre videatur,
tali,
ut pisciculi par-
facicque ementita pis-
cem, propter quem hae
insidiae tenduntur,
perniciem
vero
adducat
videatur, in
ut
ut
quae
tali
ad extremam.
sit ,
nioverique
ctlSClUhH,
disco late-
quasi vivus
unculi aculcum squama
infigitur,
emsu earum
;
illis,
nuilto tenuior, versus extremitatem
fiunt,
incnrvam denticulatus
laliter
deorsuin
applicatur funiculus, ex
qui in fossulam demissus tantillum fundum
gat.
a
inscrtiono aquis iacta
pote ad verso,
sine
opposita,
inlcrmissionc perculi-
521
qna
ciir,
moveri
et
resplcndcie cogitiir ;
loni^iiis
iindis
versus
unciilum
-Iseqiienli
modo.
iste
capi-
a
fiind»
frcistuliim
Tota
additur.
machina
pliinibi
instruitut
Ad fmcm anteriorem vectis in eodem lo*-
quo hamns pendet, innodatur funiculus ciineolo par-
CD ,
vo tcrminatus,
ita
spithamam
plicutur
circiter
ednexam rsibi lamellam,
ei
hamoque
in
Vecte
inflcxa
aquas cuneolus pei arcum intromittitur ,
que
instruitur
tali
ad
ad arcum propoitiona-
longitudinis
copulatam,
transveisum
vero pisces hamans,
funiculiim cuneolo instructum im-
extremitate altéra tenens
tae ,
vectis inflectatur, cuneolo
si
in filum
infia
si mile ,
filum
ut
longiis,
aicnm attingere valeat ;
in
modus
et
abstiahatiir ,
acvioribiis
filo
iindc
Ne vero hanius demissus
ÔAWUimb.
audit
endi
plumbnm piscem emcnticns horsnm vorsum
re
modo,
perpendiculariter
ut tinam ejus extremitatem ar-
cus delineat, alteri lamella pariter intus ^rcum ducta, po*
neqiie
eum
dum
piscis
nnciilnin
piscicultim
déglutit,
adncxTim ;
ris
traTîs\'ersum
in
obicem
ementitum escam
abstahit
cum hamo
facial.
sibi
esse
Jtaque,
putang,
furiiculum lamellae
cuneolus vero ex sub arcu a gravitate ponde-
posteriori
extremitali
vectis additi exsilit,
de fossula extrahitur, atqiie
ficiem
posita
glaciei dcjicitur.
hicme cxcicent
;
singuli
sic
Qui
piscis
hamusque
inhamatus in super-
hoc instrunirnto piscatDram
ad 20 ntunero ejusmodi machinas
52 2
.id
intervalla
rum
cursLi
sibi
tngmio,
non
longa
vohcnda-
ipso aqnariim
in
collocant, incjue nicdio coiuin oïdine, confecto
prospectant in partcm
vjdciint vectcm
hamo
pisce
mim
inshLuint.
lo
satis
ulianique
sublaluni,
suisiim
detracto iteium stipra
Singulis diebus
i!hic
iiicmoiaio
iibi
dcqae
modo machi-
foiluna favCiit ,
ciii
,
atque
,
advolanr,
ad
i5 numéro pisces extialuint; cul jam minus cadem
et
adspirant_,. 5
aut 3
piscanliir.
Piaeter frigns, qnod tem-
pestatibus expositi peipeti cof^uniur, alla nulJa
licilLidinesque
hoc
gencie
insLiumcnti
damna sol-
piscantes
giavant
torquentque.
De
Lisitatissimo
reliqiioitîm
hamornm génère hic
fuse
persciibere non mihi necesse videtur, cum eorum praeparatio
adeo simplcx
piscosis
sit,
ususque
eommunis idemque habeatur.
Quare extiemitati
adnexnm
filnm lineum val ex-
baculi longiuseuli attenuati
setis
equinis contorsum ad sui limitem
bi iinculnm,
ta
talium ubique in fluviis
aut
tencns,
qui escam piscium ^
micam panis vel
piscis
lumbricos Terrestres pu-
ahcnjus vehit ,
forte
insertnm
ut jam vel pueris hoc piscandi instrumentum no-
tum rehnquo ; placet tamen unicum ex
et
eum pondère plum-
nullibi
usitatum referre
his ut singularem
modum, quo Tatari As-
trachanenses circa fluvios in desertis errantes, in capiendo
QOMli
utuntur^ sane
is
est notatione
non indignas^
pisean»-
523
tur non
ex ripa,
sed ex nnvigio rntione scquenti.
viva
iinciikim
fiinicnlo
in
pique
in
navigii
adliacrenti
clavum
ad
miim,
altéra
addito pondère
cymbam
remis ulfra pro-
funde
cavato^ superficiem
patinam manubrio instructam, disco
ad
pcrceptLim
apprehendit,
oie
hainatur
aquariim
eum
adnatat ;
ejiis
per intervalla
momentaneus obscurusque
sontis
CoM'h
tenendo una manu ha-
sedens ,
vero
orgyiamm longo piip-
anncxiim infixa ,
aqiiam demissa, rcmex leniter
pellit ,
ut
c circiter
Rana
pro-
qiiatit,
aqois exaudiatur.
in
conspectamque ranam
cum unculo ingnrgitans inHic maxime mirari licet , quid
qciam simnl
extrahiturqcie.
cum
sonum adfugiat,
est,
quod
liqui
aufugiant? Plurimi dicunt sonum illum esse similem
voci,
piscis
quam
lue ad editum
edit femina cOArL,
maremque
allici
defraudaiique.
na
cOMh
vocem
aliquam
proférât,
sententiam
pedibcis
eo ,
vu]gi
Sed
et
simulata
sit,
an femi-
nequaquam
igitur in
ficta
cum incertum
hac
re-
potius
vero
statuo
sonum
hune repracsentare vocem ranae^ cnjus unica mihi inccrta
species scmper
loties
in
aquis lacuum dclitcscens,
audivi, sinu'Ilimtim edit
voce
aquam ^juocunque cavo percutias
vero nescit, piscem
CO.VI)
<^sse
,
eum
quod etiam, dum
exaudiri solet.
Nemo
animal omnivorum, saepius-
que illud ranas cancrosque appctere
r-um est,
bfii,
ut ipse mul-
solere.
Nil igitur mi-
audito iicto sono illuc adnatare ,
66*
conspcc-
524
tamqiie ranam dcvorare. Ratio
Kioinnib.
CQM06b
Ultimiim
cupât
lum
vulii Kos.^iet
pisc.indi
tdiis
in.
Volgd canjoe^e, quod
qucimcjuam iin[)ioprio ,
oc-
dluul est, (jihim
fer-
nihil
aut tiifuicam disstctum, versus extreinum
bifuicarn
in
Iiciim ,
uncoriiiTi
denriculdtiim, inacuatiim, baciiloque sive manubiio versus
Incolae h.iiiim
fiindiiin
insertuni.
proprie,
hoc bidenti
in
regioniim, non
cajcim et mijKù utiintur
i'ciiendis
verno
tenipore ,
cum inundalion s inoks
nacea,
declivia,
parvos jdc
Tune enim
utiaiDque
hxnc est, quod
supra
in
nMxima
S(^se
3nHh loca profunda
vitare,
dis et stagnantibus,
in.
r,unt ,
insiniiaie
ceperit.
ejicere diciint ;
copia, cn'KiH'b praeserlim, locis
Ceterum omnes
sit.
arundi-
o\a
speciein
generatipnem in actum producendam
opinio
Joca
in
cum ejusmodi et loca
appareat,
dictis,
Liciis
h.inc
muUis gregibus
pi-^caioies
ipsis
affirmant ,
ducique
et
tempus ad
convenire vulgi
verno tempore ca-
eum tune aquis placi-.
quLbus,, ut saepius curiosi
inter
ar.und.ineta
observa-
aut herbas lutuin-
que vagantur, mane et vespere fuiiosi acresque adeo,
^d
2
ulnas
liv'mphamque
locum
et
supra
6
totdm
aut
doimieniibus
lo.
aquam
in
perturbent y
numéro
sirailcs ,
ita ,
altitudinem
nieridie
congrcssi ,
ut
ni
ut
prosiliant ,.
vero
in
unuin.
perstant
mites
jam.
tetii^eris
autf
jeLSUeputuis, vix loco- sese moveant, conspectuiiique homic
,
5q5
nrm
Buiilo
peritid
rccte
laicie
temy)ris
nuncjuam
sed
Ciuidd
eniiii
a
hiijus
hnc
insfrtt-
iUis
(iiiocjne
scilicct
siint ,
sqtuiniae
soliim
compung'endjs
In
sciend.» est:
feiiendi
nias j.iciildndi ;
f|Liod
-,
faxtt.
fi'iiendis
iis
dam
t|nai
a
«nrfd^anf
minrine
a fronte aiit
adversiis sqiia-
tam durae
piscis
et
Inbiicae sunr^ ut saepkis ietiim ip^is impactum éludant et
abaque noxa rtcedant.
pia(da
est
l(vit( r
vcilnerax (lit,
enitii
vi
et
prosternant ,
tus.
loboie
quem
Ciasnojariae
magnum sasanorum
supra memorato
Praerorca
potiri^
\.-o]ii|)e
alias
ni.)nnbiiuin
CCl'UlHbl
robustus
nec vulnus
iiianibus
valent,
ut
nccesse, cui
(fficiet,
detinrbit.
nec
si
Tanta
saepius ferientem
cas^um: ipse
ego aliquoties sum exper-
adjacentes
insulae,,
lacubus-
refertae
proventuin incolis praebent, qui
modo
jaculandis
summum
veino tempore ponunt, ephebosque
qui
icti
sit
in
iis
oblectamenturw
juvenum cxistimatur,
majorem q^uantitatem eorum hocce
instrumente
com-
punxeriit.
Teitium instrumentonrm gemis^ Gonstitnnnt
retia,
quae
pro diversa latitudine et longitudine, vaviaque foraminufin
spatiositate,
i\ne
insert ion<;'que
ponderis et indicis, diversis quo--
nodiinibus insigniuntur.
lleiiOJ'b
pUctitur modo usitato ex filis cannabinis, tenuio-
lihns, trihus simul junctis ;
tiA^edaL
2 5o oigyias;
latitudo ejns jam maxima nunquam
profundiias etiam iam maxima; duar
52t5
cum
Membia, ox quibns
aequnt.
dimidia
rcte
hoc coag-
mcntalur, piscatoiicc aiidiunt ^jo.l// (partes), qiiarum in HtôO/lhy
si
cjus
maximam
lalitLidinein
considères,
5o numéro
orgyias latam poncndo,
seu alae, ut loqtintur^ fora mina
versus sinum médium
fiaet
4
4
quem MQUIHÂ seu pu-
appcUantj angustiora possidcnt ;
argvias
et
ca\'us ,
Partes extremae
digitos spatiosa habont,
saccum,
sive
erit.
unamcjiiamque 5
sacci vero, qui ad
sensim ad angustum redactus
est,
eum
con-
foraminibus vix duos digitos permittentibus;
fila
prae reliquis crassiora adhibentur, ne a multitu-
stituentia
dine piscium, quorum scmpcr major copia ex eo exlrahitur,
Funis superior, rete
disrumpatur.
vocatur a piscatoribus ji04Ù0pa
subera
sibi
applicatum tenens,
in
eepxnaji ,
quem etiam
vol lamcllae aut cortex betulae mote usitalo ,
subtiiergatur,
pcr
lapidibus,
qui
.JlOACopa
HHmnnJî.
parva
interstitia
locanLur.
ne
Inferior funis
ad fundum pertrahant, onustus, audit
rete
ejusmodi appellatur a piscato-
llctiOjl)
xibus cmpaKHeeoïi vel pkcHOn (fluviatilis); nimirum, quod illo
piscari
soient
in
fluviis
profundis
ac spatiosis.
Danttir
ycro adhuc duae cjus species, quarum primam HMMeHHOl'i^
>alterani
pacnopuon
vocant.
sumlum)
a
in
fluviatili
et profundus
sit,
<cumque niinorem
hoc
ex que
îLiLMcmoii (nomen de lacu
dilTert^
filis
quod
et
non tam latus
crassioribus plcctalur,
(j]iamH/l) possideat.
sac-
Piscantur eo in la-
527
et
rricignis
ciibiis
spatiosis,
tili,
so^d
non
ita
maxime cc(3cnil), et, qni Ibto dhvero ex toto convenit fluvia-
pKJlopnon
pisces;
ciintur,
oo, qaod partes, ex qciibns copulatnr;
in
dilTt'it
inUr se eohiicrcnt,
tenjpoie^
neces?iiiUis
lit
sepinari,
non possint pawo momento,
quaedam ab
et
inviccni'
iis
demi, Ut'jntnr hoc in ipso maii ex cybmis opeiaiii piscanubi ,
tc.s ;
tendunt ;
ni
si
grei^es
ini^entem eorum
in
mjjori
piscium
spjiio
minuattir;
tium
distendiint;.
spjtiosiiis
in
lem re.quirunlur lO
ad
dem
ad pacjîOpHOH ^
et
tantum
iiJL.ieHHOfi
sunt
in
domini
Bo.iOKmna
diiTerunt
conficitur,
in
in.
retinnr
ut vel ipsa re^
undecinius, qui audit
officium
primum
ne-^
lO, toti-
est
trahere
funes rctc
in
et subera loco debito, ubi quid
imo loca ipsa piscosa ,
Operarii apud nteo^lliK'b
divinare.
minoii
Ad nceajl» fluviati--
Operarioriim
reficere ,
fuerit ,
parciiis
si
vero, incluso m^eo.lîUKL
insereie, applicare lapides
ruptum
et
Hee04ïHK'b vero débet
retia;
labor
rrretiant.
operarii,
inciderint^
involvnnt ;
vero inopiae^
plurimos
spatiositate
60/jlûh-b;
casa
ietia<
hocqtie ideo agunt, ut
extidhenda ,
copia
niinqiiafn
nuiltitudinem
demtis
quibtisdam
UCeOA'h partibiis
vidcant,
pisciam conspieiant ,
non
aliàs
ubi
sint,-
quam
servi,
potestate.
et
eo ,
vixqiie
Jioij^iixa
sunt etiam species ncGO^a:
quod jîoisA'fXa absqne sacco seu
20
sinu:
aliqiiando orgyias excedit, in unara
52 s
tantnm
orgyîam
lacubns
aut
pans,
profLinda.
p.uvis
pisces
parvos ,
propter
non
ncc
soTet
Si
illaqtieandos.
etc.
OKtjHh
Adhibori
des
saccLim
sit
ad 5o vel 60 orgyias
aliquot
retinin
lata;
tum
audit jTOeOHJiU.
Altéra letuim specics
ad
rivnlis
in
ma-
uli
ad-
Jiotl/iuxa
mcmbia ,
eiit
tibi
nim.
ut
60.WKi{mci^
Rete hoc foramina
habet ad spithamam spatiosa ; plectitur ex funiculis penna
anseiina paulo tenuioiibus, latitudine nunquam excedit 120
imo
orgyias, piofunditatx; qualnor adimpiet; in
ha bat pondus , neque
tantum funi
funtm rccollectum ;
in
latitudinein
cum
dimidia
proprîis funiculis adhaerent,
iiias
remoti.
nens monioKh
ciem
in
béluga
hoc
très
supcine
oui
baculi,
circiter
poîlices
adslipiilatiir ,
longi ,
nullum
versus extremitatem iittenuati adtisrique, pro indice
crassi,
in
sui
in
ad spithamam
est
sui
unus ab alio duas spitha-
Piscatorice hi zeJlllbi, funiculus vero eos te-
Adhibctur hoc rete statim post gla-
imàiX..
Volga solutam ,
autiimno ,
eamque solam
graditur ,
a piscatore
et
in
aqnas
fuerit
siireum eriguntur ,
qnos
vel inde demergi ,
certior
Quare
mox
projecto
unijiji
sefnf>er
alam
luc ,
correptumque
iibi
baculi
fit
piscem
retibus
rete
in
intrasse.
applicatum
cymba navigans tenct ,
rete
indices
piscator saepius hinc
viderit
queni
quando
Dum rete
irretiunt.
dcjectum ,
exinde
ftine ,
in
fcre
nimirum
navigium attrahit,
adnatat
atqiic
ad
il-
adeo
529
pfscem illaqneatum ex eo démit,
demittit, et iteium ad
omne
sibi
alam
in
in
rursii?qiie
aqnas illud
cynba descendit. Emensus
ad piscatinn spatium adscriptiim, ad caput ejus
iterum collectis retibus pioficiscitur, rursusqne ea
ibi aqiiis
reddit ,
qiiam operam aliquando vicibus decem continuât,
in
eodemquc loco
iino
picr;in«!
qnam
natibus adspirat ,
(nomen de pliimbo
tractuir)
retibus,
ex
raiis
se.
copuldtis, plectuntiHT etiam
ex
filis
cannabinis tribus,
çonficiuntur
ex duobus
teniioribus in
unum junctis.
comprehendit
8
appellant ;
in
eoriim
frustula
foramina tantum ,
nnicam orgyiam
ad
200
oigyias
ftini
plumbi
in
est
quae piscatores
Spatium
cant
',
OiHHeo
Men
quibus utrumque rete non
profundtim ;
extenditur.
In
latitudo
his
autem
pro pondère,
inferiori retibus per latiludinen
annexo,
lamellas ducta compressaque applican-
ubi aqua strenue currit, passim ;
inseruntur.
et densis, si-
Raitim rete in profunditatem
densum vero 24 i
loco lapidnm,
tur;
vi^iic»
summo mane piscantar.
Cimnit aliter CGilHTamKJt
nisi
insomnem
nonnulli totam
agunt, vespere quoque et
mul
Xox vel maxime liis co-
unius
frustuli
ab
iibi
placide,
rarias
alio piscatores vo-
superiori vero fiini retiiim subera, qiialia
CHùCfUh sunt, adduntur.
tuDtur funcs, elongati,
Mfmoires diVAcdd.
T. VL
Ad utramque retiura alam
quorum
uniis tenet
in
adnec-
tignum aut fas-
^7
530
piscaloiicc )
aiundinjccuni {ni^pCHh
cicnUim
eiigcntcm ;
nalalilem letcqiie
piscationis
,
tempnre
pi^'-
alter propter can-
dein rtliiiin demcrsorum cicctioncn», ptippi navigii jpplicaUir:
hoc modo
diiiUin,
que
instiucta ,
relia
tcnens,
n>pLilaniiii
^j'r.ï':>'i»c
vtl
treiiieie ,
disien-
spaxitiin
petunt, piscalor in pnppi sedens manii-
fiinduiiique
funem
per fluvii
cln;ii
mami
quasi de
fiinein
ubi
cripi ,
senserlt' letia
mox
collectif
retibus piscem jam paratuni sumit, iMisusquc ea distendit,
atque ad eundem in hoc piscalii moduin procedit, cmalem,
ciiin
jTOFOH/iii
hiseiviunt haec retia
uluntur, servant,
tem-
pore iniindalionis, ncc non etiam aestatc; loca fluvii pura
nulhsque aiboribus
tur.
Quaie
retia
in
nunquam
aquas
dein
jam
si
,
iisiisque
eorum
milial la
in
rum
non ha beat.
in
piscatoies
sed
prima
vice
nova
primcim vetcribiis fundum
quid obstaculi invenerint, iisdem ex-
purgato
donenscs
ca
soient
inventores
primi
ehgun-
funduni dcnicrsis intercepta
deponere
explorant, in quo
imunt ,
in
solo
nova immittunt.
ejusmodi
Don tantum
retium
notus fuerat,
Cosaci
existimantur,
nunc
ita
fa-
Volga quoque reddita sunt^ ut neino piscato-
Restât nunc mihi uliimam retium speciem explanare: nim.
axciHI j
tus,
ad
qui nihil aliud dici potest,
2
tantum
quam saccus
reticula-
orgyias longus , ad ulnas duas circiter
profundus et latus y plectitur ex funibus crassioribus, qui
531
vnlgo
vocanUir
.ÎAM7/
(ex
coitice
parari),
tiliac
ver9iis
ofilicium
quàdiiàngulaiis, fundo convtxo, ad singiilos sui
ani;nlos
fîmes
des)
in
piscatôres
fnndnm
etiam
ciassos longos , quos' cwpa^KH
vocant , adnexos habens.
demittitiir,
fîmes duo, in longiludinem sibi op-
pondéra levLa adduntur, fundum contingat;
tenduntur, ut nim.
ille
sit
bus cymbis soient
lioc
sacco
in
fuerit
appioxiniatis ,
cymbam deponitur.
in
praeda
in
cymbisque
sacco
tantum ,
in
stentes , dari ,
invicem ex-
sibi
quasi
piscatu tantum Belugae
piscesqt»e iterum
giarc prae frigoie ceperint.
plerumquc
dumque
apprehcndunt ,
in
cunis
aut
exemptaque in
Uni tempori locisque determinatis hic-
aquae jam ligeie ,
uczugos
Ex dua-
quo submeiso ma-
piscaii ;
praesepio jacens in superficiem deducitur,
axaHh
in-
involutus, laxos funes mox conipiunt, ara-
bobusque utiinque protractis ,
ce
duo
alteii
aqua oie hiante.
intensos ex opposito
funes
piscis eo
inde
cum
laxantnr, ut scilicet appiime uno oris latcre, cui etiam
pôsiti,
nibus
(custo-
SaccLis hic
versus
concursu
alias
In
mare
:
nim.
cum
loca
piofunda mi-
principio jam
monui, circa
in
caspium , ejusmodi foveas,
duorum aut trium fluviorum exi-
nullibi et
Q.UO vero ritu quaque
inservit
pompa
nusquam
liic
in
Volga
exstare.
piscatus quolibet
anni
tempore iiberrimus spectatuque jucundissimus procédât, ordine nunc
exponam
ea,
quae ipse oculis usurpavi.
67 *
532
Ciim aqiicip, calore aestivo practeiiapso, rigorem coeli
praefectus piscaturae mitiit ad inspeclores
sentire cocperint,
uczugorum mandata, quibus piaecipit, ut omnibus piscatoiibus tain propiii?,
quam ex contiactu inibi piscantibiis, eoaditum inteidicant ,
ca-
veantque, ne quis piaeteniavigantium clamorem aut
stre-
rum locoium
ubi foveae sunt ,
,
pîtum aliquem, explosiooernque^ qua pisces terrerf auffugereque possint,, excitet. Inspectores, acceptis mandatis, piscatoribusque illinc remotis, custodes debitis locis ponunt, qui
omnem operam dent
copia y
ibi
certO/
,
ne quocunque modo ingénu piscium
cubitura ,
Die exemptionisi ut
ita loquar,
turus et opportunus putatur,
emergere
pius
ûovembiis
ribus,
demergique
ex
pisces in
conspiciuntur
illis
,
locis sae-
quod
initiO'
hune vel illum uczug con-
instructi.
pluiimis hospitibus ,
Astrachania
:
tum vel ipsi coëmto
invi-
codera
lauta
mensa:
tractatisqne-
profiscitur ,
opima parari
Deini directoï ipse ,
pracsertim optimatibus ,.
solet),.
spiritus frumenti portione data^
verit,
ma-
adveniente, (qui tum
cum
ut ad hoiam dictam in
(coena nim
consterneturque^
maxime usuvenit) nnnciatur omnibus piscato-
veniant, instrumentis
tatis
conturbetur
iis-
singulisque piscatoribus;
quae
si;
paium eos incbiia--
proprio ad crapulam usque
ingurgitant,
summo statim
Sjpectatoiibus
abit, comitante
se
diluculo ad locum certum cum'
eum
teitia
piscatoium parte,,
533
reliqua
eo
enim turba divisa ad
alias
foveas mittitur ;
axaHh
jaci,
qiiae
jiibet
attigerit,
demersa,
letia
locaque omnia occliisa ,
dum
postquam fuerint
piscatores rupto,
quod
piius servaveiant, silentio, tantos cLimoies strepiuisque subito sustoUunt ,
ut vel suido molesti viderentur.
Pisces,
vociferatione insolentt conteriiti^ alii de fiindo in superfi-
eiem
aquamm enatant, alii in mediis aqiiis haerent, quo-
cunqcie
modo
sibi
fugam molientes^ sed
frustra;
undiqua-
que enim circumfusi piscatores viam omnem abeundi praecUidunt.
Hic vidisses ingentis molis corpora supra aquas
provoidre;
conspexisses , quo
iis
invertantur;
ebrii
percepisses,
cantilcnas vocibus
xas vitciperiaque ,
modo piscantium navigia ab
quo
cum alter in
si
alterius
de fundo
rint ;
cesque
in
servantes ^
cmensus ,
etiam tune
animadvertisses
Posteaquam jam sa-
plurimosque de eo sumse-
axanh^ liO?OH,m singuli distendunt ,
mediis
ut
cymbant casu. illi-
eum movet ;
pisces^ turbaverint^
projcclo
audisses ri-
uni majoris ponderis piscem extra-
hère coram^ alterius oculis contigerit.
tis
hi madidi simulque
dissimilibus cantent;
ditur, vel de industria loco
livQiem invidiamque,
ritu
aquis
unus
natantes
aljum
irretiunt ,
sequatur ,
ordinem eum
spatiumque
ultimus itcrum a capite loci incipiat.
lites
excitant,
pis-
omne
Qiiantas
cum hic vol ille alterius vicem
praeoccupavit^ aut ad alterius retia sua proxime admovit;.
534
quae tametî approximatio nequaqiiam
cnim
lium
foveao
vix
vitaii
spa-
y)olcst ;
trecentas orgyias in lohgitddinem
excedit, piscatoiuni veio tum jam in mininuim i5o navigiis
Jucunduin sane laie
angustias occupantibus.
tantas
spec'ta-'
CLilum est, et qui nondum ociilis iisnrpavit, pLine giatum; narti'
uno fera intuitu ingens piscium copia, quasi de indiistiia propexhibendum
tec spectacultim
in uniim
,
tam compressuoi lo-
cum redacta conspicitur et nemineni feie piito, qui non
summum in modnm admiiaietur, si videiet ponderosissimk
,
tempore robusta,
anni
coipora, alio
et vel
deccm homi-
num manus in extrahendo defatigantia, tune absquè omni
reluctatione
catorum
mitia
lobore
eximique.
corripi
causam eam esse
materia
quadam
quam utpote ad
injuiiam
coeli
datam
usque
adeo
lubiica ,
tenaci ,
hujus
dcnsa,
piopellendam a natura
curant
illaèsam ,
ut
non
audeant.
Piscatores
adversarique
nioveri
Mansueludinis
pis-
volunt, quod fiigoiis tempore eoium tota
obducitur
cutis
duorum saltem
et veluti inanimata
extracti
sibi
etiaiii
mucum
hune nominant mijôa
^
haud invective sumto nomine de
rigorem
a
humano corpore
pelle ,
piscium
tio
aëris
de fovcis cxempiio duaruiii
tantum peiagjtur;
intra
coercente.
circiter
Talis
horarum spa-
quod icmpus cdito tam ludic-
ro spectaculo, piscibus jam omnibus, quotquot ibi j.iccbant,
extractis
atque in sua cujusJibet navigia deposiiis, intégra
535
pispjtoium
quoque
tilenis
ad
tiiiba
proficisciltii^,
tore
exonérât,
liic
loci
Qnodlibet
solct.
siimi; exindc
fit,
ibiqiie
praedam coiam inspec-
invidia
pio
nii
ddstant,
depiilsiis in
rixaquc
in
si
Ultiini
enim ,
giintur
mensurantiiique ,
a
se
alias
ao-i
pisces
quam
quarn
incakient ,
satis
venitur ad
cymbae , impingnntur
ambobus, sese
Çhn pioxi-
ullia proraovent,
piopioiibus pisces inspectori porii-
per
totum aliquando dieai suas
*
vices expectant.
in redditione
Neqn©'
non componunt, vercim, nacti
lites
protrusis
donec
eum non
aquas praecipites dantur.
non soluni
opportiinitatem,
a
citicis
ut unus alteiiiis cymbam a rate, in
hostcm saevit ,
ncc non
ca sumiura.
festinat
inanus ; fianguntur remi , scinduntur
cold[jlii,
sine can-
et ingenlibus clamoiibiis
sodalitimn
exponunt, amoveat; hic
in
nczugum non
practimn
j^istiiin
absqne
les
nira:
poittuir,
De U c%u fils.
Uczugi
qnibus
tua
habitant
et propiia
obeuntes,
ducti,
ti.
in
a
Astrachania
operaiii
ciica
andiunt
cum suis
vici
s.
familiis,
coloniae ,
in
munia perpé-
pisces in scpimentis {3Ct6omM) captos
non mercenadi
uti
piscatores,
sed salarie con-
longo jam tcmporê ex diversis locis ilkic deduc-
QLiatuor ejusmodi vici versus mare caspium infra As-
535
trachaniam
siti
Primus
sont.
est liVant
ab urbe 2 5 stadiis;
secLindiis maHll^Kh pari intervallo distans; tertius KJjMbtJMl,
a laeaHt 5 stad. remotus; iiltimus
6
In singulis ad
cJiciter divulsus.
stad.
raiiomm
dantiir ,
extriictum.
t^ôtypbi
a
KfjMhi3JiKi ad
5o domiis ope-
nec non etiam in quolibet templum est
Oinnes in tumulis posisi sunt ad fluvios ejus-
dem
appellation is ,
ostiis
apertis in
ex vera Volga décidantes,
maie
nec non
iluentes.
Annis aliquot abhînc pertinebant hi ad coronam cae-
ex publico per puefectos
saream ,
piscaturaqiie
mandato
constitiitos exercebattir,
sumtmn
cibus
cietati
in
in fiscum
mercatomin
illis
liicrumque totum de pis-
deponebatur ; ex anno 1763 so-
astrachanensium
sionem ab Augusta Impératrice erant
uberrimum
loca
haec
largiuntLir ,
peipetiiam
in
posses-
adscripti.
Qtiacstum
quem nunc
soient nec
integrum neque in omnes dividere, sed collectain pecuni-
am in cantora servant, aliquam tantum portionem vel per
biennium
vel
per
triennium
ii5 hominibus dividentes,
qui vel nullas suas proprias vatagas possident, aut possi-dendi
facultalibus
cartnt ;
tributum
vero
pro
omnibus
tam divitibus quam pauperibus €X eadem pecuniae sum-
ma
solvunt.
Ex
tempore
possessionis
trachaniae cantota piscatoria dicta.
constituta
est
As^
Singulis annis ad
eam
537
giibernandam eligi
cum
praefectus
pendcret ,
annui
tx?ict^\('i
ex
,
rei
ïisdcni
duo
qui
eticim ,
etiani
pecuniam
scribaium vero ,
qiialis
Ad singulos
classe constituitur.
infinia
inspectores, (jiOô'ÈpeHHbie) dicti,
concreditur
eoiumque
opeiaiios,
Huic
designatur ;
niittiintin-
qtiibns
mercatoribus
crassis
pencs qiiem
ticzugensis communisque utilitatis
adduntur.
tjuoque iiczugos
,
dircctorîs ,
litiilo
decct niimciTis, ex
nimirnm
ex priinae
soient
ncc non siimma
socii
<&
officia,
omnis cura
seu
traditur
ncc
non ipsam piscaUnam
in
^bsqnc nllo fuito aut aliquo danino exeicendam inspiciendi.
Hi obligantur omnia mandata
et
unaquaquc septiniana
in
singulis
sepimentis
ei
cantoia missa exequi,
a
rationem reddere, quot piscium
extractum
Ad
sit.
haec
eligitur
praecipuus inspector, qui p03hi34H0Ïi JloetpeUHOH appellatui;
h.
c.
excuncie aliosque inspectores, nec non ipsos ope-
ticzug
ir.iii)s,
an
pracsertim
loca
qui omni tempore nunc ad hune nunc ad illum
aut
rite
quilibet
suum
vigilare débet ,
proximas vatagas
prae rtliquis inspectoribus
Omnibus autem
bis
cujushbet
offiicium
ne quis
pisces
plus nec
et
dircctori,
rationc spcctata ,
T. yi-
in
alia
stipendii
non honoris habetur.
sociis et scrî-
stipendium ex ca-
dem socidli snmma depromitur.
Mî».oiics de VAuui.
observare;
captos
Huic
apportet.
his et singulis uti
officii ,
agat ,
68
538
opcrariomin
Miinus
ad
ucziigos
peitincntium
in
gc-
neie comprchendit ea omnia, quae vél ad sepimentum rcficiendum, vcl ad materiam pioptcr id parandam ^epesque
plectendas, ncc non ad cetcras circa pisces captos nécesicquiiuntur ,
sitâtes
quae
miinia
obire abligantmv, exceptis tantum
lare officium est piaescriptum,
non
bulo
liistrandae
nisi
omncs ^
qaotciuot
quibus jam singu-
illis,
quorum primus
jam exposui.
Tertius audit
sale aspergit.
Huic
Oiiartus
co.lH.lhuptK'b,
h.
e.
norit;
ova eorum eximit ,
nam nullus fere
est mp/iHMKh>
tus
et
vesicam extrahit,
est^
est de-
qui artem secandi non
i^artes
,
qui et ci-
scindit ;
secundum artcm
et
formam
Huic subjiciuntur aliquot pueri
CÔOplUllKU»
colligentes;
quintus
hi
,
colopiscium
qui audiunt
nimirum colligunt colopiscium
exemtum, lavant, distendunt, depurgant,
ôliud sunt
vo-
ova piscium sale condienda praeparans; sex-
KMÎo6UiH?:i
pisce
qui
exantherator , qui
conficiens.
ex
pisce.^^
Horum officium non
modo congruo piscium
lissime et
qui
e.
tamen proprie nompomitm salutatur
is
supra
subjicientes pisces salsamentario.
nec non colopiscium amovet.
tcrminatiim;
h.
se-
officia
addicti sunt aliquot opcrarii^
jiompOlUHKJ} vel pi3aM,mi^I> )
pisces dissecat ,
est aqiiam-
zaboicae tantum assignatus ;
cundus ôaiopm/iKi) et noA'bôaeopiumin: horum
cantur Ji044cimuff,
siint,
quam
discipuli jucmuiima*
et nil
Quod vatagas con-
J
539
in
cernitj
his
enim
sani
multo minor tuiba operaiiorum alitur; neces-
tantnm
siint
mUKh cum
impÂmiKh H K.km-
CQMLlhllinK'by
aliquot pueris, nec non tics aut qainque ope-
rarii,
qui et vices JiompOlUltKa gemnt, et pisccs salsamen-
tario
ponigiint.
rios
illos,
In
huncce numeriim non
inckido opera-
qui a heris conducti, rclibus pisces minores, ni-
mirutn cacafih, cifjaK'h, ôepuih et icliquos piscantur, quan-
quam et hi
etiuin
in
vatagis
Horum
habitent.
cniin nU'
merus non nullibi trigenarius aut quadrigenarius occurric,
neque tamen spectat proprie
ad vatagas ,
sed
ad pisca-
turam.
Modus
secandl ,
piscis
sale
condlendl ,
colopiscium nec
non ova praeparandl.
Pro diversa piscium magnitudine diverse
sectio
in
vatagis
instituitur.
modo etiam
debitam mensuram,
Béluga ,
de qua supra jam dictum est, excedens_, in quinque pardissecari sûlet.
Frimum exscinditur ejus abdomen, quod
miouiKil nominantj
dein exempta iinpa, ue/i et 6Â3llza, par-
tes
tes
latérales
abdomini hacrentes amoventùr, quas appellant
MÂKOlIlHbiH (molles), post bas
sura
quae
divcllitur;
in
dorsum
a
cauda
dorsum audit xpÂmoewit,
tranversum
abdominis secatur ,
habetur , Maxct.Via audit (vibratula) ;
hoc
in
transver-
cartilago;
cauda,
pro qiu'nta
parte
quod
piscis
est,
68 *
540
sempcr ea
narat ,
cÎLim
pio
vibret.
bpln2;a
T.ilis
in
quinqae-
quinque piscibus apnd pisc.nores
partes
scissa
matLir.
Caput, quod ôauuia
audit,, ciiin
branchiib
aesti-
ejiisma-
di piscis a corpoïc separatuiv, cxtraque- mensurani aestihiari
solet;^
palatum quoque ex eo exscinditur, separatimqiie sale
conditur,
quod mijAian]) iippellant;.
minoris vero> mollis aut
mcnsurae debitae béluga simul cuni capite
autein
scinditur
iramergitur;
q.uam MCïHÛcnîa vocant
que caudae, frontc
intua tantum
,
longitudinaliter
capitis
insecta ;.
tali
intégra
dissecta'
mandi-bul*
a
talis
irt
sal
inferiore,.
ad extiemum: us-
rémanente vel pcHiIisper
quoque modo
et occmi'b curru
CeôpwzŒ cultrari soient » etiamsi debitam magnitudinem excédant..
Hoc tamen- sciendum esc , quod omnium; hoium
piscium abdomen, nimirum niioiUKay exsec.etur separatimque
salsetur,
quanquam
in
eadem. fovea.
pars dimidia corporis, quae
tagis
valet,
'
Ji.liocfih
s'afcque conditur,
cum
Apud- cOM'b non
audit,
ad:
usum in; va-
venter et eaput eani-
bus devorandum projiciantur, et id quoque,
nisi
jam in ma-
xima copia obveniant,, curatury, ceterum. in totum hic
cis
nisi
pis-
negligitur..
Minores, pisces, uti
iMljKa,. ÔepiUl,,-
et
ctfAtWB,
exccpto^
casaWBr quem etiam dissccant, simplieiter exanterati,
ad. la-
tera tribus aut quatuor locis oblique, neque adeo proCunde
inseeantur,; alq^ue; sic
la-
sal deponuntur..
541
Postquani fupiint pisces dissecti, de majoiibus loquor»
trahuiULir
in
rant in iJla
munLur atque
ex
toto
Cuin jam
in
rediguntur,
et
Ocemph-
semol
ctcplO^L^
conceperint, exi-
Ei'.Uf^a
vero' primunii
JOfiOhh-
vocaflC^ audiique
in.
in his per aliquot
Ilic sinitur_,
in
ut
acervos
niulto sale adspersis.
coacervati
neque
loco,
uno'
autunino vc-
qua deiluxa
singulis eoruin' ordinibus
in;
soibuerit,,
dcfluat ;
illis
jacenC
q.ue
salis
pavimenlum sternuntur..
de
njLiria-
satis
se
in
Du-
rlemiUuntur.
per duos dics ;
acslivo tenipoie
per unum.
lO'
ibique in nuiriam
cellcim,
magis
salequc
curae
sui
rccondili,
requirunt.
acervos- pacvos cogitur, quos Jiac-
tum^ jaccrc b1) JlùCAOUKaXh,
jacendo ,
(lies-
cum-
sal substratnni
ab-
tunî altéra; vice aspergitur et in cuniulos gran-
des eolligitur, atque adeo jam in
iis
per reliquum tempus-
durât (qtiod audit lib KOpuiO jacerej^
Autuninalf tempore
CClhliClÂ
diclus,.
hoc
est
maxime parari solet piscis Ma.lCiparum
salsitudinis habcns; aestivo
vero tempore saCùMHLXH, valde saisus, qui etiam^ KOpeHHClÂ
Modiis utriusque parandi unus- idemque est,
dicitur.
quod
majorem
aestas
salis
nisi
quantitatem, autumnus niinoren*
propter aspergendos pisces requirant^
etiam
non
maximi. piaeter
quod
Parvi
qfUxi
et
pisces
alia
hi
in
ratione sale- imbuuntur,
pavimento cellae sem.-
542
per jaccant madidi ;
illi
ex cumiilis post nuiltum jam sal
haustiim, tempore aestivo libero aëie exsiccandi, foras deportantnr,
tur,
Iliinc
finem in
in
areae ,
exstriiuntur
vatagis,
quae ex his lucian-
sive in coUimnis trabes phirimis
mo-
ordinibus ponuntLir_, ad qiias pisces funiculis rudibus,
dictis ,
Za.lbi
duntur.
illis
mandibula correpti fasciculatim suspen-
pio
deniio
Exsiccati
120
asservantur.
quae in
se
singulas
ex
in
ciimiilos
locantiir ,
audit
cijAaKoei,
in
atque in
Mimma,
vatagis
comprehendit 20, ut vocant, ligaturas {c6Â3KPi),
6
non minor débet
piscis
appellatur
6 vel
5
majori
ex parte
constantes.
piscibus
esse
quam
p^40ea/l
Unusquisque
Hujus mensurae
8 ecpuiKOei.
(ordinaria) ,
ccpmKOGh vocatur ôcpuioenni ;
piscis
inferioris
vero
se.
quatenus jam hic
ôepuih et cil/iaKh parvae molis repeiitur.
Qui octo eepiUKORh superant, juacnih vocantur, quoniam taies
non soliini exanterari, verum in diias partes secari soient;
secare vero
apud piscatores proprie
dicitur Ji.mcmaïUh, hinc
jï.mcm'b.
Ova
enim
piscium
evadunt
naioaian
idem
est
iiKpa.
:
cisternam ,
sub
triplici
ScpHltCinan
specie
aut
Sepnnamiio et
praeparantur
Mcmcuincili ,
vel
:
aut
denique
.Meuicuimito salsandi
modus
nim. de piscibus exempta stalim deferunlur ad
muriam
continentem,
perquc
clatliriim ,
ipaxvniKa nominant, cisternac imponi solitum^ a
Iibris
quod
par-
543
carnosis sepavata, in
tibiisquo
uno
tiKpMllK'b
MimaJKa
spatulis,
cum
simul
vel
eani demerguntLir, postea
opcratio
ad spatiuin qnadrantis tantum horae,
vis
aut hiemc, mixtura
tiinino
talis
In
ova valde
modi
h'f;pa
sacOÀhuan
vel
Hocce modo
nnpa.'
niintiir ;
qnae tiim
granula
sunt
moUlHan
contkere
ejiis-
posteriori
minus
in
de cisterna tolkintur ,
salso
de
neque
condensata.
libras
e
nil
foraminiila
densata
saisi
fuerint,
reponuntur
in
ovis
resideat ,
e
pisce capto
asservanturque.
jiii-
quorum
àtque ad
superiori
toto
humore per
Postquam
satis
ut
lintei
jam con-
Propter
praeparationem
recentia ,
ejus-
nim. staiim de
siinita.
IlaioCHLlÂ
confici
volunt
sacco cximiintur, atque etiam in dolia
ovorum , -ova requiruntur
modi
cujus
capacibus excipiunt ,
piessione exeunte.
a
Si
est,
complicata adeo fiirmiter intorquent ,
orificia
succi
hoc
exempta sacculis
cisterna
contos, de quibus supra dixi, admovent,
saccorum
atque
defluxo in dolia repo-
illis
audit JcpHllClliayï ,
tum ova
,
lo
vel
8
linleis
vocanturque
audiimlque ejiismodi MùADCOAUiafl
/n;pa
illaesa
salsa,
JuapnaA ;
insalsata
humore
cribrum
frigidis,
aestiaii-
efficiunttir
contrahunt,
calidis
se.
priori
salsitudinis
vorsum
non tam dia procedit.
casii
per
Diebus
misccntur.
dictis,
lioisum
ab
solct;
aestivo
tantum lempore diebus fervidissimis
quoniam tum calor jepu/icmoîi aut Miintm-
544
UOÏl fieri
non
extidcta
sinuil
cum
ex cortice
seres,
multoque
Praeparatur ea sequenli modo
palitiir.
paitibiis
caïunculosis in as-
paiatos, jyÔKlt
dictos, stcrnuntur,
et
fibris
tiliae
asperso in solem ,
sale
ova
:
ut dicunt ,
exponuntur,
qui CLim ea paulispei arefecerit , misceniur, iterumqiie ut
sinunt;
arefiant,
horas
niixtura alteinis vicibus pcr aliquot
qtiae
Cum
exercetur.
sol
humoicm
<îbsorbueiit ,
condensaverit ; tum cultris ab operariis secantur,
et
carunculae
cjiciuniiu- ;
permixtaque
persa
Sex horaium
spatio,
veio
coelo
rantur ;
de
quo die pluvia
et
tandem
asseribus
dolia
hoc die fervido ,
fibrae,(|ue
tantulum
sale
in
eaque
talia
ova matii-
subnubilo integer dics requiiilur.
cecideiit,
tum sub tcclum
as-
colliguntur.
Si
afferuntur, ubi
aliquando per duos très ve dies jacent immatura, hoc est
non
condensata^
condensaii
parandi
Colopiscii
ratio
tempestas non pcrmiseiit,
talis
est :
vesicula
desumpla cultello parvo inciditur ,
piscis
lificata
in
asseribus sternitur, aestate foris,
dis domiciliis,
qua
si
a tergo
inque aqua pu-
hieme
in
tepi-
siniturque aliquantulum siccitatis contrahere,
concepta cuticula supeiior, carnis adiposae non nihil
habens ,
ab
ea
cinm
constituit_,
tur.
Ex
hisce
detrahiiur ^
in
intcnor, quae ipsum colopis-
pateram aliquam nul amphoram colhgi-
collcclis
cfficiunlur
placcniac una super
1
545
^
.'".;.!.'
['
.
'
;
nliam involtita, externeqne cnticiilis snpcrioribus de iisdem
obdùctae excipinnUir linïèb
tnictis
gente ,
sub
I
ad
hoc
emtac ,
se
sicque
picio
circdmvcstitii
tcrapoiis
ccrtiiin
ncc
linLeoqiie
non
exomni parte eâ's rémandantiir.
spatium
culiculis
Postqiiam
jactieiint ;
tiiin
cx-
solutae materiam ex
mollem, facileqiic in quaslibes formas ductilem piaebent.
aquc ex hac jam aitifex secundum norniam debitam mi-
n )ia
una
fmstula' majoii
involvcndo ad figuratn
cuticula
piopèTncdiirn cordatara et corniculatam colopiscinm, seciin-
dani legcs
formaque débita pereat ,
siccationc discedant,
CLincolo
qnem
parvnlo tenui li2;neo,
sus cornuuni extrema intorto.
atit
Ne vero cornna
parât conficitqae.
arlis^
fastes longicisculos tenues
in ex-
cauttim est
c.inn;a vocant,
ver-
demum confccta in fila
Ita
subque tecto
recolliguntiir ,
aliqno foris aut in domibns ad parietes snspensa exsiccan-
Frusta
tur.
ejnSmodi
Ad
iinamquemqiie
très
rcquirunttn-;
iinica
'très
CKOÙUH
ad
talem
parari
In
soient.
Hinc
numeiantur.
c/'6;)fO^//
CKOÔna
occmpoôa/l una
cnjuslibet spcciei opus
Nirfiiram
form=im redacta audiunt CKOÔKll.
tria
sit
piscis
sufficit ;
ceèptOiJi vesiculae
ex
hcîiigae
pondère Rdssifeb
colligi
potest ,
'
mille
quot piscibus
ad colopiscii pud comparandnm.
niillia
;• o^^/«JL>Og!&
mille ;'•'^ef^^^5
eooooo,^oooooc«
Mimorm de VAcad. T. VI.
/)Z/rf
vero
^9
33 3.
54^
DESCRIPTION ES
'qijatuor proteae
novarum specierum.
A
p.
C.
TIIUNBERG.
Conventui exhibait d;e
5 Julii i8i5.
Dedi antea dcscriptiones aliquot. novarum specierum
quas in Novis suis Actis Academiae
génère Proteae ,
periaU , et quidem volumine
inseiere pla-
K penu meo botanico iteruni conquisivi quatuor ex
çuit.
hoc ipso pulcio
va
XV, pag. 458.
e
Iin-
et
et specioso
hue usquc
génère afiicano specimina, no-
scientiae amatoribus incognita, quae, ut
spero et vehementer opto ,
benignoque
in
memet
ipsuni
eadcm ac
affectu
priora benevolentia
fore
vehm
accepta,
nec non cum orbe erudito , in auginenUini amabihs scientjae
cominunicata.
Patriain liae,
ut omnes in génère Proteae, promonto-
rium agnoscunt bonae spei Africes austrahs, steriha
dos cjus campos niontesque exoinantcs,
et
nu-
semper frulicosae,
larius arboie^pentes.
Hae
vero spccies crescunt singulae in interioribus et
rernotioribus
versus orientein
sitis
regionibus, adeoquc la-
rius occLurcntes peregrinantibus curiosis.
547
Ut vcro eo magis
enrum
sinuil icônes
dt^cvir tiones sncciftcfas îirifstrarem,
adjiingere voliii-; debui.
P
P,
plumigera
foliis
:
ROTE A.
filifoimibiis ,
glabris ;Tab.XlV.
snbtrifidis ,
caule erccto; capitulis plumosis.
spaisa ,
Folia
crcctus,
fiLitesccns,
Cciulis
pius
filifoimia,
trifida ,
glaber, ramosns.
simplicia, apice saepe bifida, sae-
patentia
cuivato-erecta ,
et
glabra,
pollicaria vcl paulo ultra.
teiminalia ,
globosa ,
Capitula
plumosa ,
nuce
avellana
majora.
Diffcrt a
P.
clecumbente, cui similis :
Pr.
1.
caule erccto.
2.
capitulis
coarctata
:
hirsutissimis.
foliis
ramisque
caule
filiformibiis ,
eieclis;
triternatis ,
calycibus
glabris ; Tab. XV.
brevissimis ob-
tusis.
Cnulis
frutescens, errctus, glabcr,
Haml pauci
versus summitatem
ramosus.
erecto-coarctati ,
ligidi^
glabri.
FoUa sparsa , frequcntia,
filiformia,
trilernata
seu snpradc-
69*
54.3
,T'3ïfiiJ'Çompasita, tiiùda ,,
caria
glabra , patulo - erecta, tripolli-
vel ultra.
Capitula terminalia, hiisula, alba.
Calicinae sqiiamae brevissimac, acutac.
pat ni a didcit :
a Pr.
1.'
lamiV' divarlcato-^'atolis', ligidis,
2.
calycinis sqiiamis atu'minatis'.
'
Tab.XVI.P. laevis:
capitiilis
:
.nui
I
laevibus, imbricatis ;
glabris,
lanceolatis,
foliis
tcrminali'biis ;
involucro bievi.
CàuU's fnitcscens, tohis glàbe/^' subdfchbtomus.
Rami pauci
,
subdichotonii , elongati, foliis tecti , siibfast
tigi'arf.'.'
FoUa
sessilia,
lacv^ia,
'
'
'
oblongo-Ianceolala, obLusiuscuIa, imbiicata.
ungvicnraHa.
'
Capitula terminalia, glabra,
Jnvolucra lacvia.
>iiiniHs
Pï.
conifcrac,
1.
in hac
2.
in
folia
a
qiia
lacvia,
tanicn
qnod
diffeit^
imbricata
:
conifera riigosa.
in
hac rami pauciores, elongati,
:
subdichotomi
:
in
conifera sparsi, flexuosi,
Hab.XVII.P--
ovata:
foliis
ovatis,
obtiisis,
integris,
glabris;
terminali ; squaniis calycinis ovatis,
capitulo
glabiis.
Gaulis iiuticosiis, teres^ rufescens, glaber, crectus, ramosus^
"
549
Raifii
àltrini^' crecti,
FoUa
spiiisa ,
cauVi siniilcs, subfastigiati.
sessilia ,
ovala , obtusa , integenima , plana,
erccto-patiila, pollicem
Capituhim
floriim
lata_,
sesquipoUicaiia.
terminale, solitarium , obovatum, grande,
glabruni, erectum.
Calycinae squamae inibricatae, ovatae, glabrae.'
*000l>C0O300C»«'«
55o
• DE NOVA I^IEDUSARUM SPECIE.
A U C T
R •£
T I L E S I O.
Conventui exhibait die 23 Aug. i8i5.
In ultimis binis,
mi
Py
ë
et
qiiod
II
m.
excurrit, decenniis, histoiia
naturalis MollLiscorum sensim increscere incepit.
insulamm
nera naiitica partim ad
anstraliuni
Plura
iti-
^co^raphiam
aiigendam, partim ad hisloiiam naturalem animaliuin et vegctabilinm
exoticoriim
promovendam
Rlolliisculoium nuniciuin
instiluta ,
et cognitionem
ad
etiam
piofccerunt.
Im-
primis Fiancogalliae scrutatoics a Cuiiero cclebcirimo incitât!
infciiores
aniiiKilinm
cioiis strLictiirae
classes
aniinalctila
irspexcninl, et in simpli-
marina per secalum feie
ne-
glecta attentioies facti viiltum induxerunt.
Pcromis in irineie nautico FrancogalloiLim, BocUno duce
ad novae Ilollandiae
litLora
instituto,
leium Zoologiam
et
Ethnogiaphiam spectantium egiegitis observator, Argonaiitis
Rossicis per trienniiim antecessit, et praeter milita alia Me.
dusarum copiam coUcgit, quarum nomina
in Actorimi Musaei Parisiensis
fascilulo
et
sciagiaphiam
94 et 95
publici
1
55
fecit
jaris
Infelicissimo
=^).
nec icônes neque
vero
obseivationcs
ductLis
consilio
specieium ,
peculiares nobiscum communiccivit,
anctor
quas detexit
sed potius
iilieiiori
et
majoii
opusculo reseivandas
bus et
phaenomcnoiLim obseivationibus rcservatis sciagra-
pliiae
siiac
auctor
ipse
tiac
bases
et
Hisce
reposiiit.
argumenta
insiint ,
quae
praematura morte Zoologiae
vero
e^o
studio
iconi-
,
cuni
ac scien-
cultoribus ereptus fuerit, absque fundamento remansit»
Sciagraphia haec (ypis mandata Peroni nil
nisi
prodromum
quo neutiquam nova sua détecta separatim nobiscum communicare voluit, uti primum debuisset, sed porcfert ,
tius
in
in
conspectum systematicum omnium Medusarum auctor
hoc libello exhibuit.
dusarum species
ex:
No vas et a Perono détectas
hoc libello,
IMe-
quo nec depictae nec
in
late satis descriptae sunt^ cognoscere non possumus, sed le-
gimus tantum earum nomina cuin
systcma
noscendi
quasi
excitant,
*)
et
jam
cognitarum in
redacta, quae spem frustraneam plura cog-
Conspiciendi
libido nosrris temporibus ita
spccificas
iis
et
arrio^it,
in
systema redigendi
ut nil nisi differentia?
genericas respiciant auctores, quo
fit,
ut sin-
Tableau des charactère* génériques et spécifiques de toutes les espèces
de Méduses connues jusqu'à ce iour par MM. Pérou et Lesueur inséré
dans les Annale-; du Muséum d histoire naturelle de Paris. Cahier 94.
et p5 de la Collection ou Cahier IX. et X. an. VII. pag, 325
366.
(.Voyez le Toiac 14. des Annales pag. 325. Genre X.)
—
552
gula non
satis
explorentur et hypothèses ingcniosae factis
substituantLir.
Pcrmultis
igitur
Medusarum
scrutatoiibus ,
nisi
pcr
.autopsiam animalium vivenlium ex ipso occano piacparati
medusarum sciagraphiani
Pcroni
donec
manebit ,
structura
obscura
analyticae
explicationes
Medusarum novae
accédant.
icônes
et
Qua de
organorum
causa plures
species, quae et mihi in cursu nautico
per triennium occurrebant,
nostro
Medusarum
aggrediantur,
et
earumque descriptiones
studio exploralae sunt,
communicabo, antequam Commentarium
lïiam Medusarum jam
meo deinceps
quae
et
icônes
in Pcroni sciagrap-
diu consignatum publici juris faciam.
Peronii libellus usque adhuc vIm plus praestabit, ac Zoologiae
Danicae
egregîi
opeiis
prodromus
praestaret ,
priusquam
auctor
paulo post subsequentis icônes illustrantes
adjecisset.
Novas ex Archipelago Japonico
cies
lectas Medusarum
jam anno i8o5 et 1806 delineavi
et
descripsi,
spe-
et an-
te/inam vix ex itinere redux societati Rcgiae Goettingcnsi
communicavi, sed cum per seriem annorum typis nondum
demandatae nec publici
jiiris
vioni prorsus traderentur
jrum
me
anteccssorem
Tactae sint ,
vereor ne obli-
vel ne aliquis successorum
mco-
jiovaque
mihi
praetereat
détecta
553
praeiipiat.
IToc saltem ccitiim
ronl
sciagraphia
Medusarum
tcm
Rledusaium
in
nisi
Peronus antcccssor indefessus
Ex
ccpisset.
viginti
ilincre
iinico
me maximam par-
intellcxi ,
detectarura
irienni
rem siiam
stabilivit.
perdidisse
inversani in-
Medusarum Peronus
gênera
I,innaei
novem gênera
quod jam ex mera Pe-
est,
An qiiartum Peroni gé-
ras Geryonia dictiim Medusam saccatam Japonicam
meam
complectetur, an Melicerta fasciculata Peroni vel an Orythia
sua
mea
cuin Alcdusa
brcvissimis
plioriuii
saltatrice
sciagrapliiae
Japonica
definitionibus
conveniat ?
vix elucet.
ex
Tele-
meum australem, quem in collectione iconum hi-
storiam itincûs celederrinii Krusenstermi illustrantium vario
situ
ad vivum dclineavi (Tab. XXI.
fig.
3o — 36.)
,
ova-
rium animalum Salpae et Monophorae noctilucae Borgl de
Saint Vincent
non Pyrosomae Peroni synonymon
nec
ex iiUiusque auctoiis leLitione
Etsi jiim nova
ïini,
nec verear
scriptioncm
mea
dam
,
ne coattaneus vel successor eandem
compleliorem repeteret ,
tamen
invidia
seducto
bus nuperrime indicatas esse,
Mémoiref de r Acaii. T.FI.
de-
mallem nova
quam suppressa
Monographiae meae de Physaliis
neuliquam vero cjusdem virtutes a
e IMuseo
intelligitur.
non ad supdficiem tantum indagave-
judicio scnitatorum publico submitti,
senescere.
tum,
mea
itineraria facile
esse,
errores
tan-
criticastro
quo-
in Epliemcridibus Jenensi-
me non impedit, quo minus
'O
554
observationes iilterfores de Medusis Velellis, Porpitis, ActiAscidiis aliisqiie
niis ,
moUiiscis
qiiorum
Animalium adeo ,
vobisciim
saliem
noiiiina
coinmunicem.
jtim
per seciila
cognita sunt, desciipliones et icônes vobisciiin in posteriiin
me non
comnuinicandac praebent ,
studio
jQagiare.
spectet ,
Cum enim
noviindi
plinirnorum
augcndi
et
labor co
quam jam inventa rite
ut nova polius invcnire ,
cognoscere studeant, non immerito
scd
cura
cum
Retz'io
celeberiimo
quaero, uter eoium, qui perpetuo no vas res detexerit, an
qui
notitiarn
jam
rerum
fumiorem
inventaium
leddere
et
augere studet, rerum scientiae melius consuluerit ?
Penitiorem rerum novarum
studeamus
et
et
cngnitarum cognitionem
recommendemus.
MEDUSA SALTATRIX, Japonica nova species ex
portu Nangasaki, Japonice Cassa curragè dicta.
Médusa pellucida
,
ovato-subhemisphaerica, umbella cam-
panulata, margine umbellae in systole coarctato^
octo rubro punetatis tentaculiferis,
lac'uuis
totidemque tentacu-
îorum filiformium fasciculis emarginato, intus cava peritonaeo vasculoso veslita quadricostata, fasciculis quatuor
intestinulorum
convolulis,
spiralibus,
glaucis, et rostro
contorto rubescente centrali styUfonni ,
nali quadiiûdo pendulis rcpleta»
stigmate teimi-
555
Ohs. Mediisa subconica, interdcim ovatn, sacpins campaniicTormis,
pclhicidd, ac niiia et distincta pailiiim fabiica
constiucta ,
contra
mobilitate
vcisalilis,
cat
ita ,
in
systolen
motu agitetur ,
hcns ,
alternis
agilis
continua
et
momentum quidem
ut ne
scd perpetno ,
,
morem
Medusaruni
qnies-
ac diastolcn sese contrafrcquentissimis in
pulsibtis
undis piopellit, et ranae ad instar poirectis tentaculis saltat
vel
piosilit_,
qua de causa saltatricem denoniinavi Me-
diisam, caetciLim ob stiucturam intestinulorum, Mednsis insolitoriim internam
admodum
omnium difficil-
complicatani
lima, iconibus analyticis illustranda.
Uinhella hemisphaeiico - conica snpra gelatinosa , sub-
cavum umbellae internum,
tns campanulata, tota pelkicida,
4.)
apertura
ampla
vasculoso
seu
venoso
membranae
vestitum ,
cnstis octo
subtus
ad
(fig.
peripheriam
tum
(a
(fig.
superiore parte visum
ut systcma
arachnoideae
(raiius quatuor)
decurrentibus
hians, peritonaeo
dilatabili
fig.
1.
simillimo
ex ccntro vertical!
h. b. h. b.)
2. et 3.
a
latere
digestionis et contractionis elucescat).
scu venulae membranae
arachnoideae
talem
observant directionem
costae
vero
(fig.
perpcndiculaicm.
postquam ad verticem umbellae
3 B.
intertexfig.
i;
Vascula
plerumque horizongelatina farta A),
Transeunt
interioris
costae
quasi,
incurvarunt , in-
30 *
556
intestinula, et inlcstiiuiln,postquam convolvendo ascendernnt,
in rostrum (fig. i.a,). Cnstac sunt organa musculosa et simul vascLilosa vel venosa,donec membranae arachnoideae intertextae
sunt,
venulae enim horizontales vel circulares
ex
oiiuntur vel
iis
iisdcm
B.)
Donec veio ex
communicant.
membrana arachnoidea versus umbellae
3.
(fig.
interioris
verticem
descendunt vel recedunt, liberae sunt et pensiles, et in hoc
statu
chordarum elasticarum more (fig, 2. ce.) convolvuntur,
fascici.los
formant intestinulorum similes,
testinula
appellavi.
Ex
intestinulis
eentro verlicali umbellae
est.,
intestinulis
quod
in
j.
fig.
in
de-
2
et
(fig. 1.
(fig. 7.)
a.)
occrpans
(fig.
4.
D. a.)
convolutis circumdatum, con-
îortum,. tubulosum,. pistilliforrae, stigmate quadiifido
(fig.
6.
vel ore unico quadrilaciniato instructura
et 4. a. D.)
hians,
oesophagi
munere' fungi
phagus: cum
ac
Stylus vel rostrum. centrale rubens cavum
campanulatum umbellae
a quatuor
ascendentibus
in-
iterum conjunctis oritur denique
rostrum; (a. fig..i.) vel stylus ,
monstratum
quam ob rem
videtur..
Descendit
nunc ocso-
suo- quadrilabiato ,, umbella: in
systole
contracta,, ila,. ut stigma vcl orificium ejus rxira
apnlu-
orificio
lam umbellae promineat.
dit
In diastole vero
et in cav^um umbellae- iterum:
diatim
ex eentro
verticali
«Bentes;
(fig.
D.
1. b.
fig.
rostrum ascen-
retrahitur.
Costae
ra-
ad marginem umbellae descen-
2. 6.)
inseruntur
laciniis
lotidem
557
tentaciiliferis
r[im ,
(fig.
i.
D.
fig.
5.D), quae contractione costa-
systole, foinicatJiii foimani indiuint, et tentaciilà
in
maif^inalia
iindulata
ad instar
flagcllomin
sursum
versus
dispergunt vel attollunt, quo facto fibrariim, qiiibus margo
umbf'llae cingitur eJLisdemqiie aperttua coarctatur, circula-
rium ope
ita
praedam adducant ,
motum
veant ,
itcrnm retrahiintur,
versus
motu alterno , aquam Tenant
ut hoc
,
introrsum
diastole
in
humoruni
circuitum
promo-
Mediisam
ipsani
cavo eiusdem
internO'
vasis
in
respiratorium augcant
cavo umbcllae
,
et
quovis pulsu ex loco propellant,
umbellae
Apertura
sat
dansa
ac
aqua praedaque impleto, médusa forniam vertit in sub-
globosarrr.
Lacinae tentaculiferae
rubris ornatae
globulis vel granulis
supra
tentaculiferae
lorum
(fig.
octo semicîrcuîares- crassiusculae
marginem umbellae cingunt
fasciculos
5. 6.)
4.
(fig.
costarum
cl cl
subditae
cl. d.)
(fig.
,
subtus
5.)
octo tentac[i-
jaculantur,
ac
imperio
mox attolluntur mox depri-
niuntur vel dilatantur vel constringuntur.
Tcntacula
cirrhosa
coloris
longitudinalibus
maiginem:
numerosa,.
lactei,
filiformia,.
internis
et
umbellae
cingentia^
undulato-subulata,
fibris
circularibus externis instructa^
ad marginem lacinidrum infeiioiem ia octo fasciculos dis-
558
tribiita
qnovis
in
,
fii^^ciculo
qnindccim
vcl
viginti
nu-
supeiior
fibris
vel
raerantur tentaciila ;ncdusa diiplo longiora.
vel
Rostrl
membranae aiachtioideae, cavum nmbellae
vasis
investimtis,
cincta (Kig.
ciiculaiibiis
quatuor
intestincilis
spiralibus
i.
C.
pensilibns
interioiis
Fig. 2. a)
oita
ex
ventiiculi
adesse videiur, cui ab oesophago contoito riibescen-
loco
te
pars
centralis
pistilU
(Fig.
7.)
alimenta ingeruntur, qnae deinde per intesti-
nnlorum canales quator suscipiuntur,
costarum
per
aiachnoideae
cumvagantia
vasa
parallela
addiictintur,
ciiculaiia
parlibiis
nutriendis
et
membranae
totum umbellae ambitum
intertexta, per
reliqiiis
vel
costis
cir-
communicantin-.
In margine crassiusculo umbellae_, laciniis octo tentaciilifesinualis
ris
lactei
gana
emarginato
,
praeter
coloris snnt et impediiint,
distingLii
fibras
quominus subjacentia
possint, venu circuJans
cendentibus conjuncta inesse
quae
circnlares ,
or-
cum costis octo des-
miiii videbatiir, et forsan
hacc
vena eiiisdem naturae ac costae ipsae cognoscitnr, mosculosae
nempe
fibrae
circulares
ac
Ad
constituiint.
vcnosae
ad
simul ,
periphcriam
peripheriam
fuere ,
in
tenebiis
forsan lacteae istae
umbellae
enim,
motus vehemenlissimi contrahcndo
si
et
iibi
venam ipsam
maxima
et dilatando
vis et
animadver-
etiam annulas noclilucus visus
est.
559
et papillae coccineae
quam
qiicie
lespiiaioiio
cingit ,
cum
costae
a nullo aIio>
Ilaec
potest.
cffici
lectangularibus
vasculis
aidchnoideae
ergo
su nt
quae nuiiginem
munere fungi.
ies{iiialionis
earutn
quod
vcnrim circulaiem,
membianae
paiallelis
scintilljinnt,
niolu
persuadant,
milii
unibell.ie
fere
Sic
vcl
itertextis
cticim.
circuiis
systeniatis
nonsoluin nervoso-musculosi sed etiam vaculosi organa esse
inuneie fungi videntur
arteii.HTun
et
omnia
cnin
us
gandent ,
sed
etiain
vasoium
videntur.
Costas
facultate
sese
manifesta
inseivire
et
nutantiimi
nimiium
formam
induere ,
partem
coire
libère
in
adeoque
in
et
vel
non solum eniin
conjuncta
vertice unibellae item m descendere ,
lium
:
contrahendi
nutrientiam loco
tubulosas
esse ,
ex
intestinulorum spira-
cavo umbellae fluctuantium
centralis
superiorem
oesophage contorto jungi ,
certutn mi-
rostri
hique ex multis majoribus minoribusque individuis observatis
comperturn
malculum
ad vivum
ac
systolen
Non solum socius Dr. Ilonier, qui
est.
dclineavit,
diastolen
umbellae citcularibus
lis
in
vivo
Médusa
haec
mollusco
ex
a
costis
sed etiam
tubulosis
reliqui
simul
anisocii
cum fibris
ac Ijciniis marginalibus tentaculifeperfici
primo intuitu observarunt.
pdrtiiim
internarum
structura
contractilis
et elastica
iterum probat,
ut hoc plurcs jam praeteiitis tempoiibus a
me obseivatae
et
forma
sola
admodum
situ
56o
culoso
lespiraiorio
confliieie,
ac
ordinum
ac
sioJoi^icas ,
rcndi,
in
in
simplicioiis
v.
vel
digestionis
in
unum
animalibus marinis inferioriim
structurae
pluies fiinctiones phy-
locomovendi, praedam anipiendi, dige-
gr.
sangninem vertendi , respirandi
et
etc.
NLipenime etiam celeberrimus Meckel, Halen-
exploiandis rébus ad anatomen comparatam attinen-
tibus expertes,
nempe
si
mile quidquam in Ascidiis detexit, saccum
branchialem
oesophagi
aliam viam adesse, pcr
tibus ad
in
liis
cum vas-
ncrvoso-miiscnlare
mitriente
et
riLitiir.iin
SLiccum
in
conjungcre,
sis,
systema
probarunt,
ISTcdiisae
fungi
niunere
ac
nullam
quam aqua cum particulis nutrien-
ventriculum pervenire possit nisi liacc sola, quam
de
dcssertatione
ascidiarum
structura
demonstravit et
icône adjecta illustravit, in qua anatoratn ascidiae niajoris
explicavit.
Organa jam dcsciipja
superficicm
et
affixa
costae Tiimirnm
elastica
ad infcriorem umbellae
membranae arachnoideae intertexta,
punctum fixum habent
in
margine
lae , nbi
maxima
vis constrigendi, jactandi et vario
movendi
locum
liabet,
membrana
araclinoidea
donec autcm
egrediuntur ,
sunt ac per ccntrum gravitatis,
antagonisticam
faciunt.
vim
accipiunt
et
quod
umbel-
modo
libéra fiunt vel
pcnsilia
ex
ac nulantia
rostio centrali inest,
proprio
vigore im[)elum
Simillimam fera stnicturam, partium numerum et
56i
functionem in Sîahberi*) MccUisa cymballoidea (Tab.XIl.fig. i.
2. '3.)
videmus, et liaec spccies simiil probat rostii cenlralis
functionem, qiiippe quod pisciciilo degliidiendo accupatum
In hoc
auctor delinravit.
contigit, ipsam
felicisiimo
momento^ quo auctoii
fLinctionem lostri ccntralis obseivandi, for-
ma lostii miiLim in modum dilatati neutiquam dignoscenda
est,
Costae,
loga,
quoium imperio umbella
rie
movetur,
fibiae
ut
affixae
systole ac diastole
in
curavit ,
utriusque
va-
cui partes in cavitate
et intertextae sunt_, ita pellucida
non a pictore percepta nec delineata
simillima forsitan specie,
neari
vel organa coslaruiu ana-
nec non membranula,
umbellae pendules
fuere ,
musculares
quam
sint.
In
celeberrimus Baster**) deli'
organa
generis
in
conspectum
veniunt, imprimis membranula arachnoidea^ forsan laesa et
*)
Natuikundige Veilustigingcn behelzende mikrnscopische
van in - en iutlan.'l^sen Waater - en Land - Dicren
.rtin'Slahbrr sitd van de Keiserlike Académie dcr Aatur Ondoor
dcrsoekertn etc. Ilarlcm by J. Fosch '778 in 4*0 17 color FLten ;
vel germanice versum a Statio MiilIcrQ
Murtni Slabbrrs physikalische
Bclustigungcn odtr mikroscopiNche Wahrnclimungen von 4^ in und
auslundiichen Wasser uiid Landthicrchen mit XVIII fein illuminirtf.n
Kupfcitattln , herausgegcbcn von A. W. Winterschmidt, Kunsthand1er u. Kupferstechcr in Nurnberg 1781. in gr. 4to (pretium 3 rt. 6 gr ).
In
origine :
Wahrntlimingcn
M
:
'*)
Bastcr't opuscula subseciva Tom. II. lib. II. Tab. V. fig
2 et 3.
pag. 55. 56. 57. 58. In ipsa descriptione auctor plura adhuc obscrvata
.Tnnatovit, quae pcrsuadtrc valent, mcdusam suam cum r.ostra maxim m
"Sobi
icônes vcro probant,
liabuisse
«iinilitudinern ,
ipsarum
curiosi, quas stylo repratser.tanr,
artifices, nisi
'
Mt'mo'.res .-le rAcad.
T. H.
sint
rcruin
maie ad hoc ncgotium applicari.
"^
^
562
quibusdtim pendnlis lacerata, et si rostrnm centrnle
laciniis
partes pcnsilcs
ac ieli(jaae
ncgieclae
atae vel
Bcrôes
Plura
cavo iiiiibcUae maie deline-
in
sint.
cum
individiia
ciicumeiis
sex Medusae
nostiae saltatricis niinoribns individuis in cylindio seu vase
vitieo sat ainplo et capaci
servandum
vchemcntissimos
pioplcr
a
sepaiare
Berois
se
marina repicto ad ob-
habcbant
salttis
me
coactiim
minores,
etsi
'tatiices,
'sibus
maie
reposita
aqLia
hacce societatc
in
et ictus
mox
et
Mediisas
quia Medusae
vidi ,
vchementissimis
sal-
tamcn earum pul-
hacc molkisca multo majora et graviora motu lento
et aeqiiali
miniitissimorum ciliorum ope remigcntia, ab una
ad alteram vasis partem ejaculatae sont.
Magnitiido
diim
tripollicaris
et
licet
illaesa ,
Rlartio anni
Medusae nostrae pollicaris,
natiiralis
rarins qiiadiipollicaris
letractilia ,
ad
portiim
legi
et
observa vi.
Nangasaki
In
et
spiritn
in
inter-
tentacula
tamen diiplo longioia.
i8o5 Medusam nostram
'iiico
est ,
Mense
Archipelago Japo-
Megasaki frequentissimam
vini
conservata brevi tem-
poie collapsa colorem et formam amiserat.
Mihi non
nisi
picturis et desciiptionibus in forma naturali conservanda fuit.
Explicatio tabulae:
Tab. XFIII.
Fig. 1.
Medusam Saltatriccm, a Japoniae indigenis Cassa Cu-
563
ragé vel cmasclié dictam a latere sistit. Vaiietasoctoradiala
et
vcl octo costata, natiirali magnitiidine
est,
diastole laciniis reclinatis tentaciilisque
in
pcisis ,
dis-
A gelatina pellucida iimbellarti
delineata.
exteiioiem formans intus C. peritonaco cosftato vel
membrana
ladii
arachnoidea
ad
descendantes,
maliens
Fig. 2.
centro
cuJLis
in
parte visam
Unibella
D
umbcllae,
pistiikim
vel
cavitate pendnlis a su-
sistit
C.
ce.
intestiniila
gelatina farta 6.6.6.
ex
costis oita
qnae postquam convolvendo ascenderiint,
ad formandum pistillum
Fig. 3.
apertura
a)
parti bus in
costae descendcntes
pensilia ,
punctatas
campana pendet.
Umbellam eu m
periore
rubio
tamquam
rostriim
costae vel
6.6. 6. 6.
marginales
lacinias
tentaciili feras
in
vestita
ex
.solo
vel rostrum conveniunt.
a)
vertice
visa
eiiisdem crassities usqiie ad
A.
gelatina
farla,
internam umbellae su-
perficiem , membranula arachnoidea C.
vestitam et
vasculis circtilaribtis intertexta
costae octo
in
infcriore
6. 6. 6.6.
umbellae supeificie descendentes
et in
vertice a) ad formanda intcstinula et pistillum con-
junctae.
Fig .4. Médusa
bellae
ab
hians
infcriore
0)
parte
stigma
visa
vel
os
D.
apertura
um-
quadriJacinialum
71
*
564
quod
rostvi,
in centio cavitalis
tinula quatuoi
dem
cavitate
dependet ce.
quae rostmm circumdant
,,
dépendent,
d.cl.d.d.
intes-
et in ea-
fdscictili
octo
tentacLilomm laciniis totidcm affixoium.
Fig. 5. Lacinia
lorum
tentaciilifera
fasciciilo,
singula
singulo tentacu-
ciini
a latere visa, magnitudinc âucta,
Dy margine abscissa. h. costa, cuius impeiio sursuni
deorsLimque
nes,
Fig. 6.
d.d.d. tentaculorum inseitio-
glandulis vel globulis coccineis supra notatae.
Rostrum
lit
dirigitiir
vel
pistillum
ex
infeiiore
parte visiim,
stigma vel orificium quadrilabiatum et miiscuîî,
quorum imperio
labia absorbendo moventur, in con-
spectum veniant.
Fig.
7.
Rostrum a superiore parte visum,
lum circumvolventium
vestigia ,
ut intestinulo-
quorum ope nu«
trinientum ex praeda capta absorptum ad intcstinula
et costas transfertur, in
conspectum
kOOOOOOwOOO 00Q4
veniant..
565
DESCRIPTIO ET ANALYSIS C II E M ICA
STEINHEILITHI
AUCTORE
7.
G A D
L
N.
l
Conventui exhibuit die q8 Febr.
i8iC>.
Ad morem mineralogorum, qui fossilia, vel recens détecta,
vel, ob deficientem cognitionem,
impioprie antea de-
nominata , novis appellant vocabulis,, recoidationi virorum
de aucta Oiyctognosia meritorum convenientibus, nos quoqiie
ausi sumus, in
neralis
mcmoiiam Excellentissimi Comitis, Ge-
et Finlandiae Gubernatoris ,
Steinheil,
Steinheilithinn vocare
Domini Fabiani de
lapidem
in Finlandia
re-
perlum , quai-tzum cacrulciim hucusqiie nimctipatiim , cujus
natLiram a qnartzo alienam esse primas,
quod sciamus, ob-
servavit Excellentissimus Vir; qui" succissivas horas, qiiot-
quot summi negotii curarnm vacitas habct, scientiae mineralogicae et geologicae studiis impendere aman§, nulli peperuit operae nec pretii, ut genuinam illius lapidis formam.
ceteraque criteria
duae,
in
certiiis
indagaiet.
svasu Excellentissimi Comitis
de Steinheil,.
hune lapidem. instituimiis expérimenta analytica judicio
566
Acadcmiae Scicnliaium Tmpoiialis
jam siibmittinnis
Ilhistiis
Petropolitanae-,
cxoidiiiin ,
cîiicentes
chaiacterum
dcsciiptionc
a
vcnia Exccllentissiini Coniiiis,
nobiscnm bcni^nissimc comnuinicavit,
in
lingiiam latinam,
Reussii, convoisa.
adhibitis teiminis technicis cclebiis
Sic vero lapidem descripsit Cornes de
j,Color
fossilis
Steinheil:
sincerissimi est obscure violaceo-azureo-
et heroVuiQ - caeraleus y qui
.per
quam
gcneiicoinm ,
vero, in majoribiis crystallis,
plcturas maculatas, fasciatas
et nubiformes,
in clarius caeruleum , grlsco - caerulcum ,
griseum et nigro-viridem ,
proiit
in
transit
vin- descenti-
lapide parcius vel
abundantiiis immixtae sint paiticulae quartzi aut substantiae
micaceae
minutisslme
squamoiae ,
oculo nndo vix discernendae.
riiintur
nac.
rcticulatac,
Raiius inspersae repe-
maculae rubro-caryphytlino - vel capillari-bru-
Piopter parvas fissuras atque rupturas, frequen-
tissime in
lapide obscure caeruleo coin parentes, cerni-
tur interdum vividus diversorum colonim lusus.
Non-
nunquam adeo obscurus est caerulcus color,
qui,
ut,
lapide versus lumen spectato, viridissimus apparet, in
quocunque ceteroquin situ,
,^Q.ua
nigri
speciem prae se
ferat.
figura m ex te ma m, habetur aut compactum,
in frustis inegulantcr angulosis;
sequentibus fonnis
:
aut crsytaïlinum, sub
567
fA) prismiitum qnadiildtcroriim ,
s.
paralIelepipedoiLim,
a)
aequilrtteroium , lectangulorum ,
b)
duobus planis oppositis
c)
guslioribus
comprehonsorum ,
niarginibus
tennincdibus
singiilis
no
truncatis ,
daobcis an-
quod
rarissi-
est,
sinuini
d)
latioribiis ,
marginihus longitiidinalibus, vel nno piavel duobus planis acuminatis. Ubi,
truncatis,
adeo descente latitudine planomm truncaturae,
ut
hacc
in
prismatis
ipsis
planis
tiansformata videtur crystallus,
concurvant,
vel in
B) prisma sexlaterale compressum , cujus aut
fl)
quatuor latiora
et
duo angustiora
sunt
plana
opposita , aut
b)
duo latiora opposita et quatuor angustiora; vel in
C) prisma octolaierale compressum, sub quatuor
ri
bus et
hensum ,
quatuor
angustioribus planis
ut contigua
quaeque duo
angustiora alternatim se
latio-.
ita
compre-
latiora
duoque
mutuo excipiant.
Ex con-
tiguis
duobus sive
planis,
unum plerumque prae alrero majorem habet
lalitudinem.
latioribus ,
sive
angustioribus
— Sed unumquodque aequale semper
et parallelum
est
paitem opposite.
piano
sibi
ad alteram prismafis
RIargo inter latius
et angustius
568
pîanum plernmque est obtuse tmncatus,
rarias vero
'margo inter duo latiora plana, et rarissime
qui inter duo plana angusta
ille,
aiictiis
Inter-
est.
sitiis
dum plana latiora, et inter se, et ciim planis trwicaturae adeo
obtusos formant angulos ,
ut efficers
videantur partes superficiei continuae curvatae con-
vexae.
Praeterea
planorum
situs,
aciem
oculi
fugere
solet verus
propter strias et inaequalitates, se-
cundura longitudinem prismatis frequentissime ob'
servatas.
„M a g n
et
parvas
i t
u d i n e per omnes gradus, inter exlmie grandes
variant
Exbnie grandla inveniuntur
crystalli.
prismata sexlatera et octolatera
perfecta
,
quae raro
sunt, sed saepius per coalescentiam
cum
et pyrite alterata, coarctata et varie deformdta.
ita
vero
inter se
tent.
Haec
longioribus
planis
suis
connatae,
aut
quartzo
Medioai-
raro sunt solitariae, utplu-
ter g}wides et parvae cryslalli
rimuin
ex parte
orani
angustioribus
aut latioribus
ut aggregata scapiformia i-epraesen-
per coagmentationes prismatum breviorum cum
decussata
et fasciculata
novas
sistere
videntur
crystallorum formas plus minus irregularcs, quaruni superficies
scabrae sunt et sulcatae, terminique valde gihberi.
„Superficies
lapidis
plerumque
spécimen compuciitm vmeqiudis ,
est stria ta ,
apud
apud crystallinum
laevis.
569
sempcr
nia
obtectd est coitice
fere
talcosa nigra ,
grisea
vcl obscure viiidi; hacc cuLiciilj tenaioie, ccricuin )iitoycm
monstrante, aut
experte.
iiitoris
„ Aspectus interniis
miiltum
obscure
pallidioris minus
vel vitreus ,
nitciis
fossilis
caerulei
nitens ,
est
nitonf
distinctus, vel pioisus expcrs nitoris.
cerico
„ Fractura obscure caerulei speciem hahet
festuca-
majusculanim vel minuscularum, et transire videtur ad
ritm
fonnam conchae imperfectam
squamas
fere
in lapide
interduin adeo pîanatam , ut
,
lamellosas exhibcat.
Hic
speciatim
transitus
pallidiore e jusque fractura transversall observatur.
Fractura ejus prlncipaUs faciem confuse lamellosam ostendit.
„ Fragmenta plerumque
Nonnunquam
hus acutis praedita.
boïdalcs,
irregularia sunt et marginl-
formas
exhibent rhom-
praesertim in speciminibus clarius caeruleis.
materia obscurior,
frustulis segregatis
intertexta esse videtur
pcUucida
fasciis nonnisi transparentihus,
striis
et
testaccis ,
rcctis ,
stere videnlur
clarloribus,
quac totum fiuslulum transeuntes consi-
ex mcmbranis
c'mereis,
micaceis,
nudo oculo
vix discernendis, anlequam ignitus fuerit lapis;
comparentibus sub
llcivo
in
cunt
v'i ri
fisso
forma
tum vero
squamularum opacarum ,
lapide conspicuarum ,
descentes,
In
colore
quae picturas produ-
nuhosas, vmculatas, destructo simul,
gna ex parte, pulc.o
l.ipidis
m: noires de rAc.uf. T. 17.
colore caeruleo.
^^
ma-
5"o
„ Pe 1 In ci d
quae
hruiioruDi ,
dens
est.
inteidmn
nis
tiansniittunt.
i
quartzo
a,
Ductilitate
hipidis,
quarzo
m
(i.umwii
ejus
i)hscure
cacniîcoruin
liiicimin
liabent
Non enim obstat
pana est. Pondère spccifieo parum
,
in
speciminibus
maxime notabilem.
„ Transi tus
in
lapidem talcosum duplici comparct
Aut enim termines crystallorum parvarum,
nigra
tenaci-
dilTert.
viridescentibus
'la
lunii-
frangaliir.
„Odorem afïlatu prodit argillaceum
modo.
,
est.
caret.
facillime
et
evi-
Iransparentia suut,
nonn'i^'i
tantum maiginibus radios
sirrile
fere
quoininiis
„ Gravitas
a
fitistuloium
aculis.simis
in
„ Du lit
tas
as
cijssiii.
Viiidescentia spccimina
et
,,
t
i
obtectos ,
cuticu-
penctravisse observatur snbstantia ser-
•pentinea coloris corvino-iiigri, quae pcr fjradus insrnsibilcs
in caeruleo lapide avanescit; aut ita
"tota
crystallus,
lem pedetentim
caerulea ,
ut ab una
in
parte
sit
comparata esse videtur
nii^ra,
griseo-viridem mutet ,
et
hune colo-
ab altéra parte
gradaiim evadens pallide viridis, deinde magis
ma^isque ad lut(um et nigrum vergat, desinatque tandem,
aut in corticem nigram, aut in speciem
„ Locus natalis
actinoti.
ad Orijcr\ i
in
pa-
roecia Kisko Nylandiae, gubernii Tavastchusensis sila.
Ibi
est
fodina
cupri
571
vcnn antiqua, jam descita, detcctiim iioc fossile,
qnondcim
in
noMiine
i\uarHi
cacruici
qnam
pulchi jusque ,
mixtum utplmiimim
iibciius
icccntioiibus vcnis comparuir, ad-
in
vcl quartzo viilgaii , vel pyritae cu-
cupreo, vaiietatibusqiie
sac
nunciipaliim ,
huciisqiie
Massae
taici,
ejiis
majores tuhero-
renifonncs passim ofTcnsae sunt circiimdatae cortice
et
asbcstina, actinoto,
pentino
Copiose quoque
simili.
mateiiave laevi ser-
chloiite aut mica,
sibi
immixtum habuernnt
pyritem cupreum, parcins pseudogalenam, et galenam plum-
nonnunquam etiam molybdaenam.
bi ,
Forma
crystallina
magis régula ris et claritas coloris eminentior esse
in
speciminibus ex vena
tioribus
hujus
illa
fossilis
in
recen-
massae."
caerulea et
ftcum ,
:
autem venis magnitudine insigniores repertae sunt
Ad expérimenta nostra
sius
antiqua desumtis
cernitiir
in
centigradi,
selegimus frusta lapidis inten-
maxime pellucida, quorum pondus
temperatura
caloris
i6
speci-
graduum thermometri
invenimus esse 2,6026, repraesentante unitate
pondus specificum aquae.
Ante tubum ferruminatorium igni exposita mox indolem prodiderunt
a
natura quartzi diversam, siquidem
cum
carbonate sodae neque phaenomenon cffervescentiae produxerunt, ncquc in
vilrum coiverunt.
A borace facilius susno *
572
cipicbantiir ;
ad
(uit
pracsUindam.
pellucidiis
i'uit
rliombicas
rnnt,
eumque
Rimis
di\iseiunt.
colorem
partim llave,ntein
scd
partes fere
partes
minus pcllucidae evase-
parlim
obtinucrunt
et
in
lapidis
intcrjacentes
servaverunt nitorcm,
et
sic
coloïc dcstiimus.
decussalim pénétra verunt,
lapideni
vitreus
cincrco vol rubcnte conspicuae,
colore lactco ,
opacitate ,
Globtilus
necessaria
apeito ignita phnimas ublinucrunt rimas, qnae
%"ase
vitrcuin
cl
copia
niaf;na
sokilionem
pioJLicUis
Tn
qnoque
hiijns
scrl
pallidiiis
caeiuleiini,
DilTracto lapide iisto,
opalinura.
in
supcrficiebus rimarum conspectiii sese obtulertint particLilae
micaceae.
ex
Itaqtie
hamogenis
nobis
probabile
ex quarlzo
mica inter se commixtis,
iisque
esse
quo ,
peracta iistione in vasa
alia
obtincre
noa
potius
idem
et
sed
fossile
formatura
partibus ,
constitui
hoc
fuit ,
phaenomena.
bcnc clauso
Sic
enim
,
obscrvarem^us
candefacta
frustula
integiitatem et liomogeneam apparentiam servaverunt. Color
tum
in
obscuiiorem: grisèo-caeruleum con versus fuit,
diminuta
luciditas
Propterci\
esse
et
nitor
existimamus ,
vitreus
acquali
in
cencum
probabilitate
pel-
mutatus.
explicanda
phaenomena diversorum colorum atque rimarum
visi
cum
lili
bilium
ex
acris
ad hujus partes
in
materiam lapidis
intcriores,
actione ,
pateret per ûssiuas adiius^
573
Fissuras in Lipide, sub ustione oitas fuisse censemus,
desîmeta
ex
paitim
cohaeienlia
caiiindcm dilatationcni vi
eiiiptione paitieiilarum aquae ,
erystaUinis occnliatae ,
pati
ignis
riato
vi ignis
inaequalem
ponderis
gradu
et
ponderis amisit ,
in
partim ex
inibi
pailler
ac in salibus
ad
fbriiiam
claslicam rcin
ignc no-
jacturam eamque diversam
pro va-
tempore ustionis.
centenarius la-
Sic
qui ad rubedinem ignitus nonnisi
pidis ,
per
tiansmissi,
Observavimus enim hune lapidcm
dactarum.
tabilcm
paitium
ignis ae^^ie
dimidiam libram.
igné ad fundendum fcrrum sufficientc
candefactus, très libras eu m quadrante perdidit.
Observa»
vimus porro, minus detrimentum capisse lapidem
repetitis
vicibus ignitum
interca
et
diuti.usque ureretur;
in
elausis
videntur,
et
perureretur
refrigeratum ,
minus, qui
vasis.
in
quam qui semel
quam qui
apertis ,
Quae phaenomena
indicare
ab admisse aeie recuperari partem ponderis per
fugatam aquam perditi ,
sive
aquam ex
per accedentem aërem comjniini-
alTectione
sibi
magis fixam
in
lapide
Indcque concludimus , quantitatem aquae
cata.
Iieilitho
conlentam
certiiis
excedere
très
in
fieri
Stein-
centesimas hujus
ponderis partes.
Pro experimentis seqnentibus lapidem triturando
aqua,
in
de^imiis.
cum
mortario achatino ad subtilissimum pulvercm re-
Sub
trituiatione senLieburaus odoiera^j
qualis
ex
.
574
humectatis corporibits
fovent ,
tLttim
compaiLiit
cincieo
diis
Ad singula expérimenta
tes
Ipse
piilvis
habemus,
oxi-
adliuc liumi-
colore,
siccalus feie albiis cxasit.
ejus
centenarinin adhibuiimis do-
qiiam pro uni-
sive octavani unciae partem ,
cimasticiim ,
tare
fenum paium
qiiae
iiigillaccis,
cxlialare solet.
nmiieris integris vel decimaiibus significan-
pondéra aliarum substantiarum.
EXper mentum
l
i
n)
Pulveri lapidis super fundeban tu r
quod mox
di
nuiiiatici,
na
elTervescenliae
flavescebat, et,
17| pondéra
jii
vante calore, sig-
producebat, odoremque
dum, illi similem, quem
aci-
excitant vapores
nonnihil
foeti-
acidi muriatici
sub dintina digesti-
cum gase hydrogenio
mixti.
one saepius
evaporata maxima acidi parte, spis-
situdinem
Milita
kito,
agitatiis,
mellis
Liquor,
contraxit ,
et
aqua dilutus decantabatur
colorem e viridi fuscum.
e
piilvere albo non so-
qui tandem sulTicienter elotus, in tUtro chartaceo col-
lectus et siccatus dimidium circiter lapidis pondus habuit.
cum
sub
Antc tubum
ferruminatoiium,
crtervcscentia
solvcbatur in globiilum vitreum pellucidum,
carbonate
sodae,
cum acido pliospliorico' in globulum opacum, proptereaque
indicavit,
omnes
fere
ticum e conjunclione
partes solubiles, per acidum
silicae
subtractas fuissse.
rauria*
575
saporem
Soliitio
6)
in
lingiia
excitnvit acidum,
dul-
cem posteuque austerum. Pnxata, per carbonatem potassae,
Insuper ad-
acido abundcjnte, liiteo conspiciebatur colore.
carbonate ,
dito
praecipitatiim exhibuit flaventem ,
quod , decantato Jiquore,
dilTcisiim ,
in
filtro
valde
colligebatur
et aqiia elucbatur.
Superficies
ta
liquoris
aquosi
ita
obtenti aeri exposi-
tcgi videbatiir pellicula teniiissima.
Ex eodem, super
c)
ignem collocato, secernebatur pulvis albus, qui lateribiis vasis
ab addito acido sulphurico,
adhaerebat,
et
centia
solvebattir,
facile
cum eflerves-
liquidum producens sapore sulp-
hatis magnesiae distinctum.
Praecipitatum
d)
non
phnrico
totum
fere
sensibiliter
verem album,
sapore
siccatiim ab instillato acido sul-
mutabatur.
Adfusa
evaporata iterum aqua parte, demisit pulsubtilem, deinde in massam granosam
initio
hujus ,
Restituta
dulci
austero
peradditam aquam ,
praedita
supernatnns
vix
mutabatur
solulio,
Admiscebatur
erat.
ammoniaca pura aquosa, quae subflavum
Liquor
vero aqua,
pedctentim solvebatnr, liquorem exhibens non
coloralum, qui,
coëuntem.
(6)
a
ipsi
dejecit pulverem.
solutione
potassae
aqua
suffîciente
purae, vcl carbonatis potassae.
e)
elotus,
Pulvis
per
digeiebatur
ammoniacam
dejectus,
cum decem ponderibus carbonatis ara-
5-76
monicae
aqua solntis, quibus nihil tradere comperieba-
in
Decantatus
tiir.
enim liquor limpidus ,
et
ad siccitatem
evaporatus, avolavit deinceps vi caloris, sine residuo.
/) Eidem pulveii, aqua denuo eloto, adhuc humido,
acetiim destiilatum , quod in fiigidiore
adfundebatur
lacteam obtinuit opacitatem,
peiatura
mit ^
solutionem
praebens
quae per evapeiationem
flavo
vini
in
minus spatium coarctata obte-
in
piilveiea ,
ad formam gelatinae cogebatur.
Admixta
videbatur levi
dam
iterum
pioduxit
vero cla-
colore conspicuam,
spuma alba
gi
calore
teiii-
solutionem,
tandemque
ipsi
aqua
tota
liqui-
natantem super materia
fusca gelatinosa.
g)
totum
Hocce mixtum, ammoniaca pura saturatum, mox
in
gelatinam
Paullalim vero sccernebatur
abiit.
li-
quor limpidus coloiis expers e subsidente
materia gelati-
nosa
novam aquam
llavente,
pluries
quiie
eluabatur.
decantato liquore, per
Ex his liquoribus comniixtis et evapo-
latis
separari
videbantur particulae ochraceae,
sim
collcctae
et
lum
siccatae
/lavo-fuscarum
quae scor-
formam acquisiverunt squamula-
nitentium ^
naturamque
oxidi
ferri
prodiderunt.
h)
Matcriae gclatinosae
pitatae admiscebatur
(g)
aequalis
e solutione acetica praeci-
quantitas solution is potassae
577
aqtiosae concentrntae,
caiisticac
gelaUnam
caloie omneni
in
qnae
foiHore digestionis
in
liquidam solmionem converte-
excepto paiixillo pulveris obscure
bat ,
riibii.
Sub
refii-
geratione veio nebulosus evasit liqiior, deposciitque pulvele
m oc h race uni notabiliorein
prae se
dati
qui itidem naLuiam feni oxi-
tulit,
Solutio hae& alcaîina
i)
ab addito sulphate ammonia-
cae tuibata,* fugata vi caloris aniinoniaca^ pulverem dejecit
album, aluminae simillimum solvcbatur enim paul-
fore
ab acido stilphuiico aqua diluto
latim
saporem
aluminis
inipertiebat
.
Veras
el.
calcfacto ,
quoque
cui
ciystallos
octaëdticas aluminis, par addiium solutioni nonnihil potas-
sae, progenuit.
Consideiatis phaenominis
nina
tus
,
sit
lutione
in
acido
vanda
esse
ex
ferri
composisub so-
Vestigia gasis hydrogenii,
mmiatico observata
actione
et alu-
silica
eu m minore quantitatç magnesiae et
Steinheilithus.
ad eam
hujus expeiimcnti ,
ducimur conclusionem , quod potissimuni ex
aquae
in
existimavimus deri-
partes
lapidis
parum
oxidatas.
EXpe
r i
mentum
2.
lapidis
cum quadruplo pondère
digestus et coctus
parum mutari videbatur ,
Pulvis
Mémoires île VAcid. T. Vl.
ac;di
nisi
1 3
nitrici
quod ad
578
snbcaciTileum
ejus
quibus
,
pondéra acidi
Addèbanttir quatuor
acidiis li(iiior.
tici
vergeret colbr, simuhic le\itrr flavrret
efficacia
solvendum augebatur.
pulvcrcm
ad
muria-
Cuni per diutinam digestionem et evaporationem acidi su-
massam spissam,
in
perflui
coloris flavo-fusci
coivit hic, sub refiigeratione ,. in
set liquor ,
ledactus es-
solidum
ex-
parvis crystallis contextum, quod, aqif^ ebuUiente extracintactuin reliquit
acidi
nitro - muriatici
tur ,
tandemque aqua elotus ,
portione
gradus 60 calefacti siccatus,
quidem
lenis
fuit,
at
bonatis
sodae
in
foco
Hic ciim nova
pulverem album.
tum ,
cum
tubi
digestus
in
et
elTecit
nonnihil minuiba-
temperatura aciis ad
0^567 pondéra. Tactil
aequali circiter quantitate carferruminatorii
etïervescentiatn.
produxit et in vitrum pellucidum coivit.
Liquori, evaporatione ad spatium octo pondèrum aqnae
redacto ,
adniiscebatur solutio sulphatis ammoniacae, quae
sub refiigeratione secernercntur
crystalli. octaë-
effecit,
ut
diicae,
quae scparatim collectae ponderi 3,2 aequales fue-
runt,
et
saporem habuerunt acidum, dulcem, nonnihil acrem,
quae
partim
in
aère calido ,
formam
et sulphate
partim
in
piilvercm fatiscebant,
crystallinam sustinebant.
magnesiae ac potassae, sale
mixtas fuisse comperimus.
lias
ferri
ex alumine
contaminaiis,
579
Scparato a crystallis liquori addcbalnr ammoniaca fere
ad satiirationcm acidi.
Dciiidc
nioniacac aqcia sohitus ,
qui pulvctcin
Hic clotus
temperatura
niiit
et
in
aëiis
colorem et pondus 0,1 5.
adniiscebatur
am-
ben/.oas
ochraceuin dcjecit.
siccatus _ nigiiim obti-
Ignitus
magneti obediit et
0,04 pondcravit.
Evapoiato denlque liquoie colatione separato, obtinui-
mus
amrnoniacae ,
sulphatis
crystallos
crant aliae, subtiles, plumosae, in
ponderis
0,162,
quae
magnesiae, et odoie,
sapore
dum
acre calido
amaio
immixtaë
quibus
fatiscentcs;,
indicaveiunt
salem
acidum ben-
foitius caleficrent,
zoicum.
EXp er mentn m
i
3.
A) Acidum sulphuricum, sive concentratum, sive aqua
dilutum nihil eftkere videbatur
Ica.
Lapidis igniti limae ,
in
ftisco
cocdoncMii cuin acida sulpliuiico ,
lominus inde
deris
ncque
augmentuni
frustuia
lapidis caeiii-
per
colore conspicuae ,
albae cvasciunt.
Nihi-
neque detiitnentuni pon-
cepisse observabatur lapis, neque partes
quasdam
so-
lutas suscepisse acidum.
B) Ipse quoque pulvis lapidis, cuin dccuplo pondère
concentrati digestus, inilio
acidi
sulpliurici
tur.
Cum vero ad
ebullitionem
redactum
parum mutabaesset
73*
mixium,
580
nîgrcscente Iiquore,
porans.
AcMir.i
pnngentem
aqua ,
aqua calida sokibilem.
ultra septiniam
Ex residao
,
totius
lapidis antca
quae, pcr
crystallinam
Aitatncn
et
odore
for-
hac via
vis.
ai-1*illae
griseae simile
n;uriaticum , ditlicilins quanr ex pulvere
intacli
vidcbantur pastts sokibiles.
sciscipi
C) Fulvis lapidis aqtia calida
per aliquot
qua,
in
pulveris paitem soUîtam obtiniiimus.
quod colore
fuit, pcr acidurn
va-
acicliini
salinae nascebantur ,
crescendo massam
evapoiaiioneni aqiiae ,
in
odorem
îlavens oiicbatur solulio ,
snb icfiigciatione, aciciilae
mabant
spaisit
horas ciim
octuplo
pari aqiiae quantitate diluli.
luimectatus digerebaluf
acidi
siilphmici pondère,
Evaporata
aqua ,
et
aucto
calore nsqiie fere ad ebullilionem acidi, nigrescebat liquot
qnam etiam rcfiigeratiis servavir.
et spissitudinem contraxit,
Addito vero aqnac patixillo, ciystallos obtubit
ratus in
massam solidam
.salinam
concrevit.
maximara lapidis parLein non resolutam
et refrige-
Adlnic tamcre
fuisse
deprehen-
diraus.
D)
Subtilissimns
fi)
aquam ex
particulis
ebullitionis calore
abiret aqua.
spissus
ad
pulvis ,
et
triplo
per
pondère acidi sulphurici,
digcrebatur, usque quOj e%aporatione
Liquor acidus obscuro
siccilaLcin
clulriationc
adhuc granosis separatus, cum 3o-plo
pondère aquae calidae
in
lapidis
vi
ij;;;nis
jim tinctus colore ef
'redigcbatur.
Aqua
ipsi
ad-
•
581
excitavit
calorem
fusa
non sokita pulverea
partem
et
massae dissoivit.
compaiens
subcinerco
fuit ,
Pars
colore.
Haec denno cam acido snlphmico dii^esta, per aquam tan-
dem
elota
et siccata
in
60 gradiuim thcrmo-
tempcratiira
metra
ponderavit 0,571^ ignita 0,5 18.
silicae
lere purae.
h)
Solntiones
per
acidum
Naturaiii
sulphariciim
liabuit
factae ,
corn-
mixtae evaporabahtLir, usque que, per refrigcrationem, in
massam solidam
crystalliîiani
concrescerenr.
alcohole
pnlverera albnm salinum ,
qui
cluntaceo
temi)craiura
inlcrvcilluin
aliquot
pondoiis 3,65
lis.
Hiil,
et
in
in
triplo
Ex solutiones hujus aquosa
ncni pritnum obtinebanlur
les,
ad
hebdoniaduin
atquc
vi calons
qaod copiosum
liquefactae. adfundebarci.r a'ÉcohoI ,
colloctirs
Hiuc
,
cryslalli
elotus ,
acris
in
filtro
vulgaii
post
siccilatcin
aqUtie
dejecir.
redactus,
pcrfecte solubi-
per lentam evaporatio-
granosae
quadiangula-
ponderis 0,66, qnae ab avjua fervida solutae, adniixLo
carbonate potassae ,
purum j
dederunt carbonatem magncsiac
praecipitatum ,
ponderi 0,22 aequalciii;
,
fere
in
quo
propterea ciiciter o, o5 pondéra magnesiae purae latuerunt.
c)
Scparatns ab bis crystallis iiqiior,
poratus coivit
in
ma.'-'-ain
ulleiiu.çqtie' 'era-
mollem' scjuamosam ,
sensiBiliter
acidain, cujus per aquaui facta solutio, akali satura ta
al>
potassiic
o.Xtilciie
praecipitatiini dédit
tassae
colore
siccalLim
cum
non miUabaUir ,
tcriac
igné ad iiibedinem
album npnnihil
ac{|ualc
lioc aluniinani potis^imani parleni
i\iit
vi
LiqLior alcohblicus
acidus
ferri.
Evaporato,
fuit.
ipsi
solutio caibonatis po-
tassae praccipitatum protulit luteum spdngiosum,
cum caibonacea
feni,
In
efficerexompeiimus, prae-
fortiter
Admixta
parliculis caibonaceis.
et
in
alcohole, massam piaebuit ni^iam ex immixlis
caloris,
catum
et
ponderi 0^32.
teieaque nonnihil ma^ncsiae et tantillum oxidi
cl)
quod
iLivcnlcni,
conspiciebatur,
tri}iplitanae
tistiim
carbonate \'eio po-
substanlia in
collcctum, elotum^ sic-
ustuni ostendit naturam ochrae
igné rubente
in
filtro
quod una
obscure luscae, magneti obcdienlis, ponderis o, o5.
E X p e r m e n t u m 4.
i
a)
Pulvis
tallorum
genteo
Repericbatur
parum
nigra ,
indicavit
fere
carbonicum
cum duplo pondère
potassae
exponebatur,
igni
cipicbat.
fere
lapidis
carbonatis
e
in
comniixtus,
(juo
omnem
argtntum
aquam
pulvcris
crys-
crucibulo arJ-iquescere
in-
massa obsciue grisea,
crucibulo
coliaercns,,
in
quac jactura ponderis
crystallisationis
carbonate fugata fuisse.
et
sui
acidum
Per adfusam aquam
calidam obtinebatur solutio alcalina, quae cum acido nitrico
parum
cflervesccbat.
Liquoris
ita
salurati
parti adstilla-
583^
batiii
soliUiû
nitralis
plumbi,
nuit.
Altcri
eJLisdem
piirti
r|iKie
limpiditateni non demi-
admiscehatur solutio sulphatis
ammoniacae, ex qnn lactesccbat, palvcremqiie album ad
fundum
quae
Hic pulvis scpnratus ,
nonnisi
sulphurico suscipiebatur ,
alumen
vasis demittebat..
paitcm
cum eodem
solutione
plumbi
ab
acido
Ex his phaenomcnis vidimus, in
pioducens.
alcalina
oxido
nullam latuisse substantiam quae cum
solem
insolubilem
piogignere potuisset ,
luininae veio et silicae tantum adfuisse deteximus, ut
a
si-
mul sumtae ponderi o^OiS acquarcntur.
b)
adhuc
Pulvis ab aqua intactus ,
pioduxit
acido- muiiatico' sensibilem
gasis
hydiothionici.
inde
extractae
Quum
,
per
fera niger ,
calorem
coctionem
cura
odorem
et
cum^ aqua,
essent partes solubiles,. restitit pulvis ni-
giicans, qui' elotus et siccatus pondère effecit quinlam la-
pidis
Hanc
partem.
habuimus,
sedi
mox
pio
parte lapidis non mutata'
observavimus ipsam nigrum colorem
né scrvasse,. cum
in
ig-
borace abundanle in vitrum pellucidum
non coloratum; cum minore boiacis quantitate vitrum obs-cure tinctum produxisse,
fenuminatoiii
diutinam
tenebatur,. non
coctionem
ponderis, ad
carboni, super quo in foco tubi
modum
cum
adhaerens ;
acido
muriatico
eandemque per
dimidium sui
ipsius lapidis peididisse, et
rémanente
pulvere albo, solutionem obtulissç viiidescentem,
ex;
qua^
584
per alcali pinecipilnta
vergens ,
Si^mm
pulvis
oblincbiitcir
,
in
fla\''ens,
uy-
nnUirani et originem, alla occasione
cujiis
propiiis examiniire nobis proposiiimiis.
Solulio,
r)
(joam ex lapide ciim potassa usip et
eloto, per acidinn
ciqiia
impetravinids , evaporatione
muîiaticiim
in
gelatinam eoivit, qna ad siccitatem redacta, pér aqiiàni
et
acidnm mniiaticiim extracta,
pondéra
silicae,
€t
silica,
vuli^arem ,
obtimiiinns
indicaverunt
dica'vimas
obtinnimus 0,448
quae per ignilionem ad o,3']6 icdncebamiir,
d) Se{:)aiata
tassae
residiia
feirnm sohitlim per prussiatem po-
sive fcrro oxidato onustiiTn ,
0,27
pondéra
0,045 pondéra
o,o5 7
pondéra
prussialis
fcrri
ferri
ferii,
metallici.
in
toto
dejeciimis,
quae nobis
Ex quo jii-
lapidis
pnlvere
iatuisse.
In rcsidua solutione muriatica, per phaenomena scipia
-memoratis
similia,
^kiminam
adfuisse intelieximiis
et raa-
'gnesiam.
EXpe
a)
Pulvis îapidis,
)•
i
ment u m 5.
cnm
sodae^'aqua crysrallisatîoms
btilo
platinaceo
Igni
(inadiiipîo
priv^ati,
expositiis
pondère carbonatis
commixtiis, in cmci-
convertebatiir
in
massam
opacatn, albam, n )nnihil flaventem, quae ab acido nuiriati-
co dilulo sokiLi, iactd evaporatione, forniam contraxit ge-
585
Haec
latinae.
cum aqua acido
clic;crcbalur
Remansit pulvis
aciijfa.
tico
siccdtn
silicae
albiis, ciijiis
miiria-
pondus,
post siccationem in temperaUna aëiis aestiva aequalis fuit
ponderi 0,6776 post ignitionem vcio nonnisi 0,45.
îiydrothionico
plane opaca
in
cum
de,
ex qua
saturata ,
Ilic pulvis,
atruin_,
filiii
subtilissimum,
val-
ope, a liqiiido separatus
siccuni evaderet, in ochraceiini.
nem aqua calida
acido
vase bcne clauso
in
paullatim mutavit prinio
aé-ie
potassa
alio tingcbatur colore et
Lentissimcque,
evasit.
spatiosiim.
coloiem
-admiscebalur
deposuit pulvciem
servatum,
de
mmiaticae
Solutioni
6)
in
lividum, dein-
Post exsiccatio-
elotus, iterumque in temperatiira aestiva
siccatus aequivaluit ponderi o, 735.
Foititer vero jgnitus
reductus fuit ad pondus 0,336,
tnm
et
particulas ochra-
ceas obscure fuscas, albis granosis immixtas exbibuit.
c)
fuit,
ex hoc praecipitato colatus mox nigricans
Liquor
dcinde, accedente
pidus^
expers
coloris
post
in
aère, claruit, tandemque lim-
evasit.
tcmpcralura
ignitionem
vero
aeris
ponderi
ab acido niurialico lentissime,
batur,
Perficicbatiir
cum additum
Per additum oxalatem po-
copiosum demisit pulverem album, qui post
tassae tuvbatus
perfcctam
ipsi
esset
siccationem ponderi 0,18,
0,09 aequalis
fuit.
Ustus
qua paitem tantum, solve-
cjus solutio ju vante digestionis calore,
acidum sulphuricum aqua attenuatura.
Mémoires de rAcad. T. H.
'
-
H
586
tnmcn
qiioqne
rrmnnsit
ccus , c[im
aciciilis
nonnrllis gypsois inixluj ponileris tir-
Sic
r\i\<^mi? piilvis
insoliitns
o,oo5.
citcr
d)
l'qdorem ex
''l'.iiidcm
piMocipitiito oxnlico colatione
séparât uni
per caibonatem potassae diiimcndo,
piilvcrem
pallide
Kx hoc
e)
per
sulphuiicum
aciduin
exliaximus
avant
silicea
quia
muiiaticum ,
feni ,
sic
commixto
(6)
qnac praecipuae
obtinuimus
residiuim
qucm pro
ter-
per inquinamentiuii quoddani rubente,
cum carbonate sodac
nem
igné
ju\antc calore,
roscum, pondcris 0,018
li.ibuimus,
formare vidimus,
praecipitato
Atque
partes.
subh'lrni
cum
et
qui
reducebaUir.
oxidunique
ahiininurn
utritisque
pulverem
pulveie
obtiiuiimus
0,076,
pondeiis
flaventeni
ad pondus o,o5
•candefactris
ra
n"]i-
euni facillime vitrtim pellucidum
igné quidcm fla\ens, post refrigeraiio-
in
vero coiore destitulum.
Itaque cx phaenomenis hujus exporimenti conclusimus
silicam in
pulvere lapidis contentam, partes cjusdem 0,47 3
eflecisse.
¥a cum
ferri
tatem
metallici
ex expérimente 4,
pondus
in praecipitatis
qualcm
ponderi
fuisse
o,o57,
(d) intelligeremus
ejus oxidati
quanti-
experimenti 5 supputandam esse ae-
0,073 judicavimus.
Proinde
esset
pon-
dus aluminae aeqtiale ponderibus 0,336 -\- o,o5
— 0,018
— 0,073
secundum
zz:
0,295.
IMagnesiae
quantitatein ,
587
expeiitncntnin
5
(c) ,
cxpriincnduiu
esse
pondère 0,o85
•censenuis.
llis
partes
considciiitis,
constitutivas Stcinheiliihi
exponiiuus, ut in ccntaraiio lapidis
sit
ita
silicac libiae
47,3
aluminae
29,5
mogucsiae
S, 5
fcni
7,3
oxiclatl
Dcfectum ponderis ex jactura partium fiigacium,
.
poiissimum aquae, deiivandum putanuis
7,4
100,0.
Fcnviu, qtiod ceitius minimo gradii oxidatum in lapi-
de adest, propterea non vidctiir tantam
ibi
efficere
partem
ponderis, quantam in hac expositione ferro oxidato tribui-
cum
ad
iïdem
pronum
nnis ;
sed
eu m
ferro
sive
magis minusve ad naturam radicalium suoruni inflam-
conjunctas
similiter
sit ,
esse
in
ceteras substantias
lapide comparatas,
mabilium propinquas, ponderaque singularum terrarum
dem non cadem
refaclis
ta
fuisse,
ibi-
ac quae in segragatis et igné tor-
partibus inveniuntur ; existinianius, per expérimen-
anahtica
nonduin
exacte
salis
defmire
posse
veram
ralionem pondciis singularum partium.
Aquam
notabilcni
mus ex tentaminibus
in
efficere
hujus
lapidis partem
antecessum jam memoratis.
H*
vidi-
Utium
588:.
vero omnis defcctus pondeiis
in
partium constutiva-
série
rum obscivaLus, dcpendeat ab aqua sola,
in
lapide
aqiiae
in
lulto
vero minoi-
ris
60 gradiuim
..it,
candetacto
etiani
paitibus
copia sic
quantitate
segregalis
et
ignitis
quae substantiis
in
temperatura ca-
lapidis
illa
longe
ciijus
esset
majoi-
siçcatis
adhaeret,
residua,
nobis non ceito con-
cum expérimenta nostra indicent alias praeterea sub-
stantias
volatiles
in.
lapide occulta tas esse.
Sic odoc foetidus^ quani acquisivit; aciduni muriatictini
cxp.
en m piilvere lapidis digest;Lim^ et niger color aci-
1.
di snlphuiicL cuiii
eodem
fortins
celcfacti,
exp.
3.
indi-
gîtasse visî siint praesentiam, substantiae oleosac vel caibo-
naceae, similiteique odor hepatius cxperimenti 4, (6) prae-
sentiam
diiri
SLilphuiis^
non
potiierint
quamvis propter nimiam exilitaiem
Dubium quoque
heic
vestigia
pertineat,
vel
nobis adhuc est, annon calx, cujus
nonnunquam
reperimus
ad
ipsum lapidem
utrum polius aut ex peregninis substantiis
immixtis venerit ,
fossili
nostro
nostris
expeiimentis insinua verit.
forte
aut
aliter
Quamvis ceteroquin analysin jam descriptam
nott
nu-^
hae substantiae.
omni ex parte perfectam^
et,
sese sub
,.
tantum
per congruentiam pkni-
um experimentorum. variis viis institutorum, quodanmiodO'
589
confirmatam esse putaiemns > postea tamen dcpiehcndimns
aliquani
satis
ejtis
concclioneni
necessaiiam
esse,
proptcr
non
perspectam naturain materiae in piilvere rubio
nobis
expeiimenti
5.
Hcinc enim, cujus color ro-
hacrentis.
(e)
sco-riiber peciiliarem poposccrat attcntionem,
Gum admodum .cxigiia
nnllis adluic
cmsim tantum,
ejus nobis supperesset quantilas non-
subjicientes
periculis ,
sequentia
deteximus
phaenomena,..
j)
In.
igné ad lubedinem calefaclus coloiem roseum suscalefaclus,
super carbone
praeseitini
liniiit.
P'ortias
in foco
flammae reckientis ante tabum, ferruminatorium,
obscure grireus tandenique nigricans evasit».
2)
Cum
carbonate
sodae
in
mma reduccnte fusus ni-
fia
giLim prodiixit vitrum^ ia foco oxidationibus apto co-
loiem
bus
fere
perdidit
vitreus,
et
pelluciditatem. acqiiisivit glo--
Hic^ ex addito
fiListulo
ferri
metaliici,
viridem; contraxit colorem,. pellucidusque mansit.
que mutala esse videbatuc
3)
•
4)
Cum
borace
superficies nitida
similiter fere scse
habuit ,
Ne-
ferii..
tardius vero-
solvebatur,, vitrum. coLoiis expeis pioduxit..
Cum phosphate ammoniacae globulum: produxit lacteo
colore
tate
conspicuum, qui ex aucta
fere pellucidus frebat..
phosphatis quanti-
Ferrum. cum hoc globulo.
590
cnndichir.i
iT£;uhini
fLiSLim
vix mutato aspcctu
5)
Ab
acido
niliico
colorem
non
phosphorei piogcnuit,
non
mntabntnr.
vjtii.
fiii;ido
digeslionis nonnullas
vini
fcni
flavcntis
et acido
tamen
Ipse
impcrtiit.
piilvis
ncque qua colotcm nuila-
minLiebalur,
sensibiliter
emisit,
biilhilas aciieas
calore
Tn
batur.
6)
Acidum
muriaticum
cfficacids
ageie videbantur,
continuae
leae
taiDcn
rauïiatico
tate
dii^estionem
pulveris,
adhuc sustinens,
in
ximus
ejus
plurimas
snbflavo colore
in
7)
pulvcre
e
cum
niassani
in
illis
vi
caloris
bnlltilae
emanaïc cernerentur,
aë-
At-
quidcm destruebatur,
cum
nonnihil paliidior
specifica
ratus
nilro-niuri.itictim ,
color pulveris ne sic
dintinam
cet
et
li-
copiose
addito
acido
Ex
majore
levi-
ficret.
qui spatium initio occupalum
liquore jam
partes
natavit, ciitelle-
fere
solcitas
laevitcr tincius, ad
fuisse.
Liquor
siccitatrm evapo-
salinam praebuit, albam \el subilavam,
aqua solubilem.
Acidum sulphuricum aqua ailcnuatuin inox non visibilem, ex immissa pulvere subiit nuitationcm, cum vero, vi
caloris
maxima pars aquae avaporassct, rufulum obtinuit
tinctum liquor acidus, nondum vjsibiliter mutata (|uanlitate aut colore pulveris.
llic
tandem^ cum diulius for-
1
59
tiii?r|j]p Ciil' fieirr
licjuor,
eo ipso obscure rutilas
ii!f|uo
ipse (juo(]iic obsctiiioiein
e\"ii(i(-i('t ,
nigio-fusciim obti-
colorem, mdqna ex p.nte adluic non solutus.
nuit
Acidiim })hosphoriciim ab aqua
soIlUumi
ciim
pulvere
digcstum
anlcquam ad
siccita-
8)
tem rcdactum
Ex
lit.
cniccre
niliil
cssct.
hac ,
Tum vero massa m nigram obtii-
aqua exlrahere
soliitionem
qiiae
vidcbaliir
vis grisco-fuscds
flavcntem
piil-
saporem habueriint sty-
(5,6,7,8,)
piicum, plus minus aciduni.
Per ammoniacam turba-
tae praecipitata dederunt alba,
per
Remansit
dederunt.
non solutus.
9) Singulae solutiones
subtilium ,
valait parles salinas,
vel subflava pulverum
prussiatcm potassae caerulea ,
par
et
tincturam gallarura flava, vel aurantii colore in liquoconspicua.
re
Ex
his
purae ncq'ie oxidi
que
pulverem illum roseum ncque
patuit
ferri
proprictalibus gaudere.
affeciiones ejus quadrent
sui
ejus
gcneris
mclius
substantiara.
expeiimcnto 4.
quod ex
tiones
illa
indagata
[b)
Ex
Cum ne-
cum indole ullius alfi nobis
hucusque cognitae substantiae, ponere
naturd
silicae
fuerit,
licebit,
novam
similiiudine
iisque
quo
illum efficcre
phaenomeni
in
memorati, dncimur ad eam sententiam,
quoque substantia orlae
massae nigrae,
sint
peculiares afTec-
acida difficilius subeuntis,
quodque
592
ibidem
inferiorem
per
grum massae
oxidationis
gradum
ni-
igné tiactatae, et viridescentem soluiionis
in
per
acidum
sint,
supputandLim esse videtur pondiis
dio massae
et colorera
niuiiaticiirn
illiiis
factae
Haec
produxeiit.
si
ita
ejiis
aeqnale dimi-
nigrae, sive decimae parti
totius lapidis.
Qiiiipropter demtis ex ponderibus silicae, aliiminae et fer-
supra exhibita, ipsis nimia attribuimiis,
li,
quae , in
ita
exhiberentur partes lapidis constitiitivac, ut ex cente-
nario
minae
cjus
23 ,
série
educlae
sint
silicae
ciicitcr librae
substantiae
novae
adhuc
magnesiae 8,5
et
ferri
oxidati 5^6.
oooooor^ooooo
45,5;
problematicae
alii-
lo,
593
A R U N D O
W
I
L
H E L M S
l
r
A UCTO RE
LEDEBOUR.
Coiivcntui exhibait die a8 Fcbr
A. pcniciila
striera
doisali
i8ib".
patuLi, calycibiis acutis bifloiis, arista
letrofracto-divancaLa coiolla lonijiori,
pilis
coioIKim aequantibus.
Hab.
ciica 1 iflin.
Ij.
Radix
Culmiis
(in
speciminibus sesquipedalis )
simplex,
erectus, teres, teniiissime striatus, glaber,
ad pani-
CLiIarn
nostris
fere
ùsqiie
foliostis.
Folid spaisa, versus apirem remotiora, vaginantia, praeser-
tim supeiioia cauli adpressa ,
acLiRiinata ,
scptem - nervia
,
Janccolato - linearia,
niargine et in pagina
supeiioii scabriiiscula, subtiis glabra,
i
— 2ï lincas
longa, siiperiora sensim minora,
Faginae
Sïiictac,
glabenimae,
foliis
mnito longiores.
Ligula exsoita, truncata, lacera, culnio aicte adpressa, latcribus drcurrens.
Panicula crccta, siricta, palula, 4-^-6 uncialis.
Mémoire! de rAcad. T./f.
"7
5
594
Rhachis
teres,
flexiios.i,
glabra, striata.
Rcunl erccti^ tenues, flexuosi, structura et supeiûcie
ihachidis ;
infciiores
pleruniquc
unifloro, duobus 3 — 5 floris
altero unifloro,
ni,
altero
;
unico
terni ,
superiores gcnii-
3 — 5 floro;
summi
solitarii,
Spiculae biflorae,
riis,
pedicellatae;
pedicellis
apice incrassatis, violaceis.
Glumae calycinae violaceae, nitidae,
rior
longiludinc va-
inaequales;
exte-
lanceolata, acuminata, valde carinata, margine
membranaceo - pcllucida, integerrima, iindique
bra;
interiori
duplo majori , acuta , margine mem-
brana lata pellucida cincta ,
pauUo lacera, valde
carinata; carina vix aut ne vix
Floscull calyce paullo
nudo ,
vel
gla-
minores ,
pilis
quidem hispidula.
aristati ;
rarissimis ,
inferiori
sessili,
brevissimis qiiandoque
suiTulto ;
superiori pedicellato ,
celli pilis
sericeis ,
affixo
lateri
pedi-
coroUam aequantibus undique
obtecti.
Gluma corollina
fida;
exterior violacea, lanceolata,
laciniis vario
modo
versus apicem serrulata ,
usque scabra ;
interior
flexis;
apice bi-
margine diapiiana,
carina a basi ad
minor ,
albida ,
aristam
diaphana.
595
apice intégra, margine versus apicem scrriilata, cari na
Ansta
glabra.
gkimae
e
carina
exterioris
paiillo
snpra
médium
provenions, flosculo paullo longior, rctrofracto - divaricata^ subflexuosa,
Ohs.
1.
Calycibus
bifloris
ciebus differt ,
hispida, apicc tantum glabra.
ab omnibus hujus generis spe-
excepta solummodo A. bengliaîensi
Retz, quae etiam spiculis
vero diversissima
Ohs.
2.
In
caeterum
est.
lionorem Wilhelms'd ,
assidue incumbit,
bifloris gaiidet,
qui plantis investigandis
nomen dedi triviale.
Explicatio tabulae XIX.
a.
Spicula magnitudine naturali.
A.
eadem magn.
aucta.
h.
Calyx magn.
naturali.
B.
idem magn. aucta.
c.
Flosculus inferior magn. naturali.
C.
idem magn. aucta.
d.
Flosculus superior magn. naturali.
D.
idem magn. aucta.
75
DISQUISiTIO DE LIMÏTATIS
SALIUM PKOPOKTIONIBUS,
K\ COMPOSITION'U:
A
G A D O L I N.
/.
Conventui exliibuit die i3 Nov. 1816.
confcsso
In
vires,
cinituii
coni'inia
non
in
-
laro
ftiit
invicem adliaeiescunt
sibi
an ex variis
vires,
corpoinm
diveisimode
caiissis
de
coiporum
a
universali ,
mine appellatam ,
in
immo per
'inter
Sic
singulaies
ceterasque
minus
efiici
propensiories
conjtingcndi ,
se
propter
eanderii
coiporibus
iibi-
explorari
summo Neu'tono systema
dissitorum
dominaii candem' vim,
mutaiiones.
commixta
dependeant lecipro-
multis visum fuit,
guis,
et
appetitiones,
sicoruni
nondiim poluit. Post stabilitiim
gravitate
,
Utrum vcro eaedcm
coniposito disceini nequeant.
cae
corporibiis
in
iiniuntnr nt praecipiiae singiiloium aiTectiones
ita
que agant
esse
insit.is
,
quibus distantia ad mutuam trahuntur vi-
iiniveisis
,
diidnni
propinquis
plurinias
probabile
attradionis no-
atqne
conti-
corpoium mixtoium
variaium substantiariun sese
aliasque
e
societale
paitium minimarum figuras,
cognitas conditiones ,
excliidendi,
densitates
specie tantum ab
597
corpaiiinj
altractione
et
Torhenio Bcrf^iuan
ipsis
univeis.ili
nomen attractionum chcmicarum
socids sibi
cligcndi. Alii
peispecta
veriint
quia
incerti
ftiit
vero, ad
tribiicntes^
et
quidem
substantiis optia
qvos hodicrni
ferc
oni-
de identitate caL>ssjinin, ubi non
efTeclniim similitiido, offimtatcs nuncupa-
siibstanliaium sese chemicc conjcingendi,
facultatts
affines eas optime dici existimavciunt,
petiint
Buifon
chcmicorum,
p.juci
videretiir phuibiis
cuni data
nes accr'sserunt ,
])raeiintibus
censueriint Juu)d
,
electiuarum,
satis
dilTerrc,
socictatam.
Horum exemplo
quae miuuam
rcceptas jamcfiidum
denominationes, utpote minime ambigLias, et caussis quibuscunqiie conjunctionum convenientcs^ nos quocjue in sequentibus adoprabimus.
Gallomm
Celebii
abhinc
inter
varias substanlias,
tiira
singulaiiim
quidem
seniori ,
esse
seculo
affinitatnm,
chemicariim, quariim le^es a na-
mateiiamm
definitas,
jadicavit.
Contra
proptereaque semper
sententiam
ejus
mox
vaiiae objcciae siint observationes, quibiis affinitas
substanliaium
tatibus,
Geoffroy
primam debemus expositionem
vigenti
constantes
chemico
qnas,
siipcrari
interdiim
videbalur
ab
aliis
aflfini-
secundum praesciiptiim ordinem vincere debe-
neque dcfuerunt ,
qui ,
phaenomenis artentius
consideratis, anomalias illas,
salva
theoria GeolTroyana ex-
ret.
Sed
plicari
posse
autumaient.
Cumque
in
série
affinitatum
598
cxlcndcnda et varia ratione cmendanda plmitni jam occu-
tandem de
pali fuissent,
ipsius doctrinae veritatc,
tempore
Bergmanni nulla superesse videbatur dubitandi ansa. Ostendit
namque
qiiae
illustris
pro
vir ,
simplici
sacpiiis
efTectu
duarum
subsiantiarum habitae sunt,
ut
attractiones ,
easdem
et denique,
sis
difficilius,,
variiibilis
tatis
quod ex
nobis
agentium
nuituo
se
in
pluribus simul viribus, per
a
dùpUces
vel
quod
'firmitate
différant
diversa
nexus
advenientibus caus-
interdum facilius, in-
afTines
interdum plane
multipUces,
proportione conjunctas ;
variis extrinsecus
ut duae substantiae
liai,
tcrduin
substantias
ut conjunctiones,
electivas
Docuit,
durant.
oiiginem
inter
dixit ,
evcniie ,
non
appareat celeroquin
coëant ;
sibi
indcque
constans
affini-
vis.
In
partibus salium constitutivis luculentius
bi conspicui
elTectus affinitatum
fuercint
quam
chemicarum.
ali-
Aci-
da namque et bases salium, quae seorsim considerata manifestis
distinguuntur charactcribus, per conjunctiones justa
propoitione factas,
quibus
ter
salia
progignunt neidra
s.
snturata,
m
plene delitcscunt notae propriae substantiarum in-
se sociatarum.
Peifcctum igitur
ibi
adesse crcdcbatur
aequilibiium viriura oppositarum, quarum mensurae ex indagatis quantitatibus partium ,
inveniri
possent.
In
salia
neutra constituentium
corpore cnim quocunque homogeneo
599
non polesL non eadem esse alTectio singiildrum molcculiirum:
propterca
molcciilaium
corporis acqualis
viiibus
omnium
simui sumtiSj et inde orilurus elTectus tanto
majus
quanto
major ,
tolius
vis
erit
molecularum
pondus corporis ex multitudine
sit
Si itaque datus sit ,
dcrivandum.
ad qiiem
tendant vires, elTectus, ad hnnc producendum tanto minus
corporis
sufficiet
pondus ,
sive
tanto
minor molecularum
multitudo,
quanto mdjor singularum vis
quidcm
neutris
in
basibus ,
et
eandem vim ad
vis
chemicis,
rie
inler
litate,
cum
se
secum
Quae
vires.
basi
constanteu
aequales ex singulis
sententia
confirmata
fuit
animadverterent, neutra pleraque salia va-
mixta partes suas constitutivas, salva neutra-
peimutare posse;
basium ,
alii
aequalibrium
desideret
acidis
vi sese diversis oile-
ex unaquaque
propterea
si
aequilii)rium poscat, et si pariter data quae-
ad
basis ,
Acquales
crunt saturalionis elTectus,
salibus
datum quodvis acidum data ubique
rat
fuerit.
sufficere
et
quantitates singularum
quae datum unius acidi pondus saturare valent,
cuicunque acido saturando, quod cum una basium
sal
producit neutrum; similiterque quantitates singulorum aci-
dorum, quibus data
potest basis, aequale cujuscun-
satiari
que baseos pondus saturare.
sint
omnium acidorum ad
um
basium
Posito igitur,
singulas bases,
quod aequales
ut cliam omni-
ad singula acida saturanda necessaiiae
vires.
6oo
erunt vires moleciilaiiim^ sive
acidomm
aiit
ba-
sium, quibiis satmatio ciim data basi aut dato acido
efTi-
pondcrnm
ratione
citur,
in
tiario
affinitates
iifllnitates
inveisa ;
illoiani
dati cujiisqtie
acidi
e
at(|nc
con-
aut bascos ad diveisas
bases vel acida in ratione dirccta ponderum, quae ex his
chcmiconim
pkires
nixi
hae exacte defmirentur,
niis
proportiones
parlinm
determinandi
quantum
vere activis ,
salinis
haerente
maxime satcgerunt
relativas
Scd quomi-
exprimendas.
vix opinata difficultas
obstitit
salibus accnratc indagandi ,
i\\
pondeiis
tribuendum
quantum ex aqua
Qua
vencrit.
vohicrunt
investic?;are
nnmcris
quaniitales
ailinitatmn
lîoc fundaniento
poscit illorimi altcrum.
saturationem
ad
in
re
célèbres
R.
sit
inelTicaci
enodanda
p.irtibus
ipsis
infdtigabili
Kmvan et I.
B.
sivc
ad-
studio
Ricliter.
Rkliter fusius
quam
ante
quod
Siilibus
neutris constantes sint proportio-
trinam ,
in
se
ullus
eam exposuit doc-
nes et acidoruni, quac ddtuni basis cujnsdam pondus saturare
\aknt,
et
dère saturanlur.
si
plurium
lexit,
basium, quac
a
dato cujusque acidi pon-
De veritate horum axiomatum ex analy-
salium
pervasus apcrtam
sibi
qua computando inveniret quantitatis
quoque
salibus,
accuratius
intt 1-
partium
in iis
quae per analysin chemicam non pctcrant
investii;ari.
logis divcrsorum
viam
esse
salium
se
homo-
iisdem
invc-
Comparatis
vcro
intcr
parlibus ,
miras
in
6oi
piitavit harmonias,
niri
nempe
pleroiumqiie
ad
ddtain
exprimeientiir
pcr
séries
acidoiiim
sariae ,
qiiod
quantitates
pondcr»
s,
basin saturandam neces-
numerorum
invicem
continua
in
omnino deincepg
non
propoitione
geonietiica
Sfquentiiim,
et
satuiantium
per
séries
numerorum
arilhinetice
proportio-
in
ordine
acidorum
mineralium
volatilitim
nalium.
Sic
se
basium datum quodvis acidura
quantitates
primum locum occuparet acidum fluoricum, cujus quantiper c significata, essent quantitates acidorum muriati-
tate
ci,
a^quales terminis aV, cd\ c(P apud
sulphurici et nitiici
alkalium
salia
basibus
tia,
sed terminis
cd'^,
terrarum alkalinarum gauden-
vel
cd^,cd^°
apud
aluminosa, ubi
salia
esset quantitas constanter
eadem, variante
turam
in
et
cujtisque
animalium ,
praesentarentur
mici ,
basées;
iiidcm d esset
ubi
pro
vaiiaret ;
baseos
ammoniarae quantitatae z^ a,
mina
potassae ir:n-f-56;
zm a
strontiana
et
magnesia
rra-f-96,
perspicacitatcm
carbonici zzz c, re-
in
et
et
per frf^ cd*, cd^,
constans ,
ordine alkalium ,
in
c
vero
posita
sodae zn « -j- 6, esset quan-
oïdine terrarum, positis alu-
baryta
19 b.
Et cum ad
Bcri^uuuuio
detectam,
r:z a -f-
Icgem
rra-r-36,
esset caix
zzia-j-'b,
icdegisset
Mémoins de VAcad. T. VI.
tartarici
ciirici,
cd", cd'*, fc?'^ rd"^,
titas
acidi
quaniiiates acidorum sebacici, oxalici, for-
succinici , acctici ,
naluia
secundum na-
ordine acidorum vegetabilium
quantitale
posita
e.
d
a
"7
^^
602
quod ex
singulis
datum acidiim
metallis
qualis pliloglstl qiiantitas extiicctur, sive,
nomcncLiUiicic
tioris
oxigcnii
aeqiiali
acidi
paritcr
acidum
:=z u ~{- a
et
conjiincta
ut
eam
salibns
ia
sufficiant ,
nietallicorum ,
ae-
idioma loquendo , quod melalla cum
qiiantitatc
productis
sntiirantibus
seccmdum recen-
esse
ad satmationem dati
per
metallicis
datum
lationem oxidorum
perliibuit
positis
quantitatibus
oxidi niccoli
:zz ?<-]-« -f- 6
manganesii
oxidi
essent oxida
feni
u -f- a -f- 2 h, zinci u -\~ a -j- 3 b, cupri u 4- n -f- 46, chromii u-]-a-\-5h, antimonii u-i- a~\-gb, cobalti a
u-t-a-^ i5b, stanni u-\~ n-\~ i6b,
auri
titanii
u-^a-\-20b,
bismuthi
uianii t^-j-n-j-- 26,
u-]-a-\~2gb,
arsenici
+ a-f-146,
pLirini
u-\-a-\-ilb,
telluiii
u-f-a-l-246,
u -\-- n -~\- 32 b ,
plumbi
U-f-a-i-366, argent! u-|-a-f-386, molybdeni u-\-a-\-6/!\.b,
hydrargyri
u -\~ a -\- "job:
oxygenii,
et
ita
repraescntantibus
a, a-\-b etc.
pondéra
u quantitatem
ipsorum
metallorum,
compârata, ut pro quocunque acido eadem valeat pro-
portio inter u, a et
erit,
essent
quod
in
Ncmini quideni praetcr opinionem
systemate recens condilo non omnia statini
exactissime
subvenientibus
6.
determinata ,
expcrimentis ,
quod
varia
séries
latione
suas ,
novis
erncndatiorcs
rcddere conatus essct Rlchter, atquc quod numéros ex observationibus
desumtos
saepius
corrigendos
esse
duceret,
ut perfecte congruerent, quae propter errorcs in experiun-
6o3
do vix evitiindos discrepare
visa
per
adco
multiplicein
experientiam
siint
At
phaenomena.
conlnmata
ipsi
vide-
bantur sna enuntiata, ut novis intciea dctectis acidis, bametallis ceitius assignaret locum,
sibns aut
bus jam dcfinilis occtiparent ,
et alias
quem
in
substantias praesagiiet, quae vaciia snpplerent in
Observaverunt autem recentiores ,
intcrvalla.
hodiernam exactitudineni
chemicam
lysin
,
invenerimL eoinni haud pauca tantum
facta coricctione,
JLista
ex canssis
subsisteie
phaenomena
Gommunem
In
quod nonnisi
tur composita,
superflua
finem
citata repetentes
a
vero deviare, ut,
ctim neque iillnm ejus
adducti
fueiunt
opinionem,
satuiata, per affinitates cbemicas^ producerenet
quod
in
salium formatione vix ullus ex
acidi aut baseos parte oriretur effectus,
vergente seculo
practerlapso
tus,
nullibi adeo valere pronitatem
L.
mutuam
de novo
perscrutari studuerunt.
plerique
C.
tius
illo
qui experimentis
mus
ad
nondum ad
cognosceretur fundamentum, omnino
natiiralibiis
dcserendam esse judicaverunt ,
institutis
sericbns
nequaquam possit laudata
qnam proinde,
seriemm doctrina ;
iii
tempoie Richtcri pervenisse ana-
expérimenta ab
et
seiic-
adhuc detectum
BerthoIIct,
cum, ad
statuerez perspicacissi-
cgrcgia experimentorum série
duarum
substantiaruin
saturationem, ut prorsus inefficax
addita alterutrius quantitas, sed
suiTiil-
sit
abundan-
facnltatem substantiae
76^
6u4
cnlusciinqiie
tate
sccnm
iiliuni
non minus
quaiii
ab iidhibita sui quanti-'
li^tiiidi
ab
Ostenderc
(icpcndcrc.
alTinitate
conatus
est,
nuncjuani non cvcniie, quod antea quoqiie in-
tcrdum
alii
obst rvavcrant ,
ut
ad alterain piacdita, quam
teitia
totum sejungere non \aleat,
pia,
quam quae ad
formandum
alla
pcr
sibi
\'i
duobus
aliis
sibi
pro ratione et
dividatur.
stantias
Autumavit
affines
in
illa
corpora in
sub-
quaniiLatuin materiei agant,
ficri
vi
et
alias afiinitate
inaequaliter
affinitatis
altéra
afiinitatum
atque
vincat ,
addita
cum
cum singula
Itaque
semper debere, ut substantia
copiosius
longe majore addatur co-
mixiioncm applicata ,
propiiarum, et
sLinîiis
nisi
eidem prius sociata, hanc
coinposituin saturatum
nccessaria.
sit
majore affinitatc
substantia
affinibus
simul
corpus
expositum
utriusque inter ipsa
conjungi
proportionibus
superiores
unumquodque
ut
et quantitatis
igitur
sibi
duas
sub-
infinitis ,
nisi
posse
numéro
proptcr accedentes caussas percgiinas efficiatur, ut in data
aliqua proportione sociatae e contactu reliquarum partium
commixtarum subtrahantur.
Et hoc quidem
ex pluribus corporibus
communi menstruo liquide
lutis,
nonnulla
ita
in
fieii
,
qiioties
so-
comparata evadunt, ut aut vi calorici
praesentis formam obtineant aëream ,
aut cohaesionis viri-
bus obediendo, solidam acquirentia formam menstruum deserant, alios ut
taceam casus.
6o5
Novii
tcre
doctiina, qn.ie
Bcrthollcti
vidcb.itur
hucusque
iicccptJin
primo
fere
intuilii
siibver-,
omnibus theoiiam
chemic.num mullos nacta est adversarios. Asser-
affinitatem
lionem ejus de non limitatis substantiarum conJLinctionibus
conciliari
natuia
non posse piitaveiiint cum examinibus coipoiiun
vel arte compositoriim ,
constiuitivarum
pailiiim
portiones
invanatas
inaverunt ciystallisationes aliasque
oiiiindas
conditiones ,
plerumque pro-
ostendenlibiis.
Existi-
ex cohaesione niolecu-
quas BerthoUet
pro
impedi-
raentis habiiit,
quoininiis in qiiacunque propoitione
formen-
lur connnbia,
non
lariim
esse
caiissas
tiarum mutuae ad versantes,
peiegrinas actioni substan-
sed potius ipsariim ai'finitatum
Contendunt ergo hodieque plurimi, conjunctiones
elTectus.
substantiarum chemicas saepissime ea ratione fieri, ut mutua
succédât saturatio, et aberrationes ab hac régula, quae in
salibus, imperfectis olim,
tis,
rum
e. s.
p.
unoquoque
obveniunt ,
composito
termini, inter quos
vim
hodie acidis aut haiicis appella-
sulphuretis quibusdam, in
in
hujus
ita
oxidis
semper esse
constantes
pluiium metallodefinitas ,
intermediae frustra quaerantur.
argumenti
iit
in
reperiantur proportionum
infringere censuerunt
Neque
vulgarem ex-
perientiam de solutionibus corporiim, quae per gradus indefinitos
successive
distingvenda
esse
peraguntur ,
talia
cum perhibeant
phaenomena solutionum
a
sollicite
phacno-
6q6
menis pcr chemicas
productis,
nffinitdtfs
atque in conjiin-
ctionibus chemicis tum dcmuin paleic veiam pioportionem
cum
pailimii ,
ex
sit
corpus
compositum.
illis
explicationum
lias
facile
solvente sepaiatum
menstruo
a
novimiis ,
diversitatcs
verbis
in
fcre
propius considérantes
tantiim
in
re
ipsa
parum
dissentivi.
Ab
ut:raque
SLibstantiis
data
proportione inter se conjnnctis gigni pos-
sit
um
enim parte
compositum neutrum sive saturatum,
adsit
rius partis
uberioris ,
quod nimium
est,
vis
sibi
substantia
dubium
in
fuit^
indefmitae
perfccta
quod ex
quo aequilibri-
virium partes connectentium , quodque
ditione sociatae ulplurimum,
in
admittitur ,
hac con-
non obstante praesentia
alte-
a menstruo solvente décédant ,
cum
aut ab ipso menstruo aut ab alia quaaffini
retineatur.
Scd nemini unquam
quin a diversis menstruis non raro solvantur
quantitates plurium substantiarum.
et
Itaque
homogenca solutione concipei^ vix
cum
liceat
inaequalem partium solutarum distributionem, concedenduin
est,
substantias solutas saepius in proportionibus indetinitis
Gonjunctas
stantia
non
essse.
Si
differt,
ex.
dam cum sulphureto
ipsum mcnstruum
gr.
tibi
metalli
ab
altcrutra
sub-
sulphur aut metallum quod-
fusum
in
corpus homogene-
um coit, aut ubi duo metalla utcunquc commixta per fu-
6o7
sionem semper exhibent compositnm omnibas suis partibus
simillimum ,
inte-granlibtis
propoitione
data
stantiae
tiis
peregrino
consideranda
solutis
:
non
quamque baseos
sae additam ,
acido
et
eniin
suscipi
salis
cujusdam
quod
literque,
tiae
cae ,
,
in
per
gradus
affinitatis
solvi ,
chemicae, a toto
qua
suscipiatur.
major utcunque
Itaqiie
onini
neatri,
salva
sive
limpiditate liquoris,
baseos quantitas:
simi-
salinis
nonnullorum metal-
vel acidi nitri,
vel alius substan-
sucessive augeantur
oxidationes metalli-
sokitionibns
per vim aëris
oxygenatae ,
vi
solutioni acidi aquo-
chemicis tribtiendum est, qtiod so-
addi possit nova sive acidi,
lorum
quisqiiam negabit, tantillani
facile
quantitas
affinitatibus
iibi
modo quod tum
menstrui cum' substan-
afiinitas
atque
est ratio ,
alia
solutio ,
salinae qnantitatem
ejusdem
dubio
lutioni
veniat
pari ratione,
aqiia
determinala
sine
ferme
NeqLic
peragitiir
si
commix'tae fuissent snb-
neutialit^tis
conjungendae.
a menstrtio
simul
iiffi-
clTcmicaium oita fuisse hacccc conniibia, qnain
nitatiini
in
aprico est, non aliter vi
in
inter
minimum
et
maximum
infinitos,
quousqtie subJiac operatione uniformis et homogeneus maneat liquor.
Sed missa haec facimus ,
ut
ad propositum
redcamus , leges consideraturi , quibus determinatae inveniuntui compositorum partes.
6o8
Animadvertcmnt non
tem
acidis aut basicis paitem
salibus
in
aequalem esse
ejiisdem vel
pridem chemici ,
ita
cjuae saturationi
ei,
abundan-
saepius pioxime
inleidum veio
siifficit,
Observaverunt
multiplicem vel sesquiplicem.
quoqiic diveisa gasa non raio ea ratione potissimiim inter
unum vokimine sit alteii aeqiiale, vel lui-
se
conjungi, ut
jns
sesquiplex aut
multiplex,
atque
conciescendo
vel
piopoitione con-
liac
acream
perdant
juncta
tcncii ,
si
niain.
Solliciti
itaque, ut de liisce icbus générales inve-
nirent naturac loges, hodicrni
linunta.
sa
Inter
induslria ,
nuiltifaria
lies
celcbris. /. Berielius,
ad
cas
for-
instituerunt expe-
irnpen-
infatigabili
adductus est conclusiones: quod
in
oxidis singulorum metallorum, aliorumque coiporum inflam-
niabilium, quae phues admittunt oxidationis giadus, quan
titates
sint
apud
oxygcnii
quantitatis
magis
per
oxygenii,
oxidata
semper
multipliées
quam minima
efficitur
oxi-
datio ; proptereaque illae inter se scquantur rationem nu-
merorum
intf giorum,
minima
genii
:
quod
tinitate significetur
in
sabbus acidis pars acidi ad satu-
rdtiontm
basées
aut
alia
ejtisdem
pars
pro
date
acido ,
constans
(|Uod
in
tiplex
quant itas oxy-
ubi
necessaria
sit
aliquola
sit
aut
:
dimidia
quod
in
totius
acidi,
salibus neutris,
quantitas oxygenii
basées
:
salibus et neutris et acidis oxygeniuni acidi mul-
sit
oxygenii basées
:
et gcneratim ,
quod
in
corpo-
6o9
ribus ,
ex pliiribus substantiis oxidalis ,
gcniiini
sLibstantiae,
minimum
quae
oxy-
compositis ,
ejus liabet
pars
sit
,
aliquota oxygenii in singulis ceterarum.
Ciim de conditionibus substantiartim
tarum infra
fiisius
inquirere conabimiir,
inler se satiira-
jam
in
iis
separa-
tim considerandis nonnihil morabimur, quae binas substan-
proportione
tias
divcrsa
in
antecesstini
nionere
conjunctas
liceat ,
ctiamnum
vel
scientissime
voritatem
raro
non
vitia
non
piovisae
adminicula
ut
oportet,
captorum
fiant
quaesitatn
patefacta
sensuum ,
aliaeque
exquisitissima
quaeque
fallaciae
ne
Ob-
conclusiones omni ex parte naturae consoCorrectiones
consectarioiuni
hic
illic
facere
habeatur tentaminum variata ratione
constans
convenientia.
Sed natuia duce
correctiones necesse est, non sola
svadcnte phantàsia,
quae
Si
expeiimentis
aliquatenus infucatam exhibere.
circumstantiae ,
ad
ducant.
nas
phaenomena
instituas
instrumentornm ,
siant
Qnociica
lespiciunt.
et
repetitorum
acutissimum
cniin
quemque
observatorem
ambiguis nituntur argumentis ,
fallere
possit.
vel iiiductionibus
ex analogia indubiorum phacnomenorum non probabilibus,
ex
aliter
factis
aiit
si
uni
emendationibus
diversae
rationabiles conclusiones
Icx
se
ipsa
eirorum
:
in
experiundo
inevitabili-*
depromi possint non minus
ne dicam,
si
praesumta naturae
contradictionem involvat ^ salius certe
Mimoim de l'Acad. T. VI.
"î "?
erit
in
6io
lis
acquiescerez
qiuie
subldUs, quae
quaiii
ut
periclitari ,
incerta adliuc et dnbia sunt,
falsa
perpensis, palmaria
suggesserunt observât iones,
tiiidae
in
mendis
loca vcrorum substituantur.
His
quacdam conteplcmur phaenomena, ex
quibus sua depromserit Bcrzelius dogmata.
Exactissime
oxidum plunibi flavum
invenit
bus
continere
oxygenii.
In
comperit
90
in
institutis pluriesque
oxido
g2, l65
eodein
partes metalli et
plumbi
fusco
sui
pondcris parti-
metalli
et
7,
oxidi
plumbi
235
partes
rubri latere
10 partes oxygenii , atque
adcsse
86,51
partes
metalli
et
Propterea habebunt 100 partes plumbi
l3, 49 oxygenii.
spcum
pondère
experimenlis
lOO
in
partes
rcpilitis
sociatas
in oxido flavo
in
799 partes oxygenii
oxido rubro 11,111
7,
in oxido fusco i5, 594.
Si intermedio
horum numerorum addatur 0^587, et uliimo
0,004, prodeunt numeri 7,799; ii,698> 15,598, qui
rationem habent numerorum 1; li, 2, sive 2, 3, 4* ^I^s
proinde in
série
pioportionis arithmeticae constitutis accu-
ratius exprimi putavit quantitates oxygenii in diversis plum-
bi
oxidis.
duodsi vero ita
intermedio
sublrahatur
obtinentur
numeri
fiat
0,08,
corrcctio ,
et
ut ex numéro
ultimo addatur 0,004,
7^799; ii,o3i; 15,598, qui
in série
6ii
continuac propoitionis geomctiicac constituli sunt, rationeiu
scqucntes
numeroriiin
i,]/c, 2,
ad quain
quam
arithmcticam
lationem
accedimt numeri expeii-
nndo
ad
oxido nigro partes oxygenii
1 3,
in
oxido
albo
19, i3,
in
oxido
flavo
2", 2
addatur
jubente BerzcHo ,
1,27,
ilidem
convertuntur
habentcs
medio nonnisi 0,1
ut
1,
ita
6»
correcti ,
ut intermedio
i3,6; 20,4; 27,2, ratio-
in
numcroruni
1,1?, 2.
Si
vero inter-
prodeunt 13,63 19, 23; 27,2,
addatur,
sulphuris
loo sulphuris
oxido
in
acido sulphuroso
in
acido sulphurico
sidphuris
sccundum praeceptum
subtrahatur
expérimenta investigando
per
partes
in
nuraerorum
100
Y 2, 2.
Oxidationes
detexit,
invenit Berzelius,
in
qui numeri,
inter se
factis,
sccum conjtinctas habeic
partes hiijus metalli
Si j
propius^
ropcrti.
Experimentis cum stanno
nem
igitiir
secum tenere consociatas
partes oxygenii
47, 28,
—
lOO, 12,
Bcizeîii ,
1, 63 ,
149> "i^ab intermedio horuni
habentur
numeri 47, 28;
98,49; 149» 70, quantilates oxygenii accuratius indicaturi,
qui inter se sunt ut 1; 2,o83; 3, 166, sive fere ut 1,2,3.
77
*
6l6
vero patet,
Ciiivis
illi
aeque
qiiod
numeri , ut proporlioniiles
et quarto sciiei gcometiicae
Ex
liqnere
his
ita
coriigi
possint
terminis primo ,
fiant
tcilio
a,a^^a^.
i,
exiatimamus ,
certo cas indicavisse séries
ipsa
expérimenta non
numerorum, qnibus, secmidum
sententiam conveniant quantilates duarum substan-
Berzelil
diim
tiarum ,
pluribus
in
Qlio vero videamus ,
cepta
facile
theoiia ,
utrum ipsa
ponere
amantes societatem,
proportionibtis
licebit ,
sibi
conjunguntur.
conslare possit con-
duas substantias miituam
quae praeter illam proportionem qua
inutua succedit saturatio, in nonnullis quoque aliter deter-
coeunt ,
minatis
conditione
ea
inter se
semper conjungi,
lit,
data alterius quantitate, exprimantur quantitates alte-
ïius
per termines
Sint
gredientis.
stantia
B
sériel
secuiidum constantem legem pro-
quantitates ipsius
A quae cum data sub-
quidam ex terminis yi
conjungi possunt ,
a /J,
,
cAt dA, etc, erunt conscquenter quantitates ipsius
B, quae cum data A conjungantur, correspondentes termini
h A,
seriei B,
-|,
y, —,
-j
etc.
Quia vero ex hypothesi con-
stans est serierura lex, eadem erit natura seriei i,o,6,c,detc.
atque
seriei -^,
y, y, y,
Ambarum
l.
itaque
termini
non possunt oïdinem proportionis aritlimeticae sequi
enim
csset
adeoque
i-f-dz^a-f-c;
a -{- c
— imc —
simulque y-f-irziy
i ;
et
:
tum
+ y;
ami::z;bzzciz;d;
6i3
quod
indicaret
niilluni
propoilione A: B.
harmonia
Aderit
cum
le^is ,
fieri
conjiincdonem
aiitein
efficerent
tiim
nisi
în
unica
demum universalis
qnaiititales SLibstantiae
A
cum data B conjungendae termines sciiei AjiA,n'A,n^An*A
simulac qiiantitates substantiae B cum data A conJLingendae
repiaesentarentiir
Commemoravit
qno
se
per B,
n~'B, n~"' B, n~^ B^ n"'* B.
Berzelius ordincm progression is ariihmeticae,
invicem sequi videntar quantitates acidi in salibus
pariterqne oxygenii in oxidis, non similiter convenire quan-
oxidatis
:
aut
radicalkim
de
pioportionibus
gcometricis
corporibus
:
videttir
apertum
enim
termines progressionis geometricae ab unitate ascenden-
do non omnino deinceps numeratos ex.
adeo
dilïerre
numeris
a
in
série
differunt correspondentes termini
vis
in
qna observatione corroborata adluic esse
hypothesis
est,
salinarum
basiiim
titatibus
hypothesis
gr.
arithmelica
i,n
',
n
«, «'
non
locatis ,
ac
i,
^.
progressionum geometricarum eo
Sed quam<;ese
com-
mendare videatur, quod proxime congiuat cum allatis oxidationum plumbi, stanni et sulphuris phaenomenis, in ea-
dem tamen inculcanda
enim
minime
cur
in nonnullis
cunque
aliis
rum^ non
persistere
disLinctam
non audemus.
Usquequo
habemus cognitionem caussarura,
proportionibus libentius
quam
in
quibus-
succédant conjunctiones chemicae substantia-
suiïicere
censeraus pauca hucusque instiuita ex-
6i4
pfuinuntu
deccrnendiim ,
ad
cadcm ubique, a^t
utniiii
in
plurimis casibus valeat qaantitatum ratio, anne pro diversitate
subsiantiarum oninimode haçc
Ad
verunt pluiimas
nem duceie
flammabilia,
lia
sabstantias
maxime
inter se
Obseiva-
affines
oiii;i-
illa-
Compererunt poiro, coipora
in-
quorum combustione natae substantiae ad
sa-
appellatis.
formanda aptae sunt, ipsa qnoque ad societates ineunapta
das
esse
:
immo
saepius evenire,
ut ea proporti'one
secum invicem potissimum conjungantur
qua
radicalia,
in
neutrOi ex productis per combustionem illorum acido
sale
et generatim,
atque basi formato, sociata latent:
bus
sive neutris,
periri
radicalium
sive acidis aut basicis eas non
quod
in
tatum
inter
Ad
cipua
in
sali-
raro
re-
proportiones, quibus ipsa radicalia nuda
firmissime inter se connecti
videntur.
llinc probabile fuit,
radicalibus inflammabilibus lateant caussae affini-
lias
partes salium constitutivas.
alTcctiones
investigandas
conjunctionum phaenomena,
caloiis
nunquam
formas capiunt.
fere
non
consideremus
quae
flammabilibus maxime conspicua sunt.
rac
spes.
hodi-
inflammabilibus radicaliuus
corpoiibus
e
pioinde
riim
ilkistianda
satiirationis
nova suborta esse videtnr
chemicis
ernis
plenae
pliaenomeha
variabilis.
sit
sentitur,
in
prae-
corporibus in-
Mutatio temperatuubi corpora novas
Frigos qxiidein oboriri visum
est,
quando
1
6i5
corpoia
solida
liquida,
in
vel hacc in acrifoiinia veitun-
calor e contrario, ctim ad
tiir ;
Tiim
cresciint.
patuit ,
ciiin
praeserlim
intei
majorem cohaerentiam con-
caloris
augmenlurn
sensibilis
conJLingerenUir substanlîac adco di-
se
versae, ut suas invicein proprietates quasi dcstruerenc, at-
mixtoruin proportione connubium omni-
que ubi ex daia
satuiatum
orirctur.
phaenomenon
ignis,
niodc
fuit
mabilium
ci
ex
duduin
Exislimaverunt pridem physi-
vel ignem
calorico in corporibus antea
horum
tes
scnsibilcm
vcro
sub combustione corporum inllam-
aère producti.
in
calorem
,
Luculentissimum
ita
patefactum prodirc
quod ,
latente,
capacitate, libcrurn évadât
:
diminuta
diniinui vero capacita-
corporum pro calorico, quoties per conjunctiones secuin
aut ex qnacunque alia caussa concretiorcm sus-
invicem ,
cipiant forniam.
Sic ignem sub combustione corporum in-
flammabilium
aère,
vitalis ,
qui
corporibus
vero
Quae
,
hodie
oriri
tenens
judicaverunt ex calorico aeris
elasticam
prae omnibus fere
gaudere capacitate calorici ,
concrescens
cum in-
multum ejusdem perdere
interpretatio ne antea
observationibus
sona
lum
formam
maxima
jlammabilibus
vidcbatur.
in
quidem
satis
con-
auctarum vel imminutarum densita-
minime quadrare
ccnsetui"
cum phaenomenis
ignis,
sub conjunctione nonnulloium metallorum
phure
aliis\ e
cum sul-
corporibus inflammabilibus orti, qui velienien-
6i6
lia
non cedit
tra
illiim
igni
modnm
explicandi
phacnomena
détecta
cens
per combustioncs producto.
Q."in con-
aperte ptignare videntur re-
ex qua
respirationis ,
calorern
physici.
Cum
enim observaient, aërem vitalem respiratu animalis
in aci-
animaliam
derivatum
vitalem
habiierunt
dum carbonicum converti, concluserunt calorern animaliiim
ortiim
similiter
nuper
a
lentiore aeris et carbonii
atque vulgo ignis oritur a rapidiore
sangvinis mutatione ,
carbonum
diicere
suiiin
Sed ex expoimentis
deflagratione.
a
cel.
Dro-
non pos-
Anglia
factis
evictiim
se, per respirationem
arte
effectam, calorern animalis, ve-
die
in
adëo
nenis
sopiti ,
hoc
quamvis
ut
vitales
siistineri
cessarent functiones,
ejus
aeqnalis
et
artificio
est,
aeris
vitalis
quantitas
consiimeretur, et aeqLialis obtineretur acidi caibonici copia,
ac
vigente
in
animali ,
tempore spiritum duxit.
mus
quam ex mera
eodem
Hinc indubitate patere existima-
conjunctione carbonii
vitalis
oriri.
Et
quod
neque
alibi
respecta
vires naturales
sub combustione carbonum ex alia caussa,
calorem
,
quod per
calorici
sic
ad
fuîeni
cum
substantia aeris
maxime pronum habemus,
ex mutata solum capacitate corporuni
originem
ducant pîurima
calons
phae-
Qomena.
Omnia vero svadent,
denominatas
in
ut crrdamus vires ab elcctricitate
conjunctionibus chemicis activas esse,
lia-
6i7
mm
duae
sensibus
sesc
ofTcne soient
nostris
sibi
tntilLiO
oppositae, se inviceni appetenles, quac per conlliclum
se
ter
ji^nis
interire
vol caloiis })rodncaUir.
kicidi,
Comparent
corpoium ,
\arioiTnn
supcificies
fiicentur
ubi
formae
miitationes
tari
docuerunt expérimenta
tum
est ,
Ex
se prodete
in
ea metalli
concludeie licebit,
occultatas in corporibus
vires, qcuie
varia ratione patefieri pos-
tum vel immutatam electricam indolem de-
vel inter se conil^gendo caloiis aut ignis pbaeIlinc
commenclat sententia
,
in
subcant corpoia
ex ad verso posita appa-
in
nomcnj exhibcant.
liuin
affines,
superficie
atîectio
bis
atque
nionsLrent,
maxime
quae metallicam perdit faciem, simulac opposita
latere clcctricitatis
sint ,
niutuuw
^alvanica dicta , quibus evic-
,
alteram electricitatem
electricitntis
reat.
densitatis
ubi
Sub oxidationibus melalloiLim easdcui exci-
quacciHique.
superficie,
ac
illae
ad
ubi
contactiim admittantur siibstantiae inter se
aut
in-
phacnomenon. ]iicis, vel
videntiir, sinuilac
quoque magna probabilitate sese
quod
et
ignis
acre ardentintn, et
is,
qui
sub mutua liorum con-
cum
siilphuie confunduntur,
jiinctionc,
ubi ex. gr.
crumpit ,
[).iriierque
nicnalla
corporum infîammabi»
caloricum sub comniixtione acidorum
cum
basibus salinis,
aliis
corporum consociationibus obscrvatum ,
ex concursu
oppositarum nascanUir.
ex duplici
cl. rtricitalum
Mûroirrs ,i: l'Ac.i.i.
cu/ii
T.n.
aqua, alkohole
Si
etc.,
vero
"^
atqnc sub
simul agrnte caussa succédèrent ,
si
non omncs
saltem coipoium conjunctionos chciiiicae ,
ipsorum corpoiiini ,
,
plurimac
nltcia
affiniiatis
coliaeicant copiilata ,
qtia
altéra ,
sese mutLio pétant patefactae clectricitalis vires,
forma
ignis \cl
lium abeant.
e
sinu
snbstantianim
paullo
aitius
nobis
calorici
Scd
"videntur combustionLim
Innotiiit
qua
cum sub
ponderabi-
perseqtienda
esse
phacnomena.
jamdudum ,
pliirima corpora inflammabilia in
aère ad igneni alendiim apto,
qtiem gas oxygcnium hodie
vocant, ardentia, ipsum aerem e^aslicitate privatum secum
conjungere ,
Cum
pere.
adeoqne ex toto «jus pondeie incrementa casimilis
mutatio
corporis
inflammabilis
fieri,
idemque huic accedere augmentum ponderis observaretur,
"ubi
combustio per alias substantias antea
ustas
tur,
putaverunt chcmici, post traditum
ab
voisier
phaenomena
ista
sibi
perficere-
illustri
La-
interpretandi praeceptum , adjungi
sub omni ustione corporibus inflamniabilibus substantiam sibi semper similcm ,
quam oxygenium nominaverunt
,
ipsa
eorpora usta, communi cognomine oxidatonim ab inflammabilibus distingucntcs.
sed
et
Ilanc theoriam non confirmatam modo,
cgregie illustratam
nis illorum inflamirfabilium ,
esse ccnsuerunt
ex phaenome-
quae per aquam
dari vidcbantur, quia indubitala jam
ptiram oxi-
nemini ftrc non eva-
6ig
sit
doctiina de aqnae natura.
Ctim
nquam ex gasibus oxygcnii
ret ,
atque
produci ,
accensis
conipaicrc,
carum
horum gasium pondère
totoqne
conveiti posse ,
ista
quod aqua
gasium oxygenii
liydrogenii 'composita.
electri-
demonstratum
certius
esse jiidicaveiunt ,
et
pâte*»
hydrogenii commixtis
eandcmque iteium per actioncs virium
gasa
in
et
enim evidentejr
substantia ex elementis
sit
Rem vero ex
integro méditantes, ne temeritatls contrahere videamiir cul-
pam
sententiae ab univeisis fcre chemicis hodie adopta-
!
eam neque
t<w non
possLimus
veisitates
corporum oxidatorum bene convenire, neque ciim
aquiie
ipsis
non adversari ,
cuni
in
di-
phaenomenis omnino congiuere existimemus.
Noviiiuis
aëiem
vitalem,
sive
gas oxygenium
titplii-
rimiim smuil ciim gase
hydiogenio ex aqua
tatem agicaUi prodire
non vero scmper ex eadem aquae
particuîa, sed,
notabili
simul
lioc
ut evidenler docuit cel.
distantia
agcnlium
Proptcrea ,
nisi
:
neque vi
dissitis ,
oppositis
per electiici-
Rittcr,
sed
duarum
viribus
formari.
unius,
clectricitatum
ex diversis
pracjudicata alia copiamur
opinione ,
ex
phaenomeno persuasum habemus, aquam non per che-
niicjin
analysin in gasa
siones divcrsimode
capite
explicabilur
illa
lesolvi,
modificatam
ficri.
phaenomenon
sed per novjs acces-
Neque
intcrdum
facile
ex alio
obscrvalum,
78*
qnod non utmmqnc
vim
sinuil
gas^
ex aqna
electricitatis
tilterutrnm tanfirm pef
sc-d
Itaque
eliceretur.
a^ifinde probdbile sir, pondeiabilem
aqnae sdhstantiam ex
partibus diversi generis compositam esse,
consentanea
interprétât io ,
erit
hydrogcnrum
ex
cum nequc
quod
maxime
veiilali
gas oxygcniuni et
çt
elemento
aquae
per diveisas tlectricitates transformato constitiiantm-.
Qnod
gas
si
mentnm
])artcm,
ponderis
ponderabili
subslantiam
veio admittatcu" ,
gasis oxygcnii
unico
in
aquae esse ponderahilem
confesso etiani erit,
corporibns
inflanimabilibus
omne augper
combci-
stionem additnm, tinico deberi principio aqueo. Vix aritem est
crcdibile,
quod contrariae alTectiones, quas di\'ersa saepius,
ncc raro eadeni acquiriint ladicalia,
ses
salium convertuntur ab iinica
invariati oriantnr.
bases salium
per
dum in acida aut bacanssa
additi oxygenii
Constat namqtie inter oinnes, acida et
oppositas vires electricas
quo
in
rata
ad primitivam indolem
nexu
salibus neutris conjuncta tenebantiir ,
restaurari.
cuum est , diversam eorum naturam ,
et
liberari,
sic
Ex quo
sepa-
perspi-
saltem ubi vinculis
liberata sunt mutuis, electricitati utrique prapriae tribucn-
âam esse.
Neqcie obscurum
erit,
electricilatcm acidis con-
\enientem eam esse ,
quac aquae principium
genium conveitat ,
illam
elcctricitatem ,
et
quae cum
in
gas oxy-
e contrario basibus conipcteie
eodcm gas progignat liydroge-
62 t
sinm
osfendeiint expérimenta
siqnidem
:
paites corpoiis cujusciincjtie acidae
tis
sit,
contr.iliaiiltir,
veniant ,
qnodl
oxvi^f niiiin piodiici pos-
s^as
i^itnr
electiicitate
adsci<;cant alia
forma m
,
liy-
quae par
inllammabia ,
corpoia
principium aqnae
acquiiunt naturam acidi ,
combtislioneni
scos induunt
aqua nascatur gas
ex
scilicct
iibi
Cuni
droi;enium.
sibi
iiqcia
elrctrica ,
pcr vini clectricita-
vrio saliiim in o[)po=i(o appaiatus loco in con-
bases
specmm
ex
tibi
ibi
niodificatam ,
omniinode variabilis
ac qiiae basubstantia,-
ciit
qnae diversas elTicii oxidationes, et fortasse ne eadeni quidcni
in
acidis vel .ba^ibus
Propterea
tis.
ac in
Jihcris
nccitie
nomen, utpote quo substantia
elemcntirm
ejus in
tuere
aeris
scilicet
qna
ccnsemus ex acre
lium residuas,
se coptila-
inter
certis
vitalis
oxygenii
dcfmita characteribus,
Itaque loco
signilicetirr.
denominationem halomeleogenil snbsti-
seqiientibiis
Toluimiis ,
iisrdein
ridem convenire videtur
substantias
vitali
et
aqua
qnarnin efîicacia
non
in
improprie
acidis
progenita
indicari
et
basibus sa-
sint
praecipua
haecce mcmhra, sive coostitutivae salium partes.
ITis
praemissfs
affinitalmn,
quae,
initiam
,
si
facere aggrediemnr thcoriae
nondiim fumis probetur argiimentis,
neve fiilcicnle experientia hodierna ad praecipua saturationis
pliaenoniena plene explicanda sufficiat, iis tamen, quae hue-
622
nobis saltem
asqiie détecta
sunt,
neque plane
dîlTcict
terdum adumbratiin
niutuo
Ponimcis phaenomenon ignis
indicatis.
itidemque
obviis,
liiim
collisu
vel
caloiici
siibstantiiic,
occultatas,
ex leviore haiiim
caloiiciim
ad
alio
vi-
in verso
ordine ex dissoliitione ignis
obtineri
diias
si
electiicilates ,
quae alterutram
corpoia
quae
in
complecti
partini
elcctiicitates plus
nonnunqiiam,
conducendum aptas
modo
adsint
Po-
sinu suscipere ament.
admotis
corporibus, conspectui nobis offeruntur,
se
motis , et sibi
libcie
atqtie
:
cuncta
nimus'
reputationibus aliorum antehac in-
a
ex oppositis electiicitatibus
pioduci
non repugnabit,
cognitis
aulTeiri
vero esse bas electiicitatutn jacturas,
sibi
minus
nuUuo
et par substantias
videntur: instabiles
quae, quamdiu non
aliam subeant corpora mutationem, ex vicinis vcl calorico
vel
tur.
libère
electiicitatibus
obenantibus continue lesarciun-
Ponimus pono, corpora, per conjunctiones sccum
vicem, mutata, pcrdidisse partem propriaruin
tamen
residuas
habere
adluic
in-
electricitatiiin,
electiicitates tenacius
sibi
adhaerentes, quibus ad mutnain tctcndcriint socictateiu; cl
proplerea
duas
substantias
catenus
intcr
se
affines
cssc,
quatenus in s>nu foveant clectricitatcs oppositas, casdeinque
se
mLituo satcnare,
citâtes
cum ptrfcclum
acquilibrium.
hydrogenii
In
commixloruni
obtincatur inter elcctri-
combusîione
liacc
i^asiuni
acqaaliui:>
oxygenii et
viiiuiii
evidenter
I
623
obtingere
videtiir
poriigentes
electricitatibus ,
subsuinticim ,
piodacunt
liquidaiii.
CK.'dcndi ,
quod
(iivfjsae
sese
siniilcm
utrinque
dcstriiendo ,
aqiiam
f|(iae
mutuo
Et cnin nulla nobis data
aliter
sit
occasio
rlTcctac sint electricitatcs ,
quibiis
ponimns dcniqne,
copulanicii- substantiae ;
quod
ex eadtm data proportione e]cctricitatum oppositarum ae-
semper oiiatur
quilibiitim
veio
Qciia
in
nominatis ,
tura,
et
iistis,
inde,
paiitcr ac
secum
quod
et
in
modo
gasibus
sociatum
habeant
ex diveisa liarum na-
ex rccipiocis earundem quanîitatibus determinata
acidi
et
bascos
Expeiimentis compertum
neutre.
coipora conjungentes.
\ire.s
piincipinrn
patebit
halomcleogenia
sint
7,5
coipoiibiis
aqiiae
tKcliicilatos,
inter
circitcr
in
quocunque
sale
quod ex data aqua
est,
partes ab altéra elcctricitate in gas
oxygenium
conve;tantur, siinul ac una ejusdem pars per alteram electricitatcm
gns hydrôgenium transformetur,
in
cissim
duo haecce gasa,
inter
se
aquam
rea ,
commixta
per
8,5
ponderis
parliuni
acidi
cujusdam
basin
a
mera
gasis
opposita
ab
illi
scqueretur,
radicale
accensa ,
vis
dependerct
quod
acidi
in
sale
augmcnluni
quod
proportione ponderum
pinam
si
basées
et
in
et
oxygenii
combustionem
redcant.
secum
gasis
i,
in
Propte-
conjungendi
electiicitate ^
elcctricitate
7,5:
vi-
et
vis
hydrogenii,
ncutro ex his partibus producto
sui
ponderis
haberet
ex 7,5
6c4
dum
partibus ,
-oxygenii
in
pondeiis rz i.
augmentum
Si
nient
et
ex
et
quod
dcfinicnda,
autcm
acido et in
et
in
ex hydrogenio aucta pondéra,
ad saluiaiionem necessaiia inde
propoitio
orietur
alia
et
hydrogenio
utrobique consideianda ve-
basi mixtae sint electricitatcs,
oxygenio
delitescat ex
b^isi
acido atque basi simul adesse debeant
in
7,5 partes oxygenii versus unam Iiydrogenii partera.
Vice
cujuscunque
partes
salis
quibus
adaucta
quam
singulis
elcctricitas
::!::
S- -\}ii
quod praeler lulomeleogenia
)i
acido
in
tani
nihil
proportio
electricitatum opposiia-
oxygenio
/•
et
iKidi
=z /'S- --4- -.^0,
bdscos
pondéra oxygcnii,
pondus
S-,
Iitîlomelcogcniuiii
Sit
(|).
per
propria
et
ii,s
pondé-
in
acido,
halonieleogenii
pondus Ii.ilonulcogcnii in basi. Ralioneni ;» -h // :/"-f s
per
analyses
esse
(ItiLiin
izzii: i.
et hydiogeniuiii ,
:
sit
m et
m -j-
quae
ziz c
radicaliuni
halonieleogcniuin
et
hvdrogenii ;
et r -i- s
incremcntis,
posito
electricitas
repraesenlanlibus
ra
cognitis
pondéra
hvdrogenii per
n (p ,
et
,
sunt
partibus
Signetur
îum.
neutii
inter
per computaiiononi invenire licebit, quae
accesscrit ,
ipsis
in
basi ,
in
ex explorata proportione
versa ,
qnoqiie
d ,
quae
chruiicas
deterii:inari
possit ,
poniiiuis
Sitque ratio constans inter oxygcnium
ad
aequiiibriuin
c-v
liypoiliesi
el( cti icilatum
ncutrai.'talis
in
necessaiia
sale
eiit
625
m
H- J'.
]iùquc in~i-r .d^^n-hS .c; et m-+-nzr: a .r-h s.
Inde htibcnuis
w.n^zac .y— s — ycl-hCs:ad^r~hs-hdr — cSf
?;/ -f- r : ;;
)
et
Tarn
:
m -+- n c — a. d ni — c n m -{- n d -\-
s zr.
:
dm
(t
.
—
c n.
vero in omnibus accuratiiis cxaminatis salibus neuuis
eam detectam habent chemici uniformitaterrij ut singularuin
datum quodcunque acidum saturantium, aequalia
basium,
sint
halomeleogenia.
tes
sint
Itaquc
cuni
m et n, pro omnibus
modo
non
constans
ne; —
erit
>•
-}-
dato acido constan-
in
idem saturantibus basibus,
et constans ratio
6"
a:i, sed
constantes quoque eiunt r, s et rationes m.S—nn—m~h^r:n-i-S—c:d.
d
c
m -L- « nz:
'
>
rr:
;-rr
c a
'
c:
m -\- n m
:
z::z
a
.
c^
:
n ziz a
.
c~
r -{- s
:
r :zz c^
-^ s
:
s
m -\- n
r
=z c''
—
—
genium
baseos
n
1
r= c
erit
c/;
:
d-
d-
c*
.
-
cd
:
c . ac
c
c
.
c
n
.
>
,
et pioindc
i
-, :
a a '
.
~ — ar
a
^
—d
— ad
:d
— ad
id.ac —
:
rn
y
d-
ci
;
',
;
;
:
n rz o,
r zno,
puium oxygenium,
acidi erit
h. e.
halomeleo-
et
halomeleogenium
o.
h. e.
purum hydrogenium.
Si a
erit
:
d-
—
— d*
ubi sequentes apparent casus
Si
—
—ce—
—
ar
c- ar -4- a i- r
c- rrl -i~ n.
,
c- s~i-d^r
d r
'
:
l
z=i d
:
c;
erit
m rz o, s
ziz.
oxygenium
totum apud basin et hydrogenium apud acidum.
Mémoirei de r Acatl.
T .71,
"'9
.
626
n:
Si
a
rz: c c d
dcijudlc
i;onlincbit
Si
i
:
c- -f-
:
;n rr n.
ciit
pondus oxygenii
zn c- -\- cl-
i
d^;
:
2 cd ;
h.
liydiogcnii.
et
r ^n s.
eiit
acidiim
e.
h.
c.
pondéra
o-wgenii et hydiogcnii pencs basin aequalia.
a ::iz
Si
i ;
erit
haloincleogenia in
Sabstitutis
i;
et
habemus
pio
m =: r, et n m s. h. c.
acido atque
c
;u -)- n
et
rz a
/2m7,5— a; r-f-jm 55,25
m-i^nziza;
;
.
posilis
sis
rationibus a:i, sequentes
Siniz:7,5^.
eiit
55, 25 ;
rzr: 7,5
Et
/•
snpra
\aloribus
d
4- j
sliiiilia
ciunt-
indicatis
7,5
bcîsi.
m
1 ,
.
/«m 7, 5. a. 7, 5 — j>
7>5
— n; szn 1,5 .a — i.
exliibcntur
p»ro
valoies quantitatum
diver-
i]i,)i,r,s:
w/:=z7,5oo; /?-- 0,000; rzzOjOOOj.fzn 1,000.
— »2=i:6,99i; /zrzOjOOp; rizio,o68; J'=:o,932.
— ;kzz6,482; nrr 0,018; rzno, i36;6"i:zo,364.
ajzii,
n— 6,5
— ;;2r=5,973; /?zz:o,027; /•-j=:Oj204;«y — 0,796.
— m-:z5,464; ;zzi:o,o36; ri:=o,C7 1; j':z:o,729.
a:zi5,5
— mzr4,955; ;in:o,o45; rzr:Oj339;j — 0,661.
n:r:5,
(/— 4,5
— ;;;=r4,446; ?irz:o,o54j ;-:iio,4o7;^zzo,593.
— «2—3,937; 22zz:o,o63; r:=iO,475;jrzo,525.
a~4,
flzz3,S 7, — »/zz3,75o; 22ZZO.067; /i=io,5oo;^z=o,5oo.
— w/zr:3,43o; )i:=z 0,072; r zz: o,5 s =:zo,/^5 ~
fl-.3,5
—
az^S,
m — 2,919; ;jrz 0,081; — 0,61 i;j'rzo,389.
az=z6,
1
J].3;
;•
:i_::2,5
— «iiz:2,^iOj /2zz:0^09o; r:=z 0,6 79; =0,321.
J-
<
62 7
Siacrrc,
eiit
m— 1,900; n — o, loo; rzr o,747;,rr:=0,2 53.
— inr=:i,l9 1; ;i=ro, 109; r ^:zo,8 14;^ 0,1 85.
— 7n— 0,882; nzro, 18;
ai=:l,
0,882; ^:::i:o, 18.
—
«—0^75, — ;n 0,628; Jirro,i22;rr:io,9i6;^ — 0,084.
— wi — 0,373; ur=:0,l2 7;r^=:o,95o;j'iz;0,o5o.
«—0,5,
a— 0.262, — ^11— 0,1 3 1; >i--=0, 3 ;rr=:o,983;jmo,oi7.
— 7wr=o,i 18; mO, 32; r := 0,984; ^=1 0,0 6.
/iz=:o,2 5
c.r:o,i33, — wrzOjOOO; H:r:o,i3 3;/"^^0,ouo;s.^O,000.
ar3i,5
r:^
r::=:
l
i
/î
Secimdum theoriam
bus nentiis
in
acidis
erit
a: i,
ratio
oinnibus basibi.s r -\- s ,
dcbent esse
ni -f- n.
1
nisi
acidoium convenicntia.
ticuni ,
in
diversis
sint
in
omnibus acidis
,
aeqiialia
acidis,
quae da-
halomeleogenia
,
per
m H- n
Et nos aegerrime conficeremus negotium
interpreiandi ,
iiinotuit,
aeqtiales
Non itaque semper erunt aug-
menta haecce ipsa acidoium
sibus
in
in sali-
halomeleogenioinm
Ar observavemnt chemici
tam saturaie valent basin
rem
invariata
,
CLim
aequales eti.im
non esse augmenta radicalium
nobis signiHcata.
1
qtiantitdtis
Propteica
basibus.
et
1
quam tnemnr
,
l
subsidio esset
indubitata pluriuin
Ex fidissimis hodiernorum
analy-
nonnulla salium neutrorum acida, ut mutia-
caihonicum, pliosphpricum, arscnicicum, aceticum,
etc.
sua
aucta
,
habere
radicalia
quam proxime
respeciu inciementi quo in iisdem
(îuplo
pondère
salibus gaudent
79*
62^
Conipeituin
jadicalia
basium.
rationcni
inciementoiuiii
akcmm
baseos ab
esse'
ubi allciuin locnni tenct aci-
,
Addimus
saturatae.
illo
nonnuUa
niissime cohaereant
candem
est ,
conjiinciionibus nuituis divorso-
in
inm oxidoiuni melallicorum
di
insiipcr
,
qiiod
fii-
ca pioporlionc con-
nietalla
juncta, ut per justam oxidalioncm alterum pondère duplo
magis qnam alterum increscere
sit
connubio oxidorum
in
ratio,
parilis
siquidem mrtallorum inter
inflammabilmni conjiinctiones
ut et alioruin corporuin
se ,
Quapropter
possit.
qmbus oxida
dependeant
viribiis ,
nectantur ,
(juamvis
illis
substantia.
Ex his itaque obser\atis colligiinus proportio-
ab
iisdetn
in
in
acidis
pcrfccte saturatoruni esse
iit
2
ad
atque
i,
oxygenii ad bydrogenium in acidis,
et in
3:1.
rum
,
basibus,
sive
r:s,
quae
a
major
aut
sive
747:253,
ni
minor
quod ex
alia
radicalicim ex
ipsis
accesserit
se-
:
n
lU.
19: 1,
scu proxime ut
mcinoratis ablndere visa snnt ,
quam quae oxygenio
saliuin
esse pioporlionem
Sic nobis probabile est, divorsitatcs illorum
quod vcl sub oxidatione
aut
ut
basibus
et conscqnenler,
cundiim computationem modo allatam ,
con-
pondcrosa aqtiac
desideretiir
nem halomeleogenionim
coruin
acido-
inde vcnire,
arre vitali et igné
electricitatis
copia,
et hydrogenio eorum conveniat, vel
caussa in ipsis
aiit
adsit uberior substantiae
aqueae quantitas, affinitatem acidis propriam
inclVicax,
aut
i
629
lialomclcogenio
dosit
ex aqua pondus.
nccessaiium
Non-
nulla coiLiin singulatim considerabimus.
j^cicliim
suJphuricum in salibus
neiitiis
basibns conjiinctiim esse repeiitur, ut
ejus
Si
ul)i(juo
banc
triplo
icHionem
sit
majus
habercnt
n =^
phatuin, essor
?«
non
conditioni
convcnit
:
aqiiae
in
i
formatione
basi.
halo/neleogenia
sul-
8 i, et r :j:=6i 1
basium
in
:
389 ; quod
At
salibus.
aliis
salium
sed
Novimus
incfficacis.
sic
laterc
constat,
ytàxs
in
generari
in
omni acido sulphurico
sal
babilc
quidem
praeter
oxygenium
sit ,
neutrum
omnem
hydiogenium
dente omnimoda ceteroquin
ubi
transierit.
hac via
et
acidum sulpiui-
in
libero
est
in
sul-
cum
aquam, cu-
basi
quadam
Cum vero ne proabire
aquam ,
quae
acido haereat, sva-
similitudine inter sulphuricum
et jduia a lia acida, suniimus substantiam, qua in
do aucrum
enini
Ex aliis quoque experimentis saLÏs
inde lacile fugari potest ,
conjunctum
in
sulphuris, in
sui,
quod nonnisi juvantibus aquae vaporibus
,
pluuicum convertitur.
jus
:
radicalis
in
acidum per combustion'eni radicalis
aère sicco non produci ,
rosum
se
cum
radicalis
non ambigua apparent indicia praesentis
acido sulphutico
]ioccc
29 9
augmentum
augmente
inter
ea ralione
sulphuris pondus ,
in
ligato
hoc
aci-
nunquam non
residuam, compositam esse ex halomelcogenio, quod pon-
630
dcrc bis snpcret halomeleogenia basiiim in salibus
quae
aqu.i,
et
au^mrnti pditein
ciiciter
teilicuii
In salibus neiuris per acidum nitncum
a
efficidt.
formatis
magis
visa
est
pondenim
Sed fateamnr opoitet, qiiod nondum
salis
ad amus-
ccteroinm
lege
ratio.
neiitris
sim explorata
acidoiiini
A tcmpore praecla-
hnjus acidi natura.
sit
rorum Cavendish
dcflecterc
et Lauoisicr
nolissimum
quod acidiim
est,
nitricLim generetur ex azoto et oxygcnio, quod veto diffe-
pliaenomenon
rat
hiijus
phaenomcnis
forniationis a
quac
,
corportim combiistioncs in gase oxygcnio comitan-
alioniin
Inde praesumsernnt plmes cheniici, azolum non esse
lur.
primitivuni acidi nitiici radicale, sed potius oxidcim quod-
dam
per
que veio
an.ab
inferiorem
radicali ,
alla
ustionis
iitmm
quaqciam
a
gradum
caibonio ,
jam cognita
exortum.
antea
A
an ab hydrogcnio,
substanlia
inflammabili
Oiîginem eluceret, incerli et inter se disscntientes fucrunt,
(isqcie
qao ex
tescerct,
nondum
vi
elecLiicis
[)hiios
experimenlis celebiis
substantias ,
quae per analysin chemicam
poterant, et praecipue
dividi
cleciiicitaLis
in
corpora
quidem alkalia
inflamnicibilia
metallis
quorum ustionem iteium sub
converti,
per
prodcant.
Ilaec enim expérimenta
que extendeient Berzclius
Davy inno-
et Pontin
cam quoquc reduci ad naturam
cum
piistina
fixa,
similia
forma
répétèrent latius-
compereriint ammonia-
substantiae
inflammabilis,
I
1
63
metallis
liane pro
nominc auumm'ù
(ia,
orii^ineiiî
(jiio
CLim
quam
in
sociato
coniposita
qiiacnnqiic alia basi
Quae vero
prao^terca
cum nonditm
et
déterminai e
conabimur ex analysi
azoïi ,
cognoscilni.
clïicerc
sit
diverte
ammoniacae
a
5o^86
coinpositio
enii potuerit,
à
partibtis acidi muriaîici et 3l.v95
,
erit
leogenkim 31,95 partium ammoniacae dimidiLim
Fer investigatiofies ab Henry et
ve
z=z
tas
detectiim habemiis,
quod
8 1,833 partes
gcnii.
Propterea latebiint
26,146
partes
azoti
et
Gonditio nonnihil mutata
parrem
vidc-
mmiatis an^moniacae
2^,g6 halomeleogenii
muriatici partes
reperiantur
alitri
Gura vcio contineant SO'^SG partes
partibus ammoniacae.
14,98.
c.\
Ex hac navimus composituni esso mtiiia-
Bcrzpîio tradita.
acidi
esse
partem
saJina
ammoniacae
teni
intCilcxeuinr,
ainmoniaca ilaque ]n'diog( nium non
In
halomeleogenii.
liir
doccntc nnpciiore e.\}")ciirn-
nonnisi azoto dcbere
snarn
nitidum
in
ammoniacae Jubitain
ladicali
dislinclani,
li)drogcnio
amnioniaca.
quod ciim liydraigyio
similis ,
coeat.
ami)li;cimii
cl
co
in
halomeleogenii
in
azoli
in
esse
si-
Daiy fac-
18,167 partes hydio-
et
partes
videtur ,
eflkiat.
illius,
100 partibus ammoniacae
3 1,95 partibus
5,804
halome-
Ex
ammoniacae
hydrogcnii ,
cum
toto
in
cu]i\^-
composite
halomeleogenio-
ammoniacae 14,98 latebunt in azoto 14,98 — 5,804 =2:9,1 76
partes:
eritque q^Liantitas radicalis
in
3i,9.5
partibus i>m'-
632
11126,146 partibus azoti :z: 26,146 - 9^1 76
moniiicae, sive
zz:
i6,9"0.
ex
64,905
et
100
amnionii
p.
p.
100 partes
eiunt
35,095
et
adaucli
p.
53,ii4
ex
ammoniacac
partes
46,1886
compositi
Propterea
ponderis,
amrnonii
P-
Quoniam dcnique
halomeleogenii.
azoti
et
ex 100
producuntur i56, 935 parles oxiduli azoti ;
partibiis azoti
2j3,86 p. oxidi
289,77
azoti;
p.
p. acidi nitrici, continebuntLir in
nitrosi
acidi
100
partibiis
327,76
(t
:
oxïdiiU azoti 41, 358 amrnonii et 58,642 augmenti ejtisdcm,
oxidi azoti
30,349
~ ~ — 69^651
acidi nitrosi
22,399
-—
19,803
— 80,197.
acidi nitrici
His
titatem
7 7, 601
ex analysibiis nitratum
dalis,
halomeleogenii in acido
definire
In
nîtrico.
niacae invenit Berzclius 67,625 partes
tibus
erunt
stra
et
ammoniacae
in
conjiinctas.
21,143
p.
19,826
eodem acido auctum
tinebit
sit
idem acjuae ad
tur
et
67 p. plumbi
jQavi.
p.
latebiint in
amrnonii
67,625
Cum vero in
ammonium pondère 54*233,
bases
secundum analysin
11, 23
halomeleogenii.
54,233—19, 826^^34,407.
,
21,143 par-
acidi
ammoniacae,
p.
ammo-
nitrate
At secundum lemmata no-
9,913 p. halomeleogenii: propterea
p, acidi nitrici
licear qiian-
saturandas
In
nitrate
inefficacis
con-
partes
plumbi inveniun-
a Chevreuil praestitam,
33 p. acidi
Continent vero 67 p. oxidi plumbi
633
33
4,79
P'
halomeleogenii.
Propterea
9,58
p.
halomeleogenii ,
quae ab augmente ponderis in
hoc
acido
26,465
subtractae
pro
valore
aquae.
Si
partes
pkimbi
nitratis
67,29 p.
oxidi
i:z4;8i,
et
sese
Beï-zelio
quo
4,
acidi
nitrici
74 p.
his
100 partibus
acidi
consistere
secundum
Berielio
a
,
et
secundum analysin
halomeleogenium
Et cum
erit
hujus aqua
argenti
obtulerunt
68,4 P- oxidi
argenti, in
çfticiunt.
Sed
3i, 6 p.
Comparatis
aquae.
p.
augmentum
sîve
80,197
analysin
nitratis
inter
ponderis
ejus
partes,
ex 29, 3 1 8 halom. et 5o,8 79 aquae.
nitratis
— — 5i,l67 —
secundum eandema5erze/io, ex 29,410 — — 5o,787 —
-
MtmtireiAeiAcad,
T.VL
in
ammoniacae
plumbi a C/iei;rcui/ datam, ex 29,030
'
et
Ideo eiunt in hoc acido 9,48 p.
nitrici,
exhibitam
partes
acidi
=19,62.
nitratis
colligimus
consectariis ,
acidi
posuimus ex 6,252 p. ammonii et
i5, 862
et
hujiis
26,232,
halomeleogenium
consistere
halomeleogenii
se
acidi
32^71 p.
acidi
sit
100 partibus
aucti ponderis.
25,342 p.
ex
consistere
halomeleogenium
3i, 6 p.
i6^885
relinquunt
plumbi, habemus
In
p.
autem cum BerzcUo ponimus 100
totum in acido augmentum
=216,612.
erunt in
-
^O
634
sectindam analysin nitrads
— — 50,19*7 —
a Bericlio factam, exSo^OOO
fligenti
Ttaque luediis assumtis nu-
100
continebunt
Qieiis,
panes acidi
—
nitrici
y^cidum fluoricum
29,489 halom. et Scj 58 aquae.
a pliivimis aliis ita
abludere
visiira
ut
angnientiim
ladicalLs
ejus pleiLimqiie aeqiule in-
veniretur
augmento
radicalis
basium.
est,
acidi
hiijus
sulTicienter
natiira
Cum autem nequc
adhnc cognita
sit
,
neque
nentra per fpsum producta satis examinata, discernere
salia
rondum tnto possumus, utium aJ eundem ordmem ac pieraque
alia
satLirata
salia pertineant fluatës.
Ex suis cum
radicali ^cidi fluorici institutis experimentis conclusit Davy,
idem non ex oxygenio, sed ex hydrogenio oxidatum
Qiiod
si ita
sit^
fieri
potest,
esse.
ut ob defectuni aquae, pon-
dère minus augeatur radicale ejus, qnani ceteroium acido-
rum
radicalia ,
hydiQgenium
aequaliter
cuni
miuorem
quani oxygenium
pollens ,
in
quod
aquae quaptitatem habeat
vi
pro
electricitatis
conLiariae
fonnando acide partim
transmutetur.
In
et
vegetahiUhus acicUs, ulpote ex carbonio> hydrogenio
oxygenio compositis^
erit,
secundum
nostriira
rem con-
,
635
modum
eiptjsndi
veio
ntrtini
immixtam
,
hoc
carboniiim
pcr
acjriani ,
ita ^lodificetur,
radicale
omnibus commune,
variata
quantitatis ratione
ut alias atque alias sibi sumehdo
halomeleogenii" quantiiates divérsas procreet acidorum species,
anne
potilis lateat horuni diversitatis caussa in occultatis
radicalibus alcalium,
quorum
tant'iUa
terrarum aut oxidoium metallicorunr,
in omnibus corporibus organicis, ut et in
cineribus acidorum perustoiuîri reperiuntur vestigia, certius
decisum non esse videtur.
Qiiantitates halomeleogenii il-
lorum ex consideratis salibus neutris per oxidum plumbi
productis computare convcnientissiriium duximus.
Qiiae in praecipuis acidis adsint radicalium quantitates ,
et
quae augmenta his accesserint
exhibere
studuimus,
in
sequenti tabula
prima columna radicalium indicantes
pondéra, et secunda incrementa eorum in IQO acidi cujas-
que partibus. Tertiam, quae quantitates halomeleogeniorum,
quousque
ex
examinibus
salium neutrorum certius deter-
minatae esse vîdeantur, et quai ta m quae aquam superfluara
latentem
significent',
pro acidis minus a<3huc perscrutatis,
vacuas rcliquimus.
aquam
loo partes
radicale
acidi caibonici continent
g 7,00
"/S.oo
"3^00
0^00
4ijio
58,90
68,90
0,00
46,50
53,5o
53, 5o
0,00
—
muriaiici
—
phosphorici
—
—
augm. pond, halomeleog
80*
636
loo partes
rndic. augm.pond.
—
acidi oxalici continent
— sulphuiici
— arsenicici
— acetici
—
—
—
—
nitrici
— citiici
—
— taitarici
^
aqaam
40,12 59,88 39,90 19,98
—
—
halom.
84,90 65, 10 42,40 22,70
66,04 33,96 33^96
0,00
— 64,00 36,oo 3 1,00
5,oo
—
—
19,80 80,2a 29,44 50,76
34,00 66,00 28,60 37,40
— '3.9,50 6o,5o 23,58
-
— siilphurosi
—
— nitrosi —
—
— gummosi
~ fluorici
—
—
— boracici
—
— arsenicosi
—
—
— telkiiici
— wolframici
—
-^
36,92
49^97 5o,o3
22,40 77,60
34,00 66,00
45,05 54,95
4o,5o 59,5a
74,4^ c5,5»
80,1019,90
80,00 20,00
— molybdici
—
66,67 33,33
—
~ chroraici
48,02 5i,9&
~ mmiatici superoxygenati 14*85 85_,i5
— hydrothionici
.6,24.
93,76
-
Praecipuarum basîum radicalia,. et acqiiisita, per ho-
iwm combustiones, augmenta ponderis, quae pro
siuin halomelcogeniis
haberaus
ipsis
ba-
seqtrentes ostendunt séries:
-
638
iOO paitct
63^
ammoniacac
-
D,l33 oxiduli
ijluminae
-
2,140 sliontianae
raagnesiae
-
oxidi
-
ferri
çalcis
-
-
sodae
-
-
oxiduli feni
7,OQ7
-
-
7>ii2
3,259
oxidi palladii
-
8,130
3,55 1
oxidiili
stanni
-
<^,354
8,897 oxiduli cupri
-
9/300
platini
2,577 oxidi
-
6,707
ccreiit
-
3.259 barytae
,
,
91^55 L
oxidi manganesii albi 4,566 oxidi bisnmthi
-
9,709
oxidi cobalti
-
4,662 oxidi
-
10,000
oxidi niccoli
-
4,664 oxiduli platini
oxidi cereiii
-
4,829 oxidi hydiargyri
i3,5i35
oxidi cupri
-
5,000 oxidi plumbi
flavi
13,986
oxidi zinci
-
-
14,450
-
25,974
potassae
-
5,099
Q.uae
ex
acldomm et
-
argenti
«^-«-^idi
5,889 oxiduli auri
-
oxiduli antimonii
titanii
6.435
-
his dalis
oxiduli hydrargyii
13,072
26,667.
computatae sunt rationes pondciî?
100
pattibus salis cujusciue neulri,
scquenti tabula cx[)osuimus,
compajationis eigo simul ex-
basiuni in
laiioncs
liibentes
per
Quantitatem
eriuas.
expérimenta
aquae
ciiemicorum oncilYtxa
ciysiallisaiionis
in
salibMs determioa'ani
indicavinuis,
tionibus
et ba^es s-alium siccatorum.
busque
inter
•
ari(Li
cliemicoruui
a^alv^ium uuclorcs.
appositia
adjur.ctis
nonauUis
siniul propor-
sigp!lica\ imus
Noirsini-
divcisarw»
r»
640
641
642
643
computata
acidum bjsis
murialis
— feiri oxiduli 43,62
— nianganesii
— cobalti
— niccoli
— ceieiii oxidi
— cupri oxidi
— zinci
— potassae
antimonii
34,54,65,46
•ceierii oxiduli
33,6o!66,4o
32,37,67,63
per
analyses
acid.
basis
détecta
aqua
cryst.
644
645
646
computata
acidum
basis
phospliatis
— stiontianae
— platini oxidi
— palladii
— stanni
~ cuprioxiduli
— barytae
— bismiithi
— titanii
— plat, oxiduli
— hydiarg. oxidi
— plumbi
— argenti
— nu
— h ydr. oxiduli
ri
Oxalatis
— aminoniacac
— aluminne
— nia^ncsiae
— fciii oxidi
— calcis
64?
computata
basis
acidum
per analyses détecta
basis
aquacryst.
acid.
49,50
oxalatis calcis
56,25
— sodae
54,76 45,24
— ferri oxidiili 5 1,80, 48,20
— inanganesii 5o,8i|49j19
— cobalti
50,29 49,71
^ niccoli
50,28 49, '/2
— ceieiii oxidi 49,4 i 5o,59
— ciipri oxidi 48,54 51,46
— zinci
48,o5j5i,95
— potassae
44,47 55,53
— antimonii 42,30j57,70
— cerer.oxiduli' 4 1,29 58,71
— strontianae 39,93 60,07
— platini oxidi 39,88 60,12
— palladii
36,72163,28
j
1
—
<
stanni
36,09 63,91
— cupri oxiduli 34,39|65,6i
— barytae
33,06 66,94
— bismuthi
32,7o|67,3o
— titanii
32,o5 67,95
26,52
— plat, oxiduli
'73,48
648
1
649
per analyses
computata
détecta
j
:idiini
j
acid.
basis
basis
aqua cryu.
SLilphntis man-
ganesii
j::52,c6|:47,94
— cobalti
— niccoli
51,8148,191 52,11147,891
Bei-zcUus
!5i, 80 48,20'
Tupputi
I
— cererii oxidi 5o,93 49,07
— cupri oxidi 50,0649,94
29,37
!•: 5
'
25,63 45,00
3,40' 46,60
1
5o,77 49>23|
Proust
3i,40j 32,30 36,30
'
Bcrzelius
I
|;:49,29 :5o,7lj
I
I
zmci
5o,oi 49,99
31,46 32,09| 36,45
1
idem
49, 5o :5o,5o
— potassae
— anlimonii
45,94 '54,06
45,25! 54,75
IVenicl
46,21
53,79
Bèrzelias
42,00
5 8,00
Klaproth
43,79 56,2 1
— cererii oxidiili 42,77 5 7,23
— strontianae 141,39 58,6
— platini oxidi 41,34 58,66
37, •/4 53,81
41,22 :58,78
— palladii
— stanni
38,14 61,86
l37,5o 62,50
cupri oxidiili 35,7 7 64,23
Mimoirii de l'Acad. T. VI.
845
Berzelius
650
con:putata
icidum
basis
pcr anah'ses
acid
b,i~!S
détecta
aqiia cryst.
sulphatis
— biiiytae
— bisiunlhi
344c 65,58
34,32' 65,68
j34,u5 65,95'
33,65 66,35
litanii
133,3966,611
plat, oxidiili
27,72 72,281
Beri-eliiis
Jiydrarg.oxidi 27,07 72,93
i26,38 73,62
phimbi
26,35' 73,65
Bet'ZcUus
26,00' 74,00
KJaproth
25,75|74.25J
25,78; 74.22
Bcriclius
— ami
i6,i8;83,82
— lïydr. oxidnli'l5;82 84,18
16,00 84,00
Berzelius
66,67' 33,33
Berzelius
arirenti
'S)
xArseniatis
am-
moniacae
73,40-26,60
i
-- iiluininae
niagnesiae
feni oxidj
73,35
j
26/0
69,56 3o,44
|64,38 35,62j
calcis
j
62,38; 3 7,621
— sodae
60,18 39,82
— feni oxiduli. 57,29 42,71
— nianganesii 156,33 '43,67
— cobdUi.
55,81 44,19
4i,5o| 36,50,22,00 Chenevix
:53,2i
46,79
3 8,00
39,00.23,00} Buchoh.
I
1
65
per analyîcs détecta
coinputata
acidum
arseniciris
acid
bisis
basis
acjua cryst.
co.•49,35 :5o,65
— niccoli
55,8o'44,20
— cereiii oxidi 54,94'45,o6
— cnpii oxicii 54,08 45,92
41,10 35,00 23,90 Clienevix
'
!
::
— zinci
— potassae
53,60 46,40
antimonii
47,78 52,22
-—
r.
54,01 45,99
50. 00 50,00
— ceier. oxidtili 46,75 53,25
— strontianae 45,35 54,65
_ platini oxidi 45 3054,70
_ palladii
42.01 57,99
— stanni
41,3558,65
— ciipri oxiduli 39,5.5 60,45
^ barytae
38,14 61,86
_ bisriuithi
37,75 62.25
_ litanii
37,04 62,96
_ plat, oxiduli 31^06 68.94
I
—hydiarg-.oxidi 3o,35 69,65
— plumbi
— arecnti
29,63 70,37
28,95
C9,63 70,37
Derzclius
7 l,o5
82
652
pcr
coinputata
aciduin
asseniatis
b.isis
analyses détecta
aqua cryst.
acjd.
b.i'iis
70,35
29,65
18,48 81,52
aiiri
— hydr.o.xidtili 18,09 81,91
Acetatis ammo-i
I
I
niacae
— alciniinje
— magnesiae
— ferri -oxidi
— calcis
— sodae
75, 1 5 24,85
75, il 24,80!
Richter
|
I
71,14 28^86
71,4628,54
'66,4633,54!
Bei-zelius
i
,'64,50, 35, 5o
64,22' 35,78
BcrzeJius
162,36 37,64'
36.95 22,9440,11
idem
::6i,70 :38,3oj
6o,36 39,64
ÎVcnzel
— feni oxidiili 59,5 4^-49
— manganesii 58,5641,44
— cobdlti
158,05 41,95
— niccoli
|58,04 41,96
— ceieiii oxidi 57,19 42,8
i
i
— cupii oxidi
56,34 43,66' 47,00 37,oo 16,00
Berzcîius
i::55,95|:44,o5j
— zinci
— potassae
155,8644, 14}
I
52,36 47,64' 49,85 5o,i5'
Berielius
36,00 37,80 26,20 Richter
.•48,57 :5i,43|
653
compiitata
acidum
accliUis
pcr analyses détecta
basis
acid.
basis
aqua cryst.
anti-
50,07 '49.93
monii
1
— cercriioxiduli 49,08 50,97
— stionti.inae [47,62 52,38
— platini oxidi 47,57 52,43
— palladii
44,25^55,75
I
— stanni
43,57,56,43
— cupii oxidiili 41,76 58,24
— barytae
40,32 59,68
— bismiithi
39,9
37.66 55,73
6,61
Berzellus
40,33 :59,67
60,09
1
39,2 i 60,79
titanii
33;05 66,95
— platini oxiduli
— hydraig.oxidi 32,32 67,68
— plumbi
31,57684.3
Strohmeyer
32,90 67,10
26,00 58,00,16,00 Tlicnard
|::3o,95 :69,o5
I
— argenti
— auii
3o,8 7 69,13
I
Berzeîius
21,80, 78,20
Strohmeyer
19590 80,10
— hvdr.oxiduli 1948 80,52
V
\itratis ammo-
3i,23 68,77
'
•
'
I
j
niacae
176,10 23,90]
!
!
67,62' 21, i5
:;76,l7 :23,83
1
r,23
Bcridhis
654
computata
acidum
basis
nitratis
pcr
anal\'se<;
acid.
basis
d**tecfa
aqua
cryst,
aki-
minae
76,05 23,95
— niiignesiae
72, 5o 27.50
— ferri oxidi
— calcis
72,OOJ 28,00
Bucholz
70,00 3o,oo
Wenzel
67,58 32,42
65,67 34,33
— sodae
63.55 36,45
— feni oxiduli 6*0,70 39,30
— maneanesii 59,80 40,20
— cobalii
59,30 40,70
— nîçcoli
59,2940,71
— CLipri oxidi 57,60 42,40
66,18 33,82
61,00 39,00
Bucholz
62,50 37.50
JJemel
6i,8i
38,19
Wenzel
61,30 26,70' 12,00
Bcrzeîius
:69,66|;3o,34
— zinci
— potassae
— antimonii
57,12 42,88
53.56 46,44
53,80 46,20
BerzcUus
51,88 48,12
If'cnzel
48,40^ 47,60
4,00 Berzelius
5i,35 48,65
— ceieiii oxiduli 5o,32 49j68
— strontianae
4^'9i
5 1,09
:5o,42
— platini oxidi 48, 85!5i,i5
.-49, 58
655
1
656
computata
basis
acidum
citralis
pcr analyses détecta
acid.
basis
aqua cryst.
ferri
oxiduli
161,43 38,57
'
— manganesii
i
j6o,5o 39,50
— cobalti
60,00 40,00
— niccoli
59^99 40,0
cereriioxidi 59,15 40,85
— cnpii oxidi 58,3TJ4i.69
— zinci
5'?,83 42,17
-^ potassae
— antimonii
54,29 45,71
57,83,42,17
Beridiiis
5o,oo 5o,oo
Fauquelin
55,55' 44,45
idem
5i,io 48,90
Riclilcr
52,08 47,92
—cereiii oxiduli 51,04 48,96
— strontianae '49,63 50,37
— pLitini oxidi 49,58 50,42
— palladii
46,24 53,76
— stanni
i45,5 7 54,43
— CLipri oxiduli 43,7 3 56,2 7
— barytae
43,03^56,97
|42,27
57,73J
— bismutlii 141,87 58, i3|
— titanii
141, i5 58,85
— platinioxidiili 34,85 65, i5
— hydiarg.oxidi,34,io 65,90
Richter
657
computata
acidum
bnsis
citiatis
plumbi '33,33,66,671'
— argenti
32,61 67,39
per analyses détecta
acid.
bnsis
aqua cryst.
33,33 66,67
6400
3 1,00
Berxeîius
5,00
idem
j
;:32,63 :67,37
— a un
2i,2iJ78,79
— hydr. oxjdiili 21, 17178, 83
Tartratis
am-
nioniacae
— aluminae
— masinesiae
— feni oxidi
— calcis
— sodae
79,9i'20,09|
74»i3 25,87
Rlchter
79,85'20,i5|
77.70| 22, 3o
idem
76,70 23j3o|
74,7'î
25,23
idem
79,00 21,00
JBucholz
69,70 3o,3o
Richter
66,00! 34,00
Fauquelin
72,24 27,76
70,49^29,51
68,52 31,48
66,20 26,80
'
7,00 Bucholz
;:7l,i8 :28,82
— feni oxidiili 65,8934,11
58,00j 29^00! i3, 00 Dcrzellus
::66,6l :33,33
— manganesii 165,01 34,99
— cobalti
64^5-3 35,47
_ niccoli
64,52,35,48
— ceierii oxid. 63,72 36,28
— cupri oxidi 62,91 37,09
1
MùntiresderAcad. T. VI,
658
659
Ex
hnc comparatione patet ,
salibus ncLitiis a
piopoilionGs pailium
nobis computatas
,
plcriimque
iis
m
conve-
niie, qiiac per novissima expérimenta analytica erutae sunt;
saltem
non
magis ab his discrepare, quam inter se
diffe-
runt consectaiia ex experimentis directe deducta. Ulteriora
chemicorum
tenta raina ostendent
si
in salibus
nondam sàlis
examinatis ea adliuc detegattir compositionis ratio ,
ipsis
assignaviinus.
Fieri
quam
utiqiie posse nobis videtuv ,
ut
quibusdam basibus vcra halomeleogenia cum incremento
in
ponderis a radicalibus earum suscepti non quadrent, et ut
propterea
qualem
acidorum
iiomenis
si
eas
ap.ud
in
quoque
determinandis
adhibuimus.
niniis
neque ,
talis
abludere
inveniatur nostra aedificatiuncula,
post factas emendationes leminatum
judicaturos esse ,
quorum
jtidicii
res
neque
quisitioni
tantillam piv^ebuisse materiara.
inaniter
nos
nostioruiu,
speramus tamen béni-
perperam
d.
sit,
nonnullorum
Quod si quandoque a veris phae-
naturae evadere queat consentanea,
gne
correctio necessaria
halomeleogeniis
sit ,
non plane
consummatiori alioriim dis-
17 Octob. 1814.
83!
66o
EXTRAIT DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGiaUES,
FAITES À ST. pÉtERSBOURG
PAR
FEU nK IKOKUOBT SOW
a]sî;Ée
mdcccvi d'après le vieux style
,
7
rédigé par
P E T R O TV.
B.
Frésenté à
f
la
Voyez Tome
Seiences de
Confcrence
le
des Mémoires
TI.
St. Péteisbourg
de
page 224.
Hauteurs extrêmes
_,
variation,
milieu
hauteur moyenne et nombre des jours ,
Paris^
du
baromètre
T Académie des.
Baromètre.
I.
teur
i8i5.
i8 Oct.
a
été
au-dessus
arithmétique,
auxquels
de
la
hau-
28 pouces de
66i
NB. m.
signifie
malin on avant midi, à m. à midi, apr. in.
après midi,
et
s.
soir
ou après midi.
661
marque
A.
Janvier jusqu'au
jours
les
i
365
de six mois d'hiver depuis
l'intervalle
i8o5 jusqu'au
Novembre
1 8 1
3i Décembic i8o6, comprenant
le
de l'année.
H. marque
1
de tonte l'année depuis
l'intervalle
Mai
i
l8o6,
le
comprenant
jours.
E. marque l'intervalle de six mois d'été depuis le
Mai jusqu'au
Ce
x
tableau
Novembre i8o6, comprenant 184
voir
fait
1)
:
que
la
i
jours.
variation totale
ou
annuelle du baromètre^ c'est-à-dire, la différence entre la
grande hauteur du baromètre (28,98 pouces) et en-
plus
plus petite (26,88 pouces) est égale à 2,1 5 pouces;
tre
la
2)
que
(de
1,64 pouce) en Février,
pouce)
la
en
variation
en Avril,
cembre.
baromètre a été la plus grande
et la
plus petite
(o,52 de
la
hauteur moyenne du baro-
être la plus
grande (de 28,281 pouces)
Août ;
mètre se trouve
du
3)
que
et la plus petite
(de
27,696 pouces) en Dé-
663
II.
l)
Tempérât lires extrêmes de ratmosplière avec leur
dinerence ou
res
riioyennes,
bientôt après
Mois
Thermomètre de Mr. Dèllsle.
viiricition,
milieu arithmétique
et:
températu-
pendcint les matins et les soirs, à midi
midi,
et
ou
pwir chaque mois de l'année iSo'î.
664
On
voit
(de
froid
^\:\\k\
pnr
précédent
tablcan
le
degrés)
189,4
avait
été
et le
28
Décembre
matin ;
2)
que
leur
(de
108 degrés)
fut
le
26
Juillet
la
que
i)
:
le
plus
le
20 Janvier
plus grande chaà
2
heures
après
midi; 3) (jue la plus grande dilTcrence entre la plus basse
et
la
4*?, 2
plus
haute
degrés)
température
en Avril,
de l'atmosphère a été (de
et la plus petite
(de
20 degrés)
en Juin ; 4) que la variation totale ou annuelle c'est-à-dire,
la
différence
entre
la
plus
basse et la plus haute tem-
pérature dans toiite l'année, a été de
la
soirs,
se
Janvier,
et
moyenne ,
température
6)
aussi
les
trouve être la plus basse (de
et
qu'à
inoyenne
pendant
81,4 degrés; 5) que
la
la
plus
haute
(de
plus
basse (de
me ci-dessus, en Août.
les
126,1 degrés) en Août;
ou bientôt après midi ,
la
et
168,4 degrés) en
midi
en Janvier, et
matins
162,'?
la
température
degrés) se trouve être
plus haute (de 119,8 degrés), com-
665
g)
Nombre
Tatmosphère
di,
ainsi
sous
et
des
été,
jours ,
pendant
auxquels
les
la
température de
matins et les
soirs,
à mi-
que bientôt après midi de chaque mois, au-desau-dessus
thermomètre.
',
a
de quelques
divisions
principales
dd
666
3)
Nombre dos
mosphère
raidi
a
été,
jours,
pemiant
et bientôt après
sous qu'au-dessus
du thermomètre.
auxquels
les
la
température de l'at-
matins et les soirs, ainsi qu'à
midi de chaque mois, tant au - des-
et entre
quelques divisions piincipales
,
667
a
Il
et
a
il
commencé
gelcpoiir
un
intervalle
où
il
de 234
à geler le
tervalle de
134 jours.
jours,
pendant
en H.
i5i jours,
La
jours,
en
du 16 Octobre i8o5,
conséquent
Octobre
•avoir
1806
un
elle
été ouverte
le
16 Mai 1806, apiès
et
notamment en E.
dernière fois le
16 Mai,
il
les
matins et les
et en
ainsi
E.
22
soirs,
jours.
a
in-
en A. 160
Il
n'a gelé
que bientôt après midi ,
em.
H t5 jours et en E. 176 jours.
rivière Nev;a,
après
fois
En A.
28 Septembre 1806, après un
a gelé,
point du tout, à midi ,
A. 260
la
Septembre matin i8o5,
25
le
jours.
pour
recommencé
Il
^e]ei
clornièie
la
gelé
avait
à
se
après avoir été couverte de glacc^
debacla le 14 Avril
intervalle
de
18 1
1806, par
jours.
couvrit de nouvelle glace,
pendant 197
jours.
^4
Le 26
après
668
ni;
Vents.
669.
calme,
j
que
i6-h58-4-7
dominant
l'cié
:
était
1
Jaovv
qui
l'a
suivi
i3-4-43-f-4, ou de
i
8i
dans
:
le
L'éta t de
l'a t
rapport
160; 3) que
dans l'année celui du Sud.
IV.
Moi^
E.,
mosphcre.
de
le vent
670
Le tableau précédent indique:
jours
entièrement
Fiai
et
Juillet ;
Décembre
H.
il
dans le rapport de
Cette année-ci
Mai,
et
pour
la
que
2)
on n'en
hiver
qu'en
sereins
a
a
été
par
que
i)
compté qu'un seul jour
44
il
:
3)
47.
neigea
première
fois
pour
le
la
dernière fois le
i6
29 Septembre, après un
jours.
tonna
pour
la
première fois le
le
25
Août.
fois
serein ;
y en avait prcsqu'aulanL qu'en été- E.
i35
la dernière
de Novembre et
mois
intervalle de
11
nombre des
pins grand en Mars,
le
les
le
24
Avril, et pour
Enfin, cette année-ci on n'a pas observé qii'line seule
parasélène
le
17
Mars,
un parhelie
le
18
du même
mois et deux aurores boréales le 7 et 9 aussi en Mars.
^eooooo^oooooi
67
1'
EXTRAIT DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGiaUES,,
FAITES À ST. PETERSBOURG
ANNÉE MDCCCVn DAPRES LE VIEUX STYLE ^
P A K
B.
Présenté à
la
W,
Conférence
6 Avril
le
extrêmes ,
vaiii^tion ,
milieu
hauteur moyenne et nombre des jours ,
teur
Paris.
du
baromètie
lôi^»-
Baromètre.
I.
ITautenrs
P E T R
a
été
au-dessus
arithmétique^
auxquels
de
la
hau-
s8 pouces de
672
NB. m.
matin ou avant midi,
signifie
et
H
a
u
t
l
s.
u
r
apr.
m. après midi,
ou après midi.
soir
v.di.i-
-.
milieu
aTithmc-
Mois
les
plus grandes,
pouces
Janv.'o8,58
m.
II apr.
et
plus
».
26,92
pouces
tt
toute
journée
li
l'
h.iutcur
poi
1,66 27,75
27,623
m
i,5o 27,87
27,978
Mars 08,67 le 1 1 apr. m. 2 7,37]le
s.
i,3o 28^02
2.7,980
Avr.
J28,73
le 10
Mai ic>8,8o le
m,
27,50 le 18
s.
1,2 3^28,1 i5 27,985
m.
27,5ole 12
s.
1,30^28,15
28,115
|27,54llçX2apr.m.0,6€ îî7,87
27,956
Juin. c848|le 3 1 apr. m.'c 7,96 Ie3s.elle4m. 0,52 28,22
28,185
luin
Ic8,20
5
'VUr"
Août '2 8, 33] le 17
le
m.
22 «près m.
Sept. '2 8,3-7 et
«.
Oct.
11 m.
et
le
25 rn.
3o
|2i7,i-7le
le
,48
27 s.
et
s,
2S m
le
'
pences
Kévr. 28,62 le 1 8 apr. m. 2 7,12|le 11
2
hauteur^
moyenne,
tique ,
petites ,
pouces
jours
le
les
I
après m.
i,i6J2T,75
28,084'
28
0,819 27,93
^28,026
20
,46r2 7-,69- 27,876^
i5
Icô^^ôile
i-6
s
1
N'ov. |c8,46'le3ttlei8aprin.'2 7,l2!le
22
S,
i,34|27,79
27.990
20
1,10 27,88
27,895
14
Janvier 1,88 27,86
2 7,974i
-22
i3éc.
|2 8,4t^!le
28,48 le 25
A. i28,80ilo 5
s.
|2 7»29Jle 3 i apr.
Mai 126,921e
le
II.
K.
;28,73|le 10 Avril 26,83
:28,8o;ie
5
Mai
26,()(y ]c
i
m
22 Nov
1806
1,90 27,78
11 Oct. |i,84 27,88
27.734 83
M,
040
1I1.
6i3
A.
marque
l'intervalle
de tonte
Janvier jusqu'au 3l Décembre
jours
Novembre
181
année depuis
le
l
i807j comprenant les 365
de l'année.
H. marque
1
1"
l'intervalle
de six mois d'hiver depuis
i8o6 jusqu'au
Mai
i
le
comprenant
1807 ,
joins.
E. marque l'intervalle de six mois d'été depuis le
Mai jusqu'au
1
Novembre 1807, comprenant 184
On voit par le tableau précédent
du baromètre a
lion totale
été
ïa
:
1)
que
plus grande
1
jours.
la
varia-
(de 1,66
pouce) en Janvier, et la plus petite (de 0,52 pouce) en
Juillet ;
plus
2)
que
la
hauteur moyenne
grande (de 28,i85 pouces)
petite (de
se
trouve
en Juillet,
et
27,628 pouces) en Janvier.
Ml moires de VActhl, T. K/.
85
être
la
la
plus
674
TI.
i)
Thci mo inct ic de xMr. Dèlisle.
Tcmpcraiiires extrêmes de l'aLmosphère,
rence, milieu aiithmcuque, et l'état
tins
et
les
soirs,
à
midi
choque mois dé l'année
ou
1807.
leur difTc-
moyen pendant les ma-
bientôt
après
midi,
pour
]
675
Ce
lc)blcau
189,4 degrés)
la
voir:
fait
clé en
a
que
l)
1806
le
plus grand froid (de
28 Décembre;
le
plus grande chaleur (de
106,9 degrés)
que
grande ditTérence
de Jtiin ;
basse.. et
(de' 38, 8
3)
la
pi.us
plus
la
.
degrés)
est
que
2}
arrivée le 6
entre la plus
hayte^ tei.npératuies
^te^J'ûtmosphcre fut
en Janvier,
pluS' petite
et
Iq
(de 19
degrés) en Octobre; 4) ^^^^ ^'^ température moyenne, pen-
dant
matins
les
basse (de
et
les
soirs ,
162,70 degrés) en Janvier,
(de •124,60 degrés) en Juillet;
après
trouve
se
midi
la
température
5)
.
degïés) en Juillet,
mi
s.t^
qu'à
moyenne
159,7 degrés) a.éié en Janvier, et
et
Jla
la
être
la
plus
la
haute
plus
midi
ou bientôt
plus
basse
(de
plus hautei (d;e/i,20
1
1
ii./
oA
I
-
85
ir
675
q)
Nombre
des
jours ,
auxquels
la
température d«
l'atmosphère a été, pendant les matins et les
soirs,
à mi-
di ou bientôt après midi de cliaque mois, au - dessous et
au-dessus de quelques di\ isions principales du thermomètre.
6-7
3)
Nombre dps
jours,
mosphère a été, penilant
bientôt
après
qu'au-dessus
thermomètre.
midi
et
de
entre
auxquels
les
la
tcmpératnre de
l'at-
matins et les soirs, à midi ou
chaque mois
quelques
,
autant au - dessous
divisions
principales
du
6-/8
a
II
commencé
à-dire encore
avant
a
pour
et
il
i^elc
à geler le
commencement de
le
dernière
L\
un intervalle de
après
où
en E.,
Mai,
il
a
,
il
2 25
gelé
avait
c3 Sep'cmbre iScî,
En A.
jours.
poiu-
recommencé à geler
et
a gelé, pendant les matins et les
en H.
jours,
i5o
jours,
et en E.
10 de
12 Septembre 1807,
le
par conséquent après un intervalle de 124
Il
notamment
den-ière fois le
la
22
jours.
soirs,
jours.
en A. 172
Il
n'a
à midi ou bientôt après n idi en A. 264 jjurs, en H.
jours et en E.
La
rivière
180
Newa,
28 Avril 1807
après midi, conséquemment
i itervalle
Le
1
après
24 matin de Novembre
mais
ce
ne
Décembre pendant
la
nuit ,
prise,
81
après avoir été converte de glace,
le
velles glaces ,
gelé
jours.
du 28 au 29 d'Octobre 1806, debacla
jours.
IL,
10 de Alai 1807,
le
fois
c'est-
l'intervalle
fut
un
se
de
182
formèrent de nou-
que du 3o Novembre an
qu'elle
après avoir été ouverte pendant
en
fut entièrement
210 jours.
679
111.
Tableau
gténéral
de
Vents.
la
force
vents pour chacjue mois de l'année
et
de la direction des
1807.
680
Les mois de Mars, d'Avril, de Juin et de Novembre
ont été les plus venteux ;
ceux de Janvier ,
de Février,
d'Août, de Juillet et de Septembre les plus calmes.
L'hi-
ver IL a été un peu plus venteux que l'été E. , qui
suivi dans le rapport de
ou de i5o
:
85 -f- 47
+ i8 91
:
l'a
-f- 5o -{- 20,
161.
Le vent dominant était dans l'hiver celui du Sud.
68i
TV.
L'étnt de l'ntmo sphère.
682
en
avait
aucun.
Il
plus, et notamment
compté que
un
et
i-ntervalle
11
pour
pour
du
soir.
en
été
qu'en hiver H.,
28,
la
il
la
de 144
tonna pour
et
avait
E.
beaucoup'
où on n'en
la
dernière
neigea
pour
la
dernière
première
fois
le
2
fois
du
28. Juillet
à.
le
fois
ic
d'Octobre, après
jours.
première
fois
le
25 de
9 au
Juillet
10 de Mai»,
à dix. heures-
On n'a remarqué qu'une seule aurore boréale
le
a
i5..
Cette année-ci
de Mai,
en
y
dixième et onzième heures du
cooooo,^_coc.oc
(faible)
soir.
III.
SECTION
DES
SCIENCES POLITIQUES.
86»
*^z
DONNÉES STATrSTiaUES»
SUR LES rRINGIPALES FOIRES DE LA RUSSIE
P A R.
Présente h
la
Conférence
l^es foires forment le
et
font
connoître
commerce
a-
IIERRMANN,
T.
C.
centre
l'état
des
le
i Novembre i8i4-»
du commerce de
manufactures
les principaux
choisi
1* intérieur
du pays:
points de
Le
réunion ,
le
GouAcmemenf erï a crée' un grand nombre de moins considérables.
quelquefois
G' est
à l'ombre
d'un monastère,
quelquefois sur une vaste plaine que le grand marché des
nations s'établit.
Un Gouvernement paternel respectera
choix des ancêtres
être
n'existent
difficile
plus
fait
sous des
depuis des
de les transférer
tort
comme
routes de
grandes
siècles.
11
qui peut est
toujours
même sur un lieu beaucoup plus
commode^ sans faire
les
circonstances
le
au commerce.
Les grandes
foires
commerce sont toujours
«hoix libre de l'industrie nationale.
du-
686
La foire de Makaricw.
•1.
De tontes les
est
plus célèbre
la
foires
de
*).
C'est
la
Russie celle de Miikariew
aux environs du Monastère
du même nom, piesquc au milieu des gouveinemens orientaux
et
occidentaux de
Russie que
la
les
marchands de
toutes les nations de l'Empire et des États voisins de l'Asie se rassemblent.
Une nouvelle ville nait et disparoit an-
nuellement, l'industiie nationale étale ses produits et
ici
qu'on peut porter un jugement impartial
actuel.
sur
son
c'est
état
Les Tatarcs et les Arméniens, les Géorgiens et les
Buchares arrivent en grand nombre pour acheter des maeuropéennes
nufactures
de leur pays.
•)
.11
Cette petite
ville
paroit
est
vendre
productions
les
que ce sont eux qui ont choisi
située
gouvcrncimnt de Xigegoiod,
toit
pour
et
rive g.mche de l,i Volqa dans Je
la
bi wcrstes de la vile de ce nom Ce-
sur
à
un villigc habité par environ Q o p.iyssns appartenons autrefois au
M.ikantw ^ct aprcscrit à la Couronne
Ils vivoient ,cie
MoDanèrc ^c
forestière.
La ville a ci!ii5 ma!^ons. Le Monastère t]ui rtt
point central du plus grand revirement du commerce d'- Tinen Russie tut fonde sou^ le rignc du Grand Duc Wasili Wa-
l'industrie
devenu
tcrieur
le
silcwitsch
le
tenebrtux
vers la
mo t é iln
i
«w s ècle
,
puis
ruine
|Jar
6:/o.
La foire commence à la
,3 j et rétablit en
fête de St. Pierre et continue depuis les prtmitrs jours du mois de
les
Tatares en
i
•
16 Août. Vis
vis de iN'ak.iriew. sur la rive droite de la
Vo'g.i se trouve le bourg Li>kowo à
embouchure dune petite r.Vièrç
du même nom qui fornie un port ou les nivircs arrivent pendant le
tcms de la foire avec les prcdu ts volumineux de l'argriculturc t des
naines.
C'est ici le gr.md marché p ur le cuivre et k ter. p ur les
cluv.iux et les cuirs non appreies.
Les h.ibitans ont la réputation de
laite dci luilcs de tiès bunnc qualité nuis étroites.
Juillet jusq'iiu
î^
!'•
687
Makaiiew pour
autrefois
La
politique
siiiiation
lieu
des
d'échange avec les Russes,
nations
a
changé,
mais leur
point de raUiemenL a survécu aux révolutions des Etats.
L'année 1811 étoit une année de paix, nous la choisissons
fane le tableau de cette fameuse
pour
foire.
valeur des marchandises russes exposées au grand
monioit à 32,;^6,ooo
r.
1,224,000
r.
à
1
Enfin
la
port de LiskovYO à 8,584,359
r..
52,154,359
r.
Les
noms: dès
très anciennes et
son origine.
Tion
marché
celle des marchandises étrangères
valeur des marchandises russes apportée
total
La
différentes- rangées
de boutiques sont
font connoitre l'état de ce
C'est ainsi qu'il y a
les^
au.
commerce dès
boutiques de toiles
blanchies, celles des passemens d'or, la rangée ancienne
et
nouvelle d'Astrachan, celle de Sibérie, celle de
de
soieries,
livres_,
de draps et de chapeaux de Moscou et de Nige-
goiod; suivent la première et la seconde ligne de pelleteries
dé Sibérie, d'argenteries
et
de quincailleries, d'épingles de
Jaroslaw, les boutiques pour l'échange des monnoies, les bouti-
ques pour la bonneterie, pour les ustensiles, en cuivre et en
étain; les armes blanches et fusils, les atteLiges, les cuirs de
Pàissie et d'Arsamas,Jes jmagçs saintes, les épingles de Moscou^
688
les modes et sonlicrs de d.imes, les marchandises coloniales, la
porcelaine, les miioiis et meubles ont Icnis rangées particulièies.
Enfin on voit les boutiques pom- les boissons, les bou-
tiques des Tatarcs, les ustensiles en fer de Jaro-^law, celles
pour
le
savon, les bouticjucs de l'Oural, celles des fruits,
de tabac,
boutiques des
les
et provisions de
tdblissent dans
bouche.
les
arts
et
métiers,
Jusqu'aprcsent les marchands s'é-
dilTérentcs
files
qualité de leurs marchandises.
11
d-e
boutiques
y a bien
selon
la
quelques excep-
mais peu considérables.
tions de cette rè^le,
des cordasses
Nos données
sur les difTérentes marchiindiscs arrivées à la foire en
i8ii
sont encore d'après les rangées des boutiques, d'où résulte
quelque difficulté quand on veut classifier les marchandises;
mais cette disposition est un document historique qui prou^'e
que
Makariew
(îes
marchands russes apportèrent au marché de
les
depuis le
passcmens
du savon
d'or,
et des
1
5 me
siècle
des
toiles et toileries,
de l'argenterie, des Soieries, des draps,
fruits;
que
les
manuf.ictiircs de Moscou, de
Nigegorod , de JarosLiw , les cuirs de Russie étoient alors
réputées
et
que
les
lalaies
d'Astrachan ,
les
l'Oural et de 1^ Sibérie visitèrent celte foire.
peuples
de
Marchandises russes sans concurrence.
Noms
jjs march.indises.
Valeur
Noms
en roubles.
des marchandises.
55o,ooo pour les
Ouvrages en
passemens en or
Arméniens et Géor-
Perses, demi -perses,
2,870,000 se vend:
en roubles.
455,000
toiles grises
ou ra-
doux, haches etc.
surtout
aux Bucha-
res et
Arméniens
et toileries
flandres
500,000
surtout en Russie,
le reste
aux Armé-
se ven-
dent en Russie
niens et Tdtaies.
1
Coffres
livres et cartes
se vend:
1er,
giens.
vendouk, toiles de
page 689
Valeur
pour 300,000 tbls.
géographiques
et
de Sibérie
de Makariew,
cabarets de Sibérie
5 0,000, les coffres
se
vendent aux Ba-
chares,
en
le reste
Russie
5q6,ooo, vontàKinap-
et
Serviettes
pes, toiles colorées
achta, la toile colo- Habillemens russes
rée en Perse, le
reste en
allemands
et
Mos
se
ven-
dent en Russie
Russie
pour 200,000 de M.
Chapeau.x de
255,400,
pour 200,000 de N.
540,300,
Toiles ordinaires
se
ven-
dent au.x Arméniens
couetdeNigegorod
vend: en Russie
se
Ouvrages en or et
et
se
ven-
en cuivre
250,000
se
ven-
dent en Russie
en étain
Cosaques
22,000
dent en Russie
argent
Ustensiles
558,000
et
se Vendent
en Russie
Souliers, bottes et
127,300,
se ven'
bas de paysans
dent en Russie
Pelleteries ordinai-
1 8 3,000, se vendent
Bouloirs de
Toula et de Jaros-
365,000
law, fusils, couteaux
dent en Russie
et fourchettes
se
ven-
en Russie
etc.
100,000
se ven-
3o,5oo, se vendent
Harnois et attelages
Equipage
en Russie
dent en Russie
27,500, se vendent
700,000, en Russie
aux marchands en
Cuirs ordinaires
et
aux Arméniens
foire
Images saintes et
67,000 se vendent
aux marchands
autres
Souliers
tableaux
Miel,
poissons, ca-
iar
et chandelles
vendent
russes
foire
7,700 se vend: au.x
au.x
marchands
Ustensiles
en
boii
marchands russes
Moscou
russes.
Essuie - mains et
petites
se
aux marchands en
141,000 se vendent
de dames
et bottes de
5,800
toileries
49,000 se vendent
et
Mèches
aux paysans
3,oou fie vendent ea
Russie
en Russie
.
t
460,000 au.x Armé»
Verrerie
628,000 se vendent
Miroirs
et
meubles surtout aux Buchares et aux Arméniens
niens
et
en Russie
5oo se vend: aux
marchands en
foire
pour l'emballage.
Total 10,293,000.
JWarchandisps russes en concuirence avec les
Jjioductions étrangères.
Soieries fortes à la 3,960,000 se vend,
Cotlonneries
5o,ooo 4,010,000
surtoutau.v Armén
manière perse
6,400,000 se \
et
soieries légères
dcnl au.xGéorgiens
Fils et
l5o,000 se ven-
petites
i3o,ooo 6,530,000
168,000
dent en Russie
cottonneries
3 18,000
Draps, mouchoirs 500,000 se vend:
de
nanquins aux Arméniens et5, 745,000 6,245,000
soie,
et thé
aux Russes
DiBiétentes mai?
2,3oOiOOO vont
1
chandises en laine surtout à Kiachta
50,000 2,450,000
2,200,000 se vend
Pelleteries
surtout en Russie
40,000 2,260jOOO
Argenteries, parfu;
l,723,OOOsevenmeries, instriimens
dent en Russie
20,000 ,1,743,000
de musique
120,000 se vend:
,|3^s,^e soie,
bonà Tiflis, en Perse
nets,
gapts
6,000
126,000
162,000
1,162,000
70,000
i5o,ooo
et au.Y Arméniens
Perles,
ambre jau- l,ooo,000,se ven
ne, quincailleries dent
aux Armén.
en ver, épingles Tdtareset Russes
^0,000
Modes et schalls
se
vend
en Russie
Sucre, thé, vitriol, 230,000 se vend:
sandal, couleurs
en Russie
2,541,000
Porcellaine, faian- 20o,Qoo se ven-
ce et crystaux
Vins
vie
de
dent Russie
3,000
2 15,000
714,000
1,914,000
1
eaux de
et
Kislar et
1,200,000
de Taganrog
'2,000.000, le cuir
Différentes
chandises
mar- Irusse se vend aux'
Bucha-Buchares, va à Bro-; 2,400,000 4.400,000
»es et cuirs russes
di
et à
Kiachta^
le reste en Russie
Fruits et bougies
200,000 se ven
dent en Russi<
9,000
209,000
J 0,0001
5 0,000
40.000 aux Arméniens et tatares
22,32 3,000 rbls. 13,230,00034,533,000
689
spmcrt des marchands de se procurer d'avance un emplacement.
Le loyer des boutiques au grand marché et aux environs
i3ii à 112,017 R. C'est
montoit en
loue pour le tcms de
marchands
En
couronne qui les
18 13, malgré la dé-
1812, ce loyer montoit à 111,001 R.
sastreuse année de
Les
foire.
la
la
sont
pressés
si
moitié du loyer d'avance.
qu'ils
payent
1811
qu'en
C'est ainsi
grande
la
ils a voi-
ent avancé pour le loyer de 1812 86^169 rbls. en
poiu l'année
i8i3 76,339 -
pour 1814 81,225 —
L'histoire
Li
années
dernières
di^s
écljircit
1812
eteni8i3
-,
ces données,
première indique l'état naturel des choses,
là
seconde
"prouve combi:'n le commerce a du
souffirir
de
que le commerce
re-
étoient les articles où Jes
ma-
i'
ennemi
,
la
troisième fait voir
par l'invasion
prend son ancien cours.
Voyons aprësent quels
'nufactures
nir
et
russes
puis
n'avoient
ceux
nous fera connoître
(Voyez
les
où
l'état
elle
point de concurrence à souteexistoit.
Ce
point
de nos manufactures en 1811.
tableaux pour la page 689.)
M(moinidcVAcaiL T.yt.
de vue
^7
6go
n resnlte
de ces
table an.\'
que les manufactincs russes
qui prospèrent particulièrement- sont
celles
1)
de soieries légères,
:
mouchoirs de
talTetats,
mouchoirs et gilets de cachemire ,
mitivals,
ceinturons, filatures et petites cottooneries ; on en
apporta
rubans ,
soie,
à
la
pour
foire
la
somme de 6,55o,ooo Roubles.
grand marché de ces marchandises
viennent
Puis
2)
toiles
les
dénominations- raontoient
férentes
méniens
Géorgiens
les
,
,
c'est
Géorgie,
qui sous dif-
et toileries
;i
4'^^4^'3o^
Tatares,
les
la
Le
•'•
^-^^
'^''"
les
Cliinois et les
goût
asiatique pour
Perses les recherchent.
3)
Les
3,960,000
4) Les
marché
est
soieries
se
r.
cuirs
en
dans
fortes
le
vendent surtout aux Arméniens.
de
tout
genre- pour
Buchdrie ,
à
Brodi ,
2,968,300
à
Kiachta
r.
Leur
et
en
Russie.
5)
Les petites marchandises en
en Chine pour 2_,3oo_,ooo
11
lement
qui vont surtout
r.
paroit que les manufactures étr-angères ne font nultort
aux nôtres pour tout ces
marché particulier en Asie
vaillés
LiiTie
dans
un genre
q,ui
et en
articles
qui ont leur
Russie et qui sont tra-
convient aux peuples qui les
691
recherchent et dnns lequel les étrangers ne travaillent pas,
donc
Voilci
manufactures
nos
sans moyens arlificirl?.
russes
discs
au
étrangères.
toient en
échange
prospèrent
de mai-chan-
tiers
des manu-
Les articles que les étrangers apporétoient:
Des draps, des mouchoirs de
j)
tiers
marche contre un
«^rand
factures
y avoit deux
Il
qui
natuiclles
du thé pour 5,745,000
soie,
da nanquin
et
r.
Comme le commerce chinois exi,ge absolum.ent le drap
contre
le
h quel
chinois aiment stntout troquer le thé et
les
nanquin, on
trouve ces marchandises réunies aux mê-
mes boutiques,
marchandises
2)
coloniales
et
des
couleurs
pour
1,541,000- r.
que
3)
Des marchandises
les
Buchares apportent pour 2,400,000
D'où
ne sont
il
pas
pour nous
avantages
ne
sont
pas
1)
que
encore parvenues
faire
l'^s
j)lus
resuite
asiatiques en laine et en cotton
nos
à
r.
de
manufactures
ce
degié
de
drap
perfection
passer de celles des étrangers malgré
olTeijs
les
à
draps
tctis
D'ailleurs
ce
de première qualité qui sont
les
nos
entrepreneurs.
recherchés dans commerce chinois, mais 1rs draps prus«
Si
*
692
Le manque de ces draps
moycnm? qualité
de
siens
dant quelque tems a dû considérablement renchérir le
marchandises
2)
Les
de
teinture
bois
qu'on:
trouvera,
coloniiiles ,
pervthé.
couleurs et le
les
soutiennent nos manufactures jusqu'à ce
moyens
des
pour,
remplacer par des
les
produits, indigènes..
buchares: font
3), Les. cotroneries
peu
si
tort
à nos cot-
tonneries que ces dernières sont dti nombre de nos
factures
les
Il
Y a
manu-
plus florissanies.
encore
des
mnntifiictur^s
fabricpies
et
nisses
qui ne sont pas de l'importance de celles que nous- avons
indiquées,, mais qui
1)
2)
paroissent prospérer,.
sont
les chapeaux Russes apportés à la foire pour 400,000
miroirs
les
meubles
et
savon.
_
-
4) dilTérens ouvrages en
fer,
3)
telJs
le
..
r».
_
^
-
62.^,000 —
_
-
-
Soo.moo _-
cuivre, étain -
971,1100
—
Un commerce très considérable se fait en perles unes,
ambre jaune
Les
etc..
11
montoit à un million.
pelleteries russes
tandis;
que
petite
somme de 40,000
les
2,220,000 de
r.
ne sont marquées que pour
la,
montoient
étrangères
,
les
à
vins de Tà^anrog et les
eaux-de-vie de Kislar surpassoicnt celles des
liai
quautiié^, notre faiance et nos cry.slaux
étran^^ers pour.
de même,.
—
••
•
.
693
un coup
lettons
d'oeil
produits ,
les
bord de la rivière
tout est national et la
ici
montoit
iiKitchandises
l'autre
L'agriculture et les mines exposent
an port de Liskowo.
leurs
sur
à
8
valeur de ces
millions et demi.
Parcourons
principaux arlicles
i)
Cire
_
_
Poisson salé
Caviar
Huile de
produits agricoles-
—
lin
—
—
—
—
—
Potasse
Chevaux
—
Goudron
pour
—
—
—
—
—
CfTanvre-
__
108,490 roubles
10,175
—
20,910
—
12,000
— ~
— —
— —
— —
total
2)
Cuivre de fonte —
CoxYie blanc
—
—
18,720
—
112,725
—
29,50O
— — bètes à cornes —
— —
— — lièvres
— — moutons — —
•—
— chevaux- — —
—
-
38,2 5 O
232,9-31
—
Peaux de rennes
—
411,480
72,386
—
—
—
—
339,587
—
6 50,47 5
—
2,057,729 roubles
produits des mines
_____
—
__
_
1,620,1 85 roubles
12,880
—
694
non ouvré
fer
de diffcientcs
fer
ouvré
______
fer
de fonte
—
^
_
Acier
Souffre
qualités-
—
_
_
__
_
—
_
_
_
—
Pierres à moulia
.
4,007,738 roubles
—
—
—
—
—
414,579
—
_
—
_
58,584
69,068
2 5,OQO
126,300
6,334,334 roubles
total
de ce tnblcau que Malvariew
est
le
non apprêtés
et
le
commerce
en chcviuix, en cire et en potasse y
est
résulte
Il
marché pour
cuirs
les
du tjbleau qui
antres produits agricoles
quées
ici se
Mais
consument à
c'est
surtout
la foire
et
que
grdnd
considérable, les
n'ont pas clé mar-
aux environs.
par son commerce en métaux ou-
vrés et non ouvrés que cette foire se distingue, la quantité
de
fer
non ouvré
cuivre est grande.
'
est
réellement étonnante ,
combitm cette
du
Voilà nos fabriques naturelles.
La comparaison des années 1811
noitre
celle
r)ire
avoit pcidue
et
181 3
par
fera
con-
l'invasion de
l'ennemi , quelles mdnuf<jctutes bdis5oi<fnt et quels aiticles
se sont soutenus ?
695
Marcliandises
1.1
toirc
apportées
de Mak.iricw
à
695
Marchnndiîes iportées ï
la foire df Mak.iricw
de dîmes et bottes
de Moscou
souliers
en
i8i3
plus
pour
14 1,00^ r,
5o,ooo
40.000
i36 000
3,771 '0 °
1,763,600
porcelaine, f.iiance etcrystaux
21 T, 000
3^0,000
miroirs et meiiblcs
6
8, '00
<?4i>'^oo
1,914,000
2,3'i7,ooo
4,4of^»ooo
35 1,000
3.a'^4,ofO
ouvr.i2:es en ftr, doux, haches
455, or o
1,146,000
104,000
savon
5oo,ooo
:i5o,ooû
493,600
i56 40
s5.5,4.oo
9.;
petites toileries
sucre, thé.
vins
couleurs
eaux
et
Kislar tt
de
vie
91,000
87,000
ioo7j5oo
1
i5,ooo
386, 5oo
de
deTaganrog
293,o'^o
diftcren tes marchand iiPS Bu,
chaies et cuirs de Russie
coffres
et cabarets
ha'^illcmcns russes et
r.lk
et bougies
fruits
grosses toiles
tjbac
souliers,
QOQ,oao
80,100
540,300
384,5oo
22,000
3,000
17 000
8 .700
117,300
45,600
pelleteries ordinaires
j8'?,ooo
188,600
horlogerie
ÔOjOOO
_QO,O0U
équipages
3û,5oo
nattes
'27,500
Diiel
,
129,000
1
55,800
bottes et bas pour
paysans
les
S,10t)
7,500
poissons ,
chandelles
•
•
697
La
fdire
nnfactiues
avoit donc presque baissé d'un
de Moscou
ëtoient
celles de Sfnoknsk. avoient
en
grande
beaucoup
tiers,
pariie
souffertes,
les ma-
ruinées,
de
la
là
diminution considérable des cottonneries et soieries légères
et fortes, des perses, des marchandises en laine, des argen-
A cause du manque des capitaux de Moscou les mar-
teries.
-chandises coloniales devinrent rares et le commerce avec les
Buchares languissoit. Les manufactures qui se sont soutenues k
foire
ou qui ont peu perdues étoient les toileries de Ja-
roslaw ,
toutes les autres ont considérablement diminuées,
la
ou d'un
Au contraire les passemens d'or
d'un
tiers
qui
ont leur marché en Géorgie et en Arménie,
quart.
la
bon-
neterie, les petites toileries, les porcellaines se trou voient
en
plus
sont
assez
Taganrog
tout
et
grande
quantité
bien soutenues ,
et
de
remarquable
à la
les
Nos
foire.
de
vins et eaux - de - vie
Kislar ont gagnés, mais
c'est
pelleteries- se
la tjuantité
ce
qui est
sur
de draps, de nanquin
de thé.
Marchandises arrivées au port de Liskowot
i)
cire
—
produits
en 1811
poisson salé
—
—
_
-,
_
caviar
Mémoires de rA(ad.
T.A7.
agricoles
108,490 en 181 3
7,75o
10,175
—
—
—
2O3910
-
—
500
^^
•
698
huile de lin
en
1811
12,000 en 18 13-
chanvre
—
—
—
—
38,2 5 o
-
—
18,720
—
—
—
112,725—
_
—
-
goudron
potasse
chevaux
cuirs
~
de bétes à cornes
—
—
—
—
—
—
lièvres—
moutons
— chevaux
—
—
~
41 1,480 —
72,886 —
339,687 —
650.475 —
282,931
—
—
—
—
—
—
—
—
2,057,729
2)
rbls.
cuivre fondu
i,620,i85
cuivre blanc
12,880
non ouvré
pierres à moulin
fer
ouvré
fer
de fonte
acier
souffre
pierres à
firipperie
3o,000
—
—
9,100
—
47,350
produits des mines
en 1811
fer
—
—
—
—
en 1 8 1 3 roubles cop.
223,435
4,007,738
2,385.646
126,300
69,000
414*579
248,561
58,584
76,120
—
—
69,068
268,501
25,000
3,33o
moulin
126,300
69,000
6^334,334
3,284,593
65,800
4,400.
60
699
Les
disparu
produits
presque
avoient
agricoles
chevaux étoient
les
tout
à
fait
à
la
foire ,
marquant,
les
productions des mines avoient diminuées de
la
Les suites de
moitié.
plus désastreuses
la
guerre
le
donc
furent
pour l'agriculture que
seul article
pour
encore
les
mafnu-
factures.
On vend ordinairement
que
plus
chandises apportées à la foire ,
des marchandises arrivées en
ainsi
c'est
i8i3
moitié des mar-
la
que
la
valeur
étoit
de 30,915, 85o
dont on vendit pour 19,444,870
reste
Le rapport général
le
commerce
a
11,460,980
sur la foire de
repiit son
tées à
Il
est dit
la
foire
comme en 1811
dises avoit été
:
que
la
ait
pu
5o
que plus que
vendue ,
est étonnant
il
arriver
en
si
peu de
valeur des marchandises appor-
avoit passées
et
1814 prouve, que
ancien cours, et
que ce changement heureux
tems.
roubles.
millions
la
de roubles tout
moitié des marchan-
comme c'étoit
arrivé
même pen-
dant la foire de 181 3.
Voici encore quelques détails sur la vente de 1 8 1 3, les
soieries fortes à la manière perse ont été bien vendues puisqu'il
700
y en avoit 'moins qti'jutiefois, car de la valeur de 3,069,(300
vendu pour 2j08o,000. Les passemens
roubles, on a
de
même
de 58o,ooo, on
car
,
d'or
vendu pour 435,000»
a
mais les cottonneries et soieries n'ont
pa^s
été recherchées,.
à peine en a t-on vendu un
de
la
tité
peine vendu la
que
quels on n'a voit apporté
la
surchargé et
étoit
Le commerce en
manquoient.
les acheteurs
marché en
le
grande quan-
nanquin et thé on a à
de draps, mouchoirs de soie,
moitié ,
et
tiers,
livres ,
des-
moitié d'autrefois,
alloit
encore pire, on n'en vendit que pour 4,000 roubles d'une
valeur de
147,000.
Les
serviettes
et
nappes
et les
vendit
jusqu'aux
deux
comme
aussi
ustensiles
les
et petites cottonneries ,
fils
pelleteries alloient
la
faiance ^
en
cuivre
et
en
meubles ne
le
étain.
Les
recherchées, de i,763,5oo
vendu pour 1,41 5, 5oo, mais
les
on en
bien,
mais Targenterie alloit mal
tiere ,
marchandises coloniales furent
roubles, on a
les
furent
la
pas.
porcellaine^
Les vins de
un
et
les
eaux de vie de Kislar
grand débit,
car
malgré qu'on en eut apporté pour deux
Taganrog
millions trois cents mille roubles, ou
plus qu'en 1811,
il
676,000 roubles.
Un
la foire
il
de Makariew
eurent
très
presque pour 400,000
n'en restoit que
pour
des
plus renommés de
articles
consiste
en
lès
la
valeur de
manufactures buchares,
n'y en avoit pas le quart d'autrefois,
mais ce
qui
s'^f
701
trouvoit fut assez bien vendu, delà valeur de 1,1 46,000 roubles
on
vendît
cle très recherche,
tabac
il
Le
pour 748,000.
vcndoit
se
il
un
iuti-
presque tout , quant au
n'en restoit qu'un cinquième, l'horlogerie se vendit
mieux que
les équipages.
Des personnes entendues dans
merce ont calculé qu'à
capital
fut encore
sa-von
foire
la
de 30,91 5,85o roubles
admettant
le
les
de
1
alTaires
8 1 3
il
1,868,365
de ce com-
y eut sur ua
de
profit.
nombre rond de deux millions sur 3l ,
aiuoit 6 i pour cent ,
profit
assez
modique qui
se
En
on
trouve
dans tous les grands rcviremens *).
2.
1.
Les produits de
et
en
fer,
nufactures
les
des
marchandises
*)
a
foire d'Irhit.
la
Sibérie
en
pelleteries,
en cuivre
marchandises chinoises de Kiachta, les
Buchares
arrivées
par
européennes
par
Moscou
Orenbourg et
et
males
Archangel
Des voyageurs instruits assurent: qpe dans les années communes il
y avoit jusqu'à trente millions de roubles en argent blanc sur la
place, et que le revirement des marchandises montoit jusqu'à trois
cents millions de roubles en assignats; que les marchands detrentedeux
Gouverna mens se reiidoient à cette foire et la noblesse de six,
que le total de la population montoit à 3oo,ooo personnes ; qa'on vendoit pour un tiers de marchandises en argent et pour un autre
tiers à lettres de change.
Le grand marché fut consommé par les
flammes en itiiô et la foire transférée à Nigegorod en itiij.
*
702
(Changées depuis
fuient
Gouvernement de Ferme,
de
rivière
la
foiiC se tient
Irbit
au
bourg
Irbit
au
bourg d'Irbit
à une Averste de l'emboucliure
nomment
Tatares
les
Irbcc.
La
environ trois semaines. Le
et elle dure
fondé en i633 fut
tout près de
grand marché
siècle
de l'hiver a la mi Janvier pour pro-
fort
du trainage,
fiter
que
17"'®
le
la
nommé
ville en
1775. Le
forme
un carré
cathédrale
en bois qui contient 91 boutiques, et deux autres rangées de
boutiques dans
Aux envi-
en renferment 58.
l'intérieur
rons on construit pour le tems de la foire encore d'autres
où
boutiques,
boissons et des
est
tour ,
vend
les
provisions de
bouche, des
marchandises peu considérables.
La
ville
de palisades et a deux portes, l'une sur le
entourée
chemin
l'on
de Tobolsk ,
l'autre sur le
chemin de Wercho-
qu'on ferme le soir pendant le tems de la
foire.
Les données que nous avons pu consulter se bornent
à Vannée
de
1814, où
à
se ressentoit encore des désastres
Les marchandises arrivées à
Moscou.
évaluées
l'on
la
somme
de
5,01 5, 800
r.
argent comptant pour 2,7 74>85o
€t à crédit
pour 1^097,850
3,771,910
roubles.
la
foire
furent
dont on vendit
703
Il
pour
donc
eut
y
vendu, mais
plus
anciennes
les
pour
1^
r.
de
manque d'argent
le
de
lettres
prochaine
1,143,890
change
On atiroit
reste.
trop sensible,
étoit
durent
être prolongées
de Rlakariew. Des 149 boutiques
foire
du grand marché, c3 étoient
restées vuides et
rons on ne comptoit que 32
boutiques.
aux envi-
Le nombre de mar-
chands étrangers montoit à 25l, les plus nombreux étoient
ceux de Catheiinenbourg 28, de Tobolsk 27, de Moscou
Kasan
de Tioumen 12;
i3,
20,
de
étoit
plus nombreuse.
Les
cottoneries
étoient
l'article
autrefois la foire
qui
se
tronvoit en
plus grande abondance, 29 boutiques en étoient remplies,
les
manufactures européennes et asiatiques montoiant à la
valeur de
1,798,000
r.
et se
vendoient à meilleur mar-
ché que l'année passée.
Dix boutiques
pour 275,000
à
tité
la
r.
foire
renfermoient
Le thé
et
Les
qu'en
les
soieries
181 3,
le
filatures
et le
thé
se trouvoit en
revenoit à 80
que l'année passée,
marché, mais
du
r.
et
du nanquin
trop petite quan-
plus cher
la
caisse
nanquin au contraire étoit à bon
avoient rencheries.
drap se vendoit à meilleur marché
les pelleteries
étoient en assez grande quan-
.
704
comme
mais
nombre des acheteurs
tité
à
étoit
plus grjnd que l'année passée, elles se vendoient à
la
foire ,
le
lo pour cent plus cher et encore au delà.
En
ar^^enterie
enivre
de
des
mines
tre
une
avec
le
pas
en
r.
petite
r.
en
r.
En ustensiles
quincaillerie
et
Le produit
ouvjé pour 2 3o,000.
fer
épingles
donc pour cette
foire
quantité
d'étain
qui se trouve confondue
Le
se vendit tout, le cuivxe
étoit
bois de sandal.
bien,
si
52,000
pour
8 5,000
pour
y eut pour 2 5,ooo
il
fer
mieux,
quincaillerie
.la
de 392,500
l'argenterie
r.
ou-
assez
bien
En porcelaine et en faiance on trouvoit pour 120,000, r.
dont on vendit
et
un quart à
Le
povl-é
sucre
La
r.
fut
piesque tout vendu.
fit
et on
avoit ap-
en vendit pour 199,200.
alloient
assez
bien, de la valeur
ne débita que la moitié de ses marchan-
montoient
caracicristique
qui ne
r.
On en
on vendit pour 65^500.
librairie
qui
quarts, la moitié pour de l'argent,
crédit.
cuirs apprêtés
72_,900
dises
trois
pour 209,200
Les
de
les
qu'elle
à
10,000
est la
point 'de crédit.
r.
mais elle
seule
eut
cela
de
branche de commerce
7o5
Xes
couleurs
pour 25,000
Le
r.
furent
papier
d'écriture
prix pour ces contrées.
•ce
très
recherchées,
y en avoit
il
et on en vendit pour c^^ooO'
est
une
marchandise de grand
On en ^àvoit apporté pour 78,950 r.
qui est beaucoup en proportion d'autres
et on
iirticles
vendit pour 62,000.
•Les
fruits
font encore
du commerce
article
on en avoit apporté pour l3o,6oo
'de Sibérie,
comptant
dît argent
un grand
pour
68^,860
r.
à
et
et
ven-
crédit-
pour
r.
6o,35o, total 129,210.
La
de
le
3
de
nature
le
faire
change
forçoit les
marchands
On
payoit pendant
la
du cuivre contre des
petits assignats
de 2 à
du rouble
k.
'marchandise
la
de
plus
crédit.
et le -rouble
d'argent 3
r.
foire
80 k. jusqu'à
10 k. en billets.
4 r.
Le commerce dans ces boutiques construites pour le teras
de
la
foire
commerce
et
eiî
aux environs du grand marché où
poissons,
se
fait
le
en tabac, en houblon, en boissons
provisions .de bouche
étoit ,
proportion gardée ,
plus
actif
que celui du grand marché.
Ces 32 petites bouti-
ques
renfermoient pour
i.
on en vendit pour
et
1,243,600
7 83,700
r.
de marchandises ex
comptant
pour 264,700 à crédit
total
1,048,400 roubles.
nUmoirc) de VAcad.
T. VL
Sp
':o6
La
d'Irbit
foire
été
a
anlrcfiiis
plus consMcrable et
comme elle fur ])<nticiilièrement fournie de i\]o:-;cou, eUo n'a
pu
se
relever aussi
tre
de
la
avoient
En
Russie,
très
l'ordinaire,
de
nous avons
d'Irbit,
dont
née
où
le
être
comparée
commerce
à
la
et
de
foire
malgré que
Makariew ,
de
la
foire
tableau pendant une an-
le
que Makariew
jours pour la Sibérie ce
la
encore très gêné ,
étoit
foire
y en '^a voit beau-;
il
8 i3 que dei 79,410 roubles.
j
fait
Moscou
de
revirement à
le
données que
ces
plus au cen-
situé
miirchands
les
14
surpassoit celui de
resuite
Il
1 8
peu de marchandises
coup moins qu'à
1814 ne
que M.ikiiricw
vite
ne sauroit
elle
tou-
est
pour la Russie
est
européenne.
3.
La foire de Rom en.
Les
foires
de
la
Russie
et
pour
aprésent
tantes
Makariew
pour
une seconde
a.
pour
certaines
la
et d'Irbit sont les premières
classe
jéunit
de
Poltawa
avec
le
quatre foires ,
est
de
située
foires qui
La
contrées.
de
foire
sont impor-
Romen
l'est
Cette ville du Gouverne-
surtout pour la petite Russie.
inent
Nous venons
Sibérie entière.
sur
Dnepre par la
la
rive,
rivière Soula
gauche.
dont celle qui commence
a.
La
la fête
qui se
ville
de
a
St.
707
Elic est
pins réputée, «lie dure depuis le 20 jusqu'au
la
3o de Juillet
nom d'une
mérite le
et
fcte
La
nationiile.
noblesse des Gouvernements limitrophes, un grand nombre
personnes
de
o;uées
s'y
Une
faires.
foire
chandises
arrivées
dans
sentir
aussi
pour
8,59i,85o
k
3,802,525
de 4,789,325
r.
la
sur
ces
foire
que
la
surpassé ces
a
La valeur des marla
de
foire
manque
St.
Elie
d'argent se
et
on ne vendit que
donc un
reste considérable
contrées
eut
y
il
le
et
fait
af-
dommage qu'il n'y a pas plus
aussi
intéressante.
Tout ce qu'on
nature de ce commerce c'est qu'il est surtout
pour
calculé
Mais
r.
C'est bien
r.
de détails sur une
sait
monde
beau
pour
1814
en
distiii-
s'amuser que pour
même celle d'irbit.
années
fit
personnes les plus
marchands
des
visitée
deinicies
montoit
de
affluence
telle
très
est
les
enfin
titrées ,
rassemblent plutôt pour
les
premières
classes ,
parconsequent on y
trouve les soieries, les cottoneries , les toileries étrangères
et
russes
,
les
quincaillerie en
modes
porcelaines ,
abondance.
plus remarquable
ici
,
c'est
le
crystaux , argenterie,
Quant aux
autres
tabac d'Oukraine
articles le
qui se vend
en grande quantité.
4.
La
La foire de Korennaia Poustina.
religion
a
fait
naître depuis plusieurs siècles cette
89*
708'foire
célèbre.
cette
foire
i3oo
Monastère près duquel
le
à 27
tient est situé
se
d'OreL
droite de Id grande route
en
ou
L'hêimitage
la bannière de la
Averstes
C'est
de Koarsk à
ici
qu'on, trouva
Vierge placée sur un tronc
St.
même de- la: nativité^ d'où vient le nom de
En 1597, on y bâtit
rhérmitage du tronc; (Korennaia).
d'arbre le jour
une belle
en pierre en honneur de la nativité de la
église
Vierge,
sainte
une
puis
trouvé la bannière C'est
de
la
Un
pied, d' une
au
située
bel
orné
de
rins
à
montagne sur
la
Touskara.
rivière
degrés ,, large
commode,
et
colonnes en pierre et cotivert,. conduit
l'endroit
les
pèle-
le
saint
où parut
pour
montagne..
Bientôt le monastère eut une
sur,
la'
'enceinte
en
pierre
Gouvernement
la:
première
encore une église;
et
fois
Mais
1612 son Monastère
eut en
en 1618 qu'on transporta
^ille^
fondemens de cette église
les
i3o
de
escalier,
'étendard
du
qu'une source d'eau vive jaillît
ici
quand on posa
terre
à l'endroit, où l'on avoit
autre
la
la
ville
et c'est
bannière de l'hérmitage
à la
mais on la rapporta toujours à l'hérmitage en grande
procession,
procession se
mense.
le
Mais
vendredi;
pendant 149
fit
Depuis
marqué que
minué..
neuvième
le
1767
elle
après
ans^. et
ne
Pâques.
attira, un
se fait
Cette
monde iœ-
plus et on a re-
nombre de pélrsins a considérablement dilai
foire
qui.
a,
pris. son. origine,
pendant les,
i
•709
peuple
céremonicns
religieuses
bords
de
la
Tonskara
,
les
seigneurs
rians
chevaux
en
ceux
cWevaux
est
mencèrent
foire
Le commerce
se
fit
les
d'abord
des environs les vendoient ù
venoient en pcJerinagc, et encore le marché eu
c]ui
ici
leur
Les
considérable.
très
inseiîsifolertTena;
de
produits
annuellement
encore
.payer
>a
industrie
les
acheteurs
chevaux pur
et c'est ainsi
que
comles
s'établit la
près de l'hérmitage du tfone.' IPÎus de cent familles
dé gentilshonimes établissent su| la pelouse leurs tentes,, d'autres font construire des
maisonnettes en plajaches ou en-claye,
chacun a sa fantaisie. Un petit bois pxès dé la rivière sert de
point de
et
C'est
réunion.
près
400
Environ
villages.
Delà
parcoiut
diins
le
l'oeil
lointain
nombre de
boutir[ues s'élèvent sur la
plaine,
marchands de Moscou et d'autres Gouvernemens étalent
leurs
le
les tentes
maisonnettes ^sMtablissent.
les
une vaste pwi rie et découvre
les
de-ce hais que
marchandises ,
bois
une foule immense se répond depuis
sur la prairie autour
du Monastère,
le
long
des boutiques,
aux environs
de la rivière et se promène dans
le bois; les uns sont en ^iTair^es, d'autres vont en pèlerinage,
d'antres
s'amusent.
marchands
de
St.
A
la
foire
de
1814
Pétersbourg , de Moscou ,
Jl
y eut des
de Jaroslaw,
de Twer, de Novgorod, de Kalouga^ de Toula, de Tambovv,. d'Oicl,
de Woronesch, de Charkow, de Jekaterinos-
•
.
7 >o
de T.ïg.inrog,
liiw,
du
de .\\ichitschewan, ville commerçante
CîoLiveineinenL de Jckateriooslcuv située sur le Don, des
marchands de Kisiar, de Kiew, de Clierson, d'Odesse, de Nigecforod,
de Tscherni£;ow, do Poirawa, de Kasan, de Kasimow,
de Staracloub, de Kostroma, de Sousdal
Leurs marchandises montoient à
Les
articles
les
-
—
et
d'autres villes.
7,616,000 roubles.
plus marquans éloient
-
pour 984,000 roubles
476,000
—
~
_
—
—
—
2 75,ooo
—
—
peaux de lièvres et de moutons
267,000
—
—
596,000
—
^
—
—
—
—
345,000
soieries
-
cottonerie
_
-
toileries
—
—
draps
—
argenterie et modes
»-
pelleterie
_
perles
cire
-.
-
_
ustensiles en
fer
couleurs et viiiiol
chapeaux
—
ustensiles en cuivre
—
—
—
—
—
974,000
546,800
860,000
48^'^^*^^
94,000
26,000
169,800
—
—
—
—
—
—
—
—
Vins et eaux de vie de Taganrog,
de Kislar, Odesse et Nigen pour - 95,000
ustensiles en
bois
—
—
40,000
—
—
-Jll
On remarque suitonr ces ustensiles en bois faites d'une
mcinière très élégante
par les filks des villages d'<ilentour
qui les mettent aussi en couleurs tiiéesde plantes sauvages.
Chevaux cosaques
et des steppes
de Id Tauride pour
3o6,ooo roubles ,
mêmes contrées
poissons salés arrivés des
99,600 roubles.
Le beau ou
mauvais tems
le
influe
succès de cette foire; malheureusement
continuelles
étoient
pendant
affreux.
foire
la
vendit
que
marchands
furent
obligés
on
tïouvoient pas
il
1814
pour
2,865,000
de vendre
à
sur le
y eut des pluies
et
C'est pour cela qu'il y eut
ne
et
de
infiniment
r.
les
chemins
peu de monde
Beaucoup de
tout
prix et ne
même à qui laisser leurs marchandises.
712
RESULTATS STATISTIQ_UES
SUR L'ÉTENDUE DE LA SURFACE ET SUR LA
POPULATION DE L'EMPIRE DE RUSSIE
DEPUIS I805 JUSQU EN X8ir INCLUSIVEMENT
P A R
C.
Présenté à
J'ai
calculé
HERRMANM.
T.
la
Conférence
données que
les
5 Avril
le
je
i8i5.
possedois d'abord par
tGouvernemens -et puis par plateaux.
Première partie.
Résultats statistiques sur l'Etendue et la Population de
la
i.VEtenduc
1.
delà iurface, .
,
,
degrés
B^'ssie
par -Gouvanemens,
Etcudue.
L'Empire de Russie
t\-^ j
latitude
xt
,
,
^ord jusqu au
«onie
78
s étend
et
depuis le 43
occupe parconse-
qucnt un espace de
35 degrés de
de
38° 5o^ jusqu'au 208° de
?'
étend
depuis
le
Ferro, ce qui fait un total de
Sa
suiface
est
environ
latitude.
Sa longitul'Isle
de
169^ degrés de longitude.
de 295,1 52 milles carrées ou de
1,478,258,146 Dessatines.
7i3
Dans
espace
cet
ne sont pas compris
Don
non \ elle
la
:
le
pays des Cosaques du
les
nouvelles conquêtes faites sur les Turcs et
les Perses, la
Géorgie, la steppe des Kirgises^ les posses-
Finlande
,
Tarnopol,
le
,
district
de
de la Compagnie Américaine et Nowaia Semia, puis-
sions
que
les
données sur leur étendue ou manquent enticrcmeni
ou paroissoient suspectes.
De cette étendue de 295,152
milles
carrés
vernement d'Irkoutzk occupe environ
127,088,
Tomsk
85,387,
celui de
Tobolsk
et
de
le
Gou-
l'étendue de la Sibérie est donc de 2 12,5 7 5 milles carrés ,
reste
pour
rés.
Nos
données
la
Russie européenne 82,67 7 milles carl'étendue
sur
des
Goiivernemens
midi Cathciinoslaw et Cherson , Astrachan et
sont
du tems où
rinosldw
et
la
et
ces
Caucasie
Gouvernemens
étO'ient réunis.
2876
carrés,
Cherson ont
Caucasie
la
5742.
milles
Cathe-
Astrachan
Les autres Gouvernemens suivent
dans l'ordre suivant selon l'étendue de leur surface
1.
du
3
714
-
~
Waetka — —
Nowgorod
—
8.
6.
•;.
9.
10.
11.
12.
1.3.
14.
i5-
Olonetz
3,147 milles carrés
—
—
2,06
—
—
Kostroma
1,808
Minsk
— — 1,755 —
— 1,434 —
Woronesch
—
Simbirsk
1,408 —
— ~ 1,327 —
Podolsk
— — 1,284 —
Wilna
— 1,170 —
Tschernigow
12,221
—
—
17. Volinsk
—
18. Tambof
—
—
Kasan
19.
—
20. Smolensk
16.
Twer
21. Nigegorod
-—
22. la Livonie
—
23. la Tauride
—
—
—
1,1 35
—
—
1,072
ij044 —
—
1,008
961 —
953 —
83l
8o3
—
— —
8oa
27. l'ancienne Finlande
781
Orel
a5.- Whidimii
26. Pleskou
q8. Pensa
_
_
zgj St. Potersbourg
—
1,1 32
~
24.
-
—
—
795
77.7
7.74^
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_^
—
TiS
3o.
—
.
716
pour
base
poitoicnt
est
l'dn
36,329,962
1810.
Les états
personnes
des
Capitales, le militaire, les peuples
ces nouvellement aquises.
siii:
la
population
deux sexes
nomades
et
sans les
les provin-
Ici commence le Gouvernement de
— 1,391,626 iiabitans. des deux sexes
— — — —
—
2. Koursk
1^212,703
— _ _ —
"
3. Podolsk
1,138,968
— — — —
— ~ 1,137,281
4. Kiew
— — — —
~
5. Volinsk
1.112,783
— — —
—
6.
Moscou
1,108,20g
— 1,077,662 — — — —
7. Tschernigof
— — — —
—
8. Tambof
1,029,778
— ~ 1^024,5^4 — — — —
9. Orel
— — — —
10. Twer
—
1,009,249
— 979,426 —
11. Woronescli
— — —
— _ — —
—
12. Waetka
949,988
13. Perme
— — 940,078 — — — —
—
— — — —
14. Smolensk
919,828
—
— — — —
i5. \\'ladim,ir
907,469
—
Res.in
_
16.
— — — —
903,769
—
— — — —
17- Toitla
896,972
Xige^orod
— — — —
~
879.897
— — —
19. Simbirsk
—
854,090
1.
Pultawa avec
•
-
,
"
1-3.
20.
Minsk
—
845,248
^
,_
—
—
m
2 i.
Charkow avec
—
C2. Kasan
— —
2 3. Saratof
—
2 4- Kostroma
2 5.
VVilna
-
827,000
—
821,862
—
8i3,i32
-—
810,391
—
—
JarosLnv
2
—
28. Kalouga
— —
29. Piensa
30. Oienbotu-o:
—
2 6,
844'^36 habitans des deux sexes
Mohilei
7.
806,763
797,641
750,967
745,574
736,725
—
—
—
—
—
_
Pleskou
—
719,781
32.
VVitebsk
—
707,638
33.
St.
PëteisboLirg
666f66g
—
—
—
34.
Nowgorod
635^81
—
35.
Wologda
—
—
3 i
.
36.
Giodno
37.
la
586,836
—
^
—
573,611
—
—
427,066
—
Livonie
38. Tobolsk
39.
Ccitherinoslaw
40.
Id
41. Irkonrzk
416,55a
—
Courldndc
--
—
—
43. Cherson
—
44. la Tauïide
42.
Tomsk
606,547
387,439
376,740
293,967
—
—
—
^
—
280,406
25j,825
—
—
_
_
—
_
— —
_ __
— __
— -^
_ —
_>
__
—
_ _ —
_ — _
_ _, _
>_
_—
^
— —
_
—
— —
-«
_
—
— __
—
— —
-_
—
_
^
_
~
_
—
_
^
.
^ —
— ^
— —
1
45. l'Esthlande avec
— 211,170 habitans des deux sexes
46. Archangel
—
20i,3o5
47. Olonetz
—
199,549
—
48. la Finlande
—
49. Biaîystok
—
50. Astidchan
Si. la Caucasie
--
-
—
—
—
—
—
—
195,822
193,903
68,63
62,773
—
—
—
—
—
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —
Les capitales se trouvant sous un Gouvernement particulier
ne
pas
sont
Gouvernemens
comprises
Moscou
de
et
dans
de
population
des
Pétersbourg.
En
la
St.
1814 la population de Moscou éioit de 124,553 hommes
et
61,520 femmes
de
1
Celle de
St.
86,o55 individues.
Pétersbourg consistoit en 243,620 hommes
et
100,457 femmes
344,077 personnes
total
des
deux
Le
530,132 habitans
capitales.
militaire
circonstances
ne
dont le
nombre doit changer selon
sauroit être évalué à moins de
les
600,000
hommes.
Les peuples
lion
ti
nomades qu'on peut évaluer à un mil-
demi ne sont pas compris dans
la
population des
•J19
Goiivernemens
puisque les Gouverneurs ne
qu'ils habitent,
marquent ordinairement que
les
habitans dont la demeure
est fixe.
D'après cela le Gouvernement le plus peuplé Pulta-
wa, a environ
22
fois
plus d'iiabitans que le moins peu-
lO
Gouvcrnemens qui ont plus d'un
plé, la Caucasie.
La
Russie
a
27 où
d'habitans.
million
la
population s'élève d'un demi-
million à un million
12 où elle s'élève d'environ
300,000 à un demi million et
2 où elle est au desous dé 100,000.
pour juger de
îWTais
tion
il
pris
pour
base
exactement
les
comptée
On
s'est
servi
en
1795
et
revisionaires
et
qui
des états
du
à l'étendue
rapporter
la
finit
la
popula- 3- R-appore
terrain;
Oii ^j^^^^^j,^^
grandeur réelle de
la
comme la classe la plus tendue du
le
fait
complets
gros
de
la'
de
la
5*"^^
Le nombre des revisionaires
iigô.
nation.
révision
étoit
dé
18,094,012.
1.
Woscou
est
a
leur tête avec
j,020 revisionaires
2.
Kiew
3ù
Toula
-^
998
tgô
par
mille cajTéf
-'
—
—
—
720
4.
Pultawa
1
72i
28. WoronescTi
349
levisionaircs
345
-
299
—
par mille carr^
-
284
-.
32. St Peteisboiirg
255
252
—
—
—
—
—
—
—
2 5o
-
—
224
222
—
—
—
—
210
»-
^
i52
~
—
i5l
—
—
—
—
~
—
—
—
-..
—
.».
29. l'Esthlande
-
30. Simbirsk.
-
3i. la Livonie
33.
Minsk
-
34. la Finlande
35. Kostroma
-
36. la Tauride
37.
Waetka
38.
Nowgorod
-
39. 40. Cherson etCa[
theiinoslaw
41. Saratow
-
-
94
90
43. OienboLirg
-
69
-
34
42. Perme
44.
Wologda
45. Olonetz
32
-
^
—
-
46. 47. Astiachan et
la
Caucasie
48. Archarigel
17
-
7
:-
-
5
-r
—'
il
^
^
49. 5o. TobolsK et
Tomsk
5l. Irkoutzk
Mfmoira de l'Atad. T. H,
-
9
^
•
La
le
population
Gouvernement de Moscou
pays
680
moins
peuplé ,
fois
plus
comptés
et compris
resuite
de
étendue de
snr
Id
nu-ine
d'htil)itans
que
le
Cîouveincinent
Celle
ptojjoition
tous les nomades de ce
si
Il
inéi^alcment partagée ;
tics
a
Irkoutzk.
saillante
la
donc
est
dans
le
nombre des
tableau
ce
moins
seioit
Gouvernement
le
étaient
revisionaires.
que 16 Gouverneniens de
Russie ont par mille carré de 5oo à 1000 revisionaires,
j
Gouverneniens
8
une population de 2 5o à 5oo hommes,
6 Gouveinemens
une populaticn de i5o à
2 5o,
7
une population de
1 7
a
Gouvernemens
100 habitans,
et
4 Gouvernemens
moins que 10 revisionaires par mille carré.
Les Gouvernemens
plus peuplés sont ceux où se
les
trouvent les anciennes Capitales de la Russie, Moscou et
Kiew.
De
ces
de la Russie
deux points de ralliement,
européenne
diminue vers
âmes par mille carré jusqu'à
7
le
la
population
Nord de 1000
à ArChangel ;
\'ers
le
sud
jusqu'à 34 dans la partie septentrionale de l'Ouialà Wologda,
jusqu'à
90
sur le milieu de l'Oural à Perme, et jusqu'à 69
1
723
sur
rOmal méridional
à
septentrionale
de
partie
Finlande
Orenbourg; vers
cSo, vers
jusqiui'
le
dans
frontière
cette
l'Ociest dans la
l'ancienne
milieu à Bialystok et Grod-
no jusqu'à 472, au Sud en Podolie jusqu'à 439-
En
jettant
que
les
Gouvernemens
tre
Moscou
un coup d'oeil sur
Kicw
et
cela
encore
distinguent
ceux
parmi
.
où
se
trouvent en-
Toula, Orcl, PoUavva, Charkow,
;
environs de Kicw, enfin
Outre
Carte, nous voyons
mieux peuplés
les
aux environs de Moscou
nois.
la
Raesan, Kalouga, Wladimir, aux
:
plupait des Gouvernemens polo-
la
parmis
les
Tambow
provinces riches en bled se
Nigegorod
,
et
la
Courlande,
manufacturière et le commerce
l'industrie
sont parvenus à un certain degré de perfection, Jaroslaw;
Twer, Kasan; preuve incontestable que
dépendent
population
moins
est
le
sol
à
Waetka,
paysan
par
à
fertile
Nowgorod
autre
comme
stérilité
population diminue;
la
comme
me à Olonetz et Archangel,
là
où
le
en Livonie, elle s'arrêta
que celle du
à Astrachan et en Caucasie ,
Sibérie,
La ou
à Pétersbourg, en Finlande,
nomades comme en Tauride, à Cherson
en
progrès de la
des moyens de subsistance.
soufTroit autrefois,
une
1rs
sol.
Des
peuj)les
et Catlicrinoslaw,
des peuples pécheurs, com-
des peuples chasseurs
comme
s'éloignent par degié, en raison du genre de
91^
724
de
des Giipitiiux
permet phis
qui
indtislrie
leur
ou moins l'accumulalioa
population des peuples argicoles, ma.-
la
DiifacLmier? et commeiçans,
La Russie n'est pas mal peuplée, on ne sauroit le répéter
que
assez souvent j. elle n'a
militaiies
gleterre,
ses
colonies et ses avant-postes
et pas audelà
contigcies,
des mers
comme l'An-
Poitugai et l'Espagne; elle traite tous ses en-
le
même manière
fans de L\
ne distingue pas
et
de l'ancien
occupe et elle
sujet
ou
doit
occuper pour
vues
de commerce certains points et langues de
le
colon
la
rus.se,
sûreté de ses
elle
nouveau
le
pour des
frontières et
terre
sé-
pares des pays habitables par. des terrains inhabitables, et
occuper
parconséquent
longues
de
après
un
terrain
immense ,.
elle
politique
de
Giand ;
elle
que depuis
soufferte
nie
d'Àue
Allie
eu.
la
balance
une administration mieux organisée
II,
grande
les
Gouvernemcns légitimes
lutte
elle
et
la
à,
sûreté
depuis le rrgne de Pierre le
règne de Catherine
le
eu
maison de
la
devenue importante dans
l'Europe que
de
contre
n'est
n'a;
n'a
guerres civiles le bienfait de la
publique que par l'avènement au trône de
Romanow;
elle
a
beaucoup
entre l'anarcliie et la
,
lutte qui
Paris par les libérateurs, de l'Europe..
tyranvient;.
6
,
T2 5
D'après
les
deu.v
des
données
sûres
55o
Capitales
il
villes,
y
avoit en
dont
on
i8ll
sans/,. Fopuia
connoissoit
j^
populalion entière selon
"*
5
dont
villes
la
les
deux
sexes, ravoir:
population montoit de 3o à
-personnes, elles coniprennoient
1 33,
70,000
020 hommes
103,070 femmes
total
2S villes de
236,090 individus
10 à 3o,000 habilans
-
comprennans
23o,320 hommes
-
210,420 femmes
total
80
villes
268i82^ homme?
278,955 femmes
y avoifr
il
total
2.09
440,740 individus
avec une population de 5 à
1.0,000 habilan's,
villes
contenons
2
a
5ooo
547>7 83 individus
lia-
-
bitans parmis lesquels
336,098 hommes
332,917 femmes
total
l!2S
villes
de
tans dont
^lon
des
villei.
.
lOOO
à
-
2000
669^015 individus;
habir
—
93,o3i hommes..
90,685 fe;nmes
total:
18 3,7.1
personnes^
•726
loo villes dont la population
bitans.
Ces
villes
moins que de mille ha-
etoit
comprennoient
34,006 hommes
-
32,083 femmes
total
Les 55o villes comprennoient donc
66,089 personnes
1 ,.095,305
hommes
1,048,130 femmes
total
A
ce nombre
dont
Pétersbourg
il
la
Capitales: Se.
population
en 1814 de
étoit
2,143,435 habitans
faut ajouter les deux
243,620 hommes
-
et
de
100,467 femmes
Moscou comprenant
total
344.077 personnes,
-
124>553 hommes
6i,502 femmes
1 86.055
Grand total de 552
ëtoit
personnes
villes dont la population entière
connue: 1,463,478 hommes
1,210,089 femmes
2,673,567 personnes
Mais
il
y a encore
72 villes où seulement le nombre
des hommes est marqué, qui montoit à i5o,534 individus.
11
la
y
Russie
avoit
donc dans
les
1,614,012 hommes,
624
et
villes
de l'Empire de
en n'admettant pour
les
727
dont
villes
.
femmes
nombre de
le
que
100,000,
il
pas
n'est
marqué
aiiroit
y
1,310,089 femmes
Grand
2,924,101 habilans des
total:
On peut donc, en
luer
population
la
é^^aid
des
aux
villes
villes.
inévitables
erreurs
en Russie à
trois
éva-
millions
d'Iidbitans.
L'industrie
du commerce,
des
villes
est
des manufactures et
celle
des campagnes est l'argiculture,
l'industrie
pêche
l'éducation
des bestiaux ,
deux genres
d'industrie sont liés entre elles par les mines
et
les
salines.
On
qui prédomine
tiie
des
d'habitans
\à
pourra
dans
et
la
chasse ; et ces
donc juger du genre d'indus-
un Etat quand on
campagnes reviennent
sait
combien
un habitant des
sur
villes.
pour
que nous présentons méritent confiance
Les
rapports
les
anciens Gouvernemens russes, pour les provinces
balliques
et
pour
les
Gouvernemens polonois
sont basés sur des rapports détaillés.-
vernemens
le
où
se trouvent
nombre des habitans de
,
puisqu'ils
Mais dans
les
Gou-
beaucoup de peuples nomades,
la
campagne
et parconséquent les rappoits seront
est
moins
moins connu,
justes.
5î
-
72S
Sous ce point de vue
les
Gouvernemens de
la Hiissie
suivent dans l'ordre suivant:
Mohilew a un habit, des villes sur 3o habit, des campagnes
1.
2. VVaetk.a
3. Minsk.
4. Poiolsk
5. Kostroma
6. Wlddimir
7. la
Finlande
8. Raesan
9. Grodno
JO. Plcscou
11. Smolcnsk
12. Volinsk
13. Vologda
14. Pcrme
1 5
.
Nowgorod
16. Nigegorod
j 7. Simbirsk
.18.
Kiew
19. Pultawa
20. Irkoutzk
2 1
.
j2 2.
Witebsk
Oienbourg
—
—
—
—
—
—
^
—
~
—
—
—
—
—
_
—
^
—
—
—
—
—
_
—
—
—
—
„
—
—
_
_^
—
—
2g i
21
20
—
«—
20
--
^-
20
-—
,«.
—
—
—
—
26
23
22
22
21
19
19
—
—
—
—
—
-r-
—
^-
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i5
—
—
i8
_-
17Ï
*-.
^17
—
—
—
—
—
^
_
—
—
—
—
—
—
29
—18
—
—
—
16
ï5
1
-•
>
729
2 3. Koiirsk a nn habit, des villes sur 14 habit, des campagnes
—
—
—
24. Jaroslaw
25- Catherinoslaw —
—
26. Twer
—
2 7.Kaio«ga
28 la CoLulande —
29. Tambof
30. la
31
.
Livonie
Orel
32 Woionesch
33. Wiina
34. ToLTÎa
35. Saratof
36. Olonetz
37.Charko-w
38. Torask
39. Archangel
'
40. TEsthlande
41. Pensa
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
"
.13.
>—
—
—
—
—
—
11" —
>—
—
--
—
—
^
—
—
—
—
_
—
—
12
12
12
1
11
loï
>-
ic
—
10
—10
10
—
—
10
—
—
-
O'
—
=—
~"
'-'
—
=
_
._
""
~^
—
-^
45. Tobolsk
-
46. Bialystok
—
»^
Mémêir,, di l'Acjti, T. ;T
—
—
~
—
—
-
—
•—'
l3
—
-
TschernigcL
44: la Taïuide
14
9|
9
"9
42. Kasr
—
—
14
9
9
7
B
—
—
92
•7
30
4 habit, des campa ones
47- Chcison a un habit, des villes sur
—
—
—
—
—
—
—
raisonnement
général
48. la Caucasie
49. Moscou
50. St. Pctcrsbourg
Si.Astrachan
Le
mesure que
mais
en
,
—
—
—
tableau est:
ce
suï
qu'à
dans
font
un Gouvernement,
dans
souffre
des
Gouvernemens où
les
en lui
juste
très
Russie
nomades
peuples
l
a^
prédomine
villes
ce raisonnement
modifications
1 i
—
nombre des habitans des campagnes diminue,
le
des
l'industrie
~
—
—
—
3
les
mtMiie
principale population des cam-
la
pagnes, elle est ambulante et parconséquent moins connue,
mais toujours l'industrie des villes prédomine extrêmement
Tel
dans ces Gouvernemens.
la
Caucasie et de
le
commerce ,
daos
les
les
villes ,
à
entre
d'autres
rapport
de
l'
Sibérie
la
industrie
chasse
y a peu d'argiculture,
il
et
rassemblent
des
villes et
population
fixe
Moscou
hommes
les
l'
agriculture ,
ou plutôt
connue
mais
c'est le
à
la
populatior»
Mais parmis
les
Gouverne-
et
où l'industrie des campagnes
culture ,
les
pèche y trouvent
la
genres d'industrie argicole ,
la
de
ces Gouvernemens le rapport n'existe
ambulante et moins connue.
merrs
où
manufactures
Dans
graîids marchés.
pas
la
est le cas d' Astrachan ,
et Pctersbourg se
est réellement l'argi-
distinguent par la po-
731
En parcouranl ce tableau, on voit
pulation de lems villes.
les
rapprochemens les plus ftappans: Archan^el, Kasan et la
Tauride, donnent les mêmes propoitions, de même Toula, Olonezt,
Tom^k, mais en réfléchissant on devine aisément les
et
locales qui les ont produites.
ditTérentes causes
Les bornes
de ce^ mémoire ne nous permettent pas de développer ces
causes
un mémoire particulier,
exigent
qui
dont l'objet
seroit infiniment curieux.
Seconde partie.
Résultats statistiques sur l'Etendue et la Population
de
La
prise
ciel
et
sur
générales
sont
car tous les
elles
sr.it
sont
la
terre
la
pays
coupe
par
zones et par degrés est
indistrinctement
La division par plateaux
plus dilTérens.
prise
Russie par Plateaux.
d'un
division
du
la
qui
confuses
élemens
claires
nature
et
sans
les
suit
et
est
une division
nature du^sol.
Les vues
erronnécs selon la première ;
plus différens s'y trouvent mêlés,
justes
la
la
terrains les
les
selon la seconde,
gêner par
les
carrés
puisqu'on
des
degrés.
Dans un pays d'une grande étendue, dans un pays agricole,
cette, division
par plateaux est essentielle.
Nous distinguons sept plateaux dans
la
Russie euro-
péenne
92 *
732
i)
là
cîii
Nord depuis
bois de cliène
les
oïl
terre
pî.Ucau
le
no'ii-e,
commencent
comprend
il
mer £;Lici.ile )n=;que
la
les
et parconséqueTil
la
Goiivernemens d'Archangel^
d'Olonetz, deWoîogda, le Noid de Wa^tka et de Penne, enfin
la
Fin-îande,
St.
Pétersbourg et le Nord de Nowgoiod,
•2)
le
plateau des Goii,veinemens baltiques, c'est l'Est h.~
l£;ndc,
la
Livonie et la Couiiande.
autour des sources de la Volga,
3) l'élévation
aujourd'hui
4)
Twer, Plescou
et
Smolensk.
plateau de l'Oural depuis l'Oural de Catheri-
le
nenbourg jusqu' k
l'
élévation
dans sa partie orientale: le
les
c'est
Gouvernemens
gorod ,
Sirabirsk ,
du coté
droit
sur
la
Volga
il
',
Sud de Waelka
et
riches en bois de chêne:
comprend
de Ferme,
Kasan., Nigc-
Tambow, Oienbourg, Pensa et Saratow
de la Volga.
Dans
sa
partie
occidentale
:
Jaroslaw, Kostroma, Moscou, Wladimir, Kalouga, Toula,
Résan, Orel, Kursk et Woronesch.
5)
le
blanche et
plateau
\à
des
basses
terres
comprend
la
P'«L"sie
Lithuanle,
6) le plateau des ^Carpathes depuis la
qu'au plateau de l'Oural;
c'est
chnson ,
mer noire jusCatherinoslaw.
PultaAva, Ciiarkow, Tschernigow^ Kiew, Podolsk et Volinsk,
"
1
733
^)
plateau des steppes ou
le
Saratow du coté gauche de
tenes des Cosaques du
Les
les
de
caractères
Volga ,
la
Don et de
différens
a
nous intéressent pas
nous
parlerons
Par
de
rapport
îci
la
la
Tauride
mer
lii
et
les
noire.
chaque plateau sont exposés danr
mémoires de l'Académie T,
La Sibérie
Caucasie^ AstrachaH;,
la
page 662
i.
plateaux,
mais
seq.
comme ils ne
sous le rapport de la population^
Sibérie
à l'étendue
diviser par plateaux.
sans La
du
terrain les plateaux, sui-
vent dans l'oidre suivanc.
La Sibérie
le
a
plateau du Nord
le plateau
le
des steppes
plateau de Basses terres
l'élévation
les terres
sur la
34,572
—
i5,i68
—
—
plateau de carpathes
le plateau
2 12,4"/ 5 milles carrés
de l'Oural partie orientale
partie occidentale
le
—
—
Volga
—
8,411 —
baltiques
—
—
—
—
—
—
5,i53 —
6,5 7 3
<
2,938
—
^^^94
—
—
•
Des 36,329,962 personnes de Tannée 1810
le
plus ». Popolâ-
grand nombre se trouve sur la partie occidentale du plateau de l'Oural
—
puis vient celui des Carpathes
Etendue;
—
—
—
8,268
—
—
—
—
1
t:on.
c) totalité.
—
9,804,85
—
7,309,812
734
du plateau de l'Oural
la
partie orientale
l*e
plateau du Nord
le
plateau des Basses - tenes
l'élévation sur la
les terres
baltiques
la Sibérie
—
—
—
—
3,950,779
2,648,858
—
—
—
—
—
le plateau des Steppes
4,395,734
—
—
Volga
5,894,926
1,172,220
1,09 7, 5o3
•—
375,279.
Le nombre des peuples nomades manque au moins en
grande partie aux deux derniers
/')
titres
Parmi le nombre de 36 millions se trouvoient
Division
de la totali-
_
_
18,228,220
^ hommes
te par sexe.
,
18^101,733 femmes.
La
de
générale
proportion
Sur
le
la
Mais
il
y a
partie orientale
l'élévation de la
du plateau de l'Oural
dans
il
y
a
1000 hommes 1,026 femmes
Volga sur
le
même
nombre d'hommes 1,024
Mais
des pla-
nombre des femmes surpasse celui des hommes-
sur
sur
donc pour tout l'Empire
hommes a 993 femmes.
1,000
teaux où
est
—
les
hommes sont
looo hommes
995 femmes
-—
992
tous les autres plateaux
plus nombreu-v que les femmes.
Eri
Sibérie
le
plateau du Nord a
il
y a sur
—
1
73:)
Id partie occidentale du plateau de l'Ou-
ral
a
de
sur
mciii
looo hommes
les
terres
le
—
baltiqLies
les Basses
—
terres
.
le
973
villes
plateau des steppes où sur
—
—
966
—
plateau des steppes
—
—
987
—
—
Le nombre des habitans des
s[ir
992 femmes
—
le plateau de Cjrpathcs
79^
est
le
plus grand parhabiu^
10 habitans des
^'°"*"
villes
ne se trouvent que 34 habitans des campagnes, puis vient
le
plateau du Nord où sur 10 habitans de villes se trouvent
74 habit, des campagnes
la
—
Sibérie
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
101
la partie occidentale du plateau de
rOural a sur 10 habitans des villes 102
les
terres
—
baltiques
la partie orient
du plateau de l'Oural 122
le
plateau de Carpathes
les
Basses terres
l'élévation sur la
Nous
1 1
i36
—
**
Volga
avons dû
167
—
prendre
comme la
plus compktte
nées.
y avoit 17,142,899
Il
ductive sur
sans le
militaire.
169
pour
et la
plus
base
la
—
~
~
—
la
S"'® révision par états et
exacte
de nos don- '^°°*''"°"*'
hommes de
951,1 13 de
'
classe
la
classe
pro-
improductive
—
,
736
La proportion générale seroit d'après cela l à 18.
™^ revision la noblesse, les officiers
\1i\is il manque à la 5
le
donc
être
peu changée ,
un
La proportion devroit
mais pour ne pas confondre
nous
données sures avec les calculs vraisemblables ,
les
nous
états
sommes
de
arrêtés
la
baltiques
res
aux
qui
proportions
résultent
productifs est le plus grand sur les ter-
où
10 improductifs il y a 5g5 productifs
sur
la partie occidentale
a
du plateau de l'Oural
sur
Volga
l'élévation sur la
le plateau du Nord
—
162
—
—
16 i
—
141
•—
i5
—
52 2
—
419
des carpathes
les Basses terres
189
—
—
—
—
10 improductifs
—
—
—
Sibérie
.
—
193
—
du plateau de l'Oural
la
partie orientale
le
plateau des steppes- a sur 20 improductifs
seulement
On
peut
productifs
derniers
qui
des
5^'^ révision.
Le nombre de
la
nomades.
et les
militaire
civils,
est
snpposer
plus grand
plateaux.
est la plus
avec
raison
que
le
nombre des
en général et surtout dans ces
Car parmis la classe de Rasnoschinzi
nombreuse de
ia classe improductive- il
y
.
737
a
beaucoup d'homnes industrieux on agricoles. En Tau ri de
exemple
par
de
vilèges
semblent
nombre
nos
notre
parmis
les
composent
cjui
tiers
devroit ctre reçu
productifs et les proportions
générales, surtout
il
•
occidentale de
partie
i
par
réJév.jtion
—
miJle carne
sur la
plateau âcs Carpathts
]cs
Basses terres
—
—
les
terres
baîti<]U'--s
1.1
pjilie
orientale
—
—
du
de l'Oural
-
le
plateau du
Nord
le
plateau des steppes
la
Sibérie
—
l\ Yl.
1233 Rapport
•
terrain
880
—
—
767
-*-
35
~-
389
—
127
—
9012
—
—
—
—
plateau
—
—
—
..^
1
é-
tendue du
7
—
-:
tion à
l,i 36 pers. des deux sexes
Volga
le
Mémoire I deVAcid.
y a dans tout l'Empire
T^^
1
r Oural
1
1
1
jus^^es.
Mais en *particulier
par mille carre.
personnes
*
r
a
plateau des steppes seroient
Les autres proportions paroîssent plus
D'après nos tableaux
la
des pri-
improductive
classe
la
environ un
tableau^
celles des Basses terres et du
changées.
joiiiçsoient
comme iuisîi en Pologne, et resG.lnoduiortzi.
Donc il paroît que des
05 1,113 hoMmes
d'après
ciiltivaleui?
Noble iise,
Li
à
de
57
5
—
—
—
—
—
9^
•
73S
En
l'étendue
réduisant
de
adoptée
carrés en Dessétines carrés on obtient
Le rapport de
la
295,152 milles
1,478,258,146.
population des 36 millions 329,962
personnes des deux sexes a ce nombre est: que 4of Dessétines reviennent sur
chaque personne pour tout l'Empire.
En particulier
—
—
en Sibérie
-
—
du Nord
975 Dessët.
—
—
au plateau des Steppes
-
—
—
terres
aux Basses
—
—
—
—
baltiqucs
terres.
—
—
au plateau des Carpathes
sur
l'élévation
de
la
Volga
sur la partie occidentale
4.
de
Nous présentons
froorès
la
po:
BuJation
population
^
ici
—
—
changemens
—
—
—
—
4i
5=
5|
arrivés
dans la
pendant sept années consécutives d'après les
Comptes - rendus des Gouverneuis
entre la
—
6^
du plateau de l'Oural
les
7
38
dans la partie orientale du plateau de l'Oural
aux
.i3
—
—
—
88
5"^=
révision et la 6™®.
et puis
la
comparaison
739
— a.
3
_
«^
!
S'-o
o
fl>
OSI
2
(*
03
a
H
1
740
Les
de
là
de
progrès
Volga
Li
101,790,
population éloient sur rélévalion
sur le plateau
de l'Oural, partie
orientale i7i353o, partie occidentale 81,1268 total 252,798.
Sur le plateau des basses terres 68,82 5, sur le plateau des
caipathes 287,824, sur le plateau des steppes 54.981, et en
Sibérie 74,980. Les pro^i^rès de la population inontoicnt sept
années à 831,963.
La population à dirainuéesur le plateau
du Nord de 1,774, et sur les terres baltiques 7,461 total 9,235,
donc
la
population a augmentée de 822734. personnes.
En supposant le nombre des habitans en 1804 10,000,
on
trouve
les
proportions
suivantes
la comparaison
par
des autres années i
ttnne
1804
i8o5.
1806.
1807.
1819. i iSio
1808.
mayetk.
I
10,000
9,938. 10,007 10,014 10,018 io,o35
10,000
9)970
1
9^996 10,001
9>997,'0>o4"^ 10,048; 0,399 10,0 63;
9.989
0,000 10,109 10,109 10,109 io,ogu
o.'®?} 9y9'^7 'o„o,o
I0,0Q0 ,0,079 10,078 10,295 10, "213 o,3o
10,OOU 9^99^ 10,01
10,1 5?. 10,. 1
0, 100
dan? tout pla-^ 10,000 10,029 lOj^oSS 10,144 10,164-' 10,178
1
1
29^
0,1 87
0,1 08,
0,
1
0.-
I
,
85
5i
0,10-3
1
teau
V.
plateau.
10,000
10,010
10,,000
to,495 10,381 10,455
9)9^9
9>962 io,oag^ 9)66
10,177
9.Ç76
VI,
plateau
0,459! 10.5:^9 te ,4.0 5 1.0,389
VU.
plateau
10,000 \o,ai6
9.90,3
10,000; io,v9i
10,337 10,387 io,6ja io,6t,8 10,728^ iQ,4a4
10,490
«
ii3ûi
1
1,680 - 1,717
10 177a
Vin.
plateau
terme
[10(000 iio,iti4 io,,ioa 10x^7^ iio,ao3!io,iQi io,a34i i.o,^i4r>
On
N'oit
avec
pLiisir
se
très
peu
n'ont
commencé que depuis
tous
les
Mais
signifiante.
pays
prouvé ,
a
perfeciiannent
progrès réels
ces
sur
tous
1rs
S3U963
de
i
comme
les
804^
que l'expérience de
que
annuellement
la
qui
dénombremcns
les
et
(ont
réitérés
pouvroit
douter
des
on pourroit
cio'ie
que
on
,
population
personnes
et
Gomptts- rendus
l'augmentation
de sept
années consécutives sont au moins en giande partie
dénombrement plus exact pour
ne sont
pas soumises aux levées militaires
directs.
Nous avouons que peut-être cela
d'un
sultait
]ûà-
trouve une augmentation, et que la diminution est
teaux
se
presque
qric
plusieurs Gouvernemens: et
le
ré-
les
classes
qui
et
aux- impots
a
eu lien en
que parconséquent une partie
de l'augmeiïtation doit être mise sur le compte de dénom-
btemens plus exacts ,
pour
mais nous sommes persuadés ,
plupart des Gotivernemens les
la
mêmes irrégularités
existent encore, plus le dénomjDrement des classes
tes
doit
de
la
capitation, et
avoir
cante de
été
la
réelle.
réalité des
que
exemp-
que parconséqiient l'augmentation^
N''ais la-
preuve
la
plus
convain-
progrès de la population se trouve
dans la comparaison^ entre hv 5'"^ et la 6"^^ révision.
La^
sixième révision n'est pas encore- entièrement
miDée, eik
l'est
pourtant
dans, la plupart
ter-^
des Gouverne-
^42
mens et pour
tats
partiels
plus nombreuses.
les classes les
font
que
prévoir
nous donnerons dans la
que
général-,
résultat
le
Les résul-
toujours favorable.
suite, sera
Le nombre des paysans en 47 Gouvernemens
c'est-à*
dire dans toute la Russie a l'exception de Vitebsk, Vilna,
Tobolsk
et
le
district
de Bialystok etoit à
de 15,287,628 hommes, à
sion
6™*^ révision
la
1
5'"®
révi-
7,068,195
L'augmentation est donc de 1,780,567 hommes
hommes.
ou environ de
1000
la
1116.
à
igme jévision
|,
le
premier nombre est au dernier comme
Seize ans se sont écoulés entre la 5"^^ et
depuis
1795 jusqu'en 1811,
Le nombre des habitans qui payent des impôts directs
dans
étoit
ces
47 Gouvernemens
16,000,099 hommes
classes
avoicnt
et
à
augmentées
la
6'"^
de
5™^ révision
a
la
de
17,840,050.
d'envi-ion ^; la proportion est presque la même:
Le nombre
de
n'y
avoit
622,804 iiommes
donc que
marchands ,
fait
plus
de
lOOO à 1 1 15.
et
k
il
la
étoit
6"^'^
à la
5'"'''
de 638,397 ,
1000
à
102 5.
Mais
le
qui font classe a part en Russie ,
progrès
réviil
15,593 hommes de plus ou environ
i, la proportion étoit de
des
ou
des bourgeois n'a voit pas beaucoup aug-
menté dans ces 47 Gouvernemens,
sion
Ces
hommes,
1,839,951
de
dans
ces
nombre
avoit
mêmes Gouvernemens.
Il
J
743
de
5"^^ Revision
à la
étoit
Cette
123,324.
cliarreticrs
de 43,022
et
proportion est pe
33,65 7
j3 75.
à
5 '"^ Révision,
52 12 hommes ou d'environ
i,
la
lOOO à 1122.
les
Révision pour cette classe est
la
6"'*'
de 48,234 hommes, leur nom-
Le nombre des ecclésiastiques dans
ncmens où
Ij-
de
looo
(Jaemschiki) étoient a la
avoit augmenté de
bre
augmentée
proportion est
la
^,
la sixième
a
avoit
classe
hommes ou d'environ
Les
de 89,667 hommes et a
35
Goiiver-
finie,
étoit
à
la
5'"^
il
y avoit donc 15492 de plus ou i, le rapport du pre-
Révision de
i67,3li6 et à la six,ième de 182,808,
comme 1000 à
mier nombre est au dernier
Les
sion
est
nombre
ème
de
en 3i
Rasnoschintzi
pour
finie
étoit
à
la
56i,5i5,
cette
5"^^
Gouvèrnemens où
classe
il
y avoit
environ ^, la proportion est de
impôts directs
avoit à la
c'est
le
à
5"^*
a
avoient
les
Révision
1024,
se
Leur
la sixi-
1000 a 970.
habitans qui ne payent pas des
été finie en
noiivbre
diminué.
i753o de moins ou
3i Gouvèrnemens.
712,176" et à
la
une augm^^ntation de 17,023 hommes
premier
la Révi-
Révision de 579,045 et à
donc
La Révision pour
109.3.
rapporte
Il
y en
6^^ 729,199,
où- environ
-\,
au dernier comme 1000
744
La sixième Revision étant entièrement terminée en 3i
on
Coiivernemens
5 '"'^
la
l\
trouvé
a
nombre
totdl
Révision de
11,213,649 habitans
Révision de
12,439,525
La proportion
classe,
est
des habitjn<5
et
6"^*
à la
1,226,876 ou environs
augmentation
Le
le
*.
lOOO à 1109.
des paysans et des marchands ont
fait
des
progrès considérables, celle des simples bourgeois se trou-
un
ve dans
a
état stationaire ,
diminuée par
les
enfin
circonstances.
celle
de Rasnoschinzi
La Russie
est
nn Etat
mais les
souverainement agricole, son commerce
est
actif,
manufactures
et
les artisans
ouvriers
libres
pour
les
ne
sont pas nombreux.
On
lation
peut
en
quième à
hardiment é valeur Jes pj ogres de
Russie
la
pendant
les
16
la
années, depuis
popu\a
ctn-
sixième Revision, à un neuvième ou à deux
millions d'hommes.
745
DES ENTRAVES À L'IMPORTATION DES MARCHANDISES ÉTRANGÈRES, COMME MOYEN D'EN-
COURAGER LA PRODUCTION NATIONALE.
P A R.
S T O R C II.
IL
Trésenté
à
Conférence
la
le
iq Fffvrier i8iy.
Première partie.
Une des principales mesures dont
pour
•mercantile
enrichir
l'importation des marchandises
étrangères qui
ture à être produites dans le pays.
a
le
double but en vue,
du. pays,
et finalement d'y
regarde
comme
mémoire
je
la
me
seule
le système
sert
à
consiste
nation ,
la
se
entraver
sont de na-
En agissant ainsi on
d'abord d'encourager l'industrie
accumuler l'or et l'argent, qu'on
et
véritable
Dans ce
richesse.
bornerai à examiner les effets des entraves
du commerce par rapport à
pendamment de
leur
l'industrie
influence
nationale,
et indé-
sur l'accumulation des
ri-
objet dont l'inutilité est
aujourd'hui
trop généralement reconnue pour avoir besoin
de nouvel-
chesses métalliques ,
les
preuves.
jMais
tel
MlmoiradfVA.ad. T. H.
administrateur
qui
désavoue tout
94
74^
haut
crtcnr po[HiLiiic,
cette
n'en
chesse des nations,
dos entraves à
il
les
sollicite,
des marchandises
pour accroître
la
masse du numéraire dans
pour enrichir
la
nation par le travail,
branches
les
d'industrie
procurer de nouvelles.
:
dit,
il
pays,
le
mais
pour perfectionner
pour
qu'elle
exerce,
et
n'est
donc pas
inutile
Il
ri-
étrani^ères
comme
maintient, non pas,
les
il
la
pas moins un défenseur zélé
est
importiition
l'
consume
l'iï'gent
qtie
lui
en
d'exami-
ner de nou\eau
et sous
portante:
entraves à l'importation répondent au but
si
les
qu'on se propose ;
salutaires ,
fets
si
et
toutes
ses
faces
la
question im-
supposé qu'elles aient quelques
leurs inconvéniens ne
ef-
surpassent pas le
bien qu'elles peinent opérer.
C'est surtout contre
les produits
tranger que se dirigent les entraves
dans
le
système mercantile,
moins lucrative que
les
manufacturés de
l'é-
l'importation
car
à
l'agriculture
censée être
es?t
manufactures et le commerce étran-
ger, et en conséquence elle est moins protégée.
l'agriculture
de
motifs
étant
de
exercée partout ,
s'en
commerce étranger ,
:
occuper que
dont
les
on
des
progrès
croit
D'ailleius
avoir moins
manufactures
naturels
et
du
paroissent
toujours trop lents et trop tardifs.
Les moyens dont on se
tion, sont
sert
pour entraver l'importa-
de deux espèces: les droits d'entrée, et les prO'
H1
h'ibitions.
pour objet d'clevci
Les droits ont
marchandises étrangères
sur lesquelles
ils
piix des
le
portent
,
et
de
âinnnucr par là leur consommation dans le pays; les proont
hibitions
pour
consommation ;
et
but
de faire
tout pour obliger la nation
le
consommer des marchandises
a.
Observons d'abord que
du moment
bande, on peut
ni
l'une
ni
excèdent
qu'ils
cette
à produire
nationales.
de ces me-
l'autre
complètement leur but.
sures n'atteignent
d'entrée ,
entièrement
cesser
Quant aux droits
les
fraix
de contre-
procurer les marchandises qui en sont
se
chargées, à un prix moindre que celui auquel le législateur avoit intention de les élever; et quant
tions,
elles sont
n'agissent
absolument sans
que comme
un
impôt.
effet
aux prohibi-
comme telles,
Pendant
Id
et
durée du
système prohibitif en Russie *), l'entrée de presqiie toutes
les
de
marchandises
manufacture
ment défendue; néanmoins
constamment fourni,
duisoit
la
il
le
tout
étoit
entière-
marché de ce pays en
l'efTct
étoit
des prohibitions se ré-
élever le prix de ces marchandises des fraix de
contrebande
•)
et
étrangère
Ce sytêine
Mars j8i6;
et
a
du
profiit
commencé
le
du contrebandier. En France,
19 Décembre 1810,
et
il
a
fini
le
3i
durée a été de 5 ans et 3 mois.
Le tarif de
1816 est loin d'.iccorder une entière liberté au commerce; cependant
permet l' importation de la plupart des marchandises jusque-là pro»
jl
bibées, en les chargeant de dioiti plus ou moins forts.
ainsi
sa
94*
743
l'a
à
contrebande est bien plus
de
CiHHo
la
marchandises
des
fraude
compte quatre pour
on
du contrebandier.
fraix
les
confisquées
au
sont
qu'en Angleterre
profit
,.,
une
Ainsi
en y ajoutant
remboursement
marchandise
an-
du marchand.
néral
peu proportionné
voit
qu'il
l'effet
à*
de ces entraves soit en gé-
l'intention
du gouvernement^, on'
faire
renchérir
d'importation
contre
lesquels
les. objets
dirigent ces entraves..
ou par une
Ainsi, en gênant par des droits
proliibition. absolue
dises dont on
veut favoriser
on assure plus ou moins
l'importation des marchan-
la
production dans
le
pays,
à l'industrie nationale qui s'em-
produire ,. un monopole dans
les
Simonde,
de transport et
fraix.
est touiours^ assez; grand, pour,
Gonsidérablemenîr
il
les
plus cher
*)..
Cependant,, quoique
*)
en.
n'y revient que de dix. pour cent
pour cent,
ploie
cent
prohibée en France, ou chargée d'un droit de cent
glaise,
se
en
entrent
qui
que parce que
contrebande n'est en général que de dix pour cent, sur
lesquels
le
des frontières ,
des employés des douanes ^ cependant l'assuiance de
profit
la.
nature
que chez nous, tant
difficile
De la richesse com/ncniulry T. II.
/>.
le
229.
marché
inté-
Suivant cet auteur,
monte, année commune,
à la
masse des assureurs n'est' réellement à couvert de cette perte, que lôr^quelle a fait.cnttercD France
pi)u:r, 100 raillions de marchandises prohibées..
la
soiiiinc
des marchandises confisquées
millions de francs;
s'il
en
est. ainsi,
la
T49
Or
rieur.
mode d'encouragement
ce
prétendu
presque jamais piodiiiie aucun bien, et il peut
coup de mal:
Quand
bonnes
la
ou
Inutile
les
peut
faire
beau-
nuisible, voilà Taltcrnative.
marchandises nationales
ne
sont
moins
ni
plus chères que les marchandises étrangères de
ni
même espèce, chargées des fraix d'importation,, ces dermonopole existe par la
nières ne sont point importées; le
nature des choses,
rif
ne
est inutile
il
de
le
proclamer.
Le
ta-
des douanes de l'Angleterre défend l'entrée d'une
infi-
de marchandises qu'on produit à meilleur prix
de
nité
meilleure qualité dans
ce pays que partout ailleurs
et
:
ces
défenses sont inutiles.
Dans
supposition
la
exceptés dont
il
sera
est toujours nuisible.
peu de cas
Arrêtons - nous à cette dernière con-
et examinons en détail les effets qu'un pareil
sidération ,
monopole
quelque
contraire,
question dans la suite, le monopole
produit..
Premier
effet :
la direction
il
force
la
fiation
a changer avec perte-
de son travail et de ses capitaux..
n n'y a pas de doute qu'ùnpareil' monopole ne donne
souvent
un
d'industrie
dans
le
grand; encouragement
qui en
jouit,
et qu'il
a
l'espèce
particulière
ne fasse souvent naître
pays les productions qu'on veut y établir;
mais.
la
c'est
plus grande de toutes les erreurs d'imaginer
que
CCS nouvelles productions sont un accroissement d'industrie
de
Point
de richesse.
et
travail
ainsi
la
quantité de
que
est
toujours limitée par la
peut y employer.
et qu'on
ou
l'une
borne à une seule;
mon
capital
entre
changer
le
faire
piofit aussi
l'autre,
deux,
les
20 pour cent, mais
de
est clair
il
que
en
gain
et
il
me
n'est
pas
je
si
partage
ne gagnerai pas plus de
je
risque de gagner moins,
je
je
longtems que
que,
me
puis faire
je
mais qu'en faisant l'une,
mon pcuvoir de
en
quantité de capital qu'on
entreprises industrielles qui
20 pour cent ,
avec ce
:
un capital de 20,000 roubles,
Si j'ai
l'autre
sans capital
à un objet quelcon-
travail applicable
me propose deux
rappoiteront
industriel
perte.
Si
et
même
cette proposition
est
vraie pour un individu, elle est vraie pour tous les indi-
vidus
qui
composent
donc limitée par
au
ses
mesures
capital national.
j)rohibitives
ne font naître
l'eiTet
ni
il
n'est
plus d'industrie
qu'elles pioduisent se
de nouvelles industries à
que
Icii
hommes
sont
peu
borne à n*2t-
place des anciennes.
la
La conduite de presque tous
tre
Or comme
pu; de richfsse dans le sein de la nation qu'il y en a voit
auparavant; tout
tre
L'industrie nationale est
nation.
pouvoir du gouvernement d'augmenter ce capital,
pas
ni
le
la
les gouvernemens démon-
sensibles à celte
vérité
si
75i
Quand
manifeste en apparence.
par leurs prohibitions
ragent
n'est
pas
que
telle
trie
de plus,
si
branche d'industrie, ce
t-'^lle
qu'ils
gonvcmemens encou-
li
croyent plus lucrarivé
mais parce que c'est une branche d'indus-
autre,
toute
co'nme
parce
toujours
les
et
qu'on ne sauroit trop en avoir.
industrie
ne
une industrie improfitablc valoit
si
encouragée ; comme
de
rètre
on
faisoit
comme
;
Comme
pas sa propre récompense ;
portoit
la
peine d'être
si
une industrie profitable avoit besoin
si
enfin
par ces opérations arbitraires
chose que transporter les capitaux d'une
autre
blanche d'industrie dans une autre.
„ L'avidité ,
ne peut
est
Avoir
tenir.
une
rmùs
elle
pouvoir
croit
les
yeux plus grands que le ventre,
proverbiale de nourrice qui convient
phrase
enfans ;
Bentham, veut embrasser plus qu'elle
dit
applicable
est
étendre
infiniment
aux
à l'homme d'État qui
l'industrie
de ses admi-
nistrés,
sans s'apercevoir qu'elle est limitée par leurs ca-
pitaux.
Cette comparaison n'est pas noble, mais elle est
juste ;
quand
et
posant,
on
est
les erreurs se
tenté
de
les
couvrent
d' un
masque im-
mettre dans un jour qui les
humilie. *'
Ju<:que-ld
mais
il
est
l'effet
du monopole ne paroît qu'être nul',
réellement
nuisible.
L'emploi des capitaux
des
ne
nation
d'une
pour
pertes
change sans
peut
être
elle.
La plupart des industries exigent
qu'il en
résulte
dos matériaux, des instruniens, des procédés qui leur sont
propres
les
ne
on
si
:
peut
point
nouvelles entreprises,
tière ;
ges,
s'il
est possible
de
s'en
la
perte de leur valeur est en-
les
adapter aux nouveaux usa-
perte est moindre, mais toujours
la
D'ailleurs
-ces
pertes
sont
changement >est plus subit
On
voit
que
si
le
du tout dans
servir
d'autant
il
plus
y a de la perte.
grandes, que le
et plus
général.
système
prohibitif a fait naître
quelques nouvelles manufactures en Russie,
cet clTet n'a
eu lieu qu'aux dépens des anciens tra\ aux, auquels on a
en partie les ouvriers et les capitaux qui les alimcn-
retiré
toient ;
que ce changement n'a pu
et
une perte
tics-sensible
entrepreneurs
ressentis
de
des
prises,
lyse
la
richesse nationale.
nouveaux établissemens ne
cette perle, c'est qu'ils
par le monopole ;
d'industiie
pour
s'effectuer
se
qu'avec
Si
les
sont pas
ont été dédommages
mais ceux dans les anciennes branches
qui ont du rétrécir ou abandonner leurs entre-
en ont soulTcrt plus ou moins; et en dernière ana-
cette
perte
s'est
repartie
sur les
consommateurs des
produits de toutes les industries, tant anciennes que nouvelles, c'est-à-dire sur la nation entière.
753
Mais
peut-être
nation
la
pertes par ]c snrplcis de
dédomniap^ée âc cch
csL-clle
pioduit qrie donnent les nouvel-
industries? Peut-être celles-ci sont-elles si avantai;euses'
les
que leur
ennes
profit l'emporte
occupations
der cette
du
suffit
il
tomber?
fait
de
pour
Pour
déci-
rappeler que les an-
se
qu'exposés k
maintenir;
se
de T étranger,
concurrence
la
ont
travail et des capitaux u'avoient guère
monopole
d'un
besoin
qu'elles
question ,
ciens emplois
de beaucoup sur celui des anci-
ils
aux
rendoient
entre-
preneurs des profits dont les consommateurs n'avoient guère
À
Les
plaindre.
se
nous
suivans
articles
montreront
si
ces
avantages sont surpassés par les nouvelles industries,
fruit
du monopole.
Second
effet
du monopole:
il
force la nation à travailler
a perte.
La
de
ses
Russie
babil ans de la
elle-même
du
du travail y
draps
classe
aisée.
draps;
ces
des
profit
de
besoin
a
fait
si
et
coûte,
si
je
Mémoires dt l'Atad.
moitié plus
T VI,
.
vêtement
l'intérît et celui
hauts ,
la
division
les ouvriers
et les
cette fabrication y sont encore
peu perfectionnés ^
suppose,
si
peu de progrès,
instrumens nécessaires à
rares
y sont
le
Elle pourroit fabriquer
mais le taux de
entrepreneurs
a
pour
fins
si
qu'une archine de drap y
a produire qu'en
9^
Angle-
.
75'4
D'un autre colé l'Angleterre a besoin de suifs pour
terre *).
ses chandelles,
ses
savons et l'usage de ses fabriques; et
degré de prospérité auquel elle est parvenue,
le
dent
du
r éducation
poud de
nécessaire d'un
Russie.
Dans
Pvusses
perdent
draps,
s'ils
bétail
si
suif y
cette supposition^
pour
5o
peuvent
cent
dispendieuse
est
que
ren-
le prix
moitié plus haut qu'en
n'est-il
pas clair que les
à fabriquer, chez
les acheter en
lui
eux des
Angleterre; et que les
Anglais en perdent autant à produire chez eux des suifs^
s'ils
peuvent les acheter en Russie;
perdues
pu
auroient
être
enfin
que ces valeurs
employées a produire
ch( z
les
(Jeux nations d'autant plus de suif, d'autant plus de drap,
ou d'autant plus de toute autre maichandise ?
Chaque pays, vu
la
de son chmat, vu le degré de
ri-
Gcnéralison& cette proposition.
de
nature
son
sol
et
de civilisation auquel il est parvenu,
.«hfsse, d'industrie
et
peut
monde commerçant certaines productions
à
fournir
au
moins de fraix que les autres pays.
ver
chez
^'autres
*)
une nation l'importation
nations
peuvent
lui
Interdire
ou entra-
des-,marchandises que
fournir de meilleure qualité
Un ërrivain vivant en Russie a calculé que les draps fins de ce pay'
reviennent de 85| pour cent plus cher que ceux d'Angleterre, quand
on les compjre sous les deux rapports du prix et de )a qualité. Voyez
Atnkhicu hier dm Xor'fiystcm in KnSilaiid, von C. Arnold, 5/., Ectenb,.
755
ou d'une m.inicre moins
à raison de quelque
flispendix?usc,
avantage particulier de leur industrie ,
donc
se re-
participer à cet avantage naturel dont elles jou-
fuser de
c'est
issent ,
c'est
forcer
nation
la
plus d'avances
qui lui coiite
chez
produire
à
et plus
ce
elle
de travail; en un
mot, c'est employer ses ouvriers et ses capitaux k perte *).
Ce
n'est
que dans
Içs
de nation
procédés
à nation
qu'on voit un tel égarement; entre particuliers, celui qui
en agiroit ainsi ,
La maxime de
mais faire chez
mais
il
censé
tout
particulier
soi
la chose qui
cherche pas à
achète du cordonnier;
pas
un
mais
il
seul de
s'essaie
genre
d'indusirie
concitoyens
sommation avec
•)
dans
iba
sou-
cordonnier ne
recours au tail*
a
point à faire ni les uns ni
deux
artisans.
Il
n'y
son
lequel
travail tout
il
a
entier
dans le
quelque avantage sur
et d'acheter les autres objets de sa con-
,
le produit
Comparez mon Cours
p.
il
le
faire ses
individus qui ne voie qu'il y va,
de son intéict d'employer
ses
mais
s'adresse à ces
ces
moins a. ache-
lui coûtera
les
marchand ne
autres ,
les
a
le
raisonnable est de ne ja-
tailleur ne
tache pas de faiie ses habits ,
leur;
son bon sens.
perdu
avoir
Le
ter qu'à faire.
liers,
seroit
— 19a.
de son travail, ou, ce qui est
d' Economie politique ,
T. IF, p. 167
95*
— 6j,
eî
756
la
même chose
avec l'argent que luî rapporte la vente'
,
Or ce qui
do ce produit.
raisonnable dans
est
de cliaque particulier, ne peut guère être
d'une nation
Une
le
conduite
dans celle
*).
qui
nation
acheter
roit
folie
la
à.
produit
chez
elle
ce
meilleur compte aii-dehors,
pour-
qu'elle
empêche pour
moins l'accroissement de son Capital, et quelquefois le
di ninue réellement.
saire
le
prix néces-
dans le pays est plus élevé que celui dans Tétranger,
ne peut point
le producteur.
fets,
Une marchandise dont
rend
rejettant
la
la
se
produire parce qu'il y auroit perte pout
Le monopole dont nous examinons
production de cette
perte
sur
les
les
ef-
marchandise possible, en
consommateurs.
Ceux-ci
sont
obligés de prendre ce surplus de dépenses sur leurs revenu?.
Cependant,
c'est
sur ces
revenus que doivent être
faites,
les économies qui seules jjeuvent augmenter les capitaux..
*)
Cttte vérité est
sentie
par to»?
Tes
hommes d'an esprit juste,
lorj
même qu'ils n'ont point médité fur les principes de rEcoiionije poliDu tcn>s de Henri IV, cette science étoit presqu inconnue en
Franccj cependant le grand Sully snvoit bien, deviner Cie qui convient
sous ce rapport à 1' Etat.
Il s' éloit dé laré contre i^ établissement
forcé des. manufactures, dfi soie, de tapisseries etc. que Henri IV encovirngeoit à grand fraix.
Un jour que qu''lques-uns de ces entrepreneurs s'étoitnt présentés chez le roi avec des échantillon* de leur»
produits que Henri l'invitait à admirçr, Sully lui dit ^uil ne howvoit
f imuis rien 'i hejii ni ./« hii » fait {juand il coûtait le douHf de ia tuaii
(^Alunoira de Sully, T. Vl, f. 3in.)..
Malfur.
tique.
,
757
En
dirahuiant on rend donc impossible l'accroissement
les
de ces capitaux;
peut-être mcme,
pour fournir à xette dépense,
et forcera-t-on les
mateurs i entamer leurs capitaux.
monopole
cessaire
il
Ainsi,
consom-
en forçant par
maintien de productions -dont le prix né-
le
domestique est au-dessus du prix nécessaire dans
l'étranger,
pense
on répète sur trop
cette opération, rendra-t-on le revenu net insuffisant
d'objets
le
si
et
gouvernement ne
le
appauvrit la nation
On
fait
qu'augmenter
diminuer le revenu national,
la
dé-
en d'autres termes,
*).
pourroit objecter que la différence des prix étant
payée aux nationaux, la perte des consommateurs est compensée par
gain des producteurs, et qu'ainsi la nation
le
ne s'appauvrit
ni
ne s'enrichit par cette mesure.
Mais
faut observer qu'il ne s'agit point ici de la différence
aux piix courant, qui constitue
piix nécessaire
il
du
le gain du
producteur, mais de la différence de deux prix nécessaires,
de
celui
de
la
marchandise nationale et de celui de la
marchandise étrangère.
tion
ne peut
se
Une marchandise dont la produc-
soutenir qu'à l'aide d'un monopole, n'est
pas régulièrement plus chère parce qu'elle donne un gain
extraoïdioaire à l'entrepreneur,, mais parce qu'elle lui coûte
•)
Court ifEarn.
polit.
T» li^ p.
i.i3 (t
169
— 173.
-?58
réellement plus
mencemens
le
dans
les
corit~
monopole, dont jouissent les producteurs les
met à portée de hausser
de
Sans doute ,
produire.
;i
le
prix de leuis marchandises et
des gains très-considérables;
mais tôt ou tard la
concurrence qu'ils se font entre eux,
réduit ces gains au
faire
qui a lieu dans toutes les entrepiises pa-
profit
ordinaire
reilles.
Le prix nécessaire de leurs marchandises , au conpeut
traire,
les
causes
que
la
les
rester
de
du
l'intérêt et
profit
progrès de la division du travail,
l'invention
siècle; car
diminuent les fraix de production , telles
qui
baisse
même pendant plus d'un
le
et l'emploi
de l'entrepreneur,
ceux des lumières,
des machines etc., ne se développent
que très-lentement ^et dans l'espace de plusieurs
Ainsi,
en
tant
que
le système prohibitif étoit
siècles.
maintenu
Russie dans toute sa rigueur, le haut prix des manu-
factures
russes qui
servoient à remplacer les manufactures
étrangères, provenoit en partie
ducteurs
jouissoient
ce rapport
quoiqu'il
il
des
dans l'intérieur de l'Kmpire,
ne diminuoit point
causât
enrichissant
du monopole dont
un
déplacement
gratuitement
consommateurs.
la
Mais
quelques
la
les pro-
et
sous
richesse de la Russie,
injuste
de fortune,
individus
en
aux dépens
principale cause de ce haut
prix étoit dans le taux de l'intérêt, du loyer, des salaires
et
du
profit
d'entrepreneur,
qui est plus élevé en Russie
759
que dans
lès
autres pays manufacturiers,
défaut
de
connoissances ,
le
nécessaires à la
de plus dans
de procédés et de machines
Tout le
fabrication.
et
surcroît de
prix oc-
casionné par cette seconde cause, ctoit une perte effective
pour
richesse
la
consommateurs
le
des
augmenter
sans
payé par
les
gain des fabricant.
Si
car
le
il
étoit
système avoit duré plus longtemps, le gain de monopole"
entrepieneurs
auroit
imperceptible de
et
et les
pertes de \a
d'un siècle
\à richesse et
le
progrès lent
de la civilisation de l'Em-
viens
nécessaires
Russie auroient continué pendant plus
peut-être.
au moins
Je
mais les fraix de
par conséquent la différence des prix
pire ;
d'avoir
bientôt cessé;
ne pouvoient diminuer qu'avec
.fabrication
et
de l'Empire,
C'est donc une mesure très - sage,
limité ces pertes par le tarif de
de dire que
le
i8i6.
gain de monopole des pro-
ducteurs, quoique fruit d'une loi injuste, n'appauvrit point
mais cette thèse
la nation;
taines restrictions.
périeurs
au taux
même
n'est vraie qu'avec
L'expérience prouve que des profits
accoutumé,
et qui
cersu-,
ne sont pas acquis
par une plus grande activité de travail au une supériorité
de mérite
à
,
invite les producteurs à donner plus d'instans
l'oisiveté,
disprn lieuses.
xeibe,
se
et
Ce
leur
font
qui
se
dépense de même.
contracter des habitudes phis
gagne
aisément,
le
pro-
Tel entrepreneur qui,
san^^
dit
76o
la
faveur du monopole, seroit laborieux et frugal, se livre
aux
au
ne
lui
coûte ni plus
qui
travail.
Quand on
tème
prohibitif
de
,
(|u il
compte sur un
d' avances
plus
ni
de
observé le train de vie <uie le sys-
a
embrasser chez nous à
fait
a
la
plupart;
on peut raisonnablement douter que leur
favoiis ,
ses
gain
parce
et
bénéfice
de
luxe
distractions
monopole
les
Ainsi ,
a enrichis.
même sous ce
rapport, le monopole tend à appauvrir le pays.
Iroisième
effet
nombre
du monopole
marchandises
des
sommateur
achète
augmenté
est
fait renchérir
monopole élève
le
prix
que
le
con-
marchandise étrangère dont
le
prix
voir
que
le
qui en sont frappées ,
la
par
un grand
de consommation.
d'objets
Nous venons de
il
:
droits
les
soit
de douane ou les fraix de
contrebande, soit qu'il s'en tienne à la marchandise nationale ,
dont
fraix
de
plus haut par les
prix
est
naturellement
production
et
s'élève
encore
monopole accordé au producteur.
Mais
ne
un grand nombre d'au-
se
borne pas là:
tres denrées.
les
le
industries
il
s'étend sur
Le monopole, en
qu'il favorise,
davantage par
le
attirant les
le
renchérissement
capitaux vers
en prive d'autres industries
déjà exercées; la production de celles-ci diminue, et com-
me la demande de leurs produits reste la même ,
bien que le prix de ces produits monte.
il
'faut
7^1
Ainsi
monopole
payer plut cher aux
ccmsoM-
marchandises étrangères prohibées ou
chargées
le
fait
matenrs :
1°.
Les
dé gros
2°.
droits qui entrent par contrebande ;
marchandises
Les
nationales
destinées
à
remplacer
les premières ; et
3°.
Les marchandises nationales dont
minae par
On
l'elTet
que dans
voit
consommateurs
est
Cependant
nation
la
de fabricans ni
dividu
qiii
ne
toujours
des artisans,
mais
il
n'est
sacrifié
à celui des
l'intérêt natio-
pas rintérêt des fabricans oa
évidemment celui des consomma-
de l'universalité des citoyens, ou de
teurs,
c'est-à-dire
qui comprend toutes les autres.
reste,
fabricans.
point composée exclusivement
classe
Au
dî-
mais elle ne compte pas un in-
n'est
est
produttion
système prohibitif l'iritérct des
un consommateur. Ainsi
sous ce rapport,
nal,
le
d'artisans,
soit
la
du monopole.
le.
comme les fabricans appartiennent également
à la classe des consommateurs, ce système leur cause des
pertes à
eux-mêmes, par rapport
à
tous les objets de con-
sommation qui ne sont point des produits de leur industrie^
„Je conçois,
dit
Turgot, que des fabricans qui neconnois-
ï62
sçnt que leur fabrique, imaginent qu'ils gagneroient davan-
tage
s'ils
avoient moins de concurrens.
n'est
Il
point de
producteur qui ne voulût être seul vendeur de sa denrée)
il
point de commerce dans lequel ceux qui l'exercent
n'est
ne
cherchent
à
écarter
la
quelque sophisme pour
faire
réussissent plus aisément
l'industrie
et
ne trouvent
accroire que l'Etat est inté-
du moins la concurrence des étrangers, qu'ils
ressé à écarter
de
concurrence ,
nationale.
à représenter
Si
on
les
comme les ennemis
écoute, toutes les bran-
ches de production seront infectées de ce genre de mono-
Ces imbécilles ne voient pas que ce même mono-
pole.
pole
qu'ils
non pas, comme
exercent,
au gouvernement , contre
concitoyens,
leur
est
les
rendu
ils
font accroire
mais contre leurs
étrangers ,
par
le
mêmes concitoyens
ces
dans les autres branches de production,
lorsque
ceux-ci
deviennent à leur tour monopolistes et eux acheteurs.
Ils
ne voient pas que toutes ces associations de gens du même
métier ne manquent pas de s'autoriser des
mêmes prétextes
pour
obtenir
même exclusion
des
étiangers;
du gouvernement séduit
ils
la
ne voient pas que dans cet équilibre
de vexations et d'injustices entre tous les genres d'industrie,
ou
les
fabricans
et
les
marchands de chaque espèce op-
priment
comme vendeurs,
teurs,
n'y a
il
et
sont opprimés
comme ache-
de profit pour aucune partie; mais qu'il y
7^3
a
une perte iccllc pour
ou pour l'Etat,
onale
vend
lui
pour
prix
la
moins
somme
des
ponibles,
et
à
branche
de
par
cert
augmentation
acheteurs
diminue
jouissances,
de pouvoir
tous,
contre
monopoles
en souffre en
guerre
on
n'a
qui ne puisse acheter
des
choses
puisse vendre
duit,
tandis
a
le
sa
excepté que la seule
que toutes oppriment de consur
nationaux, et qui,
les
peut
ne
même
jouir
que
n'y a
il
vendeur.
librement
besoin;
il
loin
du
en sorte que de tou-
Il
le
cul-
et qui
n'y a que
des étrangers aucune
n'y
aux étrangers librement
que
prête
monopole comme acheteur
lui
il
souverain,
gouvernement
le
même tems comme
dont
du
et
Cette
vendre sa denrée;
qui souffre du
revenus dis-
peuple.
tes les classes de citoyens laborieux,
tivateur
des
parce que dans cette
opprimer personne ,
droit naturel de
forcée
nécessairement
des
distribuer au
à
où
l'agriculture,
ces
somme
la
encore,
réciproque,
tous
production nati-
moins à letranf^er,
achetant
richesse des propriétaires
doublée
est
d'oppression
force
les
la
Cette
somme des salaires
la
perte
la
qui,
aussi.
tous
de
totalité
la
a
la
que
lui
qui ne
denrée qu'il pro-
fabricant de drap ou tout autre achète
tant qu'il veut le blé des étrangers.
(Quelques
/tjue
peut accumuler
l'intérêt particulier
ses
de producteurs,
la
vérité est
sophismes
de quelques
que toutes
les
96*
clas-
branches
7<^4
c!e
production doivent être
lement libres; que
en
libres,
également
libres,
entie-
système de quelques politiques nip-
le
favoriser
s'im^iginent
dernes qui
'
la
production
nationale
interdisant l'entrée des marcliandises étrangères, est une
pure illusion; que ce systèfne n'abouiit qu'à rendre toutes
les
à
branches de production ennemies les unes des autres,
nourrir
entre
guerres dont
les
plus
foibles
coûteux aux peuples^ plus
la population,
un germe de haines
nations
les
effets
destructifs de
la
et
fois
de
plus
richesse,
de
du bonheur, que tous les petits profits merne peuvent être avanta-
cantiles qu'on s'imagine s'assurer
geux aux
mille
sont
La
nations qui s'en laissent séduire.
vérité
est
qu'en voulant nuire aux autres, on se nuit à soi-même:
non - seulement parce que
tions
est
si
facile
manquent pas de
à
s'
imaginer
eu
de ces
représdille
la
que
à
aviser
les
leur
prohibi-
autres nations ne
tour,
mais
encore
parce qu'on s'ôte à soi-même les avantages inappréciables
d'un commerce libre; avantages tels que
aommc la France vouloit en
faire
si
un grand Etat
l'expérience,
les
pro-
giès rapides de son industrie forceroient bientôt les autres^
nations de l'imiter pour n'être pas appauvries par la perte
commerce
*).
Oeuvres de Turgot, T.
VL
totale de leur
•5
'*
p4
44^*
et suin.
165
Çkiatrième effet du monopole:
de la nation ,
térieur
diminue
le
commerce ex-
il
écarte
les
capitaux qui
et
il
venus alimenter l'industrie uationaie.
scroient
Lor?qii'nn gouvernement
met des entraves à l'impor*
des marchandises étrangères^
tdtion
vue que de diminuer
il
marchandises nationales:
bien an contraire ;
cependant ce dernier
rable
Si
l'autre.
rien
jamais
les
Vendre sans acheter
merce.
Ainsi
est
pierre
la
entraves
les
à
T importation ,
ne
portation
étrangères,
comme les' entraves à l'im-
s'étendent
sur
les
pas
toutes
les
marchandises
autres nations peuvent nous envoyer d'au-
plus de ces marchandises dont l'accès n'est point en-
le
passe la
la
mais
dans
en
raisonnant
marchandise
demande,
demande
s'avilit.
i8i2,
:
débit d'une
boiné par
ferte
c'est-à-dire
peut - être que ,
travé chez nous
que
sont encore
diminuent en général le commerce extérieur.
On dira
tant
tirer?"
philosophale du com-
indirectement des entraves à l'exportation,
qu'ils
est insépa-
effet
étrangers n'avoient plus
que pourroient - ils en
envoyer en Russie ,
à
ea-
importation, mais son but n'est
cette
pas de nuire à l'exportation des
dfe
proprement
n'a
et que,
on oublieroit
ainsi
quelconque
est
du moment que
de
toujours
l'olTre
sur-
la
marchandise of-
que
nous avons
vu aniver en
nos transactions
commerciales
avec l'Angle-
elTective, le prix
C'est
ce
166
La paix ayant
lerre.
glais
été rétablie
avec ce pays,
An-
les
d'abord des achats considérables en Russie^ et
firent
ne pouvant
payer avec leurs manufactures,
les
nèrent d'autant plus de matières premières ;
tes les dégoûtèrent
y ame-
ils
mais les sui-
La valeur
bientôt de cette tentative.
de ces marchandises se déprécia tellement en Russie, qu'elles
vendoicnt
s'y
prix nécessaire;
le
à St. Pétersbourg ,
port
la
impoitations
en Russie
ce pays ,
se
imposé
virent
à
qu'ils
On
faisoient
avec
la
vendu
marchandise.
cette
élever le montant de leurs
celui
dans
sur
la
de
exportations
leurs
de
nécessité
do
réduire ces
dernières, c'est-à-dire de restreindre la totalité
merce
de leur
même les fraix de trans-
ne paya pas
Ainsi les Anglais ne pouvant
ils
plupart au-dessous
sucre en poudre, par exemple,
droit d'entrée
le
et
pour
du com-
Russie.
entend souvent avancer que la plupart des objets
de notre commerce d'exportation sont de nature à ne pouvoir être remplacés par d'autres
objets,
ni
même qualité et dans la même abondance
tre
pays.
vé
le
terre
et
fournis de
la
par aucun au-
L'expérience des dernières années a bien prou-
contraire.
est celui
qui en a le
De tous les pays de l'Europe,
qui
consomme
besoin
le
le
plus
de
plus absolu ,
l'Angle-
produits russes,
à cause do
l'im-
767
mensité de sa marine et de sa fabrication; cependant, lorsque
le
système
il
trouva
continental
moyen de
ou
discs ,
sut
il
lui
ferma les ports de la Russie,
pourvoir ailleurs de ces m.irchan-
se
remplacer d'une manière ingénieuse
les
par des produits de son propre sol. L'Amérique méridionale lui
fournit,
savons
les
en partie du moins^ les peaux, les suifs et
dont
avoit besoin ;
il
aux huiles de chenevis ,
ment diminuée par
la
belle invention
à
éclairer la
de Londres.
le
l'
leur consommation
us^ige
f[it
suifs
sensible-
de l' huile de baleine et par
même les rues
Six livres de charbon de terre donnent,
l'intérêt
et
du gaz carbonique, qui sert actuellement
de
]a
en
de fluide lumineux qu'une livre
autant
de suif donne de lumière ;
que
quant aux
plupart des grands ateliers et
décomposant,
lité
et
et ce
fluide ne
coûte en réa-
somme déboursée pour l'dchat des
fourneaux, gazomètres et tuyaux; car après sa décomposition,
la
le
charbon non-calciné conserve, à peu de chose près,
même valeur qu'avant d'en avoir extrait le gaz.
ce dernier n'est pas le seul produit qu'on
des
mêmes procédés chimiques on en
de
la
obtient
du goudron,
poix et une espèce de thérébentine que les manu-
facturiers anglais assurent
à celles
î-a
IVIais
en tire: à l'aide
colle
de
être
égales et
même
supérieures
ces trois productions qu' ih tiroient du
de poisson ,
nord.
produit eAclusiverucnl propre à la
16S
qii' on
Russie ,
et
bierres,
est
mer,
qu'on
et
remplacée par celle qu'on
a
vu
pour
indispensable
croyoit
s'.inicliorcr
purifier les
des poissons de
tire
au point, qU'au dire des
inventeurs, les îles Britanniques en fourniront bientôt
autres peuples de l'Europe.
de
souiTiir
Angleterre
par le système continental,
qu'en Irlande;
fourni le lin
forêts,
et
La fabrication des
nécessaire a
toiles^
aux
loin
accrue tant en
s'est
ce dernier pays qui a
et c'est
Les immenses
cette fabrication.
jusque-là intactes, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse
de rîie de Terre-Neuve, ont été mises à contribution
pour
les bois
de constriiction ; jamais on
Angleterre qu'à
porté plus loin
cette
époque
:
mais
bâti
n'a
aussi
plus en
jamais on n'a
d'économiser le bois dans la charpente
l'art
des maisons et dans la construction des navires. Le besoin
extrême
de
chanvres,
militaire,
en
a
et
jusque
dans
étendu
la
objet
la
si
important pour la marine
culture en Irlande, au Bengale,
Nouvelle-Zélande.
Enfin ,
accroissement rapide dans sa population,
malgré
un
l'Angleterre n'a
aperçu aucun indice de disette, quoiqu'elle ait cessé tout
à
coup de recevoir des fromens de
ture
•)
l'étranger;
son sol a fait de progrès
*).
Ces exemples prouvent que,
s'il
cit
Ces
faits
le
faut,
sont tirés de l'écrit de Mr. d'Iven.^is ,
hlttui (Ontincntal «te.
tant la cul-
l'Angleterre
intitulé :
^ffct^
du
peut
à
et
si
l'Angleterre le
le
peuvent
ligueur
la
se
des produits de la Russie ;
passer
peut, les autres nations européennes
C'est donc une politique bien mal-en-
aussi.
tendue que celle qui conseiile d'entraver
de l'étranger,
ou
produits
nous
Mais
d'en
par lu le force de renoncer à nos
restreindre
avons
dans
étrangers
qui
et
encore
nos
importations
les
consommation chez
la
raisons de
d'autres
relations commerciales.
ménager
deux devient prêteuse,
riche des
marchandises
un capital qui
sont
de
la
nation emprunteuse
Kussie
se
range
dustrie
la
la plus
c'est-à-dire qu'elle
à crédit les marchandises qu'elle importe chez
ces
*).
sert
les
Loisque deux
inégalement riches commercent ensemble ,
nations
lui.
vend
l'autre.
Or
à vivifier l'in-
Jusqu'à ce moment
encore parmi les nations pauvres ou
emprunteuses, puisque son
capital^ ne suffit pas à nourrir
toutes les branches d'industrie auxquelles elle peut se livrer;
et
nations
les
sont
qui font pour elle son commerce étranger,
toutes plus riches qu'elle,
et
rpitaux dont elle manque.' Entraver
lui
fournissent les ca-
i importation
chandises étrangères, c'est donc entraver les prêts
autres
que
nations veulent nous faire de leurs capitaux^
retarder
*)
des mar-
les
progrès
de notre
industrie.
les
c'.est
En considérant
Voyez le développement de ce principe dans mon Ccun à'Eccn, j>o*
Ut. T. f //, p. 5 2 et iu'hv.
1
mfmoires dcl'Acad. T. K/.
9*?
7 70
tout
le
nul
qui
s'y
soiinicLttnt
le
({tic
bande comme un
des
lois
près
à
les
lois
qui
un
système prrthibitif cuujsb aux t'petiples
,
on
conduit
est
correctif à
l(\i^cr
icdwisent
le
:
les
son commerce:
lois
ces
coTurc-
CepcTicJjnt,
le
uièmeLieiTeU (jue
barbarie,
faisoirnt. défense
',
quii dans les siècles de
au marchand d'emprunter
pour
nuiixj
ces
la
comra«Mcei.' dàî /in.aiqnsoîiî peu
de contrebimde
trafic
ir^urdtr
à
ont,
capitaux dont il ai'oit besoin
absurdes
n' c
m p<;^c lièrent pjs
absolument tout emprunt, mais elles forcèrent l'emprunteur
à payer une usure au
traves
portées
logues
,
lieu
intérêt
d'ini
commerce étranger ont des
au
quoique moins sensibles:
tout
forcent
nation
la
emprunteuse
payer
à
effets
ana-
n'empêchent pas
elles
emprunt de nation à nation ,
^absolument
Les en-
légitime.
plus
mais elles
cher ceux
qu'elle peut encore faire par la contrebandes.
Cinquième
de
effet
du monopole:
il
arrête
le
monopole pèse
le
perfectionnement
l'industrie.
Nous avons
vu
combien
sur
les
à l'industrie
en
consommateurs, et combien
il
fait
débouchés
et
en lui retirant les capitaux
lui
fermant
étrangers
ses
qui étoient
de
tort
venus T alimenter.
Mais T industrie
en souffre encore d'une autre manière: son perfectionnement
est arrêté par le
monopole, puisque
celui-ci la
prive
des.
771
modèles'
nil oit
que
rindiistiie
des peuples plus nvancés lui four-
le
commerce
{^tmn<:;er,
[)ar
(iirectc à
éteindre l'émulalion
A
talent.
quoi
de vendre?
que
sert
puisqu'il
a
une tendance
engourdir le cènic et
de se distinguer lorsqu'on est
le
as'îuré
A quoi sert de chercher ^ fairô mieux, lors-
gouvernement
le
,
à
pris
a
l'engageoienr. d* trouver des
À quoi sert
acheteurs à ceux
mêmes
de sur-prcndre
secret des fabricant étrangers,
le
qui font plu.ç mal ?
lorsqu'on
n'aura jamais à craindre leur concurrence? C'est dans cette
posilion, c'est lorsque
liés
réputation
sa
il
qu'il
se
faire
sortir.
refuse
à
fabricant ne
le
voit plus ses intérêts
qu'il s'appesantit dans sa routine et
tout
efTort
géiiérëux' quî" pou'rroit
de l'industiie étrangcie
la
plus avancée, et en
étaiit
con-
les
chefs
stamment alarmé, par leur perfectionnement, que
d'atelier
l'en
Ce n'est qu'en ayant sous les yetix les produits
comprennent ce
qu'ils
peuvent
faire
pour Tintérêt
des consommateurs et pour le leur piopre.
Le
célèbre
Chaptal ,
autrefois
ministre
de l'intérieur
en France^, en énumérant dans un de ses ouvrages les in-
convéniens attachés à la prohibition des marchandises étrangères,
n'oublie pas celui-ci:
de ne plus
lant à l émulation des fabricans français ;
je
veux
que
les 'prdduify
'
offrir
de stimu-
aussi ^
~ajotrte-t-il
des"^f(ibn(p6^ étfan'gères
97
*
viennent
TJ:2
sur nos
concourir
qucs
propres marchés
Q.uoique
}iationahs..
le
,.
de nos fahri-
da
gouvernement
les ,,pjéj tiges
rcxécudon de ce
fiançais se soifnt opposés à
néreux
avec ceux
temoigHagç, que Ghaptal en
pas
une
a;
dessein, .gé-
liiissé
preuve que
dans, ces
hommes
les
lignes n'en
est
éclairés de
tous les pays sont d'accord sur le principe de
la liberté
joioins
du commerce,.
Six'ihnc effet
du monopole:
dé vexations et de
raliser
une sourco
faux - fraîx,
et
d'injustices,
il tend
a démo-
la nation,.
Nous avons examiné en
produit le système
les-
il" est
détail' lès- Inaux^ directs» que
proliibitif;,
jetons
un coup -d'oeil, sur
maux accessoires^ qui l'accompagnent..
i^.
l'intérêt
Il
est
fécond: en- iiijustices.
D'aboid
il
sacrifie
du consommateur a celui du producteur: mais de
quel droit force-t-on' lés consommateurs a se refuser des
jouissances innocentes, ou in faire dès dépenses plus fortes pour
se procurer leurs besoiiis indispensables,
le tout
pour aug-
menter l'embonpoint, de quelques fabricans,. ou pour enrichir quelques contrebandiers et
j
_.
,Le
commis de douanes ?
système prohibitif^ sacrifié- encore l'intérêt de
taines classes
cer*-
de producteurs à celui de ceitaines. autres
773
de
classes
mais quand
générales-,
ne
elles
fort
plus
une
l'étranger,
prohibitions
même elles
seroient pas par le
le
pas
revient
Les
producteurs.
cher
ne sont
jamais
le seroient par les lois,
fait.
Une denrée cjui ne
à pioduirc dans le pays que dans
marchandise dont le transport au loin est
coûteux, n'ont point à craindre que les produits étran^
même espèce viennent se mettre en concurrence
gers de la
avec
elles
véniens
:
des
leurs producteurs participent
prohibitions
sans
donc aux incon-
partager les profits
du mo-
nopole.
Enfin, dans les industries
même
qui profitent du mo--
nopolé, les gains ne se partagent pas équitablement entre
tous ceux qui concourent à la piodtiction: les chefs d'entreprises
di?s
exercent un monopole,
non-seulement a l'égard
consommateurs et des producteurs dans les autres bran-
ches,
mais encore, et par d'autres causes, à l'égard de leure
propres agens et ouvriers ;
de manière que ceux-ci parti-
cipent
aux désavantages du monopole comme consomma-
teurs,
et ne participent pas aux gains forcés
comme pro«-
ducteurs.
2°.
Le système prohibitif est une source de vexations
et de faux-frair.
est celle
La dépense perdue
la
plus apparente
des douaniers,^ des inspecteurs, des gardes-cotes;.
774
mais
le
plus létlle est celle do la pcite du travail ,
lii
s((iilc
travail
de ceux qui font leur mélier de
trebande, et de
cei'.x
cupation de
la
piévcnir.
le?
faux-fraix,
par
des
Parmi
casionnés
qui,
font ou
(lui
il
leur oc-
faire
transports
Les
inutiles.
marchandises
leur entiéc cloit libre, pourroient arriver par mer,
si
ou do
d'arriver par terre,
faire
où
frontière
la
à faire ,
sont obligées
des détours immenses, sur
pour
se
présenter à l'endroit
contrebande
est
plus aisée.
des routes peu praticables,
la
ou
con-
ne faut pas oublier ceux oc-
ou n'auroicnt que peu de chemin
de
[)aroissent
la
Les ha-
bitans des cotes ou des provinces frontières qui pourroient
s'approvisionner
leur
à
permis de l'importer, se voient forcés
sommation,
s'il
de
à grands
le
tirer
porte de tel article de leur con-
étoit
Dans ce cas - ci , comme dans
port et le travail
inutile
compensation pour
la
gueur,
il
fait
contrebande.
comme
je
l'ai
des voituriers
frai.x
de trans-
sont perdus sans
ou
le
système prohibitif
est
en
ri-
infailliblement un système régulier de
naître
Sous
l'autre ," les
nation.
partout
Enfin
3°.
du pays.
fraix des provinces éloignées
le
déjà
rapport
observé,
de
la
la
richesse
contrebande
nationale,
est
un mal
plus léger que le monopole^ puisqti'il sert en quelque sorte
7-5
de conc.rif à ce dernier;
iiniis
un
iilïUuc
ports
c'est
iiiélier
(jui
de
i.i
sous tous les autres rapla
conduit à niépriser les
devoirs
ses
lie
inc)l
comme
citoyen
plus dan/e relise.
lois
de
l'Etat, à se jouer
comme sujet,
j£t
Un
à devenir
parjure à ses sermens, doit certainement être regarde com-
me une
peste morale:
tent
d't^xposer leurs administrés
p.is
ncaumoins
les
gouvernemons
n'hcsi-
à cette funeste conta-
gion pocH- atteindre un but illusoire, un but qui, s'il pouvoie
atteint,
être
nuiroit
à la richesse nationale
au
lieti
de lui être utile! N'a-t-on pas \u des administrateius s'oj)I)oser
la
réduction des droits d'entrée, de peur de rendre
la
à
contrebande moins lucrative ,
et
conséquemment moins
C'est à cet excès d'extravagance qu'on parvient
*)?
forte
en se pénétrant des principes d'un système factice et contraire
*)
à l'ordre naturel des choses
!
C'est en effet la raison sur laquelle le directeur des douanes françaises,
fondoit son opposition dans un écrit publié il y a quelques
gr'icu ^
M
Dès que la fraude ne
scrois plus si lucrative ,
il
pense qu'on
avec autant d'ardeur et que cet effet entraîneroit celui que les douaniers ,
ne voyant plus l'attrait des confiscations, se dé->
goùteroient de leur métier et s'en acquittcroient avec négligence. 11 croi t
donc important d'agraver les droits pour donner de l'activité h la contretandc
seul moyen qu'il connoisse pour en communiquer aux employés de la douane.
Ceci revient au principe que le gouvernement
doit encourager le crime pour avoir les moyens de le punir.
On croit
entendre un juge qui s'afflige de la réforme des moeurs, parce que si
années.
ne
la
fcroit plus
,
l'on parveroit à n avoir
tribunaux. {S'imoiidCf
plus
de
scélérats,
-on
n'auroit bientôt plus
Dr la rktesse commcniûle, T, il, p. aag.)
de
DES ENTRAVES À L' I\lPOKTATrON DES MARCHANDlSl-iS ÉTRANGÈRES COMME MOYEN D'EN-
COURAGER LA PRODUCTION NATION.VLE.
PAR
S T O Ji C H,
H.
Présenté ^
h Conférence Je i3 Août iBay^
Seconde partie.
'Tels sont, les effets des mesures qui excluent les produits de l'industrie étrangère
ne
les
y
admettent
tre
Cette discussion, loin
d'exposer ,
matière,
qu'on
raisons
leur
il
ou qui
intérieur^
que chargés de gros
avant de quitter cette
les
du marché
importe de
droits.
Mais
faire
connoî-
allègue en faveur de ces mesures.
d'ailoiblir
prêtera
les principes
que
je
viens
au contraire de nouvelles forces,
et fera sentir d'autant plus leur solidité.
Les
pertes , dit-on,
qii
ww nation fait en prohibant ou
en entravant l'entrée des marchandises étrangères qu'elle peut
produire chez elle,
la forçant .de
.se
ne
sont que faibles et momentanées
suffire
à
elle-
même ^
elle
:
en,
acquiert de nou-
777
veïlcs
la
branches d'industrie qui l'enrichiront d'autant plus par
suite.
Observons d'jboid que
les pertes occnsionnées
mesures sont beaucoup pUis
gr*incles
On
par ces
et plus durables qu'on
se
r imagine
Id
Russie a faire par la prohibition d'un seul article, des
ordinairement.
draps
étrangers
an
et
*),
c5
à
,
millions de
ne
évahuirion
cette
a
calculé
la
roubles assignats par
pajoît point exagérée.
pouvoit supposer que vingt années eussent
l'on
parvenir
faire
monopole
même
au
,
fabriques de
nos
point
les
fabriques étrangères., la
dre
ce but ,
la
moitié ,
la
diaps ,
le
suffi
Si
pour
par le nioven
de, perfection
où
du
se trouvent
Russie eût sacrifié, pour attein-
somme énorme de 5oo
toujours
perte que
millions.
Mettons
eût été au-delà de toute
sacrifice
si
l'on
considère que le but n'auroit
été atteint qu'à demi.
Car
à
proportion,
ses
les
force d'efforts et de dépen-
fabricans russes pourroient
l'espace
les
surtout
de
étrangers,
certainement
vingt
ans à
quoique
peut-être
pervenir dans
fabriquer d'aussi bons draps que
j'en
doute;
pas les fournir au
mais
ils
ne pourroient
même prix.
Ce qui rend
nos marchandises manufacturées chères, en comparaison de
celles de
l'étranger,
c'est
principalement le taux élevé de
•) Arnold, Aiiiubten ûber dus TarifsysH/rt in Russland, p.
Mfmotrei de l'Aatd. T. FI,
aS.
9^
7-8
du
et
l'intêiêt
profit
do l'cntreprcncLU-
mens du prix ne peuvent jamais
deux
ces
or
:
baisser (juo par r'cnricliis-
du capi-
senient général de la sociclé^ par l'augmentalion
national;
tal
fallu plus
a
Il
augmentation
cette
et
de
descer>dre rintérct de
de
espérer
au
bout
prohibitif
la
de
est
l'alTaire des siècies.
Angleterre pour y faire
siècles en
trois
éJé-
lo pour cent à 4
C'est beaucoup
*)•
Russie que d y attendre une piireille baisse
la
tems
de- ce
ni.oitié
donc ^
:
si
le
système
y eût été constamment maintenu, la Russie eût
constamment des pertes, quoique graduellement moins
fait
sur cette branche de sa production , pendant plus
fortes ,
-d'un
siècle
nouvelle
Elle
encore.
eût,
branche d'industrie,
à
h^
vérité, acquis une
mais loin de s'enrichir pac
Or
le
but de la législation
économique n'est pas d'appauvrir
la
nation,
elle
là,
lichir.
se
appauvrie.
fût
Quelles
que
mènent ù ce but,
nent.
Chez les peuples
peut - être plus
est
soient
c'est
les
branches
indifférent,
industrie qui
pourvu qu'elles y mè-
riches, l'industrie
productive
mais de l'en-
d'
manufacturière
que l'industrie agricole;
mais chez les peuples pauvres c'est tout le contraire **).
Cependant, dit -on,
') Smitb^
**)
presque toutes les nations europé"
Wealtb of nations, the jtb
ed'itiony
Voyez le développement de ce
principe
T. /K, p.
IIL
i63,
i<-'i
cbap. Il
et
Fcl. /,
p.
i35.
dans^mon Cours
d'Eccu. polit,
779
^nnes ont employé
elles
système prohibifif pour introduire chc%
Je
branches d'industrie qui leur manquoicnt, et
les
La piemièie partie de celte
sont enrichies par ce moyen.
.
assertion
n'est
prouver
la
que ce
n'est
que trop fondée, mais
Smith
seconde.
elles se
a
seroit
il
difficile
de
démontré jusqu'à l'évidence,
pas par ses mesures réglementaires que l'An-
gleterre s'est enrichie, mais malgré ces mesures, et qu'elle
auroit fait des progrès
le
si
gouvernement
bien phis
a voit
rapides vers l'opulence,
prendre
laissé
à
l'industrie
route que l'intérêt individuel lui prescrivoit.
observations
se
sont vérifiées
par rapport
de
la
prospérité
Les mêmes
à la France
et
Le progrès natu-
à tous les pays florissans de l'Europe.
rel
la
amène immanquablement chez toute
nation cette époque ou la culture des terres ne peut absorber le capital national, et où
diriger vers l'établissement des
le
hasard
,
la
nation
adopte
le
devient avantageux de
il
manufactures *):
système
prohibitif
«poque, l'accroissement de son industrie paroît
de
ces
mesures législatives,
que
le
résultat
de
sa
•)
et
qu'en
le
seconder.
de Louis XIV.
Voyez Cci<n d'Eron. pciit. T. IV, p. 34o
le
ie
à
par
cette
être l'effet
réalité
situation naturelle, résultat
mesures entravent au liea de
du tems d'Elisabeth
tandis
si,
il
n'est
que ces
Ainsi ,
quand
système prohibi-
(bûp.
XllI.
98*
78o
tif fut
établi
l'industrie
de
en Angleterre et en France , les progrès de
pays
ces
ne
furent
pas
de ce sy-
l'effet
stème, mais de la sûreté mieux garantie des personnes et
des propriétés, de l'accumulation des capitaux et de
l'c-x-
tension des lumières, causes qui, sans la manie réglénientaire
des gouvernemens , eussent
manufactures ,
tions
*).
et
avec
Si le système
*)
profit
prohibitif avoit
auroit
il
mais les
du
pays où
tous les tems et dans tous les
:
également naître âes
plus de
bien
en France et en Angleterre,
dans cette vue
fait
pour ces na-
produit ces effets
produire dans
les
il
a
mêmes mesures qui
été
employé
réussirent à
Les preneurs du systèînc réglémentsire n'ont pas manqué d'attribuer
d; l'agriculture en Angleterre à un des expédicns de
savoir à la loi qui accorde une gratification {bounty)
leur S7>tême
pour l'exportation des blés. Voici ce que Smilh dit à ct-tte occasion. ,,Cc système de lois qui est lié avec l'établissement de la gral'état florissant
,
ne paroit nullement mériter les éloges qui lui ont été proL'amél oration et la richesse de la Grande Bretagne, qu'on
peuvent très-aisément s'explquer
a si souvent attribuées à ces lois
Cette assurance que donne la Const tupar de tout autres causes.
tion anglaise à tout individu, de pouvoir compter sur la jouissance
des fruits de son travail , est st- ule sufiisautc pour faire prospérer
et cette assurance a été
un pays
en dépit de tous ces réglemens
portée au plus haut degré parla révolution, presqu'au même moment
Parce que l'époque de la plus
ou la gratification a été ét< blie
grande prospérité de la Grande Bretagne et de ses plus grands proil ne
grès dans la culture a été postérieure à ce système de lois
faudroit pas, pour cette raison, en faire honneur à ce système. Cetor, ce qu'il
te époque a aussi été postérieure à la dette nationale
y a de plus certain au monde, c'est qu'elle n'a paà été amenée par
tification,
d);^aiés.
,
;
,
.
.
.
,
:
ia dette nationale.
'•
{JVealtb of nariom. Vol. //, p.
3 9.)
Colbcrt, n'eiuent jwctine suite sous Flenri IV. *); et l'ap-
du système
plication
qui est censé avoir rendu
prohibitif,
France et l'Angleterre les pays
1.1
les
plus industrieux d#
l'Europe, n'd point pioduit cet effet en Suède, en Dane-
marc
et
dans
plusieurs
avec
Id
plus
grande
Ce
étonnante.
n'est
du gouvernement,
doivent
pays
autres
rigueur
et
oîi
persévérance
la
que
les
naturel de la prospérité ,
bien plus rapide
plut
nations opulentes de l'Europe
lequel ,
ces mesures
si
la
donc point aux mesures prohibitive^
industrie et leur richesse,
leur
été faite
a
elle
ne
mais
au progrè*
sans doute ,
aiuoit été
l'a voient
entravé.
Les écrivains qui démontrent le vice des mesures réglementaires, sont souvent accusés d'être contraires au progrès des manufactures et
n'approuvent pas
du commerce étranger, parce qu'ils
moyens violens par lesquels on tache
les
d'introduire et d'étendre ces industries, avant le terme
qu€
nature des choses prescrit à leur développement spon-
la
C'est ainsi
tané.
que
j'
a vois
que des lecteurs
prêché
une
d'Économie politique,
merce,
état
•)
et
pareille
superficiels ont
doctrine dans
qu'ennemi des
arts
avancé
mon cours
et
du com-
je, voudiois que la Russie restât éternellement un
agricole.
Ce
seroit
avec
le
même fondement qu'on
Voyez Mtmotris de Snlly, T. Ul, f. 4iO.
782
accuseroit
un
instituteur
l'ennemi des sciences, lors-
d'être
qu'il conseillcroit à son élève d'attendre, pour
le
tems où
il
aura
acquis
s'y
vouer,
connoissances élémentaires
les
De mêversé
dans le
homme
qui
n'est
pas
bien
me qu'un jeune
maturité d'esprit nécessaires à leur culture.
et la
calcul, ne peut point entreprend le l'étude des mathém'a ti-
ques sans retarder ses progrès dans cette science, une nadont le capital ne
tion
ver ses terres,
res
le
et
ce
pas encore pour bien culti-
ne peut point entreprendre les manufactu-
commerce, sans
Mais du
richesse.
suffit
tort à
faire
moment où
le
l'avancement de sa
capital
est
parvenu à
terme,
rien
ne peut empêcher la nation d'étendre la
de
son
activité
sphère
industrielle ,
et ses progrès sont
alors d'autant plus marquans qu'ils sont le résultat de ses
spontanés.
efforts
Pour accélérer ce moment, tout ce
qu'il
est
au pouvoir du gouvernement, c'est contribuer à répandre
les
connoissances
générales
et
de protéger l'accroissement
du capital national; mais en dirigeant de force
nationale vers des industries précoces,
tion et agit en sens
contraire de son
il
ment
Europe
le
n'est
appauvrit
n'a
été
libre,
et
na-
mais malheureuse-
pas constatée par l'expérience.
commerce
lii
but^.
Cette théorie j dit-ort, est séduisante;
elle
l'industrie
Nulle-part en
nous n'avons point d^e-
783
xcmple crune nation chez laquelle
spontanément
pcc
'
Ceux
vcs.
que
memrcs
que
la
prohihitt-
ou supf)o-
Suisse
^n^^
jamais conna
Hollande
ne
Ta pratiqué
la
beaucoup de modération»
qu'avec
fût dèuelop-
qui tiennent ce Lingaî^e, ignorenl;,
syslcme- prohibitif ;
le
secours des
le
d'auties ignorent,
qufî
senr.
sans
et
l'indnsirie se
et par représailles
plu-
que par choix; que plusieurs contrées de l'Allemagne,
tôt
de ritalie
nise,
et
mcme de l'Espagne, telles que la Saxe, Ve-
Toscane
la
et -la
ou moins exemptes;
plus
des
que ces pays étoient au nombre
enfin
industrieux
Parmi ces exemples ,
des
et
le
est
qui
seul
plus
fl'orissans
de l'Europe.
celui qui prouve le plus en faveur
de la liberté du commerce,
pays
en ont été également plus
Biseaie^
c'est
la
Suisse, parce que ce
adopté constamment pour règle
ait
de conduite celte sage politique dans sa plus grande extension, et
Tisiblcs
que
les
fruits
qu'il
aux yeux de tout
le
en a recueillis sont encore
monde.
Ecoutons ce qu'ua
habitant éclairé de ce pays nous rapporte sur ce sujet.
„Jamais, dit Mï.' Simondc
douanes dans
cherché
de
il
n-'a
existé de tarif de
divers Etats de la Suisse; jamais on n'a
à y protéger l'industrie nationale par l'exclusion
l'industrie
*)
les
*),
étrangère et aux dépens des consommateurs.
D^ la r'ichtsic commcràaU, T. llf p. ^\i.
784
Toutes
les
portes de l'État sont ouvertes, et si l'on y per-
çoit des droits, ce
sont des péages pour la
chemins, et non point des douanes.
put
ne
qui
manufacture
aucune
On
réparation des
n'y
jamais fondé
a
soutenir
plus libre
la
concurrence, mais aussi toutes celles que la Suisse possède
sont florissantes, et ne contribuent pas moins à l'avantage
du
consommateur qu'à
de
la
du
celui
Les capitaux
fabricant.
Suisse ont suivi la direction naturelle:
ils
ont, avant
toute chose, alimenté l'agriculture, et l'ont porté au
haut
point
de
dans
aucun
pays
perfection
du
rude climat habitent
les
peut-être où
monde.
Il
elle
faut se
soit
plus
arrivée
rappeller quel
Helvétiens, et combien d'obstacles
ils
rencontrent dans la rigueiu- des frimats et dans l'apreté
du
sol.
Ils
comme dans les belles plai-
n'ont point pu,
nes de Lombardie ou les heureuses collines de la Toscane,
faire
succéder une récolte à une autre ; mais
jours su
re,
avec un degré de perfection
su
atteindre.
Plus
de
la
produire
que de l'herbe,
entendu
l'art
de
la
veur
ont tou-
connoître ce qui étoil le plus propre à leur ter-
ne lui ont demandé que cela ,
ils
ils
de
faire
moitié
l'ont
obtenu
de
la
Suisse
ne peut
mais nulle - part on n'a mieux
produire
vertu ,
ils
qu'aucun autre peuple n'a
en
abondance à
bonne herbe, de conserver aux
et toute leur
et
foins toute
la
terre
leur sa-
d'élever de beau bétail, et de
-or
tirer
un
grand
parti
d'un
sol
stérile
d'ailleurs
vigne
:
on
les
de
son
trouvées propres à la
sont
:;c
Q.uelqties collines
laitage.
en a couvertes, et
il
n'existe pas dans l'u-
nivers de plus beau vignoble, dont la culture soit
entendue
plus
bourse
legrette
des
que celui
faire
du
lac
Léman
qu' on
prodigieux , et rem-
pour son explotation ,
de
produire
fois
plus
qu'on ne
terres sont propres
faire
soit
réguliéiement les frnix exorbitans ,
point
bords
de
dont le produit
,
mieux
.i
,
au blé; on
celles qui
s'y
en demande ,
leur
surtout de la
et
n'a point
refusent ,
on
Vaux.
Peu
cherché à en
mais toutes les
prodigue tant de
leur
soins qu'on est assuré d'obtenir d'elles d'abondantes récoltes.
j.
stries,
Après que
la
plus productive de
l'agriculture, à été
duits;
un fonds
les
indu-
complètement saturée de capitaux,
Suisses ont destiné les leurs à
les
toutes
commercer sur
ses pro-
très -considérable est consacré à ce négoce ;
on en pourra juger en apprenant que le seul petit canton
de
Sch'vvitz,
cie ,
qui n'a pas quinze lieues carrées de superfi-
dont près de
la
peut - être
moitié
est
occupée par
des rochers stériles ou des glaces éternelles, exporte cha-
que année par son port de Brunnen ,
d'une
si
belle race
qu'elles
ne se
trois
mille
vaches
vendent pas moins de
quinze louis l'une dans l'autre; en sorte qiie son exporta-
786
bétail
seulement s'élève
1^080,000
à
tion
en
fjLit
y ajouter celle en fromages, en bois
qui est aussi très - considérable.
que
aussi bien
celui
Les
et
francs.
Il
en merrains,
autres cantons font,
un commerce immense
sur les
transports , les Suisses ont
ouvert
- là ,
productions de la terre.
„ Pour
faciliter les
dans tous les sens des chemins
on ne peut les traverser sans admirer l'immensité
tagnes;
du
au travers de leurs mon-
travail qui
a tracés, et leur parfaite conservation.
les
pouvoient
Mais ces industrieux montagnards ne
complètement la nature
sont
point
renchéri
praticables
les
fraix
:
plusieurs
de leurs chemins ne
pour des chars ;
de voiture.
vaincre
cette difficulté a
Les marchandises les plus
précieuses sont celles qui peuvent le mieux supporter ces
fraix considérables ,
qra'il
a
et c'est sans doute
convenu aux Suisses,
manufactures,
lorsqu'ils ont entrepris des
de s'attacher à celles d'un prix élevé et
qu'on pou voit .transporter plus au loin
joaillerie
du Locle
et les toiles
etc.
pour cette raison
et
les
montres et la
de la Chaux-de-Fond;
les indiennes
:
de coton d'Appenzell, de Saint-Gall, de Zurich
vont chercher des consommateurs jusqu'aux extrémités
de l'Europe.
„lLe
commerce intérieur,
qu'on n'estime jamais à sa
Traie valeur, est porté en Suisse au plus haut degré d'ac-
dael
livité.
pour
la
première
de
contre
doit''être l'étonnemént
fois
du
les bords
du voyngeur qui
lac
Léman,
et qui ren-
deux lieues en deux lieues de^ petites
toutes florissantes,
oh tous les habitans
sont bien nourris ,
bien vêtus, bien logés, et
suit
villes,
respirent l'aisance,
toutes lès maisons contiennent des magasins
presque
oit
et dès bouti"
ques, qui ne redouteroient point la comparaison avec celles
dos villes
commerce y
les'
également libre ;
est
est point regardé
Suisse peut - il
plus inarchandés de la France.
de mauvais
Tout
celui d'importation n'y
oeil : aussi le
consommateur
obtenir à meilleur marché ses habits ,
instrumens et tout ce qui lui vient du dehors ,
ses
qu'aucua
autre peuple de l'Europe.
„ Après que
toutes
les
été saturées de capitaux,
il
Suisses,' outre le comniercé
voies
de
la
circulation
ont
en a surabondé encore; et les
étranger d'importation et d'ex-
Des ca-
portation, ont entrepris aussi celWi de transport.
pitaux dé Neufchàtel, de Bâîe, de Lausanne, de Genève,
étoient
destinés
eux ou avec
à faire
les
échanges des Fiançais
d'autres nations;
ceux dès
villes
entre'-'
de Zurich,
Schafhatisen et Saint-Gaii réndoient le mênie service aux
Allemands; CEUX d'Altorf,
foulé
dé
de'
Luceme, dé Coire
et d'une
villages semés sur la pente méridionale des Al-
pes , en faisoient autant pour Tltalie,
où Ton
tr0Uivi#
99*
un
788
nombre prodigieux de riches négocians Grisons,
Dans tous ces
villages à peine connus.
Genevoises ,
des
colonies Suisses
bien
différent
de celles que
dans
les autres
parties
s'établir
chez
et
les
colonies
Européens
l'on
d'un
ont
de
voit
genre
fondées
du monde, puisqu'elles ne viennent
peuples , que
les
Etats ,
sortis
pour
les assister
de leurs
richesses et de leur industrie.
„ La
injuste
aussi
que ruineuse
une
guerre
du milieu de
se relève
*),
accumulé
l'
industrie
plaies qu'on lui a infligées.
de
par
ses
Suisse est encore riche , et le capital prodigieux cju'y
avoit
le
dévastée
avec une force que personne n'attendoit d'elle...
désastres,
La
cruellement
Suisse ,
sien
à citer
l'abolition
balances
en
humaine ,
C'est
ferme
partout
les
un grand exemple que
faveur de la liberté
du commerce
et
de toutes les barrières qui, sous prétexte de
empochent
défavorables ,
l'
entrée
des
produits
d'une industrie étrangère. "
Dans
les ci - devant
républiques des Pays - Bas et de
Venise, l'importation d'aucune marchandise étrangère n'étoit
défendue; celles-ci payoient un léger droit d'entrée
(en Hollande
valeur,
dans
ce droit
les
étoit
de deux pour cent de leur
États de Venise
*) Mr. Simonde écrivoit en i8o3»
d'un
pour cent seule-
789
ment):
des
produits
empêché
les
Hollandais et les Véni-
n'a
point
d'établir
chez
étiangc'ie
tiens
et
de devenir
les
eux des manufactures de tout genre
nations les plus opulentes de l'Europe.
Diins le royaume de Saxe ,
merce de
de
la
tes
les
ville
la
de Leipsic a
l'intérêt
évident du com-
triompher le principe
fait
commerciale sur les préjugés populaires; tou«
liberté
marchandises
pendant de toutes
est la
de Tindustrie
cependant l'affluence
étrangères
les
contrées
plus industrieuse et
La Toscane, au
la
tems
y entrent librement
de l'Allemagne
la
,
ce-
:
Saxe
plus manufacturière.
de
la
république Florentine,
avoit été soumise au régime des prohibitions.
Le Grand-
Duc Lèopold rendit la
Les contri-
liberté
au commerce.
butions, qui étoient en grand nombre, furent toutes levées
au
profit
fisc;
aucune n'appuyoit un monopole mercan-
Or tout le monde
tile.
rissante
et
du
de
combien
la
sait
quelle étoit la situation flo-
Toscane sous cette administration
ses manufactures
et son
éclairée,
commerce étoient su-
périeurs à ceux des autres Etats d'Italie.
Enfin ,
liberté
aussi
pour se convaincre des
du commerce ,
instruit
il
suffuoit
de
effets
lire
que véiidique rapporte sur
la Biscaie, à une
heureux de la
ce qu'un témoin
la
situation
de
époque peu antérieure aux derniers trou-
—
igo-
Suivant le récit de Bour-
tjes qui ont dévasté l'Espagne.
going *),
l'industrie,
l'activité,
cette province, formoient
et le
ertie
dénuement de
l'aisance qui régnoient dans
un contraste singulier avec
l'in-
celles qui l'avoisinoient :
aussi
ces dernières étoient- elles soumises à toutes les vexations
du système prohibitif,
près ,
toutes
ment dans
pour
les
„ Les Biscaiens, ajoute
douanes une
aversion qu'en
geant
l'esprit
plusieurs occasions
indépendant des Biscaiens, leur avoit fourni
moyens de prospérité
,'Ses
l'auteur, ont
La cour, en ména-
ont prouvé être insurmontable."
ils
restrictions
du dehors entroient libre-
marchandises
la Biscaie.
les
qu'à quelques
tandis
dontr
.ou qu'elle déploroit peut-être
elle
se
doutoit
fort
peu,
comme des enttaves à cett^
prospérité.
<!!es
exemples, dont on pourroit encore augmenter
nombre, prouvent bien que le prindpe de
merciale
n'est point
le
liberté cotïi-
la
un rêve philantropique , un principe
fondé sur une théorie purement spéculative, et dont l'ap-
que
plication seroit douteuse, peut-être funeste, parce
efTcts
sont encore irrconnus: tout au contraire, l'expérience
l»usi apprefld qtHB maint, jieuple
vu- son» industrie entra-
a-
et ses progrès vej-s l'opulence retardés par ïe régiflie
iVié^i
—
seà
^
I
_
,
_
—^—
.
—
..-^
.• *
'
•
•
^
——
=-^
79 i
mais
prohibitif ;
la
ne fournit pas un seul exemple où
elle
du commerce
libciLc
prompt
et
produire
l'opulence
n'ait
de toutes
facile
suivie
été
du développement
les facultés qui
donc permis
nationale.
Il
joindre
voeux à ceux de Mr.
est
citoyen
éclairé
dé
monde,
''^pour
que tout gouvernement qui
ment le
bien, qui ne
rer
il-
ses
Si-
désire ardem-
la
routine à laquelle
et qu'il profite des leçons muettes mais
giques de l'expérience
tout
a
pleure aucun sacrifice pour le procu-
au peuple, réfléchisse encore sur
se livre,
concourent à
éner-
"
!
y a des personnes qui, convaincues des avantages
Il
d'un commerce libre, sont cependant d'avis qu'il seroit dan-
gereux
d' êtahUr
monnaie
cette
a remplacé
supposent
que
la
le
liberté
dans
un pays bu
numéraire métallique,
valeur
de
ce
papier
le
papier-
parce
qu'elles,
dépend du change
étranger, lequel peut devenir défavorable au pays, si l'impor*
tation
des
marchandises étrangères n'y est assujéti à aucu»
nés entraves.
Les partisans de cette opinion sont très-nom-
breux en Russie.
Si
le
commerce
étoit libre ,
disent - ils,
l'importation des marchandises étrangères excéderoit l'exportation
de
nos produits,
traire,
ce
qui
dépréciés.
avilïroit
Le système
et le
change nous deviendroit
cotif
encore davantage nos assignats déjà
prolùbitifj
au
co)itraire,
eii
limitant
792
limportatlony nous rend
change favorable,
le
et
améliore par
là notre papier.
ce raisonnement étoît fondé,
Si
il
ne s'^nsuîvioit pas
encore que le gouvernement dut recourir,
valeur de son papier,
que
sible
la
a.
pour sauver
une mesure aussi violente
la
et nui-
prohibition d'une branche du commerce. Pour-
quoi n'emploieroit-il pas plutôt un moyen de guérison radical qu'un mauvais palliatif?
pas
Pourquoi ne diminueroit-il
masse àes assignats et ne leur donneroit-il pas une
la
garantie
pour assurer leur valeur, plutôt que de venir à
leur secours par des mesures, lesquelles, supposé qu'elles
pussent opérer quelque bien dans ce sens, font en
même
tems plus de mal dans un autre ?
Mais ce raisonnement
est
absolument faux, comme la
discussion suivante le prouvera
1°.
Il
tout esprit non-prévenu.
l\
ne s'ensuit pas que,
le
commerce étant
libre,
la balance du commerce et le change seroient défavorables
à
la
notre
Russie.
Au
avantage
que dans
de prohibitions.
jusqu'en
1*768)
dans les
trois
contraire,
le
ils
n'ont jamais été plus à
tems où
il
y a voit le moins
Dans l'espace de 69 ans (depuis 1700
le change ne nous a été contraire que
années de la guerre de sept ans, de
a
1761 ;
il
a été constamment au-dessus
pendant tout
le
reste
fjSg
de cette longue période
du pair,
et le plus sou-
793
vont de
lO à 42 pour cent
pit.^que
tnmes
1rs
Oi^
*),
cLuis
marchandises
crraUj^^t'ies
et
qii' (.lies
cette période,
entioient l>bre-.
ment
en
poLii
Li
pUipart modiques.
2°.
Les prohibitions n'cmpechcnt pas l'entiêe des mar-
Russie ,
les dioits
éti\ingères ;
clKindises
elles
moins coûteuse j "suivant
rendent seulement plus ou
la
volume
le
Dans ces derniers tems
chandises.
payaient éloient
et la
les
valeur des mar-
prohibitions s'éten-'
doient sur presque tous les objets manufiîCt'âVés de Tëtran'et
s^er'y
jours,
la
contrebande nous on
fouriiissoit
tou-
en abcndcince.
êl
3^^.
p.ïs
cependant
Enfin
valeur
Ia
du change étranger
,
du
papier - monnaie ne dépend
de
mais
la
quantité
du
papier.
Lorsque celte quanlite est au dessous du oesoin de \à circulation intérieure, 1^5 espèces métalliques se maintiennent
plu? ou moins
se
déprécier,
au
pays.
le
dans
pays,
le
même
quand
Lorsqu'au
et
le
le
les
papier monnaie excède
espèces sortent tout-à-fait
papier se déprécie, quelque' favorable que
Dans ce cas,
puisse être le change étranger.
') Voye?. le TiMecru
con.
papier ne peut point
cliange seroit défcîvorabie
le
contraire
besoin de la circulation,
du pays
et \q
Nr.
t II
dans
le
fixi>mc volume ds
polir.
M^:noiri{iderAi„<i.
T. n.
^
O^
les
ijior.
somm.es
Cours d'E-
794
d'argent qu'il
la
ce papier,
s'il
s'est
des
lui
prescrit
en sont aussi -tôt
surabondance du papier,
par
on
pays,
enlrcr dans le
fciit;
exj^Lilsccs
de
et le cours
relevé momentaTiément par l'importati-
ne
espèces ,
pas de retomber au taux que
tarde
quanlilé relativement au besoin de la cir-
sa
culation.
Quelque bien fondé qite
Tableau,
encore
loin
d'être
crois
donc
utile
nos assignats.
J'ai
dans
l'intérieur et
la
de ce Tableau
prouver par
les
de
la
Russie.
Je
de l'assignat
valeur
*).
11
résulte
:
,
intérieure ;
presque constam-
valu
le
change étranger que dans
car
le
ment davantage dans
culation
sont
exemple même de
dans le change étranger
Que l^ rouble assignat a
1°.
1'
ils
à cet eiTet le Tableau ci-joint,
dresisé
comparaison
présente
en
généralement reconnus
de
qui
soient ces principes,
pair de l'assignat pendant
34 années;
dant 4 ans ,
au - dessous du
et
il
n'a
été
la
cir-
change à été au - dessus du
il
a été
au pair pen-
pair que
pen-
dant 9 années.
2°.
Qt-ve
la dépréciation
progressive
de
l'assignat
a
toujours précédé de plusieurs années l'époque où le change
•)
Ce Tableau «st extrait
trouvent dans le 6nie volume
J'y ai compris les dernière*
;innées et réduit le taux du change sur les différentes places i un terme
moyen, exprimé en copcks d'argent, pour faciliter la coii)p<iraii>oo.
de
<le
ceux qui
se
mon Co«n, sous les N-os. V. et VII.
795
devenu contraire à
est
sous du
que
change
le
assignats ,
que
mencé en
1
tombé que deux
la
1784;
baisse
la
la
première
fois
déjà déprécié depuis
sensiblement depuis
3°.
n'est
pair de l'assignat:
l'assignat s'étoit
tandis
Depuis
Russie.
la
et
réitérée
des
au
des-
fois
-
en 1789, lors17 75,
seconde
la
création
et plus
en 1807,
fois
de l'assignat avoit déjà com-
804.
Que r assignat a souvent éprouvé des variations
en sens contraire du change; par exemple dans les années
1772
où
73,
et
il
et dans les années
monta tandis que
17 70 et 71,
95, où l'assignat tomba dans
le
1774
tems
le
change baissa,
et
75 et 1794 et
même où le change
s'améliora.
1
Le change ne peut donc pas
tions
de
l'assignat,
événemens.
se montre
Celle
pour
progressives
avoit créé
vement
de
en
*).
40
*)
dans
de la
ainsi
faut la chercher d'ans d'autres
progressive de ce papier
baisse
dire d'elle-même, dans les émissions
millions d'assignats, qùî furent mis Successi-
circulation.
le
il
cause des varia-
Nous voyons qu'en 1769 le gouvernement
chaque émission
.qués
et
être la
en
Quoique
particulier
Tableau auquel
Ces émissions sont
le
indic^iurcs
dan»
je
le
montant et
ne
soient
l'
époque
point
mar-
viens de renvoyer mes
Tableau Nr.V. du Ccuri,
100 *
lectfcirs,
le tanx
dé
n(?>ns
les
indique' assez clai-
rement.
Dè^
pi êinieré^ émission,
le
rouble assignat ne
vaut
la
Ka'^signat
^9 copiks-,
se
déprécie successivement
penldcmt leV trois années suivantes.
Cette baisse étoit l'effet
iquê
•
étj
natoix'l
de raugmentàtio^n
frifpper
également
fane
du
sortir
espèces qu'on en
subite dit numéraire;
elle dut
espèces métalliques et l'assignat, et
les
pays
il-
à - pc u - près
a voit
émis
autant
en papier.
de millions en
L'équilibre s'e-
tant ictabli par cette sortie des espèces ,
et
aucune nou-
velle émission de papier ne le troublant derechef, le taux
de
remonte, dès Tannée
1
773, et l'année suivante
le papier atteint sa valeur nominale.
De: nouvelles é m issioniS
l'assignat
l'en
font descendre
de nouveau depuis 17 75; mais comme
elles sont très-modérées, l'assigna^t se mainiicnt
Dès l'année 1784 des émis-
ans au taux de 99 copeks.
sions plus
sa
chute
nouveaux
fortes
est
font
le
tomber, davantage ,
accélérée par
assi^i;nats.
la
ciéalion
somme
Cette,
.
1790. par ,des émissions annuelles,
si
évidemment pac
la
simple vue du Tableau
liaison de ces
Mais
si
la
la
\
pendant neuf
baisse
est
et en
1787
de 60 millions de
augmentée depuis
dont refïet se montre
progressive de l'assignat, que
suffit
pour se convaincre de
la
doux phénomènes.
baisse de
l'assignat est
de ce papier, comment s'expliquer
rcffet
pa. /uiuv^c.
des émissions
deux
fois
vé-
pêiçe,; dons
sé
*) ?
suliit
un
Pour
d'observer
Que
l*'.
où. Igs émissions n'avoient ^aèrc ces-
teins
icsoudre
cette
contiadictian
apparente ,
il
:
cette
de l'assignat
hausse
n'a
que mc-
été
Dientanée, l'une n'ayant duré que deux ans, et l'autre trois;
Que
2*^.
époques de cette hausse sont celles de
les
deux nouveaux
vè<;nes ,
dont chacun
débuta par des rae^
suies d'ordre et d'économie dans l'intérieur, et par des ar-
pacifiques
rang,eniens
au - dehors.
L'clTet
de
ces
mesures
de voit être d'autant plus grand , que l'opinion du peuple
devançoit et leur prètoit de nouvelles forces;
les
Que l'acquisition des
3°.
la
ConrLinde qui précéda
vert
wr\
la
nouveau champ aux
provinces polonaises et de
avoit ou-
première période ,
assignats et avoit considéra-
blenrent agrandie la sphère de leurs opérations;
4°.
commerce
Knfin que, dans la dernière de ces périodes , le
et l'industrie en
général jouirent d'une liberté, et
l'Empire d'une paix et d'une prospérité rares,
causes firent naître
un
commerciale, lequel,
valeur dans
le
surcroît de
à son
et
que ces
production et d'activité
tour, exigea un
surcroît
ges qui se fai^oient.
*)
de
Ruméiaire, pour opérer le suEcroît d'échan-
D.u>s Itî aanf?cî
179G
8t g./,
et d.faj ctHes di:
1801 à i8q3-
On vojt que
ces
circonstances
passagères
expliquent
suffisamment la hausse momentanée des assignats ,
émissions
les
constante
doute
et
sans
léitéiées
S'il
progressive.
l'égard
il
cesse
expliquent
b^aisse
de cette seconde cause, les dernières an-
les émissions ont cessé ,
tée;
leur
encore le moindre
néstoit
nées de notre Tableau le détruiioient.
car,
comme
la
Depuis i8il que
chute de l'assignat
s'est
arrê-
après les variations brusques et fortes des années
précédentes,
on peut compter pour rien
rences qui ont eu lieu dans
la
les légères dilTé-
de l'assignat pen-
valeur
"
dant ces six années.
En résumant ces observations_, on se convaincra, j'esdu commerce ne peut point influer
père ,
que
d'une
manière désavantageuse
nats.
Au contraire
soit
il
la liberté
,
sur
taux de nos assig-
le
pourvu que
la
masse de
papier ne
point augmentée , plus le commerce sera libre ,
se
fera
d'échanges dans lesquels
employés; plus, par conséquent,
il
les
assignats
plus
seront
seront recherchés, et
plus leur taux haussera.
Enfin les partisans
du système
prolnbiiif essaient quel-
quefois de justifier ses mesures par la considération de lin'-
dépendance natioucde.
honteux
d'acheter
A les entendre,
on diroit qu'il est
quelque-chose aux étrangers;
ils
appellent
799f
tnbut les sommes que la partie leur paye pour Iclus marchandises »
à
et
tiennent ce langage,
patriotes qui
dans
le
pour des
étrangers
iiux
marchandises
Les soi-disant
la
dépendance
est
Russes, par exemple, payent un
les
si
l'affranchir
paioissent oublier- que,
deux nations,
coniiuercc entre
mutuelle, et que,
tribut
au gouvernement de
conseillent
d lui joug aussi ignomincur.
prix
tout
Us
coloniales,
les
des
etolTes ,
vins et des
leur en payent
étrangers
pareil pour des blés, des fers et des bois
un
de construction.
S'il
y a quelque dépendance dans ce rapport mutuel, cer-
tes
elle n'est point
ci
achète
aux
du coté de
étrangers
des
la
nation agricole.
objets
Celle-
de commodité
et
de
luxe, dont elle peut se passer quand la nécessité l'ordonne;
son débit est plus étendu, plus
siir
et plus lucratif;
il
le
devient d'autant plus que les autres nations font des progrés
marquans dans leur industrie ,
plus
mêmes
tandis
que ces
progrès' exposent les natio:is manufacturières et com-
à
merçantes
dépendance
mal pour
perdre
seroit
les
le
leur
Mais
*).
lors
égale des deux côtés ,
nations qui
s'y
soumettent ?
même que la
ou en
seroit le
Partout ou les
besoins se multiplient et ou la civilisation s'étend par le
moyen du commerce,
*)
les
nations
deviennent de plus en
Voyez la preuve de ces assertions dans mon Cours d'Ecou. polit. T. Il,
p. ôSj.
et
suiv.,
I. /r, p.
i8i
et
siiiv.,
et
W V, p. ii5 et m',-.
aoo
plus déprîulanios les unes des antres:
dépendance ,
cette
extérieur, et la
s*igesso
du Lipon
k toiU
seroit:
le
commerce
comble de la
Icgislaiive.
Cependant,
est
s'il
ab^?urde
de prétendre à une en-
commerciale ,
indépend.ince
tière
renoncer
fntidioit
il
politique
pour annéantîr
ainsi,
gouvernement doit
tout
prendre des mesures pour rendre l'Etat nussi peu dépendant
pour tout ce qui regarde sa
possible des autres nations,
{jue
défense
ou
sa
sàretè
soient ces mesures,
pins douces,
tres
de
le
encourage
gouvernement
sera
de guerre parmi ses
sujets,
justifié
Ainsi
aux ycnx
un souverain
des armes ft des munitions
fabrication
la
qtie
but ne peut être atteint par d'au-
raison de les a\'oir employées.
la
qui
le
si
violentes
Q.(ielq[ie
extérieure.
même par les
mesures les plus
sévères du système prohibitif et aux dépens de la ricliessc
nationale,
che
n'en est point blémable, parce que cette bran-
d'industrie
tems
qu'en
de
est
nécessaire
une
guerre
à
la
défcnso du pays,
combinaison
et
de circonstances
contraires peut le
mettre dans l'impossibilité de s'en pour-
voir de l'étranger.
C'est sous ce point de
justifie
l'acte
de navigation^ ou cette
loi
\'tie
que Smith
ans;laisse
qui don-
ne aux vaisseaux
et aux matelots de la Grande-Bretagne
monopole de
navigation marchande de leur pays *),
le
*)
la
Wtaltb of lictiuns, Val.
Il,
p.
19Q.
801
Cette
n'est
loi
n'en
moins que favorable au commerce de
l'Angletene, on à l'accroissement de ccttte opulence dont
le
commerce
est
ment supposé
source
la
_,
comme on l'a souvent fausse-
sur le continent.
La nation anglaise
bien plus dans le cas d'acheter à bon
marché,
si,
seroit
par la
liberté
de
la
ons
à
lui
apporter les marchandises qu'elle désire d'ache-
ter ;
et
si,
par
navigation, elle encourageoit toutes les nati-
elle seroit
du
remplis
ent
bien plus dans le cas de vendre cher,
moyen de
le
cette
plus
L'acte
de
navigation,
deurs
et
des
même liberté, ses marchés êtoi-
grand nombre
d' acheteurs
possible.
en restreignant le nombre des ven-
acheteurs
étrangers dans les marchés de la
grande-Bretagne, oblige les Anglais, non-seulement à acheplus cher les marchandises étrangères ,
ter
vendre
étoit
entièrement
l'État
est
Smith
n'
de
leurs
les
à meilleur marché que
libre.
d'une plus
pas
hésite
commerce
les
Toute-fois ,
mais encore a
là
navigation
comme la
sûreté de
si
grande importance que sa richesse,
d' appeler
cet acte
un des réglemens
plus sages de L Angleterre.
Car
la dé-
fense de ce pays dépend principalement de sa marine, et
l'acte
le
de
nombre
mais
navigation contribue non-seulement à augmenter
et
encore
à perfectionner la construction des vaisseaux,
à
former
On voit combien
il
une pépinière d'excellens matelots.
seroit déraisonnable
Mimotrn de /' Acad. T. VI.
de l\ part d'une
101
8f02
puissance conTincntalf^, dont
ne dépend point de
d'imiter l'exemple de l'Angleterre,
flottes,
Ses
snreté
Id
et de
mêmes
sans en icliicr les
aux
mêmes
sjciii\ces
existe
encore
un antre cas dans lequel
soiinKttre
se
avantag<.s.
II
.
avantageux de mettre
seroit
qu'il
diistrie
étrangère pour encourager l'industrie nationale, sa-
quand
voir
parolt
il
quelque charo;e sur l'in-
de
produit
le
celle-ci
chargé lui-même de
Dans ce cas
impôt dans l intérieur.
quelque
est
il
paroît rai-
sonnable d établir un pareil impôt sur le produit du
même
Ceci n'aura pas
l'eftet
genre, venu de fabrique étrangère.
de donner à
intérieur
que
:
l'industrie
tout
qui en
l'efTét
cette partie
nationale le monopole du
du capital
résultera,
et
du
marché
ce sera d'empêcher
travail
du pays qui
s'y
seroit
porté naturellement, n'en, soit détournée par l'impôt
pour
prendie une direction moins naturelle, et de
la
lai<?ser
concurrence entre l'industrie étrangère et l'industrie na-
tionale
sur le
même
pied qu'auparavant^
Mais ce principe
n'est- il
pas susceptible d'une appli-
cation beaucoup plus générale, et dans
mières
nécessités
de
la
vie fussent
le
cas ok les pre-
imposées dans un pay.%.
ne coiivicndroit-il pas d'imposer, non-seulement
même
espèce
qui
seroicnt
le?
objets
importes des autres pays ,
de
mais
8o3
toute espèce de march<indise étrangère^ de nature à concourir
ai-cc
tout autre produit de l'industrie nationale ?
Sans doute les iinpols
la
sliï
du
\ie haussent le prix,
les
travail
piemièrcs nécessités
et par
de
conséquent celui
de tonte marchandise produit de ce travail: cependant ce
renchérissement
n'est
pas
la
même chose que
d'une
celui
marchandise particulière, causé par un droit imposé direc-
tement
swr
elle ,
et
en diffère sous les deux rapports
il
siiivans :
1°.
toujours
est
Il
aisé
de
avec
connoître
la
plus
grande exactitude, de combien une marchandise se trouve
par un
rerichciie
il
scroit
directement imposé sur elle ,
droit
impossible de déterminer avec quelque précision,
de combien
le
renchérissement général
sur
le
prix
influer
mais
de
produite par le travail.
chaque
Il
y
de travail pourroit
marchandise
particulière
auroit donc impossibilité de
proportionner, avec quelque exactitude, l'impôt sur chaque
étrangère au renchérissement de chaque mar-
marchandise
chandise nationale.
2°.
Les
impots
ont,
sur le sort
sol
ingrat
sur
les
choses
nécessaires à
la
vie
du peuple, à-peu-près le même effet qu'un
ou un
mauvais climat.
sent les denrées de la
Ces impots renchéris-
même manière que
si
elles coûtoi-
loi *
8o4
de travail
cnt 'plus
de
cède
il
du
pauvreté
la
de dépense qu' à V ordinaire pour
Comme dans la cherté naturelle qui pro-
produites.
être
et
ou de
sol
dureté du climat,
la
absurde de prétendre diriger les gens sur la route
seroit
qu'ils ont à
prendre pour l'emploi de leurs capitaux et de leur
industrie,
ne le seroit pas moins de le vouloir faire dans cet-
il
te cherté artificielle causée par les impôts.
du mieux
qu'ils
l'entendent, leur industrie à leur situation,
c'est
évidemment
Mais
les
parti le plus
le
d'impôts;
par
et
la
trop cher les choses nécessaires
de
avantageux pour eux.
charger d'un nouvel impôt, parce qu'ils sont déjà
surchargés
également
paver
Leur laisser assortir,
plus
cher
la
raison
qu'ils
payent déjà
à la vie^ vouloir leur faire
plupart
des autres objets
consommation, c'est à coup sûr une manière
leur
fort
étrange d'adoucir leur situation.
Les
de
restrictions
liberté
la
que nous venons d'apporter au principe
du commerce ,
des deux questions suivantes
1°.
ter
la
chez
Jusqu'à quel point
libre
elle,
:
est-il
à propos de
importation des marchandises
laisser subsis-
d'une nation, qui,
gêne ou empêche l'importation des nôtres ?
Dans ce
de
nous conduisent à l'examen
cas,
représailles ,
la
et
revanche porte naturellement à
cette conduite peut être d' une
n<^er
bonne
8o5
politique
quand
vocation
des
jjlaindre.
IMais
il
gros
probabilité qu'elle amènera la ré-
a
y
droits
quand
ou
prohibitions dont on a à se
cette probabilité n'existe pas, c'est
évidemment une mauvaise méthode pour compenser le dom-
mage
fait
autre
dommage
à quelques classes
tant
,
à
ces
à[\
peuple, que de
mêmes
classes qu'à
faire
un
presque
toutes les autres.
Jusqu'à
2°.
de
rétablir
la
après
qu' elle
lorsque
par
dindustrie
importation des marchandises étrangères,
libre
a
interrompue pendant quelque tems ,
été
du système
l'effet
se
point et de quelle manière convient -il
quel
so)it
prohibitif ,
et
certaines branches
étendues au point d'employer un grand
nombre de bras ?
Dans ce
cas,
l'humanité autant que
peuvent exiger que
que graduellement
de reserve.
Si
droits et ces
la
et
liberté
la
sûreté publique
du commerce ne soit rétablie
avec beaucoup de circonspection et
on alloit tout d'un coup supprimer ces gros
prohibitions- qui gcnent l'importation des mar-
chandises
étrangères,
intérieur
fut
il
pourroit
se faire que le marché'
inondé aussi- tôt de ces marchandises à plus
bas prix, tellement que plusieurs milliers de nos concitoyens
tous
privés de leurs occupations
se
trouvassent
et
dépourvus de tout moyen de subsistance.
à
la
fois
Il
y a pourtant
8o6
de bonnes
rair-onî
pour
que
croire
mnî
le
seroit beau-cfvt:p
mcme dans un
moins ^rand cnon se
le
fignre d'ordinaire,,
pays qui auroit suivi
le
systcmc proliibirif depuis pins d'r.a
siècle
duit
et
Taurou maintenu dans
sa
plus grande
rigueur.
qu'un
pays pro-
D'abord, toutes
les
marcliandises
au même prix
et
de
chandises étrangères do la
tel
même qualité que les marmême espèce, lorsqu'elles sont
la
que
arrivées sur son sol, ne se ressenti roient
point du tout de la concurrence de l'étranger.
même quelques consommateurs vicndroicnt
à préférer la marchandise étrangère, un
droit à
si
peu de personnes,
Ensuite ,
liberté
se
trouver
subsister,
quoique dans
le
Et qtiand
par engouement
tel
capr.ce s'éten-
ne produiroit aucun ef-
du peuple.
sur l'occupation générale
fet sensible
la
qu'il
peu ou
fort
cours du
létablissemcnt de
commerciale, un grand nombre de gens
par
il
là
privés de
leur
manière
dii<;scnt
habituelle
de
ne s'ensuivroit point qu'ils fussent totalement
privés d'emploi
et
de subsistance.
Lors de
réduction
la
des troupes de terre et de mer, en Angleterre^ à la paix
de 1763, plus de cent-mille soldats
rent
tous
à
la
fois
déplacés
de
gens de mer fu-
et
leur
emploi
mais quoiqu'ils en aient eu sans doute à
ils
ne se trouvèrent pas pourtant
ordinaire ;
souffrir
dénués de
un peu,
tout
moyen
^0 7
Tiibsisrance
«Te
f.a
.
majrnie
des
pnrlic
£;('ns
cTc
me r
vr.nsoniblablcmcni entrèrent successivement au service de
v.iisse.iux
djls se
marchands ;
fondirent dans la
une
foule
grand et
si
à
de
même
et en
tems
eux
et
les
so
s
1-
masse du peuple et s'adonncre nt
Un chani^enient
professions diverses.
si
subit dans le sort de plus de cent-mille ho m-
nics,
non-seulement n'entraîrra: aucune convulsion dangereu se,
mais
même aticun
travail
désordre sensible; les salaires
même du
ne souflVirent de réduction dans aucune profession,
excepte dans celle de matelot au service du commerce
Cependant,
celles d'un ouvrier d'industrie, nous trouverons que celles
et
au dernier ne tendent pas autant
à
un nouveau métier, que colles de
l'autre
propre
été
à
toute
accoutumé
vail ;
te
l'assiduité
la
*).
nous comparons les habitudes d'un soldat
si
à
snîdaL
espèce
de
le
rendre impropre à
L'ouvrier a toujours
travail.
n'attendre sa subsistance
à
de
l'attendre
li
l'autre.
Or
il
est
que de son
paye.
sa
doivent être familières à l'un;
dissipation
à le rendre im-
tfa:-
L'industrie et
la
fainéantise et
certainement
beaucoup
plus aisé à changer la direction de l'industrie d'une espèce
à
une autre, que d'amener
la
dissipation et la
A une occupation quelconque.
*)j Sjttitb,
Wcid.h of nai'iamy l'oL
Uy p. 204»
fainéantise
8o8
plus grande partie dos
la
D'îiillenrs-,
m an n factures ont
d'autres bi^iiK hcs de
manufacture collatérales, qiii ont avec
tant d'analogie,
qu'un ouvrier peut aisément transpor-
elles
industrie de l'une
ter son
de ces ouvriers
à l'autre
ainsi reformés ,
*).
Et puis la plupart
trouvent accidentellement
de l'emploi dans les travaux de la campagne.
Le
capital
qui les mettoit en oeuvre auparavant, restera toujours dans
le pays pour les occuper de quelqu'autre
pour éviter
les
manière.
Ainsi,
inconvéniens qui pourroient résulter de la
de quelques manufactures pour les ouvriers qui y
chute
sont employés,
il
de
suffit
laisser
à tous la liberté d'exer-
cer toute espèce d'industrie qu'ils jugent à propos d'exercer, et
et
des
de détruire les privilèges exclusifs des corporations
métiers
dans les pays où ces gênes de l'industrie
Alors,
existent.
pas plus à
utiles
société
la
souffrir d'un
classes d'ouvriers,
soldats.
ni
ni
les
individus n'auront
événement qui disperseroit quelques
qu'il n'ont
à souffrir du licentiemcnt des
Les manufacturiers sont sans doute des gens
à leur
patrie,
mais
ils
fort
ne peuvent pas l'être davan-
tage que ceux qui la défendent au prix de leur sang, et
ils
ne peuvent pas
se
plaindre s'ils sont traités comme eux.
Les entrepreneurs des manufactures tombantes, dans le
cas d'une liberté de commerce rendue subitement au pays^
*)
Voyez en des exeivplci dans mon Cowrj, T. II, p. i8 et siiiv.
8 09
sans
soiifiiiroient
partie
un dommage considérable.
doute
Cette
de leurs capitaux qui s'emploie habituellement en
achat de matières premières et en salaires d'ouvriers, trouveroit peut-être sans beaucoup de difTiculté
ploi ;
mais
ils
un autre em-
ne pourvoient pas disposer, sans une perte
sensible, de celte
autre partie de leurs capitaux qui étoit
fixée
dans
Une
juste considération
leurs
ateliers
et
autres instrumens de métier.
pour les intérêts de ces entrepre-
neurs exige donc que de tels changemens ne soient jamais
faits
et
brusquement,
successifs,
mais
qu'ils
soient
amenés
et après avoir été -annoncés
pour cette raison que luut gouvernement
V
avec le plus grand soin
monopole en fiiveur de
la
de
pas lents
à
loin.
r\f^\rra\t
C'est
se garder
d'établir jamais ^uctm nouveau,
l'industrie nationale, ni
de -donn»
moindre extentjon à ceux -qui sont déjà établis.
règlement de ce genre introduit dans
l'État
Chaque
un germe réel
de désordre, <ju'il est bien difficile de guérir ensuite sans occasionner nn
nouveau désordre.
"ooi'ooo' ^o^caoo
Mlmntrrs.kl'Acnd. T.Vi.
10-
8io
TABLE
A-
UX STATISTIQUES
SUR
LE COMMERCE ÉTRANGER DE L'EMPIRE DE RUSSIE
PENDANT
LES
ANNÉES 1802 ET 1807, ET DEPUIS 1812 JUSQU'EN
i8i5.
PAR
T,
C.
Présentés à
la
HERRMANN.
Conférence
le
94 Sept. 1817.
Nouff présentons deux tableaux sur le Commerce étran-
de
l'Empire
de
ger
jusqu'en
1807,
le
Russie,
second
le
depuis
1812
Les données
statistiques sur les années
manquent ,
et
cette
depuis
1802
jnsqn' en
i8i5.
premier
1808
— 1811
norts
lacune rend les différences entre les
deux tableaux encore plus frappantes,
dont
tems du système continental^
du tems de l'Eu^
et l'autre
Tun
est
d'u
lope délivrée.
Le
terre
total
du commerce de
la
Russie par mer et par
pendant ces dix années étoit comme
suit:-
8ii
année;
8iir
de plus ,
rniîlions
de
ce
donne
qui
environ,
la
proportion
à 3|.,
1
Tout le revirement du commerce monfoit dans la prcpériode
jflieie
et
à
terme moyen par année à
114,541,817,
dans la seconde à 279,2841966 r. et surpassoit donc ce-
lui
de la première période de
164,743,149, c'est-à-dire
qu'il a voit plus tjue doublé, sans, le
commerce de
dont lïous parlerons, séparément dans
la
transit,
suite.
Nous n'fntrerona point dans la recherche intéressante des
qui ont opéré un
causes 3.
surpasseroit
qu'elle
loit
des
heureux, changement,
des objets- qu'on, peut envisager
sur
me borne ai remarquer, que le système con-
ditTcremmcntj je
tinental prédominoit en
Europe dans la première période,
que
la.
russe
commence em i8l2,, quand l'ennemi
dernière
période
si
brillante
rable les progrès
du Commerce
ji
grandes
les,
çnÛQ: le
le
Commerce
a voit passé les
russe rivalisoient avec les
progrès des armes victorieuses de
terre
pour
de l'Empire,, et que depuis cette année mémo-
frontières
Lss
puis-
bornes de ce Mémoire et eniraine-
les.
discussions
si.
routes
principales
commerce
ttnk Inattention
du
la,
Russie..
de ce commerce
par; meFi
et par
marchandises importées, et: exportées,
rfe- St;
Pê^er^bowrg en pariiculiei, méri»
statisticien, politique..
'
8i3
I.
sur
1.)
tneTn^TTtlcjue
(
Commen'ce par Mer.
mer "blanche ^ur la mer noire et d'a'îovv!';ur I.r.nLTCa'^p'.ennc
sur la
St.Pôtcrsboarg ctCronstidr
Rii^a, Perniu. \':uv;r,
An
Wiboui-,
Aren^bourj»,
Jdessc, Xiko'ac'w Ovidiopoj, FLupirorii. Sewaitopol, Kci' vil, Fcc)
Onega.
Aichan^^-il,
Lib.iu, Friedrich'.ham,Wui
ciau,
Reval.
importition
llap>,i!.
Importât
j
Importât.
lixportat
R
78 4
78Ô5
49,433,718
-7,107,653 45, i5'a 0(0
J-'Ji^^'^ ^7\^J^Hq^9
5o.|,6o6, 4,8.>a,6j8 2,960,8^6
i':*
Exportât-
27>3p4>97^ 43,007,39;
4>"^ 1*3,34
Importât,
j
Expert.
;
a,9(J),og6
666,044
4,9 4»°5j
802, iga i5o, 38
I
4,9 '5 357 _ 757^941
3>754»09>j 5,365, o-Sc)! 7 403,372 857,20
26^6^
"^95^66 "4^37,738 J^2M^ _^44_,7t>o 91,443
1
27,191,468 49,14.^,739
l6 >7
2 22 1,493
388,66;)
1^,715,788
-!8:93o,ooi
\
1
â^ 9j^l]^L 549,7
ltt02
Astrachan.
Taganrok, Mariopol, Jtnicale.
exportation
j
doiiaj
1
3,287,034
587,424
584,977
_ 397,694. ,077,610 185,599
1
total [173,733,1^4285,766,^312,707,49.9 22,y56,a,i'l'9j95c>,93l»4, 254,^92 4',7^57748 74o,2i3>
lî.
resuite de ce tableau:
1.
que r importation
mer blanche
étoit
portation ,, que
noire,, mais
le
sur
mer Baltique- et sur la
la
dans cette période
commerce
que l'importation
étoit
très inférieure
a lex—
plus égal sur la
surpassoit.
mer
de Ijeaucoup IcXt-.
portation sur la mer Caspienne..
2:.
que
1!
importation, a
diminuée sur
pendant cette période,, mais que
soutenue.
continental,
1!
Le premier phénomène
le
la:
mer Baltique
exportation s'est mieux:
étoit l'effet
du système
second provenoit du besoin que les étran-
gers avoient des productions russes..
8i4
4 I
3,
que
commerce
^ré tous
4,
Comiiverce
le
le
plus
égal
-qui
se
trouve
commerce
pourtant
le
sur la
à
est
sinioul
bien soutenue n)al-
assez
raer
noire est le commerce
Le surplus
la
1'
exportation
provient
surtout
en bled,
commerce
<îésavantageux à
sur la
mer Caspienne
est le plus
Russie, l'importation étant sept à huit
pius ^^rande que l'exportation.
fois
6,
que
l'importation générale par
moyen
cette période à terme
tion
la
s'est
entre les nations commerçantes.
du commerce dOdesse
que
mer blanche
la
obstacles,
les
le
5,
qui
d'e.\'[;orralion,
que
sur
55,623,024-
à
Russie,
qu'exporté.
pour
car
il
^*ï
y
a
mer montoit pendant
3 3, 506,643 r. et l'exporta-
balance étoit donc en faveur de
avoit 22,ii6,38i
r.
Assurément qu^on doit compter
quelque chose ,
pourtant
la
balance
plus d'importé
la
contrebande
étoit toujours
favorable pour cet Empire.
7,
à tctme
Le
ics
que
le
revirement
général
montoit à 89,129,667
moyen par année.
second
tablmu
données suivantes.
sur
le comraerde
de mer contient
8i5
'^
ui'l.T
iiT-r
sar
l>.-.ltic|ue
ne
!a
.-
un
[)l.:rfrû
I
nrtces
importation
|
Exportr.ion Imporrition; E-xponai-
R
o
,
l.i
i
-!Cf
no.'fet r. ci'nsov/!5Ût"fâTiîër~caspiennc
Importation Exportatif-:illmponur.
b
u
47,542>8i9J 8-(,9 SJ lo? 8,7»3,o83 10,609, oui 3,oi9.j[)o5
>i_4
total
76,474» "8; _^^M9^9j^
tJ9.!j37,446
8>), 1 35,941
2,409,332 i5,r)54,iro
41, ()b5, 671
Le
beaucoup
.'),396,.537 ^^.'iGg. -"88 1.769,625'
7,714,97'!
a,'2c3,()4/f c>,o3a,î-8a'
877 i3,n39..iQi (iG, G )g,5j
'3,t!fï5,25i 8jy<)/,9û4 6,o3o,3uO'
même phénomène se
commerce
d'un
c»!)? 909,
floiissdnt ,
reproduit d.ins celte pciiode
l'exportation
est
pjrlo-nt
à l'importation , excepté sur
supéticuie
Li
de
met
cnspicnne.
L'împorfation sur la
mer Riltique en
181 3 est unique
dans son genre, elle surpasse de 42 millions celle de T.in-
née i8i2j elle surpasse merae l'exportation de
duand
les
résultat décisif,
l'Angleterre
marchandises
que
ni
le
des armes- russes
victoires
quand
stirtout
le
avoient
1
3 millions,
donné un
système con-tinental étoit tombé,
combloit
coloniales
et
de
les
ses
ports
de la Russie de
Manufactures ,
Tarif existant alors le permettoit.
autant
Ni la France
r Espagne pouvoient encore prendre une part active à
cette importation
énorme en Russie,
les villes
anséatiques
étoient en parie ruinées, donc c'est surtout de l'Angleterre
que doit venir cette masse énorme dé marchandises importées.
Ce moment passé,
"
1
:,i4Ç>,8b'4
1
Exportâr.-
s
'
8 8.|5,,520'"9~iRÔ3^(^3
8o,07î,ot!3 199,617,007
297,P8B,9tio'43o 6o'i,8
i
'
°»7'^7.677 ^59,.38i 309,6891
7,793,3 981 6,.i64,(i3i i5,.»8o Ôio >, '37,734 1.918,8^4
1
i0i3
ë
J
l'importation sut la
mer Baltique
8iô
tomba de quelque chose ,
mais elle resta toujours de 33
millions supérieure à l'année
années
dernières
d'un demi
et
de 53 millions aux
période précédente.
la
l'impoitation
blanche
lions,
de
1812
pendant
la
dernière
million et moins, subitement a
la
mer
période monta
plus de 8 mil-
un cas extraordinaire qui est fondé sur
c'étoit
évcnemens
Sur
de
militaires
cette
Quand
année.
la
les
Russie
avoit pris une assiette plus tranquille, la grande importareprit
tion
diminua
jours
cours ordinaire par
son
nécessairement à
de deux
tiers
St.
Archangel,
Pétersboarg^
-elle
mais elle resta tou-
supérieure à ce qu'elle avoit été dans
la
période précédente. Sur la mer noiie et sj.u- celle d'Asow
le
commerce augmenta .mais pas
la
mer baltiquc, puisque le commerce sur cette mer avoit
si
rapidement
comme
sur
joujours essuyé moins d'entraves pendant \â période au systé--
me
continental.
Enfin le
commerce
sur la
mer Caspienne a
conservé son caractère, c'est-à-dire, que l'importation surpasse
l'exportation,
pourtant
quatitrefois,
où pendant
lions et
il
s'y
trouve infiniment plus d'égalité
six années on importa
demi, et n'exporta que pour
700,000
pour 4 milr.
car dans
ces dernièi-es années on a importé pour 8 millions et demi,
mais on
a
aussi
par cette route,
exporté pour 6 millions, exportation inouie
et
qui
paroit augmenter annucllem< nt.
—
1
,
817
L cxpoHaiion présente sui toutes les routes les résulplus salisfaisans.
tats
les
que
par
millions)
Elle surpasse
l'importation
—
—
la
mci
Baltique de
sur la
nier
blanche de
swï
mer noire et d'Asow de
37
total
196
sur
la
que
les
de
victoires ,
du
teins
(en ne comptant
là'i
millions
26
—
•
millions
étrangers ont payés à la Russie en
de
pas
dans
le
révolution Françoise, mais par un Commerce
la
régulier.
Elle surpasse l'exportation dans la pé-
libre
et
riode
du système continental de 145 millions sur
en
Baltique, de
2
blanche, de
39
—
—
noire et d'Asow, total
205
millions
quatre
ans,
plusqu' auparavant
commerce languissant.
en
Nous avons déjà
7
fait
la
mer
sur la
mer
sur la
mer
1
7
exportés
années
d'un
mention com-
bien l'exportation sur la mer Caspienne a gagnée,
ment 5,390,
années
qi.iatrc
genre de recette extraordinaire
nommé-
roubles.
Le
total
de l'importation par mer pendant ces quatre
années
monte
à
350,853,623
r.
ou terme moyen par an-
née à 87,723,405, plus 54,2 16,762 que pendant la première
période ; elle a donc plus que doublée.
Mémeirtsdet^Acad. J.Vl,
103
8i8
Le total de
année
1
l'exportation
ctoit
35,836, 141, ou 80,213,177
six années piéccdcntes.
de 543,844,567 r., pat
r.
plus que pendant les
Les progrés du commerce sont naturel-
lement plus grands à l'exportation qu'à l'importation, puis-
que
la
Le
première est toujours plus favorisée.
revirement
général
223,559,546
r.
il
que pendant
la
période
etoit
étoit
année
commune
de
donc plus grand de 134,429,879 r.
où
tenoit l'Europe enchaînée.
le
bras de fer
du
despotisine
3
8i9
Commerce par terre, premier tableau.
II.
avec
p.ir les
lens
avec
Suède
la
magne et l'Autriche
Gouverne,
de la Fin-
par
et
noimiument
p.ir Strdopol,
nie et
Ny-
1
la
angnen
podolie
,
PoJourbourg ,
Wilmani-
Kowno, Grodno,
trand et Jousch-
Brctt, lladsiwilow
chiot,
Walachie
et
la
Bes-
sarabie
G. de Vilna,
les
Grodno, par la\'olhy-
'lande et Olonei-z,
An-I
avec la Moldavie la
Pri!S«e, l'AIle-
la
les
G. de Po-
dolie et
de Chersor.
par
Mohilcv et par Parkansk et
Dubossar.
koser
Importa- Exportion
ration
I
Importa
Exporta-
Importa,
Exporta,
tion
tion
tion
tion
R
1800:
3
09.068 1 10,3911 11, 572, :j43 j^ 487,995 £^47 ^67 _779i:io4
iT^ô 7873
4>-84>63o 3,087 *5^5| 473,o.')'6
j8o4
64,016
r8u5
83, 881
7ôo6
82 249I 62,421
ÎÔ~7
72,196; 58,295
rsô ^5 3 'S5 ij ~684 2
,
1
M
3^426.157
2 ,"26¥,«63 |^_i578^
4 92't)25i
2,687,708'
481,119
10, a6o, 180I
2,584,227
1,616,202
434,176
3, i8b",o52|
2,766,710
779,a«2|
449,^23
43,606
1
8,459 56i
57,302} 8, i92,i63
1
total '4: 5,'66'4oo,438| s 1,618,617122,963,979 '^.Q' ',5173,039,676
,
Le
piincrpal
avec
celui
ccmixirerce
PoLingen jusqu'à Radziwilow,
achta ;
second rang
le
la
l'Allemagne
Prusse,.
la
de
tient
et
le
Russsie
terre
est
l'Autriche depuis
et
ax^ec
par
la
Chine par Ki-
commerce avec Chiwa
et
la Fueharic, avec la Moldavie, la Walachie et la Bessarabie;
le
commerce
le
moins considérable est celui avec
la
Perse et avec la Suède.
Et
sur
ces différentes routes de commerce la
toutes
Russie
perdoit
énormément pendant
car
terme
raoyen.
de
tandis
que
le
18,017,408'
r.
moyen que de 7,39L,74l
cette
L'importation
connue
l'exportation
Et comme
i"-
période
triste
nionioit
n' étoit
les
terme
frontières par
sont beaucoup plus difficiles à garder contre les con-
^erre
trebandiers que les ports de mer, surtout sur une
si
à
a-
énorme que celle depuis
on peut
tation
la
Finlande jusqu'à
la
étendtie
Chine,
bien sûr, que Timportation surpassoii l'expor-
être
an moins de deux, tiers.
Les plus grandes variations du commerce se présentent ài
l'importation
dan.s^
le
commerce avec
la
Prusse, l'Allemag-
ne et rAutriche, car de 10 à 11 millions il tomboit Tout d'uni
coup
le
à
à
3,
les
circonstances politiques en étoient la cause^.
commerce avec
la
Rusbie ,
s'est
la
Chine, quoique toujours défavorable
mieux soutenu.
82 1
Mais nous allons
tableau
pour
le
facilemeut
:
il3
un coup d'oeil
comparer au premier,
derniers résultats,
et contient
jetter
11
est
d'en
liier
les
compose d'après une autre forme
moins de détails que
s'orienter.
afin
sur le second
le
premier, mais on peut
Elle
n'ci
merce par
pas augmenté sur toutes les routes du' comce n'est que sur la route par les frontiè-
terre,
d'Europe qu'on trouve ce surplus énorme, partout
res
ail-
leurs l'importation surpasse l'exportation, pourtant l'exportation
par
les
frontières
asiatiques et par Kiachta
a
infi-
d'où
s'ensuit qu'à cet égard les
deux
niment gagnée,
il
tableaux portent le même caractère,' savoir: la Russie perd jusqu'aprésent dans son commerce par les frontières asiatiques et
avec
la
Perse
et
la
mais elle gagne par celui
Chine ;
qu'elle fait par ses frontières d'Europe.
En comparant le commerce
par
terre
de la
Pvussie ,
mer
par
et
le
commerce
trouvons les données sui-
nous
vantes :
Commerce par mer.
depuis
^
à terme
1802
— 1807
depuis
moyen par année
Importation
à
R
33,506,643
1
î
55,623,024
,
87,713405
Commerce par
18,0174081
7,391,741
!
— 18 15
•
terme moyen par année
Importation
Exportation
j
1812
Exportation
;
e
s
135,836,141
terre.
17,999-^95
35,252,244
823
L' cxpoitiition
dans
son
toujours
été
favorable
commerce par mer,
elle
ne l'étoit pas dans la
a
à
la
Russie
période précédente pour le commerce par terre.
Dans
à
celui
dernière
première période le commerce par terre
la
comme
mer
par
comme
l
à
4
et
environ
dans la
5j
quelque chose de plus.
et
Le commerce par mer
non seulement
est
le
plus con-
de
la
Russie , mais
toutes
les
périodes elle y a gagnée plus ou moins.
sidérable
dans
à 3
i
étoii
Le commerce par
terre
est
il
est
aussi
le
plus lucratif;
seulement favorable à la Russie
par les routes, qui mènent par ses frontières européennes,
dans
mais
par
terre
T état
lui
est
actuel
des
choses tout autre commerce
indispensable à la vérité,
mais toujours
plus ou moins défavorable.
Les principales marchandises qui occupent ce commerenviron -24 articles
parmis lesquels
ce
sont
le
lin
le
bled, le suif et le
bois sont les principales en pjemiè-
res
matières;
les toiles,
et
goudron ,
le
la
chanvre avec
le
fer,
cire,
le
d' exportation^
leurs semailles et leur huile,
les
cuirs,
la
potasse, je
savon, les cordages et les pelleteries
étoient les objrts les plus considérables pour le
en produits de manufactures
et
fabriques.
commerce
824
y
Il
a
plus de 32 arîklcs d'unportatlon parmis lesquels
de bouche, surtout le sucre,
les provisions
vin ,
premières
les
produits
le
café et le
matières pour les manufactures et les
manufactures étrangères sont les plus remar-
des
quables.
Dans
toutes
ces
les
tableaux russes sur le commerce on divise
marchandises
en
ordinairement
provisions
bouche, en métaux, en premières matières pour
factures ,
en produits des manufactures ,
en bestiaux , en
diamans, et tout le reste est compris sous le
de différentes marchandises.
Dans
titre
général
ces derniers tems
encore distingué les drogues dont on se sert pour
la
on a
mé-
étoient autrefois comprises sous le titre de pre-
decine,
ils
mières
matières.
nous
de
manu-
les
Pour ne pas
entrer
en trop de détails,
nous bornerons aux termes moyens ])our la première
période.
IMarchand ses
825
L'importation
et
raillions
des
provisions
1 7
et demi, l'exportation de 5 million's
demi à
de bouche varioit de
en 1807 a 21,9-00,000 en i8o5, elle
que
tandis
l'importation
ctoit très variable,
autour de i6
toujours
tonrnoit
14
millions.
L'importation en mèiaux et demî-mètaux tomboit de ir
millions
800,000
portation
varioit
de
4
beaucoup.
et
niilîions
i8o3,
en
r.
demi,
et puis elle remonta
à
millions en 1804, l'ex-
7
1802
Elle étoit en
1804 à
en
l
million
3 raillions et demi ,
à
i8o3
et
900,000,
le
transit
de
ces marchandises est très considérable.
Les
premières
imponées
en
i8o5
et
en
]8o3
pour
1804.
des principales
en
et
1806
10
pour
matières
pour
millions.
sources
de
les
pour
1807
12
la
cxportoit de 89 à
de suif
etc.
Mais
presque
tion
des
II
n'y
quant
le
a
40
furent
millions,
8
en 1802
en
et
en
est
une
richesse de la Russie ;
les
millions,
Mais leur exportation
l8o3
meilleures années étoient celles de
l'on
mamifactures
et
de 1804» où
millions de lin et de chanvre,
pas eu d'année absolument mauvaise.
aux
mamifactures,
double de l'exportation.
manufactures
Mémtirrs de rAcad. T. 11.
étrangères
l'importation
En i8o2
passoit
1 7
^^^
faisoit
l'importamillions et
826
demi,
elle
exportation
qu'elle
1807
tomba en
en
Le
6,800,000.
8
millions et demi.
mieux soutenue,
s'est
étoit
à
1802,
Le commerce en
n'a
baissé
article
est
elle
de cet
transit
de
car
bestiaux est en
Notre
7,800,000
r.
en 1807 qu'à
très considérable.
faveur de la
Russie.
La plus forte importation pendant les années i8o3 et 1806
étoit de 8 a 900,000 r. la moindre en 1802 de 700,000,
mais notre exportation passoit souvent
million et
1
demi.
L'importation en diomans a été peu considéra bb, elle
a variée
des
de 200 r. en 1807 a 61,260
perles
fines
étoit
r.
plus considérable,
en
en l8o5 elle montoit presque à un million.
eu d'exportation de ces
articles,
1806, celle
car en
Il
1804
et
n'y a pas
mais bien du transit pour
les perles fines.
Le
poïtant.
titre
de
différentes
marchandises
n' étoit
pas im-
8c7
Voici le tableau sur la seconde période.
8,2 8
Ce tableau contient tant de phénomènes extraordinaires,
si
que ce
à l'intérêt qu'il peut inspirer,
tort
fdire
seroit
comme
vouloit en extraire les termes moyens
l'on
dans la première période.
ctoit possible
Parmis
importent
provisions de bouche
les
le
sucre,
que
les étrangers notjy
café et le vin tiennent le premier
le
lang, parmis celles que nous exportons, les bleds.
les
étoient elles tombées,
1813,. baissa un
cha
sie
que l'importation monta de 16 mildoubla presque encore une
35 en 1812^.
il
181 5
en
peu,, mais se releva
nouveau de 60
de
consommé
seule a presque
ce qui en est
la première
déjà
l'année
que,
d' une
sorti
il
tation
qui
est
et s'appro-
bientôt,
Et la Rus-
millions.
toutes ces marchandises, car
nos voisins étoient
suivante
si
bien pourvu,,
masse énorme de la valeur de 62
étoit
également
sorti
de
que pour i25,8oir.
de
étoient
millions et
Notre expor^
12 millions, année commune, monta
34
un avantage décidé à
besoins
en
bien peu de chose, ce n'étoit que
tout d'un coup presque à
sez
fois
année que le Transit approcha dé 2 millions^
n'en est
demi,
A peine
système continental entouroit l'Europe^
barières, dont le
lions
cela
grands ,
3
à
"7
millions,
33
millions.
cet
de
article,
et
et se
soutenoit as-
Les étrangers ont
il
paroit
que no»
même que pour les drogues
8^29
médicinales,
2
millions,
qui
entrent
ordinairement pour la valeur de
et
nous en exportons environ pour un demi
les
métaux que nous
million.
Parmis
exportons-, c'est surtout
notre fer qui doit nous donner l'avantage dans la
balance
du commerce.
tombée
dans
Cette
période passée jusqu'à 3
la
nous importait
tranger
Le
demi -métaux.
en
de commerce
branche
fer,
lions en
fer
nous avons
deux
fois
nous
a
Ce
autant en plomb et en
reconquis notre commerce
commencé par exporter pour 6
1812,. et nous avons
demi en i8i5.
ëtoit
millions et demi, et l'é-
fini
résultat est
mil-
par en exporter 12 et
pour nous d'autanfi plus
satisfaisant,
que l'importation étrangère a considérablement
baissé, elle
est
tombée de 9
mi, et presque 2 en
raillions
demi à 3
et
de-
1814.
Nos premières matières pour
toujours
et
les
manufactures avoient
un avantage décidé même dans
la
période ou le
commerce
languissoit,
plus,
et
nous avons conservé notre prépondérance dans
cette
dernière
période
nous exportions toujours
d'un commerce
florissant.
trois
fois
De 37
millions et demi, que nous exportions de cet article, Texportation
est
l'importation
montée presque à 58 et demi.
ctrangcrc
Mais aussi
a con^idéiablement augmentée ^ vui
830
les
établies,
22
et
de
croissans
besoins
s'est
elle
nos
élevée de
inanufactniçs
rauvcllem<-iH
lo millions
demi jusqu'à
et
demi, et mcine jusqu'au delà de g8 ir.illions en i8l3.
Preuve certaine de
que de
de nos manufactures ^
l'aciivc
c'est
millions que nous en exportions, nous sommes
"i
parvenus à en exporter pour plus que 16, en conire l'im-
et
demi
beaucoup diminuée,
étrangère a
portation
elle est
tombée à 11, à 10
commerce
Le
en
bestiaux
intéressant dans cette période,
est
et
de
i3 millions
même à 5 millions.
devenu un
article
si
que d'un million nous som-
mes parvenus à vendre en i8i5 pour 6 millions et demi.
Mais
de
l'article
toutes
les
le
plus
remarquable
marchandises ,
qui
ne
amalgame
est cet
sont pas comprises
sous les titres précédens, j'entends les diverses marchandises.
Il
plus
n'existoit
pour
vient de s'élever à la
rapidité avec
demi,
la
s iltat,
est
où
il
éioit,
à
"/S,
passé
exportation
somme étonnante de pi
millions et
dire,
et
laquelle nous avons obtenu ce re-
incroyable; cet article remonte presque de zéro,
à
35 millions, augmente jusqu'à 44» parvient
et arrive enfin
de
notre
ainsi
beaucoup
à 91, de manière qu'il a
l'article
le
même sur-
plus brilLint de notre ex-
portation, celui de premières matières pour les manufacture?.
L'impoiiation a aussi fait des progrès, elle est parvenue 4
S3i
20
millions,
rrrnis
elle
est
bien loin de la
somme,
pour
laquelle nous en avons expoiL^.
Le
dernier résultat de ce tableau intéressant,
est
quj
nous avons l'avantage sur l'étranger sous tous les rapports,
excepté à
que
les
l'article
tableaux
des provisions de bouche, et
sur
les
années de
1816
et
peut-être
1817 nous
donnerons» encOre l'avantage à cet égard, vu l'énorme quan-
de bled que nous venons d'exporter.
tité
Il
rons
la
nous reste
pour
la
à
parler
du Transit que nouô marque-
première période par terme moyen, mais pour
seconde par année, à cause des changemens considéra-
blés
que ce genre de commerce vient d'essuyer.
Marchandises
832
Le commerce de transit en général a beaucoup baissé.
Ce
n'est
titre
à
pas
des pi'ovisions de bouche et au
l'article
des diverses marchandises que ce déficit se manifeste,
au contraire
le
transit a
gagné sur ces marchandises, mais
c'est le commerce en métaux et dèmi-métaux qui a entiè-
rement cessé, et nous devons nous en
féliciter,
puis qu'il
paroît que nous pourvoyons nos voisins en Asie
des pro-
duits de nos propres fabriques: de
même l'article des ma-
nufactures étrangères a beaucoup perdu en partie, puisque
nos manufactures pouvoient plus fournir, mais surtout puis-
que
le
commerce de
transit des
draps de Prusse étoit in-
terrompu, et comme cette branche de commerce vient d'être
relevée ,
il
y a lieu de croire , que cet article déviendra
plus important dans, la suite.
La
de
ville
Pètershourg
St.
comme premier entrepôt
du commerce
étranger
particulièfe.
Nous. allons considérer
de
la
Russie, meriie une «attention
.
i
wnerce dans les
STinées
deux
périodes.
le total
de son
corn-
S33
que l'importation de
en résulte,
Il
St.
Pétersbourg a
presque triplée dans la dernière période, et que l'exporta-
que doublée, c'est à dire qu'elle se rapporte com-
tion a plus
ine
par terie
à terme
la
première période
moyen: importation pour 5i,52 7,o5ir.
en
ayant
été de
eu
a
un
environ
et
tiers
63,014,766 r.
St.
i,
St Péters-
l'exportation
Pétersbourg en a
fait
un
et | environ.
Dans
la
mer ayant été dans
par
et
bourg
tiers
Le total du commerce de la Russie
à 2| environ.
1
la
moitié et
dernière période St, Pétersbourg a eu presque
|
de l'importation
et
un
tiers et
environ
|
de
l'exportation.
St.
Pétersbourg
a
donc ordinairement plus d'un
du
Commerce étranger de
s'est
assez bien soutenue dans les
èi(mcim,Ul'A(ad.
T.VL
la
Russie ,
et
tiers
cette proportion
deux périodes.
105
834
Les piiiicipales mara
terme moyen pour
les
Marchandises
1802
années
en
1812
— 1807
Importât. ;Exportationi Importation tCxportatior.
R
Provisions de bouche
7,601,576
Pour
la
médecine
Métaux
et
demi-métaux 1,704,003
u
-
709,72610,461,708 4,243,64s
2,627,588
1,914,110 2,541,67'?
premières matières pour
les
manufactures
Manufactures
bestiaux
Diamans
5,618,76921,517,03218.437.31745,517,321
5,942,162 4,858,545
57,329
et
2,946
perles fines
18,644
Diverses marchandises
69,947
8,376,553 6,62.5,654
337
35
1,900
58,872
19, 295j
8,205
c 11 a n d
836
En compamnt l'importation
et l'exportation
de
St. Pé-
tersbourg, pendant la dernière période avec celle du com-
merce de
la
Russie en général, nous trouvons que le com-
merce de
St.
Pétersbourg, quant à l'importation,, roule sur-
tout
sur les provisions de bouche, par lesquelles on doit
entendre sur tout le sucre, le café et les vins, et puis sur les
manufactures et diverses marchandises étrangères. Les prin-
cipaux
pour
les
articles
d'exportation
manufactures,
de
sont
une année de stagnation pour
L'année
les années suivantes,
1812
matières
étoit
la plupart des
commerce, à l'exception du lin
pendant
premières
même que les manufactures et
diverses marchandises russes.
son
les
le
et
articles
de
du chanvre, mais
commerce de
}?ourg a repris son cours ordinaire.
encore
St.
Péters-
'Jle moire j-
de 7\ CcaP.
J//^ip
c4v-
ydenoej- S^me /V. :/a &
i<7.
.
tt.
J.
i/HeTooizes i/e' <f'
ytcaPemie t^mp. des fc ^me VI. &ai. ///
<^i^. 2.
.M'mo/r^s
i/e
6-'
<yîcaû(
<y7/i^.
c/eo-
,^€.
Sa /ne VI ^/ab.IV.
\%^'-
fv-
.
^«
if-Of/: -il'
'V 'ïi
'
<•'
_ '
~i^./ Jrro nnj aa i/iJ. eciyiuJnyUê-i
^l(0<J/J/^//f.
Cl(0(J^^
//jCit/gc.
<U/A„.ur.„
^^\L^r.X:/i.j„,... £>.. ..,f,£^,^n
y.'
.Th.k'ô
/r ^'//u:///S J/.
/ara./c-m,^
J^ Jr r.i/: /.
Je
c-
m o Kl- J
-^fi?^^^
_-v
.
_x
.
^Jl^/fl'///^
^/
l
Jf
/'(fcdi/'' "I f<'
rj/
,
Tff
7 <f o
a
a Ci
\
^\^
(
k/c:
tiv (>///<'
l^J.
>y<ro
IX
Jfr..„»,-r^
)/ 'ff/// U- )
,/,.
/-.^r,,,/^;»,^
J/"f
/^' /^^^'^^ ^"- >^^->
c/,-^
.Â-
^„„. rj
,-j:,,,
>Û,n,.,:^ ^.
/,^,„M,„e .y,«/,.U.^
/r// //frfff
.A,
.'T:.,,,,
ri..-7r,6
X
.•
^^
i!
6
<'
M
y
e/c.i
,/(': /77>/,{,'
/y
.'Cr/>
XJ
c/e
A.<:„/^m,.
.y„,A
,/..,
./î
,'^,ne
l'I
.'TT.é
X
J/rY"
^m^
/'//r/f/ A
'/'-'{
JÙ„,o.,-r.,
^
^{c,,,/.,,,..
\\U
///ru/ //r//r/ /•////
,
•/„,/,
,^^
.y?
,7S-„,
ri ^/. ^//
e'
.
//////.
t/t'.i
,
.
^'
/•^^^•-/w
.'/,y,:
,/,.,
./;.<>„„ ri
:'/:,/,:
^f
>v
V
V
Ne
.1-
Al
-^
/
<
t
1
,y^e/fe<>f/-fj
t/e
U/J
/\^r{iuc/emn'
<//>/</<•.
t/fJ
u
^/r.
tK)/if
r^J. .tKi X/f:
Ttr f// f>/ f<'.>
\J
</<•
f
(nrr/f //t/c
y/'r^/rr/
,
'//t/i
f/f,l
r(u//?/^//a
^
^
I
"s
^
^
,^
^f'^ftae^V'J
f/e
('
<
Tc^rf/e////'f
«L>v>y^.
t/e^J
t-yc:
K^a-^^f^if
l^J ^ylié
X
,
( ).
Ç^..
c/e.i
cVîl.
i^>m<-
l'I.
l'/i^il
XI 71.
ife'mo,,'e,>
c/^
/y>/^-r/
.^.'.,./,-»„e
^y,„/,
f'/v//?/'
./>:>
./c:
iîC^ J'I ,"/^/( A77/
/.. /r-y^r/z-AJ/jy//.
/(rr////r/
/f///ff//w,r
\///f>///rf/./^(f>/.j(/ (//7fn/r
/'''/^
^;y/.v..,/
'^iiu.r/yx
_ l/./.u. ..y.K^J
^''-
/."::;..
r/;^/^///
^
y^f^
V4^>* •'•«-.
/*A
'
/r-,
K^,.
J
1
:!'
:^.
CD
l
1
O)
3
^1
fo:
-r%- !
oo:
î'î/V'